 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Jamais ne Désespère...[1] Colditz – 1941 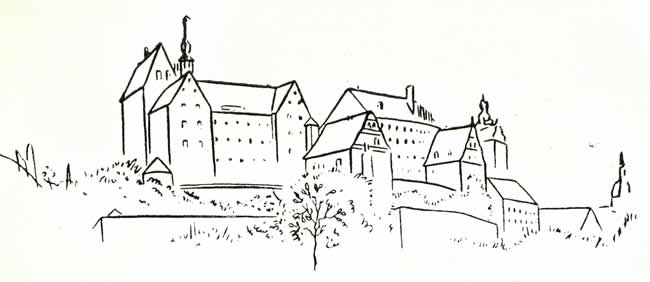
Le château. Le château de Colditz, en Saxe, est une ancienne
demeure royale ; bâti sur un éperon rocheux qui domine la ville et la
vallée de la Mulde, il complète à souhait un décor dans le style romantique de
la vieille Allemagne. Les
bâtiments du château témoignent des apports d’époques s’échelonnant, sans
doute, depuis le haut moyen âge jusqu’au début du XIX° siècle, asile de fous
jusqu’en 1918, depuis lors caserne, siège d’organisations du parti nazi, décor
de cinéma et enfin camp de prisonniers pour officiers « mauvais
garçons » de diverses nationalités : Anglais, Français, Polonais,
Belges et Yougoslaves. En 1941,
quand nous arrivâmes, la plupart des pensionnaires étaient des récidivistes de
l’évasion. Aucun d’entre eux n’était contaminé par cette lèpre morale à
laquelle tout prisonnier est normalement exposé : la crainte d’être mal
noté par les gardiens. Il régnait
là une atmosphère de grand collège, de ces mauvais collèges, dont on nous parlait
quand nous étions petits, où les élèves sont unis par une constante hostilité
envers le personnel. La cour du
château mesurait environ seize mètres sur trente ; elle était entourée de
hauts bâtiments : trois étages sans les combles ; le soleil n’en
éclairait le fond qu’en été et rien que pendant une heure ou deux, au milieu de
la journée. La lourde porte donnant sue le chemin de ronde était garnie de
chaînes et de cadenas ; il nous semblait qu’un économe prodigue avait
veillé au décor qui convient à une prison plus qu’à l’utilité même de ses
accessoires. Trois des
angles de la cour étaient occupés par des tourelles à l’intérieur desquelles un
escalier de pierre, en colimaçon, donnait accès aux étages où se trouvaient les
dortoirs des prisonniers. Ceux-ci étaient selon leurs nationalités respectives,
répartis en quartiers : il y avait le quartier anglais, le quartier
français, le quartier polonais, le quartier hollandais et le quartier belge. La
disposition des locaux était conçue de telle manière que l’on pouvait, en
principe, passer, à chaque étage, d’un escalier à l’autre ; mais lorsque
le château avait été affecté à des prisonniers, les Allemands avaient, pour la
facilité du contrôle, condamné certaines portes ; c’est ainsi qu’au moment
où nous y fûmes, chaque quartier n’était plus desservi que par un seul escalier
et n’avait plus qu’un seul accès, ce qui permettait de procéder par surprise à
des fouilles et de s’assurer que, dès que l’on occupait la porte, rien ne
pouvait plus sortir du quartier. La
discipline imposée aux prisonniers mettait en œuvre un nombreux personnel
allemand dont les deux chevilles ouvrières étaient un
« Oberfeldwebel »[2]
et un « Gefreiter »[3]
qui semblaient tous deux appartenir au château plutôt qu’à l’armée. L’« Oberfeldweber » était le type
du vieux sous-officier hâbleur : bien en chair, haut en couleur, fort en
gueule et ne se déplaçant jamais qu’avec un bruit de clefs : les
prisonniers l’avaient baptisé « Mussolini ». Le
« Gefreiter », au contraire, avait un teint de cire, une peau flasque
sur un corps chétif, une allure timide et fuyante ; pour les prisonniers,
il était « La Fouine ». Ce surnom le dépeignait bien : il
arrivait toujours sans bruit surprendre ce qu’il ne fallait pas qu’il surprit. L’escalier
défendu. La vie des prisonniers comportait plusieurs appels par
jour ; on n’appelait pas les prisonniers individuellement ; on se
contentait de les compter ; ces appels avaient lieu dans la cour ;
seul les malades et les officiers généraux étaient dispensés d’y
assister ; mais, pendant l’appel, Mussolini ou La Fouine allaient dans les
chambres s’assurer de la présence des bénéficiaires d’une dispense. Comme les
quartiers ne communiquaient pas entre eux, s’il y avait un malade dans deux
quartiers différents, le contrôleur devait d’abord vérifier un quartier, puis
repasser par la cour pour se rendre dans l’autre. De tout ceci, il résultait
que su l’on parvenait à rétablir, à l’insu des Allemands, la communication
entre deux quartiers, on pourrait dissimuler l’évasion d’un camarade, en
faisant compter un malade pour deux. 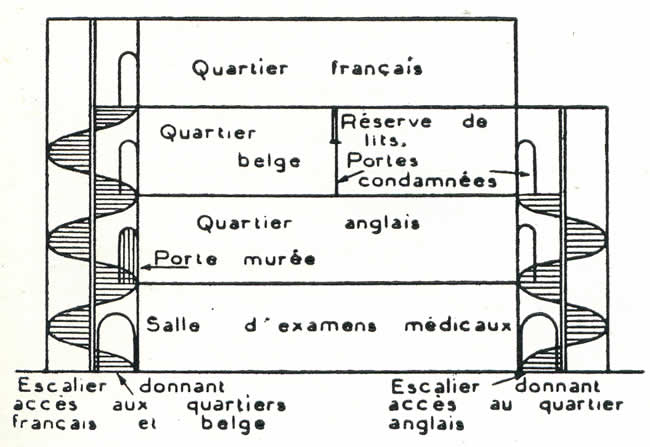
Il était
donc important de rouvrir les portes condamnées par les Allemands et de le
faire sans laisser la moindre trace, que l’œil attentif de La Fouine n’eût
manqué de découvrir. Quelques
Belges, j’en étais, venaient d’arriver au Château de Colditz. C’est en leur
honneur que fut créé le quartier belge. Il occupait la moitié d’un étage,
au-dessus du quartier anglais. On y avait accès par la tourelle de gauche,
tandis que celle de droite servait aux Anglais. Entre notre
quartier et le palier supérieur de l’escalier anglais se trouvait une grande
chambre inoccupée dont les deux portes, la nôtre et celle des Anglais étaient
munies de serrures de sûreté et toujours fermées. Par l’imposte vitrée et
grillagée, nous avions pu apercevoir que dans la chambre étaient emmagasinés
des lits et des paillasses de réserve. Dès que
nous eûmes fait connaissance avec nos nouveaux compagnons de captivité et que
ceux-ci se furent assurés de la solidité de nos convictions, un Anglais, le
Major Paddon, vint m’expliquer l’importance qu’il y avait à trouver un truc
pour ouvrir les portes qui séparaient son logement du nôtre. Après
examen du problème, il fut décidé que l’opération serait entamée de notre côté ;
une garde fut organisée, un outillage rassemblé et, aidé par le Major Paddon et
le Lieutenant Teere, je me mis au travail. Il s’agissait
d’une porte à deux vantaux, surmontés d’une imposte vitrée ; celle-ci
était amovible, mais doublée de solides barreaux. Les pivots des charnières de
la porte étaient de notre côté. La première opération fut d’enlever les six
pivots de charnières et de faire basculer la porte toute entière. Cela fait,
démonter la serrure n’était plus qu’un jeu d’enfant. Tout ceci fut mené à bien
en un rien de temps. La serrure
fut ensuite attaquée, on supprima l’ergot du ressort qu’actionne la clef, de
façon à ce que le pêne ne puisse plus être bloqué quelle que soit sa position.
Puis de nouveau, tout fut remis en place en un tournemain. Hélas, avant de
refermer la porte, mes deux complices et moi, allâmes inspecter la chambre que
nous venions d’ouvrir et la porte qui la séparait de l’escalier anglais. Et c’est
ici que le drame débuta : pendant notre visite, La Fouine surgit, découvrit
la porte ouverte et notre présence dans la chambre défendue. - Was machen Sie da ? (Que
faites-vous là ?) - Wer hat
diese Tür geöffnet ? (Qui a ouvert cette porte ?) Dans un
charabia fait d’anglais, de français, de flamand et d’un peu d’allemand, nous
lui expliquâmes de l’air le plus bête que nous pouvions nous donner, qu’un
soldat allemand était passé faire une ronde la nuit et qu’il avait tripoté à la
porte (tout ceci était strictement vrai) et que ce matin (ceci était moins
vrai) nous avions constaté qu’il avait laissé la porte ouverte. Inutile de
dire que notre discours ne convainquit pas notre « Fouine » :
trouvant que mes poches avaient une drôle de forme, (j’y avais mis mes outils)
il me dit : - Was haben
Sie da ? (Qu’avez-vous là ?) et joignant le geste à la parole, il fit
mine de me fouiller. Je
protestai immédiatement avec indignation : « Ich bine in Offizier »
lui dis-je « und es muss ein Offizier sein, der mich dursucht ! »
(Je suis un officier, et ce ne peut être qu’un officier qui puisse me fouiller !) La Fouine
était un de ces Allemands sur qui agit encore le prestige de l’officier, fût-il
ennemi et prisonnier. A ma surprise, mon discours calma ses intentions
immédiates. - Kommen
Sie mit mir zum « Evidence ». (Venez avec moi à l’« Evidence »[4],
nous ordonna-t-il. Mais l’incident
avait rassemblé autour de nous un grand concours de camarades et nous aurions
eu à traverser une véritable foule. La Fouine sentit immédiatement que seul, il
ne pouvait nous surveiller tous à la fois et que si nous avions des objets
défendus il nous serait facile de les passer à un camarade avant qu’il ait pu s’en
saisir. Il savait bien d’autre part, que s’il ne se présentait pas au poste de
garde une demi-heure après son entrée dans le camp, la Kommandantur serait
alertée et aussi son ami Mussolini viendrait à sa recherche. Aussi, se
ravisant, décida-t-il de nous faire rentrer, lui, Paddon, Teere et moi, dans la
chambre défendue et s’appuyant sur la porte qu’il venait de refermer, il se mit
à attendre calmement que le secours lui vint. Pendant que
Paddon et Teere lui parlaient et le distrayaient, je parvins à cacher mes
instruments dans une paillasse ; mais leur propriétaire, qui était mêlé à
la foule de l’autre côté de la porte, était très inquiet à leur sujet et très
anxieux de les récupérer avant l’arrivée de Mussolini. Aidé d’un camarade, il
démonta sans bruit, au-dessus de la tête de La Fouine, l’imposte de la porte et
me demanda de lui rendre son bien. Heureusement La Fouine ne comprenait bien ni
le français ni l’anglais. Nous
convînmes qu’on le distrairait pendant que je récupérais les outils. La
distraction consistait à faire descendre devant les yeux de notre cerbère et
sous les rires des spectateurs un bâton de chocolat attaché à une ficelle. Le
stratagème réussit pleinement. Soudain, un camarade qui se trouvait dans le
dortoir entrouvrit brusquement la porte derrière La Fouine et lui lança dans l’oreille
un cri véhément. 
Aussitôt La
Fouine se retourna pour reconnaître l’insolent : une seconde de
distraction suffit pour me permettre de déposer les outils sur la tablette de l’imposte.
La Fouine, se retournant à nouveau, me trouva en face de lui et un peu près,
mais ne devina pas ce qui venait de se passer ; tandis qu’il me repoussait
du bras, les outils étaient enlevés par leur propriétaire et disparaissaient. Cet
intermède avait transformé en joyeuse farce ce qui s’annonçait mal et, nous
aussi, nous attendîmes patiemment Mussolini. Accompagné
de quatre factionnaires baïonnette au canon, il arriva enfin ; sa surprise
et sa colère devant la porte ouverte et notre explication firent rire tout le
monde, ce qui n’était pas de nature à calmer son indignation. Après nous
avoir fait passer de l’autre côté de la porte, prenant son grand trousseau et
choisissant avec soin la clef compliquée qui seule pouvait actionner la serrure
spéciale, d’un double tour il referma la porte, qu’un simple coup de pouce
permettait maintenant de rouvrir. Très satisfait de lui, il dit au major Paddon : 
« Ich
habe achtzehn Dienstjahre in der Wehrmacht, und um einen alten deutschen
Unterffizier wie mich zu täuschen, muss ein anderer kommen, als ein dummer Engländer ! »[5]
Le plus
satisfait n’était cependant pas Mussolini. La froide
raison. Nous étions à peine depuis quinze jours au Château de
Colditz que les services de contrôle du camp, soucieux de leur responsabilité à
l’égard des prisonniers redoutables que dénonçaient nos dossiers, décidèrent de
refaire eux-mêmes nos fiches anthropométriques. Dans le Grand Reich tout était,
en effet, incertain ; les complicités et les négligences les plus
inattendues se révélaient à chaque crime contre le régime, à chaque catastrophe,
et sur une échelle plus réduite, à chaque évasion de prisonnier. Or donc,
par un jour ensoleillé de juillet, dans la cour du château, une équipe de
censeurs sous la direction de leur chef, l’Oberleutnant Teiger, que son âge
avancé et son aspect décharné faisaient plus communément appeler « Trompe-la-Mort »,
s’installa derrière une table couverte de fichiers, et les nouveaux venus, dont
nous étions, furent appelés à se présenter. Nous étions
une trentaine : dix Belges, autant de Français, deux Anglais, trois
Yougoslaves et quelques Polonais qui passions à la queue leu-leu devant la
table. Trompe-la-Mort s’emparait de notre fiche, vérifiait le signalement,
déposait la carte sur la table et nous ordonnait de nous placer devant le
photographe pour qu’un nouveau cliché, reproduisant à coup sûr nos traits
réels, fût pris et collé sur la nouvelle fiche qu’un censeur subalterne
préparait déjà. Au moment
où je me faisais photographier, je pouvais, à distance et à l’envers, voir ma
fiche déposée sur la table. Je lus que mon adresse civile comportait une erreur :
le numéro de ma maison, sans doute copié d’une carte d’identité datant de
plusieurs années déjà, était un ancien numéro changé depuis. Lorsque le
photographe me libéra, m’adressant à Trpompe-la-Mort, je dis : - Herr Oberleutnant, il y a une erreur d’adresse,
puis-je la corriger ? - Certainement
Monsieur le Capitaine, me répondit-il. Ceci me
permit de prendre ma carte en main et d’y lire sous mon nom la mention « Fanatischer
Deutschfeindlich » (Germanophobe fanatique) Après avoir
corrigé l’erreur d’adresse, je rendis la carte à Trompe-la-Mort et, lui
montrant le jugement porté sur mes sentiments, je lui dis : - Il y a aussi une erreur ici. Et mon interlocuteur de s’indigner et de
dire : - Oh ! mais vous ne pouvez pas lire
cela, Monsieur le capitaine. Puis se reprenant, d’ajouter : - Et où est l’erreur, Monsieur le
Capitaine ? 
- « Fanatischer » est de trop,
Herr Oberleutnant, mes sentiments ne sont que le résultat de la froide raison ! - C’est
bon, c’est bon, Monsieur le capitaine, ne dites jamais cela : c’est très
tanchereux ! Les
distractions de Monsieur le Comte. Nous avions un camarade de captivité qui nous
déroutait continuellement par sa distraction, sa désinvolture et un
comportement général de grand seigneur qui lui faisait supporter sa captivité
comme si les Allemands n’y jouaient qu’un rôle de valets grossiers qu’il faut bien supporter parce qu’on n’en
trouverait pas d’autres ! Malgré ses
soixante-trois ans et de très brillants états de service durant la guerre
précédente, le Comte de Gavre n’était que sous-lieutenant et il lui avait même
fallu beaucoup d’obstination pour être autorisé à rentrer sous les armes en mai
1940. A Colditz,
la base de notre alimentation était constituée par le contenu des colis que nos
familles et la Croix-Rouge nous faisaient parvenir ; mais les Allemands
nous interdisaient de disposer des emballages ; ainsi nous devions leur
remettre en dépôt les boites de conserves ; lorsque nous voulions en
disposer, il fallait, assiette en main, demander à l’Allemand de service de
vider dans cette assiette le contenu de la boite de fer blanc. Une exception
était tolérée pour le lait condensé : chaque prisonnier pouvait avoir en
sa possession une boite de lait dans laquelle les Allemands avaient pratiqué
deux trous avant de la remettre à son propriétaire. Lorsque la boite était
vide, il fallait la rapporter pour en recevoir une autre pleine, mais
préalablement percée des trous réglementaires. 
Ainsi donc,
le Comte de Gavre, distrait et bavard, était allé au dépôt chercher une boite
de lait. Sans regarder ce qu’il faisait, parlant avec vivacité à l’un de ses
camarades, il sortit du dépôt tenant par mégarde sa boite à l’envers. Son
compagnon, se rendant brusquement compte de ce que le précieux liquide se
répandait hors de la boite, par terre et sur la tunique de Gavre, le lui fit
remarquer. Gavre ne
manifesta ni surprise, ni regrets ; il se contenta de hausser les épaules
et de dire : « L’imbécile ! il l’a percée à l’envers ». Le Comte de
Gavre était, par ailleurs, d’une activité souvent trépidante, bien que plus
orientée vers les mouvements de l’esprit que vers les travaux manuels auxquels
s’adonnaient la plupart de ses camarades. Cette
activité mentale associée à la distraction presque pathologique dont souffrait
notre camarade faisait souvent notre joie. Gavre avait
fait une partie de ses études à Oxford ; il parlait et écrivait l’anglais
aussi bien que le français et faisait preuve d’une rare érudition en tout ce
qui touche à la culture et à la politique britanniques. Il en avait conçu pour
les Anglais et l’Angleterre une estime sincère que venait exacerber, en prison,
la haine qu’il nourrissait pour les Allemands. Gavre
enseignait l’anglais à ses camarades belges et français ; il donnait le
cours dit « supérieur », ce qui était une manière comme une autre de
montrer ses sentiments ! Nos gardiens, d’ailleurs, le comprenaient fort
bien et ne se faisaient à ce sujet aucune allusion ; pour eux, Gavre était
un incorrigible anglophile. Chaque
soir, Gavre préparait dans notre chambrée la leçon du lendemain. Il s’installait
dans un curieux fauteuil fait de lanières et de toile, il s’enroulait dans une
couverture et protégeait son crâne et ses oreilles contre le froid ambiant par
un bonnet cocasse tricoté en forme de heaume. Ce couvre-chef complétait
parfaitement l’aspect très aristocratique de notre ami, qui pouvait authentiquement
suivre la trace de ses ascendants jusqu’à l’un des compagnons de Godefroid de
Bouillon. 
Un certain
soir, coiffé de son bizarre bonnet, Gavre semblait chercher avec difficulté un
mot nécessaire à la traduction sur laquelle il s’acharnait. Brusquement il m’interpella :
« Decard, dites-moi, « spider », « spider », comment
donc appelle-t-on en français cet insecte qui fait des toiles d’araignée ? » Le grand
tunnel. De tous les moyens d’évasion, celui qui a été le plus
souvent essayé, et, je pense, celui qui a toujours donné les moins bons résultats,
est le tunnel. C’est en tout cas celui qui demandait le plus d’efforts, le plus
de patience et aussi la plus longue dissimulation. Mais le prisonnier qui a une
tenté de s’évader et qui a échoué recommence toujours et, en général, en
utilisant les mêmes moyens, convaincu qu’il fera mieux la prochaine fois. Creuser un
tunnel pour s’évader d’un château fort perché sur un éperon rocheux, où trois
enceintes concentriques séparent les prisonniers du monde extérieur, peut
paraître une gageure ou même, plus simplement, une histoire inventée de toutes
pièces, pour satisfaire des lecteurs avides d’aventures ayant pour cadre les
décors romantiques et leurs accessoires les plus classiques. C’est
pourtant ce qu’a tenté une équipe de jeunes et courageux officiers français sui
furent nos compagnons de captivité au Château de Colditz. Cette aventure qui
faillit réussir, dura un an. Dans ce camp, sans doute le plus surveillé d’Allemagne,
policièrement parlant, des sapeurs improvisés travaillèrent pendant plusieurs
heures chaque jour ; ils évacuèrent des tonnes de gravats et de décombres
sans éveiller, chez nos gardiens, d’autre suspicion que celle qui était l’ordinaire
de leur fonction. Il faut
expliquer qu’il n’y avait, dans l’enceinte des prisonniers, aucun espace de
terre libre : tout était pavé ou dallé, ou même tous simplement du roc. L’évacuation
des décombres ou même tout simplement du roc. L’évacuation des décombres ou
leur dissimulation étaient des problèmes sérieux ; ils furent résolus par
l’utilisation des combles et des espaces morts, entre plafonds et planchers aux
étages. L’un des petits
côtés de la cour rectangulaire du château était occupé par la chapelle, sans
doute l’un des plus anciens bâtiments de la forteresse. Bâtie sur une cave
voûtée, cette chapelle avait un aménagement intérieur bizarre qu’elle devait au
fait que le château servait, entre les guerres, d’asile de fous ; il y
avait, à l’intérieur, trois étages de galeries divisées en loges grillagées. Du
temps des fous, chaque galerie communiquait directement avec les étages de
dortoirs ; les pensionnaires pouvaient ainsi être conduits par le plus
court chemin et enfermés dans les loges d’où ils assistaient aux offices
religieux. Du côté Sud
de la chapelle, on accédait à chaque galerie par une simple porte donnant
directement sur le palier correspondant de l’étage voisin ; du côté Nord,
il fallait emprunter un couloir long de quatre mètres. Lorsque le
château devint un camp de prisonniers, l’autorité militaire estima qu’il ne
fallait qu’une porte à la chapelle : celle qui donnait dans la cour, et
tous les accès vers les bâtiments voisins furent murés. On mura même les deux
extrémités de chacun des couloirs superposés qui, du côté Nord, donnaient dans
la chapelle. Ainsi isolés, ces trois couloirs formèrent trois petites chambres
secrètes dont nous soupçonnions l’existence sans pouvoir y accéder. La tourelle
d’angle contenant l’escalier en colimaçon qui donnait accès au quartier
polonais et au quartier belge était accolée à ces chambres secrètes. Avant d’être
fondues pour les fabrications de guerre, les cloches de la chapelle se
trouvaient dans la toiture de cette tourelle. Les cordes qui naguère
actionnaient les cloches étaient encore en place et descendaient du quatrième
étage jusqu’au rez-de-chaussée dans une gaine triangulaire formée par l’arrondi
de la tourelle et les murs droits des bâtiments. Le prisonnier aime mettre le
nez partout. Un camarade français, de petite taille mais souple et rigoureux,
avait découvert que l’une des faces droites de la gaine était faite de panneaux
de bois qu’il avait fait sauter pour déboucher dans l’une des chambres
secrètes. 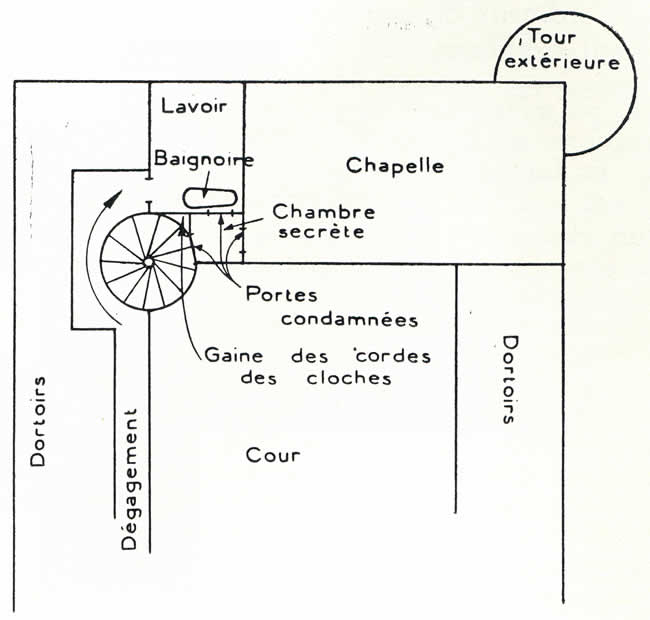
Cette
découverte fut l’origine du grand tunnel de Colditz. On installa
dans les chambres du premier et du second étage des ateliers pour la fabrication
et la réparation d’outils. Une nuit,
la barre de fer qui servait de rampe à l’un des escaliers en colimaçon
disparut, bien qu’elle mesurât environ vingt mètres de long. Malgré toutes
leurs recherches, les Allemands ne surent ce qu’il en était advenu. En fait,
elle avait été transportée dans ces ateliers er transformées en barres à mines
et en pieds de biche. La gaine
donnait, au rez-de-chaussée, dans un petit réduit obscur, également muré ;
un trou dans le pavement conduisit à découvrir qu’entre le pavement de la
chapelle et les voûtes de la cave, il y avait un espace vide, à moitié comblé
par des gravats et traversé par d’énormes poutres en chêne sur lesquelles
reposait ledit pavement. On savait
qu’à l’autre bout de la chapelle, les trois enceintes se confondaient en une
seule parce que le roc était abrupt. On savait aussi que ce coin du château ne
comportait qu’une tour très ancienne, inhabitable, et dans la toiture de
laquelle se trouvait une sentinelle relevée toutes les deux heures. Il s’agissait
donc, sur toute la longueur de la chapelle, de se frayer un chemin dans les
gravats accumulés entre les voûtes de la cave et le pavement de la chapelle,
puis de creuser une galerie oblique dans le grès jusque sous la tour et de là
un puits et une seconde galerie jusqu’à l’extérieur. Dans l’atelier
du second étage, on s’aperçut que la cloison condamnant le passage vers le
quartier belge n’avait qu’une demi-brique d’épaisseur ; de l’autre côté de
cette cloison était notre lavoir. Les trois baignoires qui s’y trouvaient
étaient pour nous un grand luxe ; moyennant quelques cigarettes, on
pouvait de temps en temps obtenir du cuisinier deux seaux d’eau chaude et
prendre un bon bain. Nos
sapeurs, désireux de disposer d’un chemin de retraite en cas de découverte de
leurs travaux par les Allemands, établirent dans leur atelier, derrière cette
cloison, un bélier puissant : c’était la partie de l’une des grosses
poutres de chêne qu’il avait fallut enlever pour se frayer un passage sous la
chapelle. On avait suspendu cette lourde masse de bois au plafond par deux
chaînes de telle façon que, si on la faisait balancer, elle heurtait de tout
son poids la cloison, et celle-ci n’était pas construite pour résister à un tel
choc. La gaine
des cordes des cloches dans laquelle on avait, avec les cordes, établi un petit
monte-charge, permettait assez facilement d’amener les gravats et les décombres
jusqu’au quatrième étage sans risquer de se faire surprendre par les Allemands. Le tunnel
commençait donc au quatrième étage, sous les combles et descendait
verticalement jusque sous le pavement de la chapelle ; il courait sous
celle-ci et sur toute sa longueur. La première galerie creusée dans le roc
avait atteint le dessous de la tour de garde. Tout allait pour le mieux et on
comptait qu’il suffirait encore de six semaines pour atteindre l’air libre hors
de l’enceinte du château. 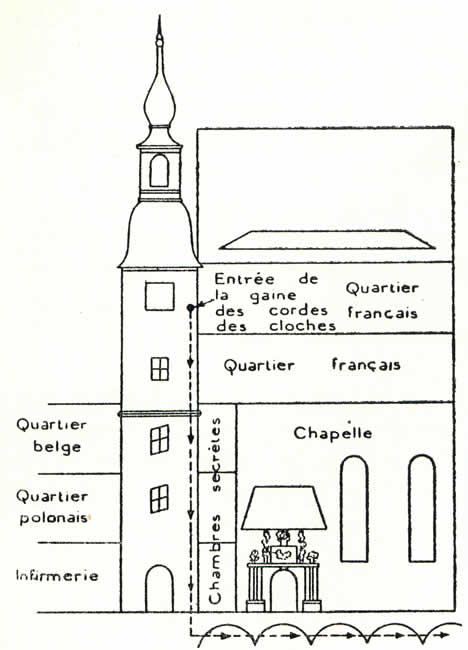
Une
imprudence gâta tout : du tunnel dans la voûte, on voulut aller voir dans
la cave ; on fit un trou ; l’endroit était bien choisi, il était bien
au fond de la cave derrière un dépôt de bois à brûler. Mais une fois dans la
cave on voulut atteindre la réserve de vin des officiers de la Kommandantur et,
de temps en temps, subrepticement, on prit une bouteille. Un jour,
Mussolini découvrit le pot aux roses ; il devina l’usage qu’on avait fait
de la gaine des cordes ; mais il était trop gras, trop lourd, trop raide,
et sans doute aussi trop craintif pour s’aventurer dans le passage qu’il avait
découvert. Discrètement, il alla chercher à la caserne trois jeunes recrues d’un
modèle particulièrement léger ; deux d’entre elles devaient, par la cave,
explorer le tunnel tandis que le troisième devait se laisser descendre du
quatrième étage par la gaine. A ce
moment, nos sapeurs n’étaient heureusement pas dans le tunnel proprement dit,
mais dans leurs ateliers. Alertés par des guetteurs, ils font manœuvrer le
bélier. La cloison s’effondre et ils disparaissent dans le camp avant que les
Allemands n’aient pu les identifier. Une chose n’avait
pas été prévue : notre ami le Comte de Gavre prenait paisiblement son
bain, lorsque la cloison s’effondra brusquement sur lui. Avant qu’il ait pu se
rendre compte de ce qui arrivait, les sapeurs français avaient passé comme des
ombres et le jeune soldat allemand qui les poursuivait ne trouva plus que Gravre
nu comme un ver, sauf le couvre-tête en forme de heaume qui ne le quittait
jamais, même au bain ! Gavre, remis de son émotion, exprima sa pensée et
dit « Je ne trouve pas ça drôle du tout ! » 
Mussolini
arrivant sur les lieux voulut au moins une victime et notre noble ami, très
simplement vêtu, dut, malgré ses protestations, l’accompagner jusqu’à « L’Evidence ». Il fut d’ailleurs
rapidement mis hors de cause. La stupeur
des Allemands devant cette découverte inattendue faisait plaisir à voir. Tous
les jours des autorités venaient se rendre compte de l’importance des travaux ;
on fit venir un savant architecte archéologue de Dresde qui évalua à vingt-cinq
mille marks la dépense nécessaire à la réfection du sol de la chapelle et à
celle des plafonds qui s’effondraient un peu partout sous le poids des gravats.
Comme on n’avait pas pu mettre la main sur les coupables, on décida de retenir
un cinquième de la solde de la solde des prisonniers jusqu’à ce que la somme de
vingt-cinq mille marks fût réunie. Cette
punition collective et arbitraire provoqua chez les prisonniers une vive réaction.
Les doyens de chaque nation de réunirent en collège et décidèrent d’adresser à
l’autorité allemande d’énergiques protestations. Je crois me
souvenir du contenu de celle dirigée par le Colonel Desmit, doyen des officiers
belges ; elle rappelait que la Convention de Genève interdit les sanctions
collectives pour les fautes individuelles ; elle signalait que les
Allemands n’avaient qu’à s’en prendre à eux-mêmes s’ils n’avaient pu se saisir
des coupables ; elle rappelait qu’il est normal et presque un devoir pour
les prisonniers de chercher à s’évader, tandis qu’il est du devoir des gardiens
d’exercer sue ces mêmes prisonniers une vigilante surveillance ; en
réalité, elle impliquait avec humour que si des coupables devaient être
trouvés, il fallait les rechercher chez les gardiens, puisque, pendant des
mois, ils avaient manqué de vigilance et qu’au moment de la découverte, ils
avaient laissé les sapeurs s’échapper. Cette
protestation était bien dans l’esprit frondeur du château de Colditz ;
nous eûmes un réel plaisir lorsque son texte nous fut communiqué, mais nous n’avions
naturellement aucun espoir de la voir aboutir. Chaque semaine on nous diminuait
notre solde de quelque dix marks ; un jour les vingt-cinq mille marks
furent atteints et on n’en parla plus. Puis on nous changea de camp et nous
allâmes à Lübeck. Nous y
étions depuis quelques semaines lorsque nous fûmes avisés que l’on nous
remboursait « les prélèvements indûment faits sur notre solde à Colditz ». C’est ainsi
que je fis, bien malgré moi, quelques économies. 
[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951. [2] Oberfeldwebel : premier sergent major dans l’armée allemande. [3] Gefreiter : caporal dans l’armée allemande. [4] L’ « Evidence » était un local situé dans la cour et où devaient se présenter les prisonniers que l’autorité allemande désirait soumettre à un interrogatoire. [5] J’ai dix-huit ans de service dans la Wehrmacht, et pour tromper un vieux sous-officier allemand comme moi, il faut autre chose qu’un bête Anglais ! |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©