 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Mon curé chez les Nazis[1] 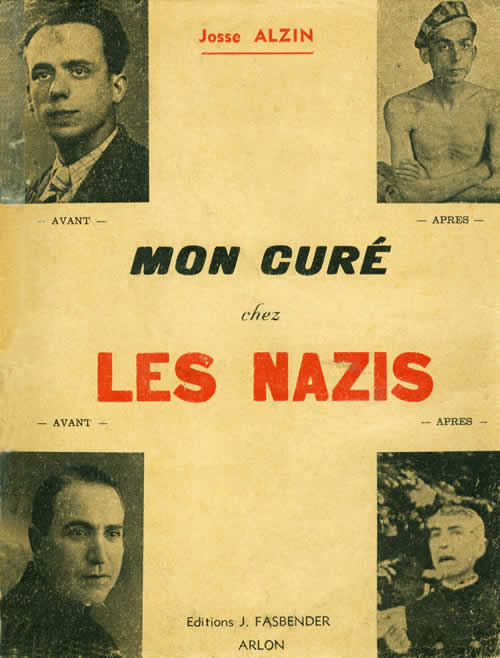
« Nous avons connu la souffrance par la maladie, empoisonnement de
sang et pneumonie, par les tortures, ainsi que par la faim ; mais tout cela,
nous l'avons subi pour que grandisse la Belgique, Unie, Libre et Indépendante. » (Abbé LALOUP) « Il faut être passé par là pour se rendre compte de ce que
peut-être, en plein vingtième siècle, une journée entière de torture. » (Abbé FROIDURE) « Nous revenons las,
fatigués, épuisés, vidés, mais nous rentrons forts. Oh ! ces
chères âmes des prisonniers rentrés, ayez-en pitié et gardez-les sur les
sommets où elles se sont élevées. » (Père LELOIR) J'avais
juré de ne pas écrire une ligne sur ma captivité. Livrer complaisamment les
tourments et les chutes de sa marche au calvaire, pourquoi ? Faire monter plus haut
encore la flamme de la haine entre les peuples ? Notre religion n'aime pas
la haine. S'enfiévrer de rancœur et appeler les vengeances ? Non. Avant tout secouer
tout et revivre. La vie paroissiale, l'apostolat de la plume ; déjà les
éditeurs me harcelaient sur d'anciens projets. Ceux qui n'ont pas été
forçat, me disais-je, pourront-ils d'ailleurs nous comprendre ? Mais aujourd'hui que je me
débats, sur ma couche, avec les traces perfides dans mon sang, dans mes os, des
maladies contractées là-bas, je pense à mes frères d'infortune. Et j'apprends par des
entrefilets de journaux, et par des lettres, que certains manquent de tout, ont
bien touché leurs premiers billets mais regardent avec angoisse l'avenir. Quand
leurs trois indemnités seront avalées, par un peu de suralimentation, personne
ne s'occupera plus d'eux. Or beaucoup d'entre eux ne
pourront plus travailler, mordus pour toujours par la longue faim, le typhus,
l'œdème, les furoncles, la dysenterie. On se lasse d'avoir pitié. Les premiers jours on
court chez les rescapés. Les plus larmoyants sont ceux qui ne reviendront pas.
Les autres se précipitent avec leur petit cadeau. Huit jours après le bagnard
allongé, desséché, désincarné, manquera peut-être du nécessaire. C'est pourquoi j'ai résolu
d'écrire ces pages et de les vendre pour venir en aide aux plus malheureux que me
signaleront des amis ou les organisations fondées pour cela. Je n'écris que ce que j'ai
vu. D’autres ont vu davantage
et souffert plus que moi. Pour moi, sans passer par « d'atroces mutilations » comme
on l'a dit par erreur, j'ai saigné sous la terreur nazie, en mon corps, mon
cœur et mon âme. Si le ciel a eu pitié,
c'est à cause du réseau de prières qui m'a entouré sans cesse. Et c'est peut-être parce
que Dieu a jugé que ma journée n'était pas finie, que je devais encore livrer témoignage.
Témoignage de foi, témoignage de charité et de patriotisme. Aidez-moi à le faire.
Votre récompense est assurée. Josse ALZIN. I LA CROIX SUR LA MAISON Cauchemar du 4 juillet 1944 ! En une des journées les plus sereines de l'été commençant. Mes paysans faisaient leur sieste avant de reprendre le défilé des charretées de foin titubantes. Les colombes jalonnaient les faîtes des toits brûlants. Il y avait pourtant comme une terrible et générale conjuration des choses, jusqu'à cette cachette beaucoup plus sûre qu'on eût pu-choisir pour se terrer et qui demeure inviolée. Le presbytère est facile à reconnaître. Maison haute aux façades dominées d'une croix et se dressant au front d'une pente où sont assises une cinquantaine de maisons. Dans cet asile se rencontraient, se restauraient depuis de longs mois en toute sécurité les gars du maquis, isolés ou en groupe. De là partaient pour la grande forêt, ou pour les vieux châteaux où on avait installé des « centrales », vivres, vêtements, ustensiles de cuisine, mots d'ordre, 1ivres, etc., etc. Dans cette maison entre le chemin et les vergers on était à l'aise pour des rencontres avec des chefs de diverses organisations patriotiques ; par derrière on pouvait gagner tout de suite les bois ou une petite route déserte. Deux réfractaires logeaient depuis quelque temps au presbytère, l'un qui était « quelque chose » dans l’Intelligence Service ; l'autre un cadet de la Marine polonaise, qui avait de beaux états de service déjà dans la Résistance française. C'est à celui-ci qu'on en voulait. Il vint d'abord le visiteur aimable, blond, cheveux ondulés, qui accepte une cigarette et se dit chargé d'une mission pour celui que vous cachez. Apparition derrière laquelle tout initié devait voir, hélas, hélas, l'ombre de quelque dénonciateur. La ruse étant déjouée et le visiteur éconduit, l'auto de la Gestapo arrêtée plus loin, se rua vers le presbytère qui fut assiégé et entouré de revolvers braqués. Les hurlements, les coups, les fouilles, le pillage de la cave au grenier, les menaces de mort, enfin l'enlèvement du pasteur et des deux jeunes gens, menottes aux poings, programme connu. Départ pour les interrogatoires et les tortures, puis pour la prison, le tribunal, et les camps, je le savais. Derrière moi, ma paroisse, ma maison calme, mon vieux père et les miens, mes manuscrits éparpillés, les armoires vidées. La douleur est plus lourde que les mots. Le jeune Polonais enchaîné à moi et moi-même nous gardions le silence. Sans nous concerter nous disions peut-être la même prière. Pas pour nous-mêmes. II MENACES, PROMESSES ET MATRAQUES Le premier interrogatoire que je subis, le soir même, voulait être déjà une instruction en règle. J'appris que j'avais prêché contre le Grand Reich et son Führer, même à l'I.N.R. et les pièces étaient là : mes causeries radiophoniques sur le véritable « axe du monde » ! Que j'avais monté ou fourni ou caché un poste de radio clandestine. Que j'avais caché des centaines de réfractaires dont je connaissais le chef si je ne l'étais moi-même. Que j’avais un dépôt d'armes et commandé ou organisé le meurtre de plusieurs Rexistes. L'instruction était vraiment piquée des hannetons. On me laissait d'ailleurs à peine le temps de répondre. Les premiers mots à peine formulés, je recevais en pleine face un soufflet formidable ou bien un coup de poing sur la tête. Ce ne fut pas long le premier soir ; on me promit pour le lendemain un interrogatoire en règle ; on me donna l'assurance que je parlerais, qu'aucun de ceux qui étaient passés par ce que je verrais le lendemain n'avait pu se taire. Un grand colosse à la tête noire de jais, pommadé, mais au visage en vraie porte de prison. Il me tira par les cheveux ; « tout cela va être raccourci » vociféra-t-il, m'arrachant une touffe dans ses mains d'étrangleur. Il ajouta : « Et dons quelques jours ce sera le K.Z. » (Il prononçait : KaTsett). J'ai deviné qu'il voulait signifier par là le camp de concentration. Je savais que les camps de concentration étaient les pressoirs des vengeances nazies. Je ne savais pas que nous y serions condamnés à une mort lente. Je crois en effet que si la guerre avait dû se prolonger longtemps encore, la proportion des morts déjà si atroce eût été épouvantable. Et l'on me conduisit en cellule après un coup de téléphone à la prison : « Avez-vous une écurie libre pour un curé ? » Je ne redoutais qu'une chose : être seul en cellule. Je fus préservé de ce malheur et rencontrai de bons compagnons d'infortune. J'eus même la joie d'apprendre que dans la cellule d'en face, se trouvait claustré mon ami polonais. Il l'apprit de son côté et hardi comme il l’était, il eût tôt fait d'établir entre nous un petit courrier. Deux jours après, ayant changé de cellule et d'étage, il risqua sa vie pour venir me commander une messe à cause de son départ prochain pour l'Allemagne, et sa décision de s'évader dès que possible ; ce serait la troisième fois. Les repas en cellule étaient satisfaisants : la Croix-Rouge et le Secours d'Hiver s'en chargeaient. Nous avions des 1ivres de prière et même l'un ou l'autre livre de lecture clandestin, des jeux de cartes, de dames et d'autres, confectionnés par les prisonniers ; tout cela devait s'évaporer dès qu'un pas allemand annonçait une visite. Nous avions même des cigarettes. On ne pouvait en fumer que durant la promenade en rond à la cour, mais que de cellules où l'on fumait nuit et jour. Une pierre de silex suffisait et un peu de celluloïd gratté sur la brosse à dents ; bien d'autres ruses nous procuraient la flamme. La flamme spirituelle n'était pas trop vacillante. Chapelet dévot tous les jours. Bonne entente cordiale. Bon moral. Les premiers jours seuls furent sombres et douloureux. Plusieurs après-midi successifs d'interrogatoire, de coups, de tortures. La matraque de caoutchouc mou, celle de caoutchouc dur, les nerfs de bœuf, les martinets de cordes et ceux de fil de fer à pointes, les piques d'acier qui tombent on ne sait d'où, des trappes qui s'ouvrent et font tomber votre corps nu et endolori dans une cuvelle immense d'eau glacée, etc., etc. Je n'ai pas connu les poulies et les pendaisons par les pieds mais dans la chambre noire à peine éclairée d'une petite ampoule bleue, j'ai dû hurler deux fois sous des tentatives de tortures sadiques que les bourreaux me promettaient de reprendre. Ces séances coupées de questions et de tourments duraient environ quatre heures. Un soir où j'avais particulièrement été mis à l'épreuve, on me reconduisit languissant, délabré au bureau de l'interrogatoire. L'atmosphère avait changé. Je vis un personnage doucereux, qui parlait excellemment le français. Il me dit sans sourciller, sans reprendre haleine, et sans attendre que je me remette de mon ahurissement : « Asseyez-vous dans ce club ; Monsieur le Curé, on vous a bien malmené ... Prenez une cigarette. Vous ne fumez pas ? Un petit verre ? (Le geste suit l'offre ; deux verres s'avancent.) C'est un excellent petit cognac... Remettez-vous, vous en avez besoin... Faites-moi confiance, je ne suis pas un bourreau et je désapprouve les tortures... Vous préférez peut-être un verre de Bourgogne ?... Non?... Alors, écoutez-moi... Parlons d'homme à homme. « Je respecte les prêtres ; c'est pourquoi je veux qu'entre nous s'exprime non la haine mais la raison, l'humanité... Ecoutez ... La parole demeurait rapide, me donnait presque le vertige à cause de mon affaiblissement et de l'inflammation qui commençait comme chaque soir à cuire dans mes bosses bleues et rouges et dans mes veines presqu'à nu. « Nous sommes convaincus que vous ignorez ce qu'on voulait savoir de vous... Vous n'êtes ni un chef ni l'ami d'un chef du maquis ou de l'Intelligence Service... mais je vous propose et vous conseille de répondre très franchement à cette unique question : Et la question fut jetée avec précipitation tandis que deux yeux devenus durs s'avançaient : – Qui est Freddy que vous avez reçu un jour chez vous ? Il ajoute avec trop de hâte : – Dites son nom et vous serez libéré. Jugea-t-il tout de suite à mon impassibilité qu'il avait fait un pas de clerc ? Il dit encore : – Vous ne croyez pas à ma promesse ? Il se leva, se mit à taper : Je rédige votre papier de libération... Réfléchissez… Voulez-vous réfléchir jusque demain ? Ici éclatait sa naïveté. Je l'avais cru plus habile. Il me fit reconduire en auto avec un cigare en poche, que je jetai sur le seuil. Je sens encore dans le dos sa grosse main d'hypocrite sur nourri me donnant une tape comme à un veau stupide qu'on mène à l'abattoir. – Comment peut-on avoir le courage de se taire sous les coups ? me demande-t-on. La volonté qu'anime une certitude peut faire des miracles. Plus ils frappaient, plus j'étais convaincu qu'ils n'avaient rien découvert de précis. C'est tout ce que je voulais savoir. Beaucoup de ceux qui ont passé par les tortures disent que le plus dur fut de découvrir chez des hommes des instincts et une cruauté auxquels malgré tout on ne veut pas facilement croire. – Comment peut-on être si cruel ? Qui donc a empoisonné cette race ? J'ai trouvé la réponse. Il y a dans le vocabulaire allemand un mot affreux, que ne possède aucune autre langue : « Schadenfreude ». Joie qu'on éprouve de souffrir. Atroce volupté des hommes d'infliger des douleurs à d'autres hommes. Et la vie de cellule continua plus calme. Le lendemain du dernier soir de torture, comme si le ciel voulait mettre un baume sur mes blessures, je reçus une valise autel. Je fus enveloppé soudain d'une sorte de bouffée surnaturelle. Une telle joie après un tel calvaire ! Le lendemain à l'aube, je dus réprimer les battements de mon cœur, les tremblements de mes doigts ; le Seigneur était parmi nous, tous communièrent. Plus tard je devais éprouver une émotion plus vive encore, lorsqu'en pleine infirmerie du camp de Hambourg je tins entre mes doigts une custode d'hosties consacrées. C'était plus que la visite de l'ange à l'apôtre Pierre dans sa prison. Chacun de nous pouvait recevoir tous les quinze jours un paquet de linge et remettre du linge à laver. Emoi indicible du premier colis venu de la maison. Chaque objet semblait chargé de tendresse. Et avec quelle fièvre on cherchait les lettres clandestines sur papiers à cigarettes collés bout à bout et cousus sous les boutons. Billets relus dix fois ; on les rebuvait goutte à goutte. Un ami me montra un jour son livre de prières où il avait écrit en piqûres d'épingles ses impressions devant les photos chères. Il fut plus tard condamné à mort et son 1ivre est retrouvé. Quelle relique ! A mesure que finissait l'été, nous apprîmes les bonnes nouvelles des victoires alliées en France. Nous nous raccrochions évidemment à toutes les raisons imaginables pour espérer ne pas partir vers l'Est. Chaque avance alliée, nous la savions aussitôt par nos sources secrètes d'informations. Et c'était chaque fois comme pour le voyageur, un tournant derrière lequel il croit devoir toucher au but. Et quand le canon tonna tout près, la confiance gonfla le cœur des plus pessimistes. Et quand avec précipitation on nous rassembla tous les 105 dans le grand hall du rez-de-chaussée, l'abbé Edouard Adam me chuchota : Les Alliés sont aux portes d'Arlon. Quatre jours après, nous devions débarquer à Neuengamme. III ESCLAVES EN ROUTE VERS L'INCONNU. 30 août entre midi et soir. Au déport d'Arlon, nos papiers nous suivirent. Nous avions tous la même fiche : « Bon pour le travail ». Tous forçats, tous destinés à la tonte des cheveux, au dépouillement de toutes choses, au travail forcé, à la faim. Nous ne savions pas tout cela. Entassés dans les camions, nous vîmes notre convoi nous entraîner vers Bastogne, « On va nous laisser à Liège ! » Nous n'osions nous interroger. Nous portions tous au fond des yeux l'espoir fou des jours d'avant et qui commençait à vaciller. D'autres avaient dans le regard encore la face de ceux qu'ils avaient vu arracher avant l'aube à la cellule pour les conduire au poteau. Pour ma part, je verrai devant moi, toute la vie, le visage terrifié et serein à la fois de mon ami Barthélémy que j'avais préparé à la mort tout en faisant croître encore en lui l'espoir, puisqu'il restait de l'espoir. Arrivée à Bastogne. Arrêt interminable. Enfin les camions font le tour de la Place du Carré et prennent la direction de Marche. La nuit tombe. L'incertitude nous empoigne. Certains affirment encore qu'on demeurera en Belgique en quelque prison centrale. D'autres : On va nous conduire à Breendonk. C'est un camp de la mort. De temps à autre, les camions malodorants et cahotants s'arrêtent. On peut descendre une seconde, mais rester au bord de la route. On eût pu s'enfuir dans la pénombre des bois. C'est la naïveté qui nous en a empêchés : « Pourquoi exposer sa vie ? La guerre va finir ». Marche. Namur. La nuit noire. Une triste pluie fine. On nous entasse dans un passage souterrain entre les quais. C'est là qu'on passera la nuit ; assis sur les valises, rognant les provisions du bon colis « Tempels » que des mains de miracle ont confectionnés la nuit avant notre départ de la prison. C'est le lendemain que nous fîmes connaissance avec de vrais S.S., hargneux, vengeurs. Avant de
prendre place dans le train qui allait nous emporter, il fallut vider ses
poches. Mon bréviaire et mon vieux chapelet aimé comme une relique furent jetés sur le quai et piétinés avec
rage. On ne nous laisse qu'un quignon de pain
pour durer environ deux jours. Rien d'autre. Tout le reste fut jeté on ne sait où.
On n'en devait plus rien retrouver. Alors
nos mauvais wagons à bestiaux où nous étions installés sur la paille roulèrent interminablement,
s'arrêtant parfois interminablement aussi en pleine campagne, puis repartant en
grinçant dans la nuit. Nous reconnûmes enfin le Pays Noir. Nous
avions emmené de Namur les captifs de la prison de cette ville. Nous allions drainer aussi ceux de la prison
de Charleroi. On évacuait donc toutes les prisons. Peu rassurant. A Bruxelles on chargea les prisonniers de
Saint-Gilles, à Anvers ceux de la prison de la ville et des prisons des deux
Flandres. Nous ignorions tout cela dans notre wagon
bouclé. Nous le savons maintenant. En nous hissant vers la lucarne, nous
pouvions seulement constater que notre train était un bien long et lent serpent
et s'allongeait de plus en plus. Aux arrêts on entendait bien les
vociférations, les allées et venues, mais sans comprendre. Renoncer à comprendre, c'était la devise
que nous étions forcés dès lors à faire nôtre, nous qui n'étions déjà plus du
nombre des hommes libres ni des civilisés. Au départ d'Anvers le convoi d'esclaves comptait
une cinquantaine de wagons. Nous dévions passer à Esschen,
Breda, Tilburq, dormant dans le wagon, ne recevant ni
eau ni supplément de nourriture. Le premier septembre nous traversâmes la
gare d'Eindhoven et roulâmes vers Venlo pour quitter les riants Pays-Bas plus
tard et approcher du sinistre Reich. Le
doute n'était plus possible. Et lorsqu'enfin on nous gratifia d'un seau d'eau
pour tout le wagon, nous eûmes devant nous des S.S. armés jusqu'aux dents et
nerveux. Des coups de feu environnaient le train
sans cesse, soit pour nous faire peur, soit pour tirer sur l'un ou l'outre prisonnier
qui tentait une évasion. On a dit que dix ou onze furent abattus en
route. Et certains d'entre nous disaient tout haut que notre voyage se
terminerait pour tous par un coup de feu dans la nuque. Une nouvelle nuit dans le wagon. Nous
nous enveloppions dans nos manteaux et nous nous étendions sur la paille
sordide. Et notre dernière pensée avant de sombrer dans un abrutissant sommeil, allait
vers les nôtres. Notre cœur se gonflait de tendresse pour ce que nous avions
quitté. Déjà des confidences m'étaient faites dans
le soir. « Je voudrais me confesser, monsieur le Curé ». – « Je n'ai pas assez estimé
la vie chez soi ». – « Nous n'avons pas été assez chrétien dans nos paroisses
». – « C'est maintenant seulement que j'aime ma femme et mes petits réellement
». Couché entre Raphaël Sindic
et l'abbé Adam, je rêvai de dîner d'accordailles, car le petit Polonais arrêté
et ligoté avec moi le 4 juillet avait trouvé chez moi son pain, du travail
patriotique... mais aussi son étoile. Et le beau rêve se poursuivait. Je
bénissais les jouvenceaux. Je bénissais mes paroissiens que je voyais emplir l'église
toute embaumée d'irréelles fleurs. Je chérissais cent fois plus que naguère mon
petit peuple. J'étreignais les tout petits et... guérissais les malades. Arrêtons-nous
là. Mes compagnons avaient eux aussi de ces
visions projetées dans l'imagination par le cœur ému, déchiré. Et le long train avec sa charge
d'esclaves s'enfonçait en Allemagne. Des problèmes pratiques urgents se posent
pour des gens enfermés, celui des besoins naturels par exemple. La consigne fut
: Dans le fond à droite, un petit trou entre deux planches. Dans mon wagon se trouvaient la plupart
des otages d'Arlon, l'abbé Origer entr'autres,
qui apportait dans l'épreuve les allures affables, la bonté des mots qui
étaient dans sa nature. Nous jurâmes de faire l'impossible pour
demeurer groupés, mais nous devinions bien un peu l'étendue de notre candeur. Enfin dans un tôt matin froid sous une menue
pluie glacée, nous fûmes débarqués à Neuengamme. Etait-il quatre heures du matin ? Moins
encore peut-être. Avions-nous séjourné dans ce wagon trois jours ou trois mois ? Des doubles rangées de soldats armés et
hurlants, dont plusieurs s'élançaient sur nous pour nous précipiter hors du wagon
et nous pousser en rangs. Une vraie tornade de rugissements gagnait
un wagon après l'autre. L'air vif nous réveille, nos habits étaient
couverts de fétus de paille. Dans le hourvari des braillements de tous
ces fauves, je ne saisis que ce sarcasme à la vue de nos six soutanes : « Na, da sind ja die Heilige auch dabei ! » Nous étions fixés. IV NEUENGAMME, PLAQUE TOURNANTE DE LA
MORT. C'est de Neuengamme que des milliers de
bagnards partirent vers leur destin de mort. D'autres milliers venaient échouer
à leur point de départ pour y être rôti. Quand on débouchait sur la Place des Parades
à Neuengamme, on se croyait dans un camp de plaisance ou dans un camp-sana. Le
grand crématorium semblait un temple. Une propreté incomparable sur l'immense
pavé ; tout autour, des baraquements aux fenêtres fleuries de pétunias. Au-dessus
un vaste ciel d'un bleu un peu pâle où tourne de temps à temps, lentement, un
épervier. Tout près une longue baraque, occupée par
des Français qui ont gardé par un arrangement avec Vichy, leurs habits, une
relative liberté de circuler, et la dispense du travail forcé. Nous voyons déambuler parmi eux des prêtres
et des religieux en soutane et, un espoir naît en nous ; on nous laissera peut-être
notre habit. On nous cite et on nous montre Monseigneur
Bruno de Solages et d'autres personnalités. Et nous voici enfin versés à flots dans une
immense salle souterraine, où il n'y a ni place pour s'asseoir, ni eau à boire et
où nous demeurerons des heures et des heures, Belges, Hollandais, Français, Russes,
Polonais, Danois. Les uns ont des provisions, les autres n'ont
rien. Peu à peu, sous le mot d’ordre : « Ils prendront tout » véritable charité fraternelle éclate. On peut obtenir partout des
biscuits, des confitures, du pain,
du saucisson, des fruits.... Nous nous mettons à engouffrer toutes
ces merveilleuses choses que les tendresses des mères, des épouses avaient
serrées dans les va1ises et les colis. Il y eut trop de vivres et trop de
douceurs. Bientôt l’on vit
traîner à terre les restes de cette orgie. On ne pouvait plus manger et
beaucoup ne voulaient rien laisser aux Allemands, jetaient plutôt les gâteaux à
terre et les piétinaient. Un officier bedonnant qu'on nous dit être
le grand chef de Neuengamme traversa tout-à-coup la salle et s’écria : « C'est une grande gochonnerie ! » Nous mourrions de soif et de fatigue ; cela
ne l'intéressait pas. Enfin avant le soir, nous fûmes tondus, dépouillés,
douchés, habillés de guenilles et chaussés de sandales de bois. Puis dirigés
vers nos blocs. C'étaient des baraquements à box étagés
où l'on dormait à quatre. Pas de travail les premiers jours. On fit
connaissance. On
rencontra des juges, des notaires, des banquiers, des artistes, de jeunes et de
vieux prêtres, l'un de 70 ans, un jeune époux arrêté au lit d'hôpital où sa
femme accouchait, un autre au chevet de sa mère mourante, des avocats, des
industriels, des martyrs de la Gestapo qui me montraient leurs dents cassées,
les ongles de leurs pieds arrachés. Une fraternisation intense, ardente s'établit.
On forma des groupes de priants. Nous portons en nous tous les autres hommes,
nous l'oublions trop. C'est dans l'angoisse, la souffrance supportée ensemble
que nous sommes soudain éclairés d'un soleil que nos yeux ignoraient. Dès les premiers jours, en effet,
commença notre détresse que nous ne devions réaliser que peu à peu, station par
station. – Privation du corps, de l'esprit, du cœur. – Alanguissement fatal des âmes par la
carence de tout secours spirituel. – Dépouillement de toutes choses, les
mouchoirs de poche même étant inexistants. – Souffrances à venir, imminentes, du corps
dans de telles conditions, car dès les premiers jours nourriture insuffisante. – Angoisse perpétuelle sur son sort et sur
le sort des siens dont on sera toujours sans nouvelles. Seul le lien de la charité pouvait faire
circuler comme un sang de mystère dans notre être qui allait se vider
lentement. Il nous fut possible en effet de rester ensemble
ces premiers jours, les amis du pays d'Arlon et d'autres amis Belges. On s'imagine ce que peut représenter en
de telles circonstances de vie le commerce intellectuel, les échanges d'idées, de
confidences, de projets, les mots pour rire. On se félicitait mutuellement pour son
accoutrement ; l'un de nous, un prêtre, portait un costume vert et brun où l'on
dénombrait exactement cinquante six grandes pièces. Cette vie, qui était supportable, à part
les désagréables « Aufstehen » à la matraque, et les
longs appels sur la Place sous les flots d'une musique stridente, ne devait
durer qu'une dizaine de jours. V LOS ! LOS ! TRAVAILLER OU MOURIR ! Nous étions passés aux douches. On nous
avait vêtus du costume zébré. Et surtout nous étions devenus des
numéros. Ce que nous portions de plus précieux sur nous, à ne pas perdre sous peine
des pires sévices, c'était notre carré de zinc-matricule suspendu au cou. Les prêtres allaient être employés aux mêmes
travaux que tous les forçats ; on ne les reconnaîtrait d'ailleurs à aucun signe. Nous voici prêts. Nous n'avons plus qu'à
attendre notre destin. Nous portons des galoches dont le dessus
est de toile. Certaines sont rapiécées déjà ou raccommodées avec des bouts de
ficelle. Et nous voici sur la route, gagnant à marches
forcées quelque but qu'on a bien soin de ne pas nous dire. Nous marchons par rangs de cinq, et bientôt
les pieds qui ne peuvent se plier nous font mal sur ce chemin mal pavé. Sommes-nous trois cents ? cinq cents ? Tous ceux du pays ont pu rester ensemble et
c'est un soulagement. Nous n'avons pas mangé avant de partir.
Il est midi passé. Rien dans les poches. Sous les pommiers bas qui longent la route
gisent dans l'herbe rase quelques fruits. Les plus hardis se baissent. Un coup
de matraque ou de crosse et l'ordre de rejeter à terre ce qu'ils ont ramassé. Enfin, après plusieurs heures de marche épuisante,
nous voici débouchant sur l'Elbe. Un petit débarcadère. Un vieux bateau qui
nous prend sur son pont où nous devrons rester debout sans bouger. Jusqu'où ? Ne jamais poser de questions. C'est le crépuscule quand on nous fait débarquer
à Hambourg. Aurons-nous quelque chose à nous mettre sous
la dent ? Certainement ! disent les optimistes. Tout est prêt pour recevoir
tant d'hommes ! Rien, rien, rien n'était prêt. Ni la table,
ni la couchette. Un colosse à torse nu ; matraque en main,
nous reçut dans un des immenses greniers des entrepôts d'Hambourg. On voyait traîner des paillasses, il y avait
quelques rangées de lits-cages et d'autres bois de lits qui se chevauchaient dans
les coins. Un doigt de poussière sur toutes choses. Nous voulions manger. Le colosse Paul,
chef de bloc, répondit : Celui qui n'a pas de lit ce soir couchera tous les jours
sur le sol. Il fallut garnir les cages de planches, chercher
des sacs à paille, les remplir, défendre son bien contre les Russes et les
Polonais, chercher à faire groupe. Tout nous réussit assez. Et quand la nuit tomba, nous pûmes mordre
dans du pain et même du saucisson. Mais, et c'était bien allemand, on nous avait
dit que nous pouvions consommer tout. Le lendemain matin, on nous donnerait une
nouvelle ration. Le lendemain, ceinture jusqu'au soir. C'était
un dimanche. On nous dispensa du travail. Par exception. Nous fîmes connaissance dans le grenier-bloc
de ces ersatz d'S.S. à ration double et triple de soupe et de pain : les «
capos ». L'un d'eux circulait parmi nous, nous commandait
déjà, se disait très juste et très bon. Un « capo » était une sorte de contremaître,
de surveillant. Certains étaient des brutes consommés, tous Allemands, cela va
sans dire. Ils étaient mis à notre tête par les S.S. qui jugeaient qu'entre eux
et nous on ne pouvait placer mieux que des prisonniers de droit commun, criminels,
parricides, pédérastes, bandits. C'est au travail que nous allions
surtout subir leur hargne et leur comportement de dégénérés. Et il faut se
refuser à parler de leurs habitudes morales, des faveurs ou châtiments dont
furent l'objet auprès d'eux les jeunes Russes de seize et dix-sept ans. Le lendemain, départ en commando de travail.
Si nous eûmes la chance de rester en groupe pour ce travail de déblayement de
magasins du port bombardés, ce furent cependant des semaines bien dures qui
rongèrent peu à peu nos belles forces. Longue marche le matin pour aller au chantier
; autant le soir pour rentrer. Rien à manger à midi. Des semaines et des semaines, nous n'avons
rien vu d'autre que des bouts de murailles poisseuses de fumée, de suints, de
brume... Des heures et des heures tous les jours nous
n'avons reniflé que des odeurs insidieuses de phosphore mouillé, de soies pourries,
de produits alimentaires carbonisés, de rouille, de cendre et de vert de gris.
Le travail était forcé, harcelant. Défense de redresser l'échine ou de poser la
lourde brouette. Défense de bavarder. Les matraques étaient toujours levées. Un
grand chef S.S. était venu hurler au bloc : « Travailler ou mourir ! » L'Elbe passait non loin, mais nous l'avons
vu rarement refléter le soleil. Malgré cela faisant la chaîne de
ferrailles ou de briques, il nous arrivait de chanter comme fauvette au vent.
Et je pense au cher avocat Laroche que je ne pourrai jamais oublier, au jovial Sittinger qui jurait d'être à la kermesse dans ma paroisse
en novembre. A l'aller et au retour sous la rosée, le
brouillard ou la pluie battante, nous nous arrangions pour nous grouper et dire
le rosaire. Ainsi si nous étions traités comme des bêtes,
à ces moments-là nous nous sentions enfants de Dieu. Le partage du pain et du soupçon de margarine
soulevait des inquiétudes et suscitait des incidents. Si cela semble puéril, il
faut s'imaginer notre mentalité d'homme à ventre creux. Quand on nous disait : Ce soir boule à cinq
et non à quatre, c'était une catastrophe. Notre ordinaire se composait en général d'une
soupe et d'une tranche de pain de six à huit cm. d'épaisseur avec un menu
morceau de margarine qui s'éclipsait d'ailleurs parfois. De temps en temps, une petite cuillerée de
confiture de betteraves s'y ajoutait et nous réjouissait. C'était tout pour les vingt-quatre heures.
Nos bourreaux savaient bien que peu à peu le moral le plus solide peut fléchir
à cause de la détresse physique, de la dégradation corporelle. Nous voilà donc désormais bien claustrés
dans une vie horriblement vide. Tous nos goûts, tous nos besoins, tout cela est
balayé. Nous allions souffrir beaucoup plus encore.
Et pourtant, Camps d'horreur, oui, mais aussi montagnes d'expiation où pouvait
se renouveler la jeunesse de quelques hommes sincères qui retrouvèrent leur âme
ailée. VI UNE SOUPE DE PLUS, MAIS : LA BOUE, LES COUPS, LES MALADIES. Nous faisions donc à six heures du matin,
le ventre creux (on gardait son crouton pour midi) une longue marche ;
le soir, le ventre à nouveau dégarni, la même trotte, une dizaine de
kilomètres. Rien d'étonnant si peu à peu les
premiers bobos nous tombent dessus, jambes enflées, pieds blessés qui ne guérissent
pas, abcès, érésipèles. Plusieurs retirent, au retour du
travail, leurs godasses ficelées et regagnent pieds nus les blocs. Vous aviez des plaies aux jambes ou sur
les chevilles ou même sous les pieds, vous restiez bon pour le travail. On vous
enduisait le mal d'une pâte noire, on l'enveloppait de papier et en avant. Au chantier
on tonitruait si vous ne travailliez pas : On n'a pas besoin d'infirmes ici
! Allez au Revier (infirmerie) ! Au Revier on vous mettait à la porte. Et voici qu'on parla de changement. Les
divers commandos de travail seraient supprimés ; on travaillerait par blocs
entiers à de grands travaux de fortification. On aurait une soupe à midi ! Evènement ! Etant plus nombreux au travail on serait
surveillé de moins près. On gagnerait les chantiers par train et
on reviendrait avec le même luxe. Le premier jour, jour d'inauguration des
nouveaux travaux, fut pour nous épouvantable. Tout le bloc en effet fut parqué dans des
wagons de chemin de fer, mais ces wagons, il fallut les attendre sous une pluie
battante diluvienne, pendant plus de deux heures. Défense de se réfugier quelque part : Nos
défroques zébrées nous collaient aux os. Nous nous serrions les uns contre les
autres sur le quai, à dix, vingt, rentrant les têtes; pour ne recevoir les
flots du ciel que sur l'échine. Mais dans nos souliers coulait la boue. Allions-nous rester trempés de la sorte jusqu'au
soir ? Vers deux heures de l'après-midi, sur les chantiers nouveaux en pleine
campagne, le soleil commença à faire monter une mince fumée de nos pauvres
guenilles. La soupe de midi qui nous eût réchauffé un peu à l'intérieur ne vint que le soir avant le
retour vers Hambourg. Pataugeant toute la journée dans une immense
prairie que longeait un canal, nous devisions sur ce qu'on allait nous donner
là comme travail. Les stratèges les plus avisés ne trouvaient pas grand-chose. En rentrant dans notre turne le soir, nous
gémissions : « Jour néfaste ». Un point clair à l'horizon pourtant. La soupe avalée
au bout de la journée triste avait été de petits pois, épaisse et chaude. Quel
miracle ! Et on nous avait fait de belles promesses pour les jours suivants. Dès le lendemain nous connûmes que la
soupe payait mal le travail qu'on exigeait de nous. C'était à Hausbruck,
près de Hambourg. Le canal était à élargir, à approfondir pour former une ligne
anti-char. Les boues, vases, limons, algues étaient
à rejeter avec nos pelles toujours plus loin par travail en chaînes. Par
endroits, les couches étaient moins puantes et moins gluantes, mais que de
journées où dès les neuf heures, nous n'avions plus aux pieds que des bouts de souliers
retirés des bourbiers. La soupe était bien payée. Outre les capos
aux matraques plus sifflantes que jamais, on avait-mis à la tête des groupes de
forçats, de vieux civils dont la plupart, bien instruits sur notre compte, nous
houspillaient : Plus vite ! Plus vite ! Que vos pelles soient brûlantes ! Les
capos, eux, grognaient, sacraient, hurlaient. Le travail devait être achevé en
huit jours ! Ils étaient partout à la fois et quelques crapauds à leur service
nous rabrouaient aussi quand nous nous redressions. Cela paraissait cette fois le fin du fin, du sortilège nazi, abuser des pires détresses, des
crevards que nous étions. A midi les capos et leurs amis «
écrémaient le potage» pour les sentinelles d'abord, pour les porteurs de
chaudrons ensuite. La soupe aux pois devint une soupe aux
choux ou aux rutabagas claire et le resta. Les travaux étant achevés à Hausbruck, nous fûmes chargés de creuser des tranchées antichars
dans les campagnes au loin autour de Hambourg. C'est pendant une des dures journées dans
la glaise que la ville de Hambourg fut l'objet d'un sérieux bombardement. Une bombe, hélas, atteignit nos blocs, quartier
infirmerie, enfouissant sous les décombres beaucoup de nos compagnons. Quant à nous, une marche forcée de trente
kilomètres, à la vue des incendies qui illuminaient l'horizon d'Hambourg, nous
conduisit à la grande prison d'Ohlsdorf où désormais
serait notre gîte. Ceux qui nous ont vus dans les premiers jours
de notre retour, cadavres ambulants, ont touché des réalités qui jusque là
dépassaient leur cœur : notre longue faim, notre longue fatigue, notre longue
misère. Quant aux premiers d'entre nous qui sont
morts en terre ennemie, comme tous les autres trop nombreux que la détresse a
couchés là, ils méritent pour prix de leur ultime sacrifice l'épitaphe : « Mort
pour la patrie ». VII LES BLOKAELTESTE, LES CAPOS, LES
VORARBEITER, ET MEME PARFOIS LES « INTERPRETES » N'ETAIENT QU'ERSATZ S.S. Tous n'étaient pas des tortionnaires au
service des S.S. Certains ont pu profiter de leur situation d'intermédiaires entre
les S.S. et les forçats, de « premiers travailleurs » ou d'interprètes, pour
nous faire du bien. Mais il en est dont il faut stigmatiser la
lâcheté, l'hypocrisie et même la cruauté. Tout le commandement des camps incombait
aux « capos » ou chefs d'équipe, tous condamnés allemands de droit commun. A
leur « tête », le premier capo ou Blokaeltester. Tous
portaient un brassard. Sur les chantiers ils se faisaient aider
par les « premiers travailleurs » ou « Vororbeiter »
choisis parmi nous. Ceux-ci ne portaient pas la matraque mais certains Russes
remplissaient ces fonctions un gros gourdin à la main. Tous ces gardes-chiourmes recevaient les
rapports des mouchards, discutaient les rations, et n'avaient jamais faim. Et ils
étaient bien vêtus. Les « interprètes » cumulaient parfois leur
fonction et celle de Vorarbeiter. Alors ils savaient
prendre un visage glacial quand approchaient les capos, et savaient s'entendre
avec eux comme avec des parents de provinces. Misère ! On a vu des Vorarbeiter
qui n'étaient que des gamins frapper des détenus cassés par l'âge. Beaucoup nous harcelaient sans cesse, surtout
pendant les travaux de terrassement si épuisants pour nos échines, pendant dix
heures par jour. Ils avaient constamment à la bouche les
insultes basses et ordurières qu'on ne trouve que sur les lèvres allemandes. Le travail fourni par nos bras amaigris fut
énorme, mais le sabotage ne fit pas défaut, poutres glissant dans les ravins,
terres remuées poussées à droite puis ramenées à gauche, abandon de travail
pour diarrhées imaginaires, fuite du chantier en cas de pluie malgré les clameurs
des capos. A midi, arrêt pour avaler une pauvre soupe
puis reprise immédiate du travail ; ceux qui étaient les plus pressés de manger
devaient reprendre le pic ou la pelle les premiers. Beaucoup d'entre nous refusaient en général
de manier le pic, prétextant quelque fracture du poignet ou du bras. On en
était souvent quitte avec une gifle ou un coup de caoutchouc. Et aussi souvent que possible, on nous voyait
appuyés sur la pelle et rêver. Parfois on rêvait trop loin, on ressaisissait son
outil pour ne plus penser. Ou pour ne pas se refroidir les membres. Parfois
aussi, on s'oubliait à se réchauffer à coups de pelle et on se rappelait à
l'ordre : Pour qui travailles-tu ? Dans le train aux carreaux cassés, aux
roues certainement carrées nous nous assoupissions l'un contre l'autre, engourdis
et gelés. A la prison, depuis la cour jusqu'à la porte
des cellules en passant par les escaliers, il fallait se débattre pour rester avec
des copains et ne pas aller dormir avec des étrangers. Puis nous « touchions » notre soupe du soir,
décoction de feuilles de choux ou de rutabagas, quelques fois, ô miracle, une soupe
à l'orge où la cuiller tenait presque debout ! Longtemps on dut manger dans, le noir et
se coucher sans lumière. Lorsqu'au lieu de soupe on nous servait des patates en
robe des champs, il fallait les avaler telles. Pour le morceau de pain qui accompagnait
la soupe, et qu'il eût fallu garder pour le lendemain, souvent il était
sacrifié tout de suite, avec sa lamelle de margarine ou le dé de pâté que nous
appelions pâté de chien. Et tous les jours que Pieu fit, sous la pluie,
sous la neige, en plein vent, nous creusions et rejetions la terre allemande. Puis, toutes les tranchées finies et
Hambourg sûr de ses défenses, on reprit le travail en commandos. Par groupes de
50 ; de 100 dans les usines bombardées, récupération des ferrailles, bouchage des
trous de bombes, etc. Un matin, serré dans les rangs avec deux
compagnons, je m'écroulai à leurs pieds. Vertige. Point de côté. On me transporta
à l'infirmerie non sans m'enlever de la poche mon pain, et de mon dos ma
capote, de mes pieds mes godasses. C'était la loi. Cela devait commencer par un premier accès
de dysenterie avec vertige et finir par une pneumonie. Les premiers jours je restai assez
valide et fus réquisitionné pour transporter les morts. Il fallait les faire
aboutir dans des cellules de l'entresol qui servaient de morgues. Dans chacune de ces chambres, des
cadavres faméliques, empuantis. Nous les portions pieds nus, marchant dans des
1iquides brunâtres ou noirs et regardions les S.S. chercher les dentures d'or. Les corps décharnés que nous devions jeter
les uns sur les autres prenaient des attitudes hallucinantes, des gestes
atroces. Certains semblaient regarder venir les nouveaux macchabées, de leurs
yeux de glace. Tous les jours dans les couloirs, un, deux,
cinq, six cadavres, nus comme des vers. Certains devaient peser à peine trente
kilos. Tous les soirs, à la rentrée du travail,
deux scènes déchirantes que j'entendais de ma cellule. De nouveaux malades
refusés à l'hospitalisation. Des séances de matraque ; ceux qui avaient été
signalés pour indiscipline ou vols réels ou non, recevaient en public 10, 20 ou
50 coups. Une nuit, les couloirs de l'infirmerie retentirent
de cris poignants, de plaintes longues, désordonnées, puis de hurlements
saccadés, déchirants ; un malade, jeune Lyonnais perdait l'esprit, nommait cent
fois son ami, demandait grâce au capo, se déchirait la gorge à jeter ses
exclamations de peur dans la nuit. J'entendis les soldats l'emmener enfin en
criant plus fort que lui. Un matin, faisant un peu de toilette, je
regardai mes bras, mes jambes. Il n'y en avait plus. J'avais fait une pneumonie
dont je sortais comme par miracle. Mes camarades n'étaient pas moins dégarnis.
Les genoux, les coudes faisaient des protubérances sur les bâtons des bras et
des jambes. Les côtes, les clavicules semblaient prêtes à faire éclater la peau
jaunie. Mais sur nos poitrines osseuses, nous avons
pu cacher parfois avec amour des saintes hosties consacrées pour les mourants. Les prêtres devaient, pour distribuer le
dépôt sacré, user de moyens difficiles et dangereux comme ceux employés aux époques
des persécutions et des catacombes. Je fus chassé de l'infirmerie par le capo-chef
de l'infirmerie, Willy, un tzigane à la peau bistre, aux yeux et cheveux noirs
comme une nuit de crime. Il m'accusait d'avoir été voir les
malades pour les confesser. Il vint m'arracher un matin à la cellule : Au
travail ! Il me bouscula jusque dans les corridors. J'allais de traviole, un
abcès non guéri au bas de la colonne vertébrale et butant aux marches que je
devais gravir pour aller me chausser de godasses trouées. Je continuai les jours suivants à
visiter les malades au retour du travail, surtout lorsque par l'intermédiaire
du zélé docteur breton Loyac je pus obtenir des Saintes
Espèces. Mais le chef de la prison devait tout apprendre.
Il me fit comparaître devant un tribunal ou plutôt un guignol. Au milieu, le « président » tient un long
papelard en mains et m’attend. Willy le tzigane est là ; autour du cou son
fichu à pois blancs. Il s’approche de moi. « Il faut tout avouer ! Voyou ! » – A quel sujet ? Ruhig ! crie
le président. Il y eut une sorte de jugement sommaire.
Des hurlements incompréhensibles du président, un S.S. authentique au regard
dur derrière des lunettes à demi-verres comme des serpettes. J'entends que je suis condamné à la pendaison. Willy m'arrache à mon siège et à mon hébétude
et me pousse en avant. Comme je ne sors pas assez vite, deux soldats me
bourrent les côtes et le genou du tzigane me cogne violemment le bas du dos. Si j'avais été pendu, je connaîtrais la lumière
sublime qui fait le rayonnement du martyre. Dieu ne l'a pas permis. VIII SUR LE FUMIER DE JOB. Un jour le bruit courut que nous allions
quitter la grande prison pour regagner une autre aile des blocs de Hambourg qui
nous .avaient d'abord abrités. La nouvelle n'était pas pour nous
réjouir. Nous allions devoir gagner de nouveau à pied notre travail. Nous
allions connaître aussi de nouveau les descentes à la cave au moment des
alertes. Nouvelle néfaste qui se confirma
rapidement. Peu de jours après, nous étions de nouveau tassés à trois cents
dans un grenier du troisième, sans air ni lumière. Et bientôt ce fut la multiplication des maladies. Nous souffrions du froid le jour et la nuit.
D'autant plus que nous avions faim. Vers la fin de la nuit cette impression de
froid semblait émaner de l'intérieur du corps et se répandre jusqu'aux extrémités. La soupe du soir ne réchauffait pas nos
membres engourdis. D'abord elle était servie trop tard et rarement bien chaude.
De plus elle ne contenait pas assez de matières grasses. Nous faisions la file pour la « toucher ».
Si le serveur qui regardait son client chaque fois, se contentait de prendre le
dessus de la cuvelle, on était sûr de n'avoir que l'eau. Si la louche allait au
fond, on pouvait espérer recevoir du solide. La vie dans les blocs devenait épuisante
et quelques-uns se laissaient aller au découragement. Leurs plaintes s'exhalaient surtout au
retour du travail. Nous étions aux mois des pluies. A Hambourg
il pleut d'ailleurs sans cesse. On dit dans la ville qu’on reconnait un citoyen
d'Hambourg en ce qu'il porte toujours un parapluie. Nous rentrions donc deux jours sur trois
trempés de pluie, les pieds nageant dans les loques infectes qui garnissaient nos
souliers crevés, retenus aux chevilles par des bouts de fil de fer. Impossible de sécher ses habits, ses souliers,
ses « chaussettes russes ». Pour celles-ci, on essayait d'en pomper l'humidité en
les étalant entre son corps et la paillasse durant la nuit. Le matin il fallait tout remettre sur le
dos et aux pieds. Les habits de rechange étaient
inexistants. Nous avons porté tous la même chemise, le même pantalon rayé et la
même veste mince et le même manteau rayé, le tout de coutil, d'octobre à décembre,
certains d'octobre à février. Ce n'étaient que hardes puantes aux bords
en lambeaux pendants. Impossible aussi de faire sa toilette. Nous
montrions à ce moment des faces et des mains d'hommes de cavernes. Les civils
qui nous voyaient passer avaient peur de nous. Et puis ce fut la vermine. Les poux, par
centaines, par légions, par générations. Et les appels et les alertes ! Deux de nos
gros cauchemars. Dès le retour du travail, avant la
soupe, alors que nous étions las et affamés, on nous rassemblait. Nous
demeurions debout une heure, parfois plus. Sur cinq files. C'était la norme. On partait
au travail et on en revenait sur rangées de cinq. Les « capos » nous comptaient d'abord, se
trompaient, recommençaient, ne tombaient pas d'accord entre eux. Puis le chef du bloc, minutieusement, dénombrait
son bétail dans un silence impressionnant. De temps à autre, cela va sans dire, un grognement,
une insulte lourde, un coup de matraque. Enfin, un des chefs S.S. arrivait,
flegmatique, un sourire cynique sur les lèvres serrées. On lui donnait la liste
des présents et des malades et il nous passait en revue, cherchant à distribuer
lui aussi, ses paires de gifles ou ses coups de matraque. Manquait-il un homme ou l'accord ne se
faisait-il pas sur les effectifs, l'appel durait, durait, la soupe attendait. Nous tremblions d'entendre sonner l'alerte
aérienne, ce qui faisait sauter notre soupe pour une heure ou deux de plus. Les alertes, les descentes à la cave, second
et terrible cauchemar. Il fallait gagner les souterrains, des centaines d'hommes,
par un escalier étroit, obscur, incommode. De chaque côté un capo armé du caoutchouc.
Aucun de ceux qui descendaient ne pouvait se venter de n'avoir pas reçu un coup
sur l'épaule, le dos, ou la tête. En bas, dans la cave humide et noire, on
se bousculait, on écrasait les malades qui avaient commis l'imprudence de se coucher.
Et le lendemain on pouvait souvent retirer un ou plusieurs cadavres. Un matin je dus demander
l'hospitalisation à l'infirmerie pour œdème aux jambes et abcès. En entrant, on passait devant une rangée
de cadavres nus. Tous les jours cinq à six morts. Si on ne réagissait pas
bientôt, le nombre en allait augmenter de plus en plus. N'était-ce pas là ce qu'on désirait dans
les centres nazis où se réglaient nos destins ? N'étions-nous pas des hommes
condamnés ? Et voici que, l'infirmerie s'engorgeant de
plus en plus, on décida de nous conduire à Neuengamme. Nous y fûmes enfin épouillés et passés à
la douche. Et nous reçûmes un accoutrement ridicule qui devait être un pyjama. Là aussi, si le nombre des malades évacués
augmentait chaque jour, celui des nouveaux arrivés croissait davantage. On
parla de nous coucher à trois sur une paillasse. Un
soir, un afflux considérable de nouveaux vint tout bousculer. Les salles durent
les digérer comme elles pouvaient. Après trois triages qui me conduisirent
chaque fois nu dans un autre local, j'aboutis au « Blok Schonung
». J'y trouvai R. Sindic,
R. Biren, Sosset, Marchal,
l'abbé Origer, L. Sittinger,
H. Bosseler et P. Bestgen, tous d'Arlon. On me jeta dans la salle des grands malades
aux jambes dévorées d'ulcères et des « chiasseux » c'est-à-dire ceux qui avaient
ce mal qui a tué tant de mes compagnons. Me voici, pensai-je, sur le fumier de Job
; cela sentait à plein nez la gangrène, la diarrhée. Il y avait des excréments partout, par
plaques, par mares, par flots. La nuit, on marchait dedans avec ses pieds nus. Le
matin il fallait nettoyer à la pelle les couloirs entre les lits en étages.
Tous les cadavres qu'on emportait le matin en étaient remplis. La souffrance, le dégoût, la misère ont
rappelé à beaucoup de forçats leurs préoccupations les plus secrètes, les plus profondes.
Celles qu'ils repoussaient naguère. Elle leur a changé la valeur des grands mots
humains. La « mort » mot vague et lointain a été changée en un autre « je meurs
». Des milliers d'hommes ont murmuré là-bas
ce verbe au présent. IX LA DERNIERE ETAPE. On évacue Neuengamme. Telle fut la rumeur
sensationnelle qui emplit les salles un jour. Alors des milliers de malades durent se
mettre en route, les uns pour un but inconnu, les autres pour leur mort. On nous fit marcher jusqu'à la gare, nous
gratifiant d'une paire de sandales de bois et d'une couverture. Le transport mit de longues heures à se
préparer. Des rames immenses de wagons à bestiaux, les uns garnis de paille, les
autres vides. Ce transport fut l’une des trouvailles les
plus abominables des derniers S.S. de Neuengamme. Ils savaient que sur cent hommes
qu'ils entassaient dans chaque wagon, cinquante à peine arriveraient vivants. Le voyage dura six jours et sept nuits. Pendant
ce temps nous ne devions respirer l'air pur qu'une fois tous les deux jours, ne
recevoir que deux fois un peu de pain et deux fois une gorgée d'eau. Les arrêts se faisaient en pleine
campagne et le train se dirigea d'abord vers le sud. Sinistre pays où je vis par la lucarne un
peu de neige encore accrochée à des carrefours de montagnes. Des forêts de pins
entretenaient dans notre wagon un constant crépuscule. La montagne et la forêt
paraissaient vouloir nous engloutir. Puis nous redescendîmes vers le nord-ouest
pour revenir enfin vers l'est. Les soldats qui nous gardaient se relayaient
tous les jours, ne nous parlaient pas, répondaient à nos questions qu'ils ignoraient
tout, mangeaient devant nous avec bruit pain, saucissons et fruits. Chaque nuit c'étaient des scènes atroces,
ignobles. Tous ces malheureux voulaient une place assise et c'était impossible.
On se battait dans le noir, on s'écrasait. Les invalides étaient littéralement piétinés.
Ni les hurlements atroces, ni les appels au secours n'émouvaient les soldats ;
ils ne craquaient même pas une allumette pour voir ce qui se passait. Tous les matins on sortait les morts bleuis
aux grimaces atroces et on les jetait nus dans la forêt. L'incertitude est dans des circonstances
aussi horribles une grande souffrance ; nous ne savions pas la longueur de notre
affreux tunnel. Le moral demeurait malgré tout assez bon
chez tous, même si de certaines lèvres tombaient vers moi parfois des paroles plaintives
: Ah ! monsieur le Curé, qu'est-ce que nous avons fait
à Dieu ? On nous fit descendre enfin quelque part
entre Hanovre, Brême et Hambourg. Nous ne pouvions deviner que nous étions si
près de la libération. Toute la troupe épuisée, affamée,
titubante s'étendit d'abord sur l'herbe entre les quais de la petite gare. Alors un aumônier militaire occupé dans
une ferme voisine nous dit des choses à nous gonfler le cœur : –
Les Alliés approchent. On va vous installer dans des baraquements tout proches
d'un camp de prisonniers belges et français. Ceux-là vont s'occuper de vous.
Confiance ! Votre calvaire s’achève ! Tout cela était vrai. Nous devions connaître encore deux ou
trois jours pénibles, avant l'organisation du ravitaillement, les Allemands nous
ayant abandonnés et les prisonniers militaires ne pouvant encore sortir de leur
camp. Puis ce fut la nuit de la « révolution ».
Vengeances exercées contre d'anciens capos ou vorarbeiters.
Invasion des cuisines par une troupe de détenus qui prenaient la fuite. Le matin, des cadavres. Des capos
enfermés, leurs brassards à terre devant les portes. Un capo étendu dans la
cour, la boîte crânienne décollée des yeux à l'occiput. Nous étions, hélas, pour la plupart, couchés
dans notre fièvre quand on cria dehors : Voilà les Anglais ! Les drapeaux alliés
flottent dans le camp ! Le clairon français retentit. Ceux qui pouvaient
se traîner dehors les virent arriver fleuris de pensées et de jonquilles du
béret aux genoux. Le printemps entrait avec la libération sur
le plateau de Sand-Bostel. Ce fut alors la bonne nourriture, les habits
propres, la Sainte Messe dans le camp, les hôpitaux et maisons de repos pour
les malades. Hélas, le typhus exanthématique fit beaucoup de victimes encore. Grand Reich, pays à la face hostile que je
me refusai à regarder une dernière fois tandis que l'avion quadrimoteur nous
faisait glisser en plein ciel bleu de mai vers la Patrie ! X ET MAINTENANT, CURE, PARDON OU
VENGEANCE ? On me demande : Et l'Evangile ? Faut-il pardonner
? Le Christ l'a fait sous les coups, sur la croix. Voici ce que répond à ma place Mgr. Piguet, de Clermont-Ferrand, rescapé de Dachau : « Nous ne conservons dans notre cœur aucune
disposition contraire à la charité du Christ et nous pardonnons comme nous
avons pardonné dès le premier jour à ceux qui nous ont offensés. « Mais la vérité, toute la lumière de l'Evangile
nous fait un devoir de dénoncer
les erreurs, les mensonges et les abominations qui furent à la fois la doctrine
et la pratique du nazisme. » Une chose a frappé douloureusement tous
ceux qui ont souffert en Allemagne : les femmes et les enfants avaient souvent
l'air féroce et hargneux de toute la clique nazie. Ce pays devrait être considéré comme un
pays de missions. Victimes de la haine, nous ne pouvons imaginer
construire rien sur la haine. Le dieu de la vengeance n'est pas notre dieu. « Mais si j'ai accepté de joindre ici mon
témoignage à celui de tant de compagnons, c'est pour faire triompher la justice
si manifestement outragée. » Ainsi parle
encore Mgr. Piguet. Ne rendons pas les coups mais la
justice. Et n'oublions pas nos morts. « Je suis fier
de mes amis ; ils sont tous morts » s'écriait Aragon. Soyons fiers d'eux. J'ai vu leur cran moral tenir jusqu'au bout,
à part l'un ou l'autre qui avait le cafard dans le sang. Les yeux que j'ai baissés vers ceux de mes
amis morts avec qui j’ai tant travaillé, tant souffert, tant prié, tant espéré,
je les ai relevés pleins de fierté. Et puis, n'avions-nous rien à expier, à liquider
? Notre dur carême, notre interminable passion,
qui percera ce mystère ? Ne fallait-il pas que l'on souffrît tout
cela pour la gloire de Dieu et l'équilibre du monde ? |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©