 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
La Maison du Souvenir remercie Monsieur Francis Rouard,
fils de l’auteur, de nous avoir permis de vous présenter cet émouvant
témoignage sur notre site. DANS LE GHETTO DES BARBELÉS 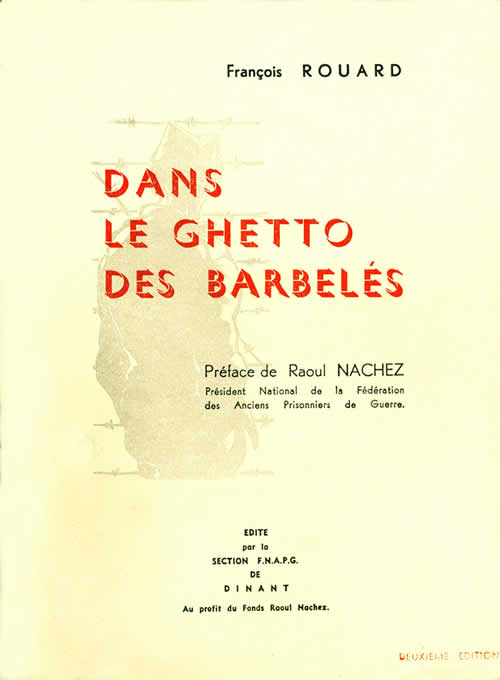
PREFACE Qui pense encore, aujourd'hui, parmi
les hommes qui vont et qui luttent chaque jour, dans un monde plutôt égoïste, à
l'épreuve que connurent deux cent mille belges, soldats de 1940 ? L'oubli du sacrifice, qu'ils offraient
derrière les barbelés, en soldats devenus otages de la Nation, ne devait pas
tarder à prendre l'aspect d'une injustice coupable. Et cependant, ces hommes avaient laissé
derrière eux leurs enfants, leur foyer, leur famille, leur Patrie. Ils allaient payer, par centaines de
leur vie, par milliers de leur santé, les autres de leurs souffrances physiques
et morales, le prix des erreurs et des fautes dont ils ne pouvaient être rendus
responsables. Retranchés de la communauté nationale,
ils devaient, repliés sur eux-mêmes, vivre la plus belle fraternité avec toutes
ses exigences, goûter à l'amitié sincère et durable avec toutes ses richesses, connaître
le vrai sens de la Patrie avec toutes ses certitudes. Jugeant, non sans raison, que le
souvenir de ces heures amères de l'exil ne pouvait être suspecté, discuté et ne
devait pas périr dans l'indifférence de notre époque ingrate, F. Rouard a voulu apporter par sa plume alerte, son tribut à
la cause du P. G. et à son action sociale. Son ouvrage clair et bien écrit, je n'ai
pu le lire sans une certaine émotion. Je fais des vœux pour que le lecteur
s'arrête et tire la leçon qui s'impose. Raoul NACHEZ. NOTICE «
DANS LE GHETTO DES BARBELES » n'est pas d'aujourd'hui. Ses chapitres ont paru,
sous le titre « L'OBSCUR P. G. » dans le bulletin « LOIN DES MIRADORES » de la
section F.N.A.P.G. dinantaise, dès le mois de mai
1946.
Cette relation de la vie du prisonnier de guerre, en captivité, avait un
but.
Dès sa rentrée au foyer, le prisonnier de guerre fut profondément
affecté par l'indifférence que, manifestement, lui vouait une notable partie du
public. Depuis longtemps déjà, il était averti. N'avait-il pas lu, en 1941 : «
La rentrée d'un prisonnier de guerre ne suscite plus aucun intérêt ». Et cependant,
à l'époque, il se serait mal jugé s'il avait ajouté foi à la prose d'un journal
emboché. Le
prisonnier de guerre ne comprenait pas non plus l'apathie des Pouvoirs publics
à son égard. De même, il ne pouvait accepter les articles injurieux, voire les
menaces de certaine presse politique.
Il fut surtout frappé par l'égoïsme qui régnait sur le pays et dont
l'âpreté au gain était à la base, car le marché noir subsistait dans toute son
ampleur.
Et encore, on disait au P. G. : « Nous n'étions pas mieux que vous et
nous vivions avec l'appréhension d'aller vous rejoindre, un jour ». On ne faisait
donc pas la distinction entre le fait de se trouver en Bochie
et la crainte d'y être emmené.
Un esprit faussé et trop répandu rejetait dans l' ombre, le prisonnier
de guerre.
Désemparé tout d'abord et absorbé qu'il était par sa réadaptation à la
vie normale, le prisonnier observait un mutisme bien compréhensible. Mais, après
un temps, la réaction s'opéra. On la connaît.
C'est alors que, dans la sphère régionale de la section, j'entrepris de
décrire ce que furent les souffrances physiques et morales ou, plus exactement,
la vie du prisonnier de guerre, afin que le public ne persévère pas à croire
que la position du P. G. en captivité, était celle, du touriste en
villégiature.
Et si, aujourd'hui, je rassemble les chapitres de L'OBSCUR, P. G. en cet
ouvrage, c'est avec l'intime conviction que sa diffusion apportera un peu de
bien-être à mes malheureux camarades qui subissent un second exil au sana Belgica de Montana et à Ste-Ode et contribuera à leur
guérison.
Toutefois, je me crois obligé de réclamer l'indulgence du lecteur, car
je ne me reconnais aucun talent d'écrivain ; ce n'est pas mon métier. Mais
l'assurance lui est donnée qu'il peut accorder à ce récit tout le bénéfice de la
sincérité. Mes compagnons de captivité en sont les témoins. F. R. I DERNIERES HEURES DE LIBERTE.
Ce matin du 28 mai 1940, l'annonce de la capitulation de l'armée belge
nous laisse abasourdis, Dans ce coin de Flandre Occidentale où les soldats alliés
se trouvent mélangés à des dizaines de milliers de réfugiés, les bombes
allemandes ne cessent de faire des ravages et des victimes. Le soldat belge, cependant
animé d'un courage remarquable, est impuissant devant le harcèlement continuel
de l'aviation ennemie et ne possède pas les armes nécessaires pour riposter
efficacement à une armée trop supérieure en nombre et en engins des plus
modernes ; nos alliés eux-mêmes n'ont pu empêcher notre encerclement.
Au-dessus de nos têtes, les combats d'avions se multiplient : Dernier et
Messerschmitt contre Hurricane et Spitfire. Ça et là, un avion s'écrase au sol,
d'autres s'engloutissent dans la mer. Dans le ciel, des parachutes balancent
très haut quelques échappés a la mort ; des colonnes de fumée montent un peu
partout. A quelques pas de nous, deux maisons craquent dans les flammes.
Nous sommes environnés de dangers et la capitulation portée à notre
connaissance dans un moment aussi précaire, ne sera commentée qu'en phrases très
brèves. Et d'ailleurs, à quoi bon, nos yeux humides sont assez éloquents pour
exprimer le sentiment pénible qui nous étreint et extérioriser le regret d'une
défaite qui, disons-le, ne nous incombe pas.
La veille, dans la soirée, de la digue de Westende
où nous étions cantonnés, nous avons pu voir passer au large, une douzaine de
navires prenant la direction de l'Angleterre. Ce sont, nous a t’on assuré, des
transports de jeunes gens que l'on conduit en lieu sûr. Nous avons accepté ce bobard,
comme tant d'autres. Aujourd'hui, la vérité se fait jour, il s'agissait du
retrait des troupes anglaises.
Hier encore, des tracts lancés par les avions ennemis nous annonçaient
que « notre roi félon nous avait abandonnés, qu’il était inutile de poursuivre une
lutte inégale » et le conseil nous était donné de déposer les armes. Ce texte
insultant n'avait pas eu l'effet escompté, son influence démoralisatrice était
nulle. Nous gardions confiance !
Aujourd'hui, la proclamation du Roi nous ouvre les yeux sur cette basse
manœuvre de l'ennemi. Mais, tout est fini... !
Dès l'accalmie des combats aériens, nous procédons à la
destruction des armes et du matériel, avec cette frénésie fiévreuse de ne
vouloir laisser aux boches le moindre butin. Et la mer engloutit toute cette
pâture qui a coûté au pays tant de travail, de fatigue et d'argent. Avec elle,
disparaissent aussi toutes nos folles illusions et nos mâles énergies.
Oui, tout est fini !...
Ce sera ensuite le départ vers l'intérieur du pays, suivant les ordres
de nos chefs.
Nous nous dirigeons vers Bruges dans un encombrement indescriptible de
véhicules de toutes sortes. Les piétons, soldats et civils, forment une colonne
interminable ; la fatigue se lit sur tous les visages et tous ont la même anxiété devant
cette inconnue que sera l'occupation ennemie. Les plus vieux se rappellent les
mauvais souvenirs de l'autre guerre, sous la botte allemande.
A quelques kilomètres de Bruges, nous croisons un motocycliste allemand
qui se meut, avec calme, dans la cohue. On se retourne, on le suit des yeux, des
larmes nous échappent. Encore eux !
Mais non, tout n'est pas fini... En le voyant, on a conscience que la
guerre n'est pas terminée et que nos malheurs pourront continuer longtemps
encore, car l'ennemi exécré va occuper, cette fois, la totalité de notre pays.
La Lys, aujourd'hui, ne pouvait être une barrière, comme le fut l'Yser, en 1914.
A Bruges, où nous arrivons, un régiment allemand défile dans la rue,
scandant sa marche d'une chanson guerrière. A cheval, un officier à la
contenance hautaine et méprisante, conduit la troupe. Cela fait mal ! S'il lui
était donné d'entendre nos réflexions, notre peau ne vaudrait pas cher. Un long
convoi suit, simple charroi hippomobile. Dans la ville, les réquisitions sont
nombreuses : voitures automobiles et chevaux surtout. La discipline règne en
maîtresse et nous revoyons l'invasion de 1914. Rien n'est changé.
Nous faisons nos apprêts pour passer la nuit sur la route, à la sortie
de la ville. Les vivres sont rares et on ne songe même pas à se restaurer.
Le lendemain, au petit jour, nous nous dirigeons vers Gand. La fatigue
se fait sentir, les 18 jours de guerre nous ont bien peu permis de repos. En cours
de route, nous nous débarrassons de ce que nous croyons être superflu pour
alléger notre marche et le fossé, à chaque kilomètre, recevra les choses les
plus utiles que nous regretterons plus tard. Sur la fin du parcours, les
conseils judicieux et presque paternels d'un camarade réveilleront le courage
de celui qui ne veut pas aller plus avant et celui-ci, cent mètres plus loin,
devra user de réciprocité envers l'autre. Nous nous traînons péniblement, on
est harassé de fatigue ; la faim et la soif nous tenaillent, à leur tour.
Nous arrivons au bord du canal Gand- Terneuzen et passons à l'autre rive
sur des péniches qui font office de pont. Un modeste cabaret villageois aux
vitres brisées et le toit dégarni par les bombes, est là accueillant, mais la
foule est dense qui s'y précipite et il ne faut pas espérer y trouver l'oasis rêvée.
Nous poursuivons notre chemin, rassemblant nos forces pour atteindre
Gand, le même jour. Nous y arrivons dans la soirée et pouvons, avant d'y pénétrer,
nous désaltérer de quelques verres de bière. A quelques mètres du café, une sentinelle
allemande, à l'air débonnaire, suit nos allées et venues sans paraître se
soucier autrement de nous. Mais lorsque notre intention est d'entrer dans la ville
cette même sentinelle nous place le long d'un muret nous fait observer – on ne
peut plus gentiment – qu'elle fera usage de ses armes si nous tentons de
quitter cet endroit. La souricière était ainsi établie autour de la ville et
personne n'y échappait. D'autres viennent nous rejoindre. Les commentaires vont
leur train, mais qu'y pouvons-nous encore ? Dès ce moment, nous sommes
prisonniers !
La nuit venue, on nous conduira au parc des Floralies, où des milliers
de soldats belges sont réunis déjà. Nous nous étendons sur les pelouses du parc,
sur cette herbe fraîche que la rosée de la nuit vient accentuer d'humidité. On
dort peu ou pas, trop de fatigue nuit au bon sommeil réparateur que nous
espérions ; nos membres s'engourdissent et nous ressentirons les premiers
effets d'un rhumatisme naissant.
Et c'est là, dans ce magnifique parc des Floralies gantoises que, à 3
heures de nuit, nous connaîtrons les trois premiers mots de langue
allemande qui devront, par la suite, revenir sans cesse comme un leitmotiv : « Aufstehen ... los ... schnel !...
». II LE CACHET DE LA NAIVETÉ.
Ce matin du 30 mai, à 4 heures, nous sommes en colonne de marche, à cinq
de front, à la sortie de Gand. Le jour pointe à l'horizon et les
premières maisons de Mont-St-Amand apparaissent dans un léger brouillard.
Combien de milliers d'hommes sommes-nous là ? Impossible à évaluer,
la tête de colonne n'est pas visible et, derrière nous, la masse s'allonge
interminablement.
Nos conversations et nos réflexions convergent vers un sujet unique. Un
avis vient d'être donné et a parcouru tous les rangs : on nous conduit à Anvers
où l'autorité militaire allemande doit appliquer un cachet sur nos cartes
d'identité. Cette formalité nous permettra de rentrer chez nous librement et en
toute quiétude ; elle est rendue nécessaire par le fait que cela équivaut à
notre démobilisation.
En d'autres lieux, d'autres groupes reçoivent le même avis et les
espoirs naissent partout. Le doute nous effleure parfois, mais on le rejette
aussitôt sur les dires d'un camarade qui paraît être bien renseigné ou dont les
déductions logiques n'admettent pas la contradiction.
La colonne qui, au début, avait pris le pas cadencé est, après quelques
kilomètres, dans le plus complet désarroi. Pour les causes les plus diverses, des
vides se creusent dans les rangs, vides qui ne se comblent pas, car des groupes
d'amis et de connaissances se sont formés et ceux-ci veillent strictement à ne
pas être séparés.
Bientôt, un soleil de plomb rend notre marche plus pénible. Dans les
villages que nous traversons, les paysans ont fait le geste charitable de
déposer, devant leurs demeures, des seaux d'eau fraîche où chacun va se
désaltérer d'un gobelet, car la chaleur et la poussière nous sèchent la gorge.
A l'entrée des champs, on rencontre parfois une modeste croix de bois
surmontée d'un casque. Un soldat, sans nom peut-être, dont la mère, l'épouse, les
enfants, attendront vainement le retour au foyer et ignoreront toujours le lieu
où il repose.
Très fatigués, nous arrivons à Lokeren, but de cette étape. On nous loge
dans une usine de textiles. Nous n'avons mangé, en cours de route, que les maigres
vivres que certains d'entre nous possèdent encore. Nous nous étendons entre les
métiers, gênés l'un par l'autre.
La nuit, un continuel va-et-vient de gens pressés à satisfaire un besoin
naturel, empêche de dormir. Dans tous les coins, on entend les grognements, jurons
et imprécations à l'adresse de ceux qui, maladroitement, enjambent les corps
dans l'obscurité, pour joindre la sortie. C'est avec soulagement que nous voyons enfin
paraître le jour, que nous pouvons abandonner notre position incommode et
secouer nos membres engourdis. Dans la cour de l'usine, une mare d'urine nous
empêche d'y séjourner, on en a la respiration coupée ; aussi, préfère-t-on
regagner les locaux de tissage.
Vers 11 heures, nous nous mettons, en route vers Anvers. Au départ, nous
recevons de la Croix-Rouge belge un kg. de pain pour quatre hommes. Manne
céleste dont nous mesurons les parts avec une précision mathématique ; la
moindre mie est récupérée ! avec un soin que les oiseaux jalouseraient.
Cette étape de 34 kilomètres vers la métropole sera la plus dure que
nous aurons à connaître et beaucoup d'entre nous devront se faire transporter. Les
pieds sont échauffés à sang et couverts d'ampoules. La fatigue se fait sentir
plus nettement encore, d'aucuns se traînent péniblement accrochés aux bras de
leurs camarades. La colonne s'allonge désespérément, les vides s'agrandissent
entre les groupes et les gardiens nous font remarquer, geste à l'appui, qu'ils
ont des aptitudes innées à la brutalité, dès que l'un ou l'autre s'assied au
bord du fossé pour prendre un peu de repos.
Aussitôt arrivés au but de l'étape, à Ste-Anne, nous nous sommes affalés
dans le plâtras d'une caserne en construction, ouverte à tous les vents. Et
peut-être avons-nous mieux dormi cette nuit-là. Mais, hélas ! une trop grande
fatigue ne nous a pas permis de profiter d'une largesse qui ne se renouvellera
pas.
Des centaines de cruches contenant du riz, des haricots et de la viande,
sont là, dans la cour, mais personne ne manifeste cette avidité que la faim autorise
de rencontrer. On touche à peine à ces aliments, mais on ne tarde pas à se
vautrer dans la poussière pour y trouver un sommeil réparateur, la tête
reposant sur la besace.
Le lendemain, ce sera la traversée d'Anvers, vers Merxem
d'abord, à Brasschaat ensuite. Les bâtiments militaires du polygone abritent
des dizaines de milliers d'hommes, la plupart démunis de vivres. La soif est
très vive, mais ce n'est qu'à 10 heures, le soir, qu'un camion-citerne à faible
contenance apportera à ceux qui ont l'a chance de l'approcher, le décilitre
d'eau qui calmera – si peu – les gosiers en feu. Cette parcimonieuse distribution
se fait sous la garde d'un feldwebel qui, revolver au poing, vocifère
crapuleusement le long de nos rangs.
Par suite de la pénurie de vivres dans la région, la Croix-Rouge
n'arrive pas à nous ravitailler et, certain jour, chaque homme de notre groupe,
privilégié, reçut cinq cuillerées de soupe claire et il n'y en eut pas pour
tous, ce jour-là.
Avec le concours d'un jeune médecin dinantais et
de quelques infirmiers bénévoles, une infirmerie fonctionne. Mais les soins
sont souvent donnés sous la forme de conseils à mettre en pratique, car la
plupart des médicaments font défaut. Inlassablement, le docteur et ses aides
pansent des plaies, soignent les pieds meurtris, auscultent.
Que notre hommage leur soit rendu pour le dévouement parfait dont ils
ont fait preuve envers nous en cette circonstance.
Hommage également à tous ceux qui ont vécu ces journées malheureuses,
pour la dignité de sentiments qu'ils ont su conserver
jusqu'au bout. Car il faut reconnaître que, vivant dans une ambiance déprimante,
jamais aucun ne s'est laissé abattre. C'est avec le plus grand calme que nous faisions
face à la disette et que nous attendions qu'il soit statué sur notre sort.
Des canards ? Très peu. On se borne surtout à recevoir de camarades que
nous rencontrons au hasard, des nouvelles plus ou moins fantaisistes sur nos
familles, nos amis, notre patelin.
Le cachet ? Il n'en est plus guère question. Les boches nous ont roulés.
Des civils anversois sont venus nous rejoindre, accompagnés de sentinelles allemandes.
Soldats rentrés en leurs foyers après la capitulation, ils ont eu, comme nous,
la naïveté d'ajouter foi aux bobards allemands et la Kommandantur les à envoyés
grossir nos rangs.
Et déjà se forgent des projets d'évasion, mais on ne veut les mettre à
exécution qu'avec le maximum de sécurité, car un cordon de sentinelles nous entoure
et des coups de feu claquent par moment. Très peu réussiront à s'enfuir du
polygone.
Puis, ce sera le départ d'un contingent de 2.000 hommes et
l'embarquement à Calmpthout, dans les wagons à bestiaux, ce qui nous ôte toute
envie de croire a un retour au foyer. Parqués à 50 hommes par wagon, avec de
maigres bagages que nous arrimons de notre mieux, il reste bien peu de place et
pas de confort. Certains wagons, en roulant, impriment un mouvement latéral de
va-et-vient qui nous brise les reins et empêche tout repos.
Nous traversons la Hollande à la vitesse du train de permissionnaires si
bien chanté par Botrel. Le soir venu, les portes sont verrouillées et nous nous
installons plutôt mal que bien dans l'espace restreint du wagon.
Le lendemain matin, au petit jour, le bruit des portes sur les
glissières réveillent ceux qui ont eu le courage et la chance de dormir et nous
pouvons apercevoir à proximité de nous, des bâtiments industriels et des
maisons de commerce où le nom de Werner voisine avec ceux de Schultze et de Schmidt.
S'il nous restait des doutes sur notre sort, ils sont bien vite
dissipés.
Nous sommes en Bochie ! III LES SIX-JOURS DE DORTMUND.
Les rayons dorés du soleil naissant viennent nous réchauffer quelque peu
dans notre prison roulante. Le convoi s'est remis en marche et nos gardiens ont
laissé une ouverture à la porte du wagon, mais si étroite que le corps se
refuserait d'y passer. La petite lucarne dont est muni le wagon est coupée en
sa longueur par des barres de fer qui rendent la visibilité difficile. Et par
ces deux espaces restreints, nous regardons de tous nos yeux ces
paysages nouveaux qui défilent devant nous, mais qui sont empreints d'une
monotonie désespérante.
Ils changeront, cependant, dès que l'on approchera du Rhin. Nous
traversons Kempen, Krefeld, le fameux fleuve du Rhin,
Mulheim et Essen. Centre métallurgique de première
importance, cette dernière ville de près d'un demi-million d'habitants, laisse
apercevoir d'immenses usines pointant d'innombrables cheminées vers le ciel.
C'est le domaine de Von Krupp.
Le paysage industriel se transformera encore pour faire place à la
nature. Puis, tout-à-coup, le train pénètre dans une agglomération où toutes
les constructions disparaissent sous le pavoisement de centaines de
milliers de drapeaux à croix gammée. Cela tient de la fantasmagorie. A toutes
les fenêtres, d'immenses drapeaux sont déployés et il n'est pas jusqu'à la
moindre lucarne des toits qui ne sorte un drapelet ; des arcs de triomphe se
dressent un peu partout. Une débauche de croix gammées.
La gare apparaît bientôt et nous sommes renseignés : DORTMUND.
Encadrés de sentinelles, nous nous acheminons vers la sortie et
traversons la ville. Le public semble marquer à notre égard, cette indifférence
feinte de gens que rien n'étonne. Nous remarquons, dans les artères
principales, des blocs nombreux de « familiehaus »,
abritant des centaines de ménages et construits dans le style Kolossal.
Une immense verrière encerclant le faîte d'un énorme bâtiment attire
notre attention. On nous conduit dans une prairie avoisinante où de vastes tentes
sont dressées. Au robinet unique, nous pouvons nous procurer un peu d'eau pour
nous débarbouiller, chose que nous n'avions faite depuis bien des jours. On
nous rassemble ensuite par rangs de cinq hommes et un soldat allemand nous
prévient, en un français très pur, que nous allons passer à la fouille et que
quiconque tentant de quitter les rangs sera fusillé. Les rasoirs, allumettes,
briquets, lampes de poche, outils, etc., disparaissent dans
des caisses déposées sur le terrain. La fouille terminée, nous sommes conduits
dans le bâtiment sous verrière.
Nous constatons alors que ce bâtiment est le vélodrome de la ville, lieu
où notre champion Victor Linart accapara tant de prix
internationaux de cyclisme ; nous devions y passer six jours. Apparentant notre
passage en ce lieu avec lès épreuves cyclistes bien connues, nous avons dénommé
notre séjour au vélodrome : « Les six-jours de Dortmund ». L'humour ne perd
jamais ses droits, même en les circonstances les plus tristes.
Etendus à même le sol, encaqués comme des harengs, nous sommes là
plusieurs milliers. En dehors, d'autres ont pris place dans les tentes et la prairie
elle-même recevra bientôt des milliers de prisonniers anglais et français,
parmi lesquels des officiers généraux et supérieurs qui passeront plusieurs nuits
à la belle étoile, si l'on peut dire, car la pluie tombera à de fréquentes
reprises.
Le lendemain de notre arrivée, à midi, un repas chaud nous est servi.
Cela consiste en une soupe assez épaisse faite d'orties et de pommes de terre non
épluchées, le tout écrasé. La faim nous tenaille, aussi cette substance
est la bienvenue, quoique plus apte à faire les délices d'un cochon. Pour le
restant de la journée, nous aurons à discuter avec un méprisable quignon de
pain gris et une rondelle de saucisson d'un centimètre d'épaisseur. Il en sera
de même des jours suivants.
Nous nous retrouvons à plusieurs camarades de la région. bien décidés à
ne pas nous séparer. Un jour, cependant, l'ordre nous est donné « Tout le monde
dehors avec armes et bagages » (sic) et par une circonstance malheureuse, notre
groupe est réduit de moitié.
Une nuit, les sirènes beuglent l'alerte, la D.T.C.A. entre en action et
deux explosions dont nous ressentons les secousses au sol, annoncent la chute de
bombes. Trois jours après, nous pourrons en constater les effets peu importants
: trois maisons détruites.
Un incident : Un prisonnier anglais, revenant de la distribution de
soupe avec sa modeste pitance contenue dans une non moins modeste boîte à
conserve à demi-rouillée, reçoit, sans raison, une bourrade d'une sentinelle
allemande qui le suivait. Notre anglais, déposant sa boîte sur la balustrade le
long de laquelle il, allait, se retourne et, d'un geste vif, une droite bien
appliquée envoie le schleuh sur le carreau. Et
reprenant son récipient, notre P. G. s'en fut le plus paisiblement du monde, la
conscience en paix. Evidemment, cet incident devait provoquer un remue-ménage
de bottes cloutées, entremêlé d'appels rauques, mais nous sommes toujours restés
dans l'ignorance de la suite de cette affaire. Il est bien probable que
l'auteur de ce coup de force sera resté anonyme dans la masse des prisonniers.
Les canards les plus fantaisistes et les nouvelles les plus
contradictoires circulent parmi nous. On attache beaucoup d'importance à des
racontars qui ne sont que l'effet d'un mensonge joyeux, mais, dans ces moments,
le moindre renseignement est commenté à longueur de journée et fait naître des espoirs
ou tomber des illusions.
A vrai dire, notre passage à Dortmund (stalag VID) fut sans histoire.
Nous passions le plus clair de notre temps allongés sur le sol, afin de
récupérer sur la fatigue des jours précédents et aussi de remédier par le repos
à l'insuffisance de nourriture.
Dès 7 heures du matin, on nous ouvrait les portes du vélodrome et nous
allions respirer un peu d'air frais dans une petite cour où l'on pouvait se
tasser à 150 hommes à peine. Les cigarettes étaient allumées mais, déjà, on
pouvait s'apercevoir de leur rareté par le nombre de fumeurs qui se brûlaient
les lèvres à tour de rôle au même mégot.
Les lieux d'aisance (ô ironie) étaient des plus rustiques et ne
désemplissaient pas, du matin au soir. Construits uniquement d'un chevron
horizontal fixé sur des piquets placés à hauteur calculée et, à quelques
centimètres des pieds, un fossé profond de deux mètres. C'était là tout le
confort de ces W.C. dont on pouvait dire qu'il y avait péril à les utiliser.
Vingt types se trouvaient constamment assis sur la planche avec, en face d'eux,
vingt autres qui attendaient patiemment le moment de prendre place à leur tour.
A 20 heures, les portes se refermaient sur nous. Pendant un moment, on
entendait encore le murmure de conversations tenues à voix basse, auquel succédait
bientôt le silence.
Cependant, un soir, un chant s'élève jusqu'au dôme de l'immense salle.
Chacun se tait et écoute religieusement ce ténor dont la voix pure lance à l'écho
de nos cœurs des mots qui répondent parfaitement à la, nostalgie qui nous
étreignait. Dommage que des applaudissements chaleureux, en récompensant le
chanteur, viennent mettre fin à cet unisson mental qui nous liait à lui !
Mais ce n'est pas tout, deux autres gars, juchés au haut des escaliers
qui conduisent aux tribunes, se font entendre aussi. Mais quoi ! Un lied ? les paroles
sont en allemand. Cela jette un froid, on ne les écoute plus, on reprend les
conversations. Ce sont des « rédimés », nous dit-on. Le chant terminé, ils ne
récoltent pas le succès obtenu par le premier, mais tout de même de faibles
applaudissements se font entendre de très haut et nous font lever la tête. Dans
la demi-obscurité qui nous environne, nous pouvons apercevoir, au faîte du vélodrome, une espèce de cage semi-circulaire,
dans laquelle se trouvent deux soldats allemands, auteurs des applaudissements
; entre eux, une mitrailleuse dont le canon est braqué sur nous. Jusqu'alors, peu d'entre
nous avaient repéré ce mirador intérieur et il fallut ce méprisable incident pour
que son existence nous fût révélée. Inutile de dire que cette
expérience de chant ne se renouvela plus, l'auteur de cette initiative ayant certainement
éprouvé le regret d'avoir suscité cet incident imprévisible en extériorisant
par sa voix chaude et prenante les sentiments intimes de ses camarades. IV NOUVELLE ÉTAPE
NEUBRANDENBURG. Heraus
! Ce seul mot bref, lancé
sur un ton de commandement, retentit sous le dôme du vélodrome et nous tire
brusquement de notre sommeil. Furtivement, on s'interroge : Que se passe-t-il ?
Que nous veut-on ? Il est 4 heures ! Dans
l'obscurité, on prépare fébrilement ses bagages. Ceux-ci sont d'ailleurs
réduits au strict minimum et, à part un objet à ranger dans la valise, un
couvercle à refermer ou une courroie à resserrer, on est bientôt prêt. Dehors, une pluie fine
nous accueille. On nous parque dans une prairie où, toujours par rang de cinq
hommes, nous attendons l'ordre du départ. Cette attente se prolongea pendant
plus de 6 heures sous la pluie, entourés de civils armés dont le bras gauche
s'orne d'un brassard jaune portant, en noir, l'araignée hitlérienne. Nos
uniformes sont trempés. Pendant cette longue
station très fatigante, on procède à une distribution de pain et chacun reçoit un
saucisson dont la dimension nous paraît extraordinaire, la disproportion avec
la rondelle traditionnelle est énorme. Mais notre satisfaction fera bien vite
place à l'indifférence, sinon au dégoût car dès que l'on presse là saucisse, il
en sort une eau jaunâtre qui la réduit à un quart de son volume et nous
constatons que la chair n'est composée que de nerf bâché, crissant sous la dent
; pas un atome de corps gras. Ils s'y entendent, les boches, à nous nourrir
sans que cela leur coûte. Vers 11 heures enfin, nous
nous mettons en marche et faisons en sens inverse le chemin parcouru six jours
auparavant. A la gare de Dortmund, on
nous tasse par 50 hommes dans les wagons à bestiaux et le convoi s'ébranle au
début de l'après-midi. Nous avons vue sur le
paysage par la lucarne grillagée du wagon et par un espace laissé libre sur 10 cm
de la porte à glissières. Pendant des heures, les villes et villages se
succèdent ; quelques-uns d'entre nous prennent des notes sur un agenda, histoire
de tuer le temps. On assiste aussi à des situations cocasses, tel ce camarade
qui fut pris d'un besoin pressant et, le papier étant rare, dut se résoudre à
se soulager dans sa gamelle et à lancer contenant et contenu dans la campagne. Dans les champs, nous
apercevons des prisonniers au travail, des Polonais. Parfois, l'un d'eux nous
adresse un petit geste amical. Parmi tant de villes
traversées, nous remarquons surtout Hanovre, Braunschweig,
Magdebourg et, dans la nuit, Berlin. Le lendemain, à 6 heures
du matin, le convoi s'arrête en gare de Neubrandenburg. Un double cordon de
sentinelles est rangé sur le quai ; telle est donc bien notre destination. Cette petite ville du
Mecklembourg-Schwerin compte 12.000 habitants et s'est spécialisée dans la fabrication
des articles en os, comme nous pouvons nous en apercevoir, en traversant
la ville, par les nombreux magasins exposant ce genre de marchandise. Par
contre, nous remarquons aussi que les magasins d'alimentation sont très peu
fournis et que les « Konditoreien » (confiseries) ne
présentent à leurs étalages que des bocaux vides et les noms publicitaires d'un
chocolat qui fait totalement défaut. A la sortie de la ville,
un chemin escarpé nous conduit au stalag IIA et l'on nous introduit sur un terrain
que nous avons eu coutume d'appeler « la prairie » alors que, en réalité, il
s'agit d'un terrain sablonneux où n'existe le moindre brin d'herbe. A
proximité, des casernes immenses sont en construction. Devant nous, des
baraques, des tentes. A l'entrée du camp, 3 à 4
cents Hollandais prisonniers nous ont cédé le passage, ils sont libérés. Cette
nouvelle est fortement commentée et suscite parmi nous des espoirs nouveaux. Il fait une chaleur
tropicale. Pendant près de 4 heures, nous faisons la file pour obtenir quelques
pommes de terre – bonnes et mauvaises – qui, constituent la ration du jour. La nuit, alors que nous
sommes étendus dans un méli-mélo de valises et de besaces, une bise cinglante
nous frigorifie sur place et soulève la poussière qui nous pénètre dans les
yeux, la bouche et les oreilles. Du haut des miradors, les projecteurs fouillent
sans cesse parmi les corps, tendant à prévenir toute évasion et les
mitrailleuses sont constamment braquées dans notre direction. Des prisonniers français
viennent nous rejoindre sur le terrain et repartent quelques heures plus tard. Déjà,
le temps est mis à profit pour procéder à des échanges commerciaux, ayant le
tabac et les cigarettes en guise de monnaie-or. C'est à ces occasions qu'on
retrouve sur le marché des objets prohibés qui sont passés inaperçus à la
fouille de Dortmund, tels que couteaux, briquets, rasoirs, etc. Cinq jours durant, on nous
tiendra exposés à la bise, la nuit et au soleil, le jour. Chez tous, la faiblesse
augmente et il ne se passera pas un quart d'heure que l'un ou l'autre
prisonnier, défaillant, soit transporté quelque part dans le fond du camp, à
l'infirmerie. Nos gardiens sont très durs envers nous et l'un d'eux se montre
particulièrement brutal, se frayant un passage parmi nous, à coups de plat de
sa baïonnette, ce qui provoque toujours la débandade chez les prisonniers, le
piétinement et l'éventration des valises. Un camarade subira plus particulièrement
les effets de cette brutalité, l'œil enlevé par la pointe de la baïonnette de
cette immonde brute. Après cinq jours,
transférés dans le camp, on nous loge à 300 hommes par tente. Le régime n'y est
ni pire, ni meilleur, sinon l'abri ; comme nourriture, soupe à l'eau de
vaisselle, quelques petites pommes de terre en robe des champs et un cinquième ou
sixième de pain. Rares sont ceux d'entre nous qui peuvent se lever, sans
retomber aussitôt ; il faut souvent l'aide d'un camarade pour réaliser ce léger
effort. Impossible de s'approcher
des cuisines, car celles-ci sont gardées par des prisonniers sénégalais farouches
et menaçants, armés de respectables gourdins ; leur attitude décidée en impose
immédiatement. Le seul moyen d'obtenir un supplément de nourriture est de
s'entendre avec les prisonniers polonais affectés aux cuisines, mais un morceau
de pain vous coûte votre montre ou votre alliance. Alors on prend patience. Comme s'il était besoin
encore de diminuer nos forces, les feldwebels et unteroffiziers
nous font faire des exercices de marche
et de gymnastique trois fois par jour. Le soir, à 8 heures, tous
les prisonniers doivent réintégrer les tentes et ne peuvent en sortir avant le
matin. Couchés sur le sol, côte-à-côte, il reste bien peu de place pour se
mouvoir et le sable refroidi nous engourdit. Ayant obtenu d'un prisonnier marocain,
en échange de quelques cigarettes, un lot de planches qui formaient un paravent
aux latrines, nous n'eûmes la satisfaction de nous en servir comme couchette
que durant une seule nuit car, le lendemain, au cours d'une visite fouillée,
les schleuhs confisquaient ce que nous considérions comme
une aubaine. Et enfin, c'est dans ce
stalag que nous ferons connaissance avec le n° 1 du « Trait d'Union » infecte
feuille de propagande qui nous poursuivra jusqu'au dernier mois de captivité,
mais qui, cependant, il faut le reconnaître, avait son utilité en remplaçant
avantageusement le papier hygiénique. V AU STALAG
D'IMMATRICULATION. Notre séjour à
Neubrandenburg dure depuis dix jours et on parle maintenant d'un nouveau transfert,
le stalag IIA étant exclusivement réservé aux prisonniers français. Cette
nouvelle nous réjouit, quoique nous ne connaissons rien de notre destination
future, mais nous avons assez souffert en ce stalag du diable pour désirer en sortir. La veille de notre départ,
un aumônier belge célébrera une messe en plein air. Combien de prisonniers belges
et français y assistent ? C'est difficile à évaluer, on parle de vingt-cinq
mille. Plus de six mille communiants s'étaient présentés au moment où les
hosties vinrent à manquer. Aux côtés de l'autel improvisé, le fusil entre les
jambes, deux sentinelles sont assises, surveillant d'un air idiot tous ces
hommes dont les têtes restent inclinées dans un pieux recueillement. Qui saura dire tous les
combats intérieurs qui se sont livrés, ce jour-là, dès le réveil, pour résister
à la tentation de grignoter un morceau de pain, alors qu'il faut rester à jeun
; pour d'aucuns, il fallut faire preuve d'une volonté quasi-surhumaine. C'est le lundi 24 juin que
nous quittons ces lieux inhospitaliers. Le bruit circule que nous
nous rendons vers l'Ouest, à Krefeld. Le fait d'aller dans cette direction ramène un
espoir nouveau en chacun et nous revoyons ces hollandais qui, à peine arrivés,
ont été réembarqués à destination de leur pays. Mais il n'en fut rien pour
nous, car notre lieu de destination était Greifswald qui, avec la prononciation
allemande, pouvait se confondre avec Krefeld pour des gens qui, comme nous,
n'étaient pas familiarisés avec la langue tudesque. En traversant la ville de
Neubrandenburg, un unteroffizier nous interpelle et
nous lance : « Fous allez au trafail, pas peaucoup trafailler et pien mancher ». Ces paroles nous
refroidissent, nos illusions disparaissent. Vraiment, les canards sont
décourageant. Nous prenons place dans
des wagons à bestiaux dans lesquels nous trouvons, cette fois, des banquettes avec
dossier. Pendant le voyage, qui n'a rien d'attrayant, nous pouvons tous
assister au défilé des campagnes, car les portières nous ont été laissées ouvertes. Et c'est à 8 heures du soir que nous arrivons à ce fameux stalag II C,
à Greifswald. Il ne s'agit pas ici d'un
camp, mais de casernes récemment construites, dont les garages, séparés des corps
de bâtiments par des fils barbelés, servent de logements aux prisonniers. Affaiblis
et, disons le mot, crevés, nous passons notre première bonne nuit sur la
paille. Le lendemain matin, nous
passons tous à une fouille sévère, au cours de laquelle on nous enlève même
notre nécessaire, tels que chemises et pullovers. Notre argent disparaît contre
remise d'un accusé de réception. Des renseignements divers nous sont demandés,
et entr' autres, l'adresse de la personne qu'il y a
lieu d'aviser en cas de décès. Cette question nous atteint cruellement, car la
plupart savent que leurs familles ont été évacuées vers la France, mais
ignorent si elles sont toujours en vie. Quelle adresse déclarer ? Cette pensée
fut d'ailleurs, au début de la captivité, celle qui nous attira la plus grande
souffrance morale. Chaque groupe de
prisonniers répartis dans les garages se trouve sous le commandement d'un Kompagnieführer, un Unteroffizier
qui profite de notre situation pour faire « de bonnes bedites
affaires ». C'est ainsi qu'en échange de stylos, porte-mines et autres objets
ayant quelque valeur, il nous passe un bout de pain ou un paquet de 6
cigarettes Juno. Il en est qui se laissent prendre à ces
appâts, tant est obsédante l'envie de manger et de fumer. A midi, la soupe nous est
distribuée. Pour des estomacs affamés, elle était excellente : il s'agissait d'une
soupe au poisson dont les arêtes pouvaient nous étrangler mille fois. Mais
l'avis fut unanime, cette soupe était délicieuse et réconfortante. I1 est vrai
que notre appréciation, à ce moment, devait tenir à peu de chose, car on eût
bouffé des cailloux. L'après-midi, nous posions
devant le photographe, dans la position assise ; une ardoise sur les genoux
portait le numéro matricule qui nous avait été attribué le matin et qu'on
retrouvait sur une plaquette qui se balançait sur notre poitrine. Ce numéro
était désormais notre principale identité et convenait parfaitement à la tête
de forçat qu'enregistrait la pellicule. Celui qui, par la suite, a pu voir sa photo
sur la carte d'immatriculation, eut peine à se reconnaître : pâle, les traits
fatigués, les yeux cernés, amaigri, c'était bien là une figure de bandit et non
d'honnête homme. Le lendemain matin, ce
sera la séance de vaccination et, aussitôt après, nous assisterons au premier marché
d'esclaves. Des civils, portant des serviettes bourrées de paperasses sous le
bras, vont et viennent dans l'enceinte des barbelés et nous désignent pour nos kommandos de travail. Ces gens de l'Arbeitsarnt,
nous aurons l'occasion de les voir souvent, au cours de notre captivité. Dès aujourd'hui, nous ne
sommes plus que des esclaves dont on cherchera à extraire un rendement. Le
travail obligatoire auquel nous sommes soumis, par la volonté de ceux qui ont
rédigé la Convention de Genève, apportera parmi les prisonniers bien des
déboires, des maladies, des accidents. Que de protestations, de révoltes, de
punitions n'entraînera-t-il pas ? Que de sanctions seront prises collectivement
à notre égard, dès ce moment où nous ne fûmes plus qu'un numéro ! Dès
maintenant, nous sommes considérés comme des êtres inférieurs desquels on peut
tout exiger. Et les articles de la Convention qui nous reconnaissent certains
droits ou privilèges seront bien peu respectés. Dans les premiers temps
surtout, croyant à une victoire facile et certaine, les boches n'auront pas à
se gêner avec nous. Le sort en est jeté. Il
faut nous résigner à entreprendre un nouveau voyage ; nous commençons à en
prendre l'habitude. Les wagons à bestiaux sont
toujours en gare, qui nous attendent et moins de 48 heures après notre entrée
au stalag d'immatriculation, nous repartions, en direction de Stettin, cette
fois. VI EN POMÉRANIE. Le marchand d'esclaves a
désigné notre, kommando et nous quittons le stalag dans
1’après-midi du 26 juin, inquiets malgré nous de connaitre notre nouvelle
destinée. Nos wagons à bestiaux
s'arrêtent à chaque gare, des camarades y descendent, arrivés à leur destination
; ils sont accompagnés d'un feldgrau armé. Nous
jugeons les gardiens à leur mine ; certains inspirent quelque peu la confiance,
d’autres sont antipathiques au suprême degré. L avenir nous apprendra que ce
jugement hâtif est bien hasardeux et ne répond pas, bien souvent, a la réalité. Nous arrivons en gare de
Stettin, où l'animation est grande sur les quais. Nous devons changer de convoi
et profitons du court répit qui nous est accordé pour nous désaltérer d un
gobelet d eau. Une micheline nous
emporte, commodément installés, cette fois, sur les banquettes du compartiment.
Le train longe l'Oder et nous pouvons faire connaissance de visu avec le grand
port de la Baltique. De nombreux navires de gros. tonnage mouillent l'ancre,
d'énormes grues font jouer leur flèche en tous sens ; un va-et-vient continuel
d'un charroi important encombre les quais. L'Oder, rudement, roule ses eaux
vers la mer Baltique, que les Allemands dénomment aussi Ostsee
ou mer de l'Est. Un quart d'heure de voyage
suffira pour nous amener à destination. Il s'agit d'un village quelconque, aux
habitations pauvres construites en briques et dont les toits s'élèvent en
pointe ; un chemin raboteux, des caves de plain-pied s'enfoncent dans les talus. Dès la sortie de la gare,
nous sommes escortés par une troupe bruyante de gosses qui se bousculent pour
mieux nous voir. Le long de la rue principale du village, hommes et femmes,
devant leurs demeures, nous regardent curieusement et font des commentaires
que nous ne comprenons pas, mais déjà, chacun de nous est apprécié diversement. Le croiriez-vous ? Ce fut
un bien pénible moment. Peut-être n'avons-nous jamais si bien ressenti notre
basse condition. Depuis ce jour-là, nous étions des esclaves sur lesquels on se
décharge des plus lourds fardeaux, auxquels on repasse les plus fatigantes
besognes ; des esclaves subissant la mauvaise humeur des chefs et qu'on rend
responsables de tous les péchés d'Israël ; des esclaves dont la dignité d'homme
est atteinte à chaque heure du jour par le dédain, les sarcasmes, voire les
mauvais traitements. En certains endroits, les
prisonniers furent accueillis par les huées de la population, qui leur jetait
des pierres et leur crachait au visage. Je dois à la vérité de dire que tel ne
fut pas notre cas. Et nous avons défilé sous les yeux de ces Prussiens de
Poméranie en gardant une attitude digne et fière d'hommes non asservis. Nous sommes introduits
dans la salle des fêtes du village où, sur le plancher, les 31
prisonniers que nous sommes trouvent un nombre égal de paillasses. Sur
celles-ci, deux tranches de pain fourrées en sandwich de lard ou de saucisson y
ont été déposées à notre intention. On examine curieusement ce casse-croûte
copieux et on s'interroge : Est-il destiné à notre repas du soir ? ou, par prudence,
est-il préférable de le maintenir en réserve jusqu'à demain matin ? La plupart résolvent la
question immédiatement et mordent. à belles dents dans ce délicieux pain bis ;
les hésitants, l'un après l'autre, suivent bientôt cet exemple. Vraiment, la
tentation était trop forte, nul n'a pu y résister. Quant à demain... on verra ! Mais la Providence se
montre particulièrement démente, ce premier soir en kommando.
Une vingtaine de jeunes gens envahissent la cour et, avec des protestations de
sympathie, nous glissent quelques cigarettes dans les mains, pendant que nous
les dévisageons avec méfiance. Cette amicale démonstration nous paraît louche,
mais l'un d'eux entreprend de nous expliquer en jargon petit nègre, que ses camarades
et lui ne sont pas allemands, mais polonais déportés de leur pays et au travail
depuis huit mois déjà dans ce village qui a nom : Ferdinandstein. En hommes jusque là
habitués à ne considérer que notre propre sort, la sympathie nait aussitôt envers
ces frères étrangers dont l'infortune est égale à la nôtre et dont le premier
mouvement est un geste charitable qui doit adoucir quelque peu notre appréhension
de la vie qui nous sera faite ici. Un peu d'histoire
clôturera ce chapitre. La Poméranie couvre un
territoire de la Prusse sur une superficie légèrement supérieure à notre pays,
alors que sa population n'atteint pas deux millions d'habitants. Cette
disproportion se comprend par la pauvreté du sol de cette région ; celui-ci est
généralement bas, de nature sablonneuse, humide et médiocrement fertile. Le
climat est froid et brumeux. L'agriculture est pauvre ;
seule la culture de la pomme de terre est d'un rendement abondant. Les prairies
sont inexistantes et, de ce fait, les vaches ne sortent jamais des étables et
sont d'une maigreur pitoyable. Il faut se diriger vers le Brandebourg pour y
trouver des campagnes verdoyantes. La Poméranie appartint à
la Pologne pendant des siècles et elle ne fut définitivement rattachée en totalité
à la Prusse, qu'en 1815. Le Traité de Versailles, en juin 1919, en a restitué
une partie à l'Etat polonais reconstitué. Dans la Poméranie de l'Est, la
population est de langue allemande, mais est assez fortement mélangée
d'éléments slaves. Dans la Poméranie de l'Ouest ou oderienne,
des centaines de villages témoignent encore par leur nom de leur origine slave. Malgré cela, il est une
chose qui nous frappe : le poméranien est le type qui s'enorgueillit le plus d'être
Prussien et les vieux se vantent avantageusement de ce que les Poméraniens
formaient, en 1914 , l'élite des régiments de Ulhans,
si tristement réputés chez nous. Mais le Poméranien,
grossier, lourd et quasi-illettré, se heurtera au caractère plus raffiné et
têtu et à l'esprit plus subtil et frondeur du wallon. VII KOMMANDO
VILLAGEOIS. La population du village
de Ferdinandstein est composée presque entièrement de
petits cultivateurs maraîchers qui cumulent cette profession avec celle de
cafetier, épicier, coiffeur, boulanger, etc. Chacun possède quelques hectares
de terrain, desquels il retire le seigle, l'avoine, les betteraves, les pommes
de terre et le foin, en quantité de très peu supérieure aux besoins de
l'exploitation. Mais un hectare de culture maraîchère constituera le plus clair
des ressources de ses paysans. 
François Rouard (à droite) avec un autre P.G. (non identifié). Vraisemblablement à Ferdinandstein L'Ortsbauerführer a réparti, dans 29 petites fermes,
les 31 prisonniers et, dès 6 heures du matin, le premier jour, les cultivateurs
sont venus prendre livraison de leurs esclaves. La plupart d'entre eux arborent
vis-à-vis de nous une fierté insolente et, pendant longtemps, nous serons le
principal sujet de leurs conversations, les uns marquant leur chance d'être
servis par un homme de leur profession, les autres manifestant leur déception
de posséder des employés qu'ils appellent les « Bankdirektor
». Nous sommes dans un état
d'épuisement moral et physique qui ne nous permet pas de nous adapter rapidement
à nos nouvelles fonctions et beaucoup ne connaissent le travail des champs que
de façon purement théorique. Aussi bien,
le travail est d'autant plus dur pour ces derniers et doit être expliqué jusqu'aux
moindres détails, avec force gestes et démonstrations par nos suzerains. En cette saison d'été
1940, le travail commence à 6 heures et se termine le soir, entre 9 et 10 heures.
L'interruption aux heures des repas est réduite au strict minimum et une
demi-heure pour le repas de midi est bien le maximum accordé. La fenaison est particulièrement
éreintante. Elle se fait sur les îles de l'Oder et le foin est ramené au port
sur deux grandes barques jumelées. Il me souvient que le terrain le plus
éloigné me força de ramer pendant près de deux heures pour nous y rendre, mon
fermier et moi, et autant pour en revenir. Le foin, mêlé de joncs, est de
qualité plus que médiocre et sert aussi souvent de litière aux bêtes que de nourriture. 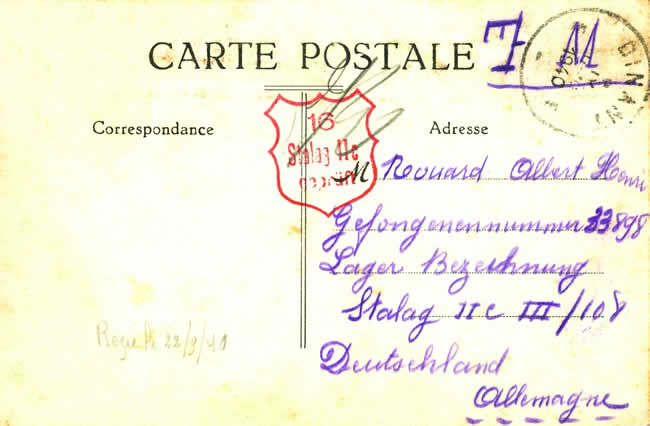
Carte envoyée par son épouse 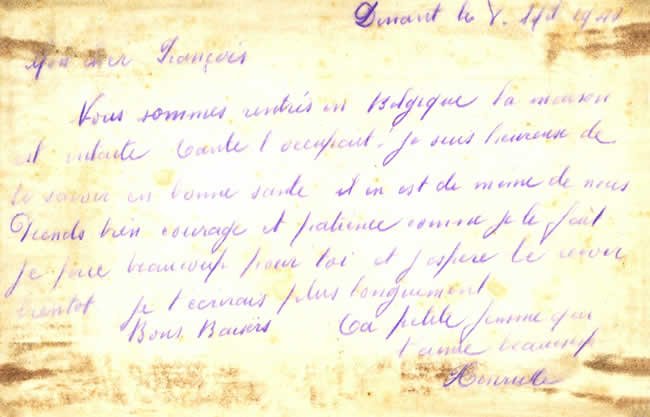
Carte envoyée par son épouse Henriette, le 08 septembre 1940 (et reçue le 22/09) Mon
cher François, Nous
sommes rentrés en Belgique. La maison est intacte, Tante l'occupait. Je suis
heureuse de te savoir en bonne santé, il en est de même de nous. Prends bien
courage et patience comme je le fais. Je
prie beaucoup pour toi et j'espère te revoir bientôt. Je t'écrirai plus
longuement. Bons
baisers. Ta
petite femme qui t'aime beaucoup. Henriette Le fauchage du foin, du
seigle et de l'avoine était très fatigant pour ceux qui ne connaissaient
la faux que de nom. Et cependant, le soir, s’ils se laissaient tomber sur leur
paillasse, exténués, ils n'en ont rien laissé voir à leur bauer
pendant la longue et dure journée, retenus par ce ridicule amour-propre que
tout prisonnier a connu, au début de sa détention. Trois fois par jour, il y
avait la nourriture à donner aux bêtes, le fumier à extraire des étables, la
traite des vaches et cent autres travaux inhérents à l'exploitation fermière. Mieux est le travail
maraîcher qui, au moment de notre embauchage, consistait surtout à manier la
binette pour l'enlèvement des mauvaises herbes qui croissaient dans les
légumes. Ce travail est moins fatigant que tout autre, mais fastidieux par la
répétition du même mouvement durant des heures interminables. Heureux sommes-nous
lorsque le bauer nous accorde la liberté du dimanche,
car nombreux sont ces paysans qui ne respectent pas le repos dominical. Notre ignorance dans le
travail provoquait parfois des gags amusants dont on s'entretenait volontiers lorsque,
le soir, nous nous trouvions tous réunis. Tel celui-ci qui m'est resté en
mémoire : Un camarade est chargé par son « patron » de nettoyer un champ
d'asperges, de ses mauvaises herbes. Deux heures après, il revient à la ferme,
portant la binette cassée ; il explique au cultivateur que le champ est envahi
par des plantes tellement coriaces que l'outil n'a pu y résister et qu'il vient
en quérir un autre. Pris de soupçon, le paysan se rend sur les lieux et
constate, à son grand désespoir, que les trois-quarts de son champ est nettoyé...
de ses asperges. La difficulté de se
comprendre amène aussi des quiproquos non moins amusants : Deux prisonniers, pendant
le repas de midi, discutent entre eux de ce qui peut être advenu à l'ex-Kaiser
Guillaume II qui, avant les hostilités, se trouvait à Dom, en Hollande. – Demande-le au vieux, dit
l'un. S'adressant au vieux
fermier, l'autre pose la question, en français : – Et le Kaiser, où est-il
? – Da ! répond le vieux, en
montrant un panier à couvercle qui traînait dans un coin – Dans le panier ? – Ia ! Que voulait-il dire ?
Ayant soulevé le couvercle du panier, nos deux amis y trouvent deux fromages. Ce n'est que le soir, à
leur rentrée au kommando qu'ils apprirent le mot de
l'énigme. Le vieux avait compris qu'il s'agissait de « Kâse
», c'est-à-dire fromage. 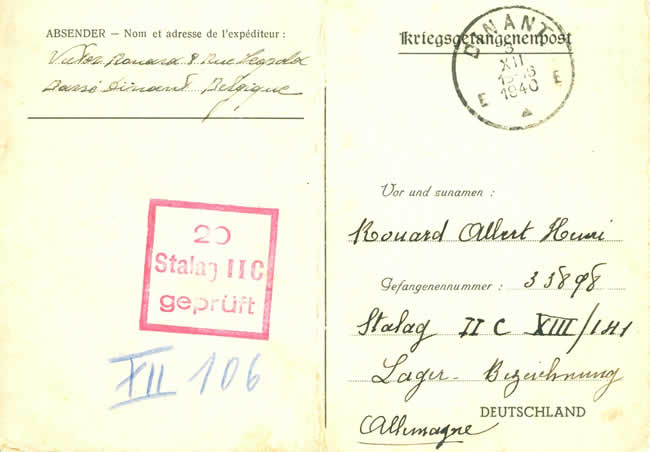
Carte envoyée par son fils aîné 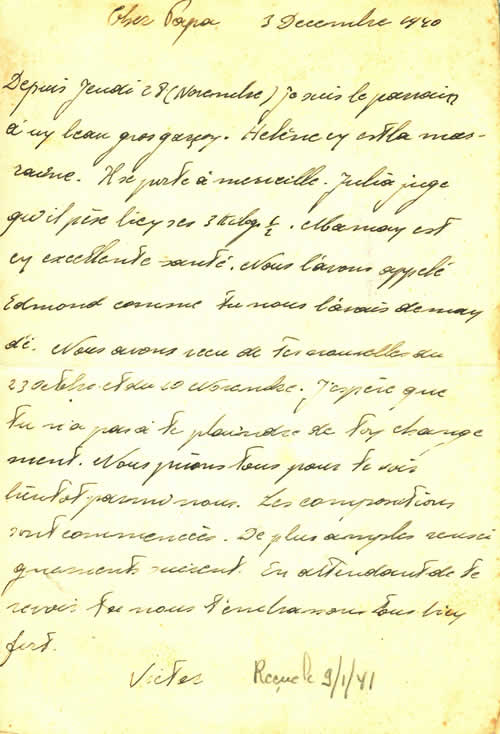
Carte envoyée par son fils aîné Victor (16 ans) et annonçant la naissance de son petit frère Edmond (dit Eddy), le 28 novembre 1940. Reçue le 9/01/1940. Cher
papa, 3 décembre 1940 Depuis
jeudi 28 (novembre), je suis le parrain d'un beau gros garçon. Hélène est la
marraine. Il se porte à merveille. Julia juge qu'il pèse bien ses 3kgs1/2.
Maman est en excellente santé. Nous l'avons appelé Edmond comme tu nous l'avais
demandé. Nous avons reçu de tes nouvelles du 23 octobre et du 10 novembre.
J'espère que tu n'as pas à te plaindre de ton changement. Nous prions tous pour
te voir bientôt parmi nous. Les compositions sont commencées. De plus amples
renseignements suivent. En attendant de te revoir, nous t'embrassons tous bien fort. Victor Certes, ces petites
histoires, innombrables au début, nous font bien rire, mais n'empêchent pas notre
moral de rester à un niveau assez bas, provenant surtout de l'absence de
nouvelles des nôtres. Le cafard fait son apparition. Nous sommes affectés par
une dépression morale bien difficile à définir et cet état mental du début
s'accentue encore par le fait que, bien souvent, chacun de nous travaille seul
à longueur de journée. Les Allemands, à nos côtés, ne peuvent obvier à cette
maladie morale, tandis que la présence d'un camarade, dans le champ voisin,
nous procure une joie de gosse et on ne se lasse pas de s'interpeller et
d'entretenir une conversation qui ne prendra fin qu'avec le travail. Qui d'entre nous peut se
vanter de n'avoir pas laissé couler ses larmes, sans retenue possible, sous la
pensée persistante des siens et de son pays. Bien peu ! Et ces moments-là
furent réellement des plus pénibles. La douleur physique représente peu de chose,
mise en comparaison avec l'effet moral de notre situation. Nul ne le comprendra
qui n'en a subi le choc ! Les premières lettres de
Belgique sont reçues à la fin août et c’est avec une joie délirante que ces précieuses
missives sont lues et commentées, ajoutant une peine de plus à ceux qui
n'avaient pas ce bonheur et qui continuaient à vivre dans l'appréhension et
l'angoisse du malheur. Il nous faudra atteindre le mois d'octobre pour que
chacun ait ses apaisements sur le sort des siens et, dès ce moment, la vie
devient plus supportable. 

Au point de vue physique,
il est à constater que nous avons tous gagné, dès les premiers jours, du
rhumatisme aux mains. Celui-ci se faisait particulièrement sentir pendant la
nuit et lorsque, dans notre sommeil, il nous arrivait d'ouvrir ou de fermer les
poings, la douleur provoquée par ce mouvement naturel nous éveillait et le cri
qui nous échappait inconsciemment éveillait les autres. Au début d'octobre, les
grands travaux des champs sont terminés et quelques paysans se débarrassent de
ceux dont ils n'ont plus besoin. Dix prisonniers quittent le kommando, y laissant le regret d'une séparation qui fut
pénible, tant étaient vivaces les sentiments de camaraderie qui nous unissaient
l'un à l'autre. VIII DANS UN
DOMAINE PRIVÉ. Ce 9 octobre 1940, un tortillard vétuste
et démodé nous emmène a travers la campagne poméranienne. Bois et campagnes
défilent sous nos yeux ; çà et là, quelques champs de betteraves marquent leur
emplacement parmi d'immenses étendues de culture de pommes de terre. Descendus au hasard d'une
halte, nous nous trouvons dans un petit village dont les maisons, à bas étage
et recouvertes de tuiles rouges, sont habitées par des familles d'ouvriers
agricoles au service des gros fermiers de l'endroit. C'est le village de Woltersdorf ; un nom, parmi tant d'autres, qui ne nous
apprend rien. Les hobereaux,
propriétaires de domaines, possèdent des bois et terrains de plusieurs
centaines d'hectares, beaucoup dépassent le millier. Le plus important qu'il
m'a été donné de connaître était de 3.500 hectares, après un morcellement
ordonné par l'Etat quelques années auparavant ; précédemment, ce domaine
comprenait, 18.000 hectares de terrains et de bois. Ces fermes sont
industrialisées au plus haut degré, cela se comprend, et sont nanties d'un
outillage agricole des plus complet. Certains domaines, avec leurs hautes
cheminées, présentent plutôt un caractère d'usine. Le villageois et tous les
membres de sa famille, y compris les enfants, sont occupés exclusivement dans
ces domaines où chacun gagnait, à l'époque qui nous occupe, de 9 à 12 pfennigs
de l'heure, ce qui équivaut à 10 % environ du salaire horaire d'un ouvrier
d'usine. Par contre, le paysan bénéficie du logement et reçoit le lait, le
beurre, le pain, les pommes de terre, le charbon, etc. C'est, en somme,
l'asservissement tel qu'il se pratiquait au moyen-âge. Le village fourmille de
jeunes gens polonais, filles et garçons, portant obligatoirement sur le côté gauche
de la poitrine, le « P » mauve sur fond jaune bordé de mauve qui les
distingue de la population allemande. Il serait dangereux pour eux de se
débarrasser de cet insigne, car un châtiment sévère les attend. On retrouve
partout ces jeunes Polonais qui ont été déportés pour parer au manque de main-d'œuvre
dû à la mobilisation militaire ; leur nombre s'élevait, en 1940, à plus de
quatre millions. Il y a, en outre, quelques
prisonniers de guerre polonais qui, bientôt, à leur tour, passeront dans les
rangs des civils, après extorsion de leur signature par les autorités
militaires allemandes. Notre venue n'étant que
temporaire, on n'a pas pris la peine de nous chercher un logement et de nous
préparer une paillasse. Nantis chacun d'une botte de paille, on nous dirige
vers une villa, au centre d'une propriété assez vaste. La villa, vidée de tout
meuble et fraîchement repeinte, est bien faite pour nous plaire, mais c'est sur
la terre battue d'une de ses caves que nous arrangeons nos couchettes. Les
soupiraux sont munis de barres de fer scellées dans la pierre et une porte
solidement cadenassée bouche l'entrée de la cave. C’est moins bien qu'un
vulgaire cachot de nos permanences de police. Toutes ces précautions sont
d'ailleurs purement symboliques car, après le travail ou le dimanche, on nous laisse
circuler librement dans le village. Nous ne sommes ici que
pour une période de quatre semaines, étant venus en renforcement de l'équipe
villageoise et polonaise préposée à l'arrachage de 110 hectares de pommes de
terre. Cette besogne est fatigante pour les non-initiés que nous sommes. Au
moyen d'un trident à pointes recourbées en équerre et muni d'un court manche,
le travail se fait à genoux, ce qui est très éreintant. La journée finie, il ne
nous est plus permis de nous courber sans grimacer de douleur. La machine à arracher
les pommes de terre que l'on voit dans de très nombreux domaines, ne peut être
employée sur ces terrains, car ceux-ci contiennent d'énormes galets qui
remontent à la surface du sol et contre lesquels les dents de l'arracheuse se
briseraient. Une sentinelle nous suit
dans notre travail ; bonhomme accommodant en l'absence du maître, mais nous
admonestant d'importance lorsque le patron est là. La présence du hobereau sur
les lieux du travail est plutôt rare, mais on le voit fréquemment sur un
monticule qui domine ses propriétés et, à cheval surveillant le travail au
moyen de jumelles qu'il porte constamment au cou. Nous ne sommes ni mieux,
ni plus mal, qu'au kommando précédent. Déjà, les
jours raccourcissent. ce qui nous donne l'avantage d'une durée moindre du
travail. En outre, nous n'avons pas
à nous occuper du bétail. car il y a un personnel spécialement affecté aux
écuries, aux étables, à la porcherie, etc. Le dimanche, aucun travail
n'est exigé et nous jouissons de la plus complète liberté. Nous mettons ce
temps à profit pour écrire à nos familles, entretenir nos frusques et veiller à
l'hygiène corporelle. On nous permet d'employer
un foyer dans la cave, la nuit ; nous n'avons jamais compris par quel hasard providentiel
nous avons évité l'incendie, car le vieux poêle laisse passer les braises rougies
par une dizaine de trous et viennent rouler à proximité des fétus de paille.
Pendant notre sommeil, les rats nous passent sur le corps et le visage, sans
souci aucun de notre répugnance. Nous arrivons ainsi au
début de novembre. Les nuits sont froides, il gèle durement, déjà. On nous affecte
alors à l'arrachage des betteraves fourragères et sucrières. Le matin, les
feuilles sont recouvertes d'une mince couche de glace, ce qui a pour effet de nous
écorcher et crevasser les mains. Dès que le soleil paraît, l'humidité des
feuilles transperce les manches de nos manteaux et nos pantalons. Mais le
travail se poursuit sans que personne ne porte attention à ce fait et nous ne
pouvons que maugréer intérieurement. Peu importe ce qui peut
nous advenir en travaillant dans de pareilles conditions, la santé et la vie d'un
esclave pèsent moins que rien dans les mains de l'ennemi et la question
humanitaire ne se pose pas. Au cours de ces 28 jours,
notre salaire s'est élevé à 18 marks pour chacun des 10 hommes, ce qui va nous
permettre de faire quelques petits achats de choses toujours nécessaires. Mais
le gardien, jeune alcoolique, s'en charge lui-même, en disparaissant avec les
180 marks qui nous revenaient. « Adieu, veaux, vaches,
cochons et pommes de terre. » Le 7 novembre, nous allons vers d'autres lieux !
Pour peu que cela dure, la Poméranie n'aura bien vite aucun secret pour nous. IX KOMMANDO
D'USINE. Il est 4 heures du matin !
Un petit traînard poussif nous fait revivre, en sens inverse, le voyage que
nous avons fait quatre semaines auparavant, s'arrêtant aux haltes et dans les
petites gares de campagne pour embarquer quelques ouvriers matineux et charger
d'innombrables cruches de lait. Le travail de chargement
se fait avec la lenteur habituelle des « travailleurs forcés », la
plupart des polonais et sans aucun respect pour l'horaire. Au cours de ma
captivité, j'ai toujours constaté que, sur les lignes secondaires où de
troisième ordre, les chefs de gare en prenaient eux-mêmes, à leur aise discutant
ferme avec le chef de train ou le mécanicien, sans souci du retard occasionné. L'Oder réapparaît, Stettin
est traversé à nouveau. Nous descendons ~ 4 kilomètres au-delà de la grande ville,
à Finkenwald. A proximité de la gare, un terrain
d'aviation est aménagé, une soixantaine d'appareils y sont posés. Nous ignorons encore où
l'on nous conduit, mais bientôt de hautes cheminées d'usine se rapprochent et
nous pouvons lire sur le fronton d'une vaste entrée grillagée : « ZEMENTFABRlK » ou, autrement dit : Fabrique de Ciment. Après le travail au grand
air, le boulot dans la poussière grisâtre d'une cimenterie. Très peu
réjouissant ! Nous sommes rejoints par
16 autres prisonniers belges. Notre kommando groupe
donc 26 hommes. Un vieux bâtiment est mis
à notre disposition et nous l'aménageons de notre mieux. Cette fois, nous avons
un lit à étage, ou plutôt un assemblage de chevrons et de planches qui fait
penser à un lit. Depuis cinq mois que nous sommes en Allemagne, nous n'avons
pas encore vu ce genre de couchettes, ayant toujours dormi allongés sur le sol.
Le travail est extrêmement
dur, pénible et malsain, on le devine. La population ouvrière civile montre
assez bien d'indulgence envers nous et pour cause : parmi les 250 civils
environ au travail dans la cimenterie, il existe très peu de « nazillards ». Nous en avons connus qui avaient fait du camp
de concentration pendant trois ans et étaient toujours sous surveillance
spéciale. Le travail de nuit est
particulièrement esquintant ; il comporte surtout l'alimentation des fours rotatifs
et le déchargement des péniches. Les 12 heures de travail qui nous sont
imposées de nuit au débardage, sont très longues et ne sont pas compensées par
le repos diurne, ni par une « nourriture saine et abondante » dont se prévalent
les boches dans nos pays occupés et qui n'est qu'un appât publicitaire pour
attirer dans leurs rets nos jeunes ouvriers. Rentrant de nuit, à 2
heures ou à 4 heures, nous avons encore le triste courage de faire la chasse aux
poux dont les becs d'acier nous picotent le corps. Car nous avons des poux ! Nettoyer les malaxeurs, alimenter les fours rotatifs, décharger les
péniches. pousser les wagonnets, charger les sacs de ciment sur de hauts
camions, etc., sont autant de besognes auxquelles nous ne sommes pas accoutumés
; aussi, les contremaîtres nous harcèlent-ils plus que de convenance pour
obtenir de nous du rendement. 
Carte de la déportation entre Dinant et Stettin Je me souviens qu'un lundi
matin, une équipe de 8 prisonniers, arrivant à pied d'œuvre, refusa de prendre
le travail, prétextant n'avoir pas déjeuné, la ration de pain étant insuffisante.
Cette petite grève eut pour effet de nous faire obtenir 250 grammes de pain en
ration supplémentaire par semaine. Et cela nous valut aussi l'admiration des ouvriers
civils qui n'en croyaient pas leurs yeux de cette hardiesse. Cela fit l'objet
de leurs conversations pendant huit jours ; les camarades, eux, n'en parlaient
que pour en rire. Egalement, un soir, un
prisonnier perché sur un monticule de terre glaise, entonna à pleine voix le
chant de l'Internationale. La voix portait loin et résonnait dans le silence de
la nuit. Les civils allemands avaient arrêté leur travail et paraissaient en extase
devant l'audacieux chanteur. Néanmoins, le chant terminé, ils sermonnèrent le
prisonnier, lui faisant remarquer tout le danger auquel il s'exposait en extériorisant
ainsi pleins poumons une opinion défendue chez les nazis. Notre ami en rigola
bien. On commence à prendre de
la bouteille et la réaction se fait sentir chez nous. Il n'est pas rare que 12
prisonniers commencent le travail et de n'en plus retrouver que trois ou quatre
après une demi heure. Au contremaître alors de faire la chasse aux quatre coins
de l'usine pour retrouver les manquants. Le plus souvent, ceux-ci se tiennent
dans la salle des W.C. qui est pourvue du chauffage central ; un contremaître
ne peut empêcher quelqu'un, celui-ci fût-il un vulgaire prisonnier, de
satisfaire un besoin naturel, même si cela doit se répéter plusieurs fois
pendant la journée, car le prisonnier invoque toujours son cas spécial de
dysentérique. Bien sûr, le profane qui
ne connaît rien du prisonnier, trouvera l'endroit peu ragoûtant. C'est possible,
mais s'il interroge tous les prisonniers, de tous les kommandos,
de tout le Grand Reich, il apprendra que les waters ou « Abort
» étaient devenus un lieu de plaisance et de repos et que les Kgf ne se
faisaient point faute de les utiliser à longueur de journée. Le ciment use très
rapidement le cuir et les semelles de nos chaussures en périrent ; nous n'avons
rien pour les réparer. Les sabots et les « claquettes » font leur apparition.
Nos uniformes tombent en lambeaux, malgré nos efforts pour les conserver dans
le meilleur état possible. C'est dans cette usine que
nous passons le premier NOËL de captivité, enfermés dans notre vieux bâtiment
et n'ayant d'autre distraction que jouer aux cartes, ressasser les vieux
souvenirs, conter des histoires ou chercher l'isolement dans nos pensées. L'hiver est dur ! Le froid
atteint un degré inconnu dans notre pays. Des blessés, des malades parmi nous,
déjà ! Le 30 décembre, ce sera à
nouveau le voyage vers une nouvelle destination, toujours inconnue à l'avance. Vie de chien ! X STETTIN-BREDOW. Ce lundi, 30 décembre
1940, nos baluchons sur le dos, délaissant la Zementfabrik,
nous partons vers l'aventure. 
Le Kommando de Stettin-Bredow Sur le quai de la petite
gare de Finkenwalde, la bise noire qui semble suivre
le tracé des voies, nous torture le visage et les mains ; le thermomètre
indique 24 degrés sous zéro. Nous occupons les moindres recoins des bâtiments
afin de nous préserver de la morsure du froid et nous battons la semelle durant
trois heures avant d'être embarqués dans un train qui nous ramène, après
quelques minutes, à la Hauptbanhof de Stettin qui
commence à nous devenir familière. Nous reprenons ensuite, sur une autre voie,
le train qui nous conduira dans un faubourg de la ville, c'est-à-dire à Bredow où se situe le nouveau kommando
qui nous attend. Avant de poursuivre, il
est nécessaire d'ajouter quelques renseignements d'ordre documentaire qui, comme
on s'en apercevra plus tard, trouveront leur utilité dans la suite du récit. Stettin, capitale de la Poméranie et, ceci dit entre parenthèses, lieu
de naissance de l'impératrice Catherine de Russie, est par ordre d'importance
commerciale, le deuxième grand port d'Allemagne, Hambourg venant en premier
lieu et Kiel étant considéré comme port militaire. Située sur la rive gauche
de l'Oder, la rive opposée comprenant seul le faubourg de Lastadie,
Stettin possède une population de 280.000 habitants et est entourée en
demi-circonférence par des faubourgs dont la population est au moins égale à
celle de la ville. A l'entrée et à la sortie
de Stettin, l'Oder se divise en plusieurs bras, formant ainsi des îles
marécageuses et mettant la ville – au Nord – en communication avec la mer
Baltique. Bredow
est un faubourg situé au nord de la ville et le camp de prisonniers est installé
le long d'une voie ferrée. Cette ligne de chemin de fer, partant de la Hauptbanhof, effectue un trajet semi-circulaire autour de
la ville, puis se dirige vers le nord où elle trouve son point terminus à Ziegenort, petite cité balnéaire sise sur l'estuaire de
l'Oder. Etablie sur un parcours de 42 kilomètres, cette petite ligne fut
construite par les prisonniers russes en 1914-18 et est à voie unique ; le
croisement des trains se fait dans les gares. Pour autant que nous ayons
pu en juger, cette voie de communication doit être d'un rapport déficitaire. Bâtie
sur un talus sablonneux dans la majeure partie de son parcours, des
affaissements continuels du terrain nécessitent une main-d’œuvre importante de
piocheurs et autres qui rend l'entretien très coûteux. Ce ne sont qu'équipes
nombreuses de polonais, prisonniers belges et français et, plus tard, prisonniers
russes, puis italiens. Mais elle a l'avantage d'acheminer, chaque jour, des
milliers d'ouvriers vers les usines installées le long de l'Oder. Dès Bredow,
en effet, en se rendant vers le Nord, nous trouvons l'Oderwerk,
la Gollnow und Sohn (usine de sous-marins), une cimenterie, deux chantiers
navals, une usine métallurgique, une papeterie (5.000 ouvriers), une fabrique
de munitions de guerre et d'autres encore, mais surtout, la fameuse usine
d'essence synthétique de Pôlitz qui emploie, à elle
seule, près de 25.000 ouvriers. Cette dernière est ceinturée par un cordon de
maisons ouvrières en construction à l'époque qui nous occupe, tandis que plus
de 200 « saucisses de protection » se balancent à quelque 2.000 mètres de
hauteur. Journellement, la voie de chemin
de fer s'écrase au passage de dizaines de convois acheminant, vers l'usine, le
charbon qui sera converti en benzine et ramenant vers l'intérieur du pays les
wagons-citernes de ce précieux produit. Le kommando
qui vient de nous « accueillir » appartient à la Reichbahn
; il est affecté uniquement à ses services et, en ordre principal, à
l'installation d'une seconde voie de chemin de fer, avec tout ce que cela comporte
de travaux complémentairement obligatoires, tels que construction de viaducs et
de talus, travaux de terrassement, bétonnage, etc. Les 5 à 6 cents prisonniers
belges et français du camp de Bredow sont répartis
entre diverses firmes ayant l'entreprise de ces travaux, ce qui justifie le nom
de « Sammelarbeitskommando .» qui désigne ce camp. Au moment de notre
arrivée, le camp disparaît sous la neige et les baraques laissent pendre aux rebords
des toits une lignée impressionnante de stalactites qui démontrent bien les rigueurs
de l'hiver en cette région, si l'on n'en ressentait les effets. Composé uniquement de
baraques (logements, cuisines, lavoirs, etc.) ce camp planté dans la neige, fait
immédiatement sur nous la plus mauvaise impression. Nous allons connaître la
vie du prisonnier dans ce qu'elle a de plus pénible, de plus triste. Le kommando
est dirigé par un sous-officier ayant des sous-ordres et étant lui-même sous le
contrôle d'un feldwebel qui sera notre bête noire jusqu'à la fin de notre
captivité. Plus tard, un feldwebel, secondé par un unterfeldwebel
présidera à demeure aux destinées du kommando.
Affligés de 25 à 30 sentinelles, nous sommes sous surveillance continuelle,
avec tous les ennuis que cette situation crée fatalement. Notre horizon se
borne, pour ainsi dire, aux barbelés qui nous entourent, car le camp est
installé dans une cuvette ; seul, l'Est nous accorde une échappée sur la ville
de Stettin. Bredow
fut toujours considéré par les autorités militaires de contrôle, comme camp de
discipline de Stettin et les mesures de représailles à l'égard des prisonniers
des nombreux kommandos de la ville, se résumaient en
deux mots : Nach Bredowlager.
Nous n'en avons jamais connu le motif ; peut-être fallait-il faire naître la
crainte ou était-ce plutôt en raison du travail de forçat qui nous était imposé
? C'est dans ce kommando que, mes camarades et moi, nous passerons la
majeure partie de nos cinq années de captivité et que naîtront bien des
misères, et des drames. XI LE TRAVAIL AU
XII-I06. C'est la pleine nuit
encore ! Un coup de sifflet strident vient de parcourir les baraques, auquel a
répondu une série de grognements peu amènes et des imprécations les plus
diverses. Peu à peu, chaque « stube » se réveille et
l'animation grandit. Un camarade apporte la cruche d'eau chaude que l'on pare du
nom de café ou, plus simplement de jus. Chacun s’en sert un gobelet et remplit
sa gourde Il faut faire vite. En effet, des coups de sifflet répétés, suivis d’appels rauques,
nous invitent à sortir des baraques et à nous placer en colonne pour
nous rendre au boulot. Ceci fait, feu blanc par devant et lanterne rouge
à l'arrière, nous nous enfonçons dans la nuit, en silence et mal
réveillés encore, pour atteindre la petite gare de ZulIchow
où nous devons prendre le train qui nous conduira sur les lieux
du travail. 
Un groupe de P.G. de la « Firma Hamann » du camp de Stettin-Bredow En 1941, le réveil était « sifflé » à 3 h. 30 et les colonnes
quittaient le kommando à 4 h. 15 pour ne rentrer, le
soir, qu'à 18 heures. Ce seul fait suffit à démontrer que la fatigue était
notre seule compagne tenace de tous ces mauvais jours. 
Photo du Roi Léopold III, envoyée à tous les P.G. belges à Noël 1941 Le chantier se trouve à Messenthin, petit village voisin de l'Oder et à proximité
de la mer Baltique. Il s agit d y construire un pont de chemin de fer. Travaillant au sommet d'un
talus d'une vingtaine de mètres de hauteur, nous sommes exposés, à l'âpre bise
du matin au soir. Le début de l'année 1941 est particulièrement déprimant ; la
température minima que nous avons pu relever au thermomètre se situait à 38
degrés sous zéro, à 9 heures du matin. Les coups de pioche dans le sable durci par
le gel n'enlèvent que des plaques larges comme des pièces de cent sous. Les chutes de neige sont
abondantes et tellement drues que, parfois, on n'y voit plus à dix mètres. Dans
de telles conditions, le travail ne pouvait se faire qu'avec un équipement
vestimentaire plus que complet et qui comprenait pour la plupart des
prisonniers : deux passe-montagnes, une ou deux écharpes, un ou deux
pull-overs, la veste, la capote militaire, des moufles remontant jusqu’aux
coudes, etc., sans oublier les « fusslap » qui s
enroulaient autour de nos pieds et de nos chevilles Nous nous arrangions au
mieux pour exécuter le travail, le dos tourné vers le Nord, pour éviter la persécution
de la bise. Deux mots seuls, qui valaient des ordres, avaient le don d'être bien
accueillis : « Frühstück » et « Mittagessen
». C’était alors la galopade vers la baraque qui nous abritait à ces moments du
petit déjeuner et au repas de midi, pour y prendre de maigres collations qui
font penser à l'abstinence du temps de carême sous sa forme la plus poussée. Mais
nous étions sûrs d'y trouver un bon feu que nous avait préparé un camarade et cela
seul nous réjouissait. Malheureusement, il ne
nous était accordé qu’une demi-heure et le moment était bien vite arrivé où le
contremaître, alcoolique invétéré, nous invitait à reprendre le travail par
cette courte phrase haineuse : « Heraus der Krankenstall », car c’était
bien ainsi qu’il dénommait notre baraque : l'écurie des malades. Posément, traînant la
jambe, se laissant injurier par cette immonde brute de « polier
», le prisonnier retournait au boulot, dont le gros œuvre était le terrassement
de milliers de mètres cubes de terre. Par la suite, les travaux
d'étançonnage nous firent manipuler de lourdes
poutrelles en bois et en fer. Puis, ce furent les travaux de « Stiefbeton » qui consistaient à creuser, jusqu'à 12 mètres
de profondeur, des trous de 32 cm, de diamètre, que l'on emplissait ensuite de
béton. Ces pieux constituaient les assises sur lesquelles s'élèveraient les
piles du pont. Ce travail se faisait par un système de main-d’œuvre très dur et
très fatigant, enlisés que nous étions dans la boue jusqu'à mi-jambe. Ce travail,
qui dura près d'un an, n'était pas exempt de dangers, mais il fut aussi pour
nous l'occasion de nous livrer au sabotage, chose dont il sera parlé plus tard. Le travail fut
particulièrement tuant lors des travaux de bétonnage. Le contremaître était continuellement
sur place, nous harcelant de ses propos injurieux pour activer le travail. Mais les ressources du
prisonnier sont infinies lorsqu'il s'agit de tirer au flanc et toute la variété
d'emploi du système D était mise en œuvre pour retarder les travaux. Je citerai notamment le
cas de ce camarade qui avait le talent de dérégler le moteur actionnant la bétonneuse,
ce qui avait pour effet de mobiliser tous les ouvriers allemands du chantier,
appelés à ausculter le patient, à donner leur avis, à procéder à des
démontages, remontages et essais successifs qui duraient parfois pendant des
heures. Ce camarade savait varier les pannes et profitait du moment d'une pause
pour exécuter son coup en toute tranquillité. Après plusieurs mois de
travail à la firme Hamann, les prisonniers n'avaient jamais touché les 70
pfennigs de leur salaire journalier. La « Lôhnlist »
(liste de paye) était cependant envoyée chaque semaine, à Berlin, par le
comptable allemand, mais le contremaître qui recevait l'argent en retour, avec
charge de le distribuer, le mettait mieux à profit en s'emplissant de « schnaps
und flaschenbier » à la
buvette de la gare et dans les cabarets du village. Ce fut là un nouveau
prétexte pour ralentir sérieusement le travail et on ne fut pas surpris, un jour,
de trouver en des endroits différents, une vingtaine d'inscriptions à la craie :
« Kein geld ! kein Arbeit ! ». Le contremaître,
entra dans une rage folle, s'empressa de faire le tour du chantier pour laver les
mots compromettants pour son avenir et sa sécurité et envisagea enfin de nous
payer chaque semaine. Cet alcoolique devait
finir ses jours tragiquement, en France, au cours d'une rixe de cabaret ; il
dirigeait, à ce moment, les travaux de défense au fameux mur de l'Atlantique. Ces deux exemples, pris
entre mille, montrent bien que le travail du prisonnier se faisait au ralenti et
si, le soir, dans les baraques du kommando, les voix
s'élevaient au cours de vives discussions, il ne fallait pas chercher d'autres
motifs que celui du reproche fait à ceux qui avaient montré trop d'ardeur au
cours de la journée. Quoi qu'il en soit, après
deux ans et demi, le pont n'était pas encore terminé. La conception du peintre-dictateur
de remplacer l'étalon-or par l’étalon-travail dans l'économie du pays devait
fatalement aller à un échec par l'emploi de la main-d’œuvre « prisonniers ». Néanmoins, malgré toute
notre volonté de freiner, la fatigue ne s'en faisait pas moins sentir et nous
rentrions au camp, chaque soir, bien fatigués. Le réveil trop matinal, la
station debout pendant les longues heures de la journée, l'insuffisance de repos
(on travaillait même le dimanche) et de nourriture, ainsi que l'affaiblissement
moral, faisaient de nous des êtres dont le ressort se détendait de jour en
jour. Seule, une volonté de résister, de revoir les siens, nous donnait la
force de faire face à ces conditions déficientes de vie. Quelques civils allemands
étaient aussi occupés sur ce chantier et tous faisaient figure de maîtres vis-à-vis
de nous. Aussi, toute besogne exigeant un effort physique un peu plus
important, nous était désignée. Souvent, par mauvais temps, les civils
regagnaient leur baraque et il ne nous était pas permis de les suivre, il
fallait œuvrer sous la drache. Le soir, nous rentrions au kommando,
trempés jusqu'aux os et, le lendemain, on reprenait le chemin de Messenthin, avec les vêtements mouillés de la veille. Aussi, le groupe des 48
prisonniers belges et français occupés sur ces travaux n'était-il jamais au
complet, il y avait toujours des absences dues aux maladies et aux accidents.
Ceux-ci étaient fréquents et on ne comptait plus les doigts et les orteils écrasés,
de même que les blessures à la tête et les coups au corps. Pour se restaurer, pendant
la journée, nous prenions habituellement un morceau de pain de l'épaisseur
d'une boîte à allumettes, que nous divisions en quatre fines tranches. Et, au
cours de la première année, c'était une aubaine de pouvoir se procurer quelques
pommes de terre. Cuites, la veille, nous les mangions froides, le lendemain ;
c'était autant de gagné sur la ration de pain. Parmi nous, deux camarades doués
d'un bon appétit, ne pouvaient se contenter de ces tartinettes
et, au réveil, avalaient leur ration entière de pain et se mettaient la
ceinture jusqu'à la distribution de soupe, le soir. Rentrés au camp, il y
avait enfin un peu de détente. Se retrouver tous à la fin de la journée était le
seul bon moment que nous apprécions après ces dures et longues heures de
travail. XII LE CAFARD. La vie normale d'un homme
a été rompue brutalement et cet homme a été appelé à connaître toutes les
misères d'une vie inhumaine : la faim, le froid, la vermine, les travaux
forcés, les mauvais traitements, etc. Mais il est une chose particulièrement déprimante
entre toutes, c'est l’état d'isolement dans lequel il se trouve, c'est-à-dire
privé du contact affectueux de ses parents, de sa femme, de ses enfants, que
l'amitié de ses camarades ne remplacera jamais ; privé de tout ce qui faisait
sa joie de vivre, il se sent presque abandonné. Et il s'ensuit une dépression
mentale terrible qui vient le torturer. C'est le cafard ! Nous avons tous connu
cette petite bête qui nous trottinait dans le cerveau et faisait de nous des
êtres sans volonté, des loques humaines. Toute la tension, d'esprit converge
vers un seul but : revoir les siens... au plus tôt. Les plaisanteries, la
lecture, un spectacle monté en kommando, ne
réussissent pas à vous tirer de cet état d'abattement dans lequel vous êtes
plongé. Plus rien n'existe autour de vous, l'esprit reste fixé vers de tendres
images. Vous voyez votre place vide au foyer et vous la réoccupez, vous parlez
aux vôtres et ils vous répondent ; votre petit dernier vous entoure le cou de
ses bras câlins. Oui, ils sont tous là ! Et de cette vision, vous
vient une souffrance qui vous fait dire avec le Christ : « Mon âme est triste
jusqu'à la mort ». C'est le cafard ! Le cafard ! Agonie du cœur
et de l'esprit ! Cela fait mal, au point que beaucoup d'entre nous ont sombré
dans la folie et que d'autres ont mis fin à leurs jours. Ce beau et vigoureux
garçon, couché sur sa paillasse, pleure silencieusement et son
silence n'est qu'un ardent appel vers les siens. Depuis de longues heures, il
est là, étendu sur sa couchette, insouciant de ce qui se passe autour de lui,
n'entendant rien des bruits de la baraque. L'heure de la distribution de soupe
est passée depuis longtemps déjà, sans que rien l'en ait averti, il ne peut
avoir faim. Il ne vit que par le mal qui l'étreint. Ce jeune homme, appuyé sur
sa pelle, n'a nulle envie de travailler. Sa pensée erre par delà la frontière en
un décor plus familier. De lourds sanglots gonflent sa poitrine, deux sillons
humides sont tracés sur ses joues. Il n'entend pas le contremaître qui, de
loin, le morigène. Pour lui, tout est abstrait et il faudra que l'obligeance
fraternelle d'un camarade vienne le rappeler à la réalité. C'est le cafard ! La lueur
du jour disparaît, tout est nuit dans l'âme ! Chacun de nous a connu ces
moments de sombre désespoir et reconnaît qu'il n'est rien de pire ; les douleurs
physiques ne sont en rien comparables à ces souffrances morales. On a maintes
fois dit et écrit que les prisonniers étaient doués d'un bon moral mais
celui-ci n'exclut pas les moments tristes et tel qui, aujourd'hui, faisait
montre d'un optimisme des plus réconfortant, sombrait, le lendemain, dans un
abattement qui le laissait meurtri pendant plusieurs jours. Collectivement, le moral
était excellent mais individuellement, chacun subissait à tour de rôle l'emprise
poignante du cafard. Qu'est-ce donc qui pouvait provoquer chez les prisonniers
cet état de démoralisation ? Peu de chose parfois, un
geste, une pensée. Une lettre que l'on écrit et que l'on arrose de larmes ; celle
que l'on reçoit et qui contient une mauvaise nouvelle. La photo des êtres aimés
que l'on vient de sortir du portefeuille, alors qu'on y cherchait autre chose.
Un camarade qu'on vient de conduire à sa dernière demeure. Une bonne nouvelle
qui vous remplit d’espoir et qui s’avère fausse par la suite. Quel est celui qui ne
craignait, le dimanche matin, d'entendre les cloches des églises appeler les fidèles
à l'office religieux. Ces sonneries de cloches sont les mêmes partout et nous
ne pouvions les entendre sans éprouver un serrement de cœur et porter immédiatement
nos pensées vers la petite église du village ou la cathédrale de la ville où
nous avions coutume de nous rendre à pareille heure, il n y a pas si longtemps,
lorsque nous étions encore des hommes libres. Il ne faisait pas bon
s'attarder à ces pensées, c’était dangereux, car le cafard vous atteignait comme
une flèche, vous étiez marqué ; il s'installait à son aise, vous étiez à sa
merci. C'était la torture morale dans ce qu'elle a de plus triste, de plus
douloureux, de plus poignant et, pour tous, provenant de la même aspiration :
revoir les siens, son pays. Cet état de démoralisation
individuelle exista surtout au cours des deux premières années de captivité.
Par la suite, le cafard perdit son agressivité virulente pour ne plus conserver
qu'un caractère bénin. Tout espoir de retour au
foyer était perdu et nous nous rendions compte que seule la fin de la guerre
nous apporterait la délivrance. Nous suivions attentivement les événements et
le moindre échec des armées allemandes était commenté avec enthousiasme.
L'annonce de la capitulation de l'Italie, en septembre 1943, fit naître un
espoir fou de la guerre abrégée ; la retraite de Russe était suivie
minutieusement sur les cartes d’Etat-Major sorties
précautionneusement des cachettes. Tous nos espoirs se concrétisaient, cette
fois, sur des faits probants et le cafard ne pouvait plus nous atteindre à l'éclosion d'une
nouvelle plus ou moins fantaisiste. D'autre part, nous étions
mieux adaptés par le temps à notre situation. L'égoïsme qui, il faut bien le
dire, s'était installé en nous aux premiers temps de la captivité, était à tout
jamais banni ! Nous nous étions ressaisis et la franche camaraderie rayonnait
parmi nous. Des groupes se sont
formés, composant des ménages bien souvent disparates, ou l’intellectuel se retrouve
aux côtés du primaire et l'industriel coudoie l'ouvrier, mettant en commun les
bonnes choses reçues dans les colis et cherchant ensemble à améliorer
l'ordinaire par tous les moyens en leur possession. Les différentes classes de
la société ont opéré leur soudure dans le malheur et la misère. La plus profonde
amitié nous unit ; l'égoïsme du début a fait placé à la grande et noble fraternité
d'âme tant souhaitée par d'éminents sociologues et pacifistes. A ce moment, le cafard
était vaincu ! XIII LA VERMINE. Dans le chapitre
précédent, nous avons pu lire comment nos facultés mentales étaient affaiblies sous
le coup du cafard. Ce n'est plus de cette vermine morale que nous nous
entretiendrons ici, mais de la vermine tout court, qui ajoutait amplement à
l'autre par la persécution incessante de ces petits insectes qui sont les poux,
les puces, les punaises. Les poux, nous apprend-on,
sont de deux espèces : les poux de tête et les poux de corps ; c'est à ces
derniers que nous avons à faire. Les poux de corps se
rencontrent surtout sur les personnes malpropres ou affaiblies et, partant, il se
trouvait tout naturel qu'ils fassent partie des bagages du prisonnier de
guerre. On a pu comprendre, en effet, que la vie misérable que nous menions
pendant les premiers mois de la captivité, nous prédisposait à l'invasion des
poux. Cela ne pouvait manquer, nous en fûmes infestés. Le pou de dos, petit insecte transparent,
n'est facilement repérable que lorsqu'il est gorgé de sang, son appareil
digestif laissant alors apparaître une tache noire. On le rencontre surtout sur
le dos, la poitrine et sous les, aisselles. Il peut être porteur de germes, de
maladie, le typhus notamment et c'est bien ce qui nous inquiétait. Les poux se multiplient
avec une rapidité effarante, au point que quelques « totos » sur le corps d'un
homme, pouvaient infester toute une baraque en l'espace de quelques jours. La démangeaison
provoquée par leurs suçoirs piqués dans la peau était agaçante et insupportable
et le grattage qui s'ensuivait nécessairement ne faisait qu’aviver le chatouillement. Naturellement, des chasses
étaient organisées et faisaient pas mal de victimes, mais les œufs éclos pendant
la nuit pourvoyaient au remplacement des pondeurs qui avaient éclaté la veille
entre deux ongles. Je me souviens que à la Zementfabrik, après 12 heures d'un travail qui prenait fin
à 2 heures ou à 4 heures de nuit, notre premier souci, avant de nous mettre au
lit, était d'enlever nos chemises, de les fouiller jusque dans les moindres
coutures pour y détruire les malsaines bestioles qui s'y trouvaient réfugiées.
Notre œil exercé nous faisait découvrir des poux dont la grosseur n'était pas
supérieure à la pointe d'une épingle. Il n'était pas aisé de
nous en débarrasser car, ne possédant qu'un seul foyer et un petit bassin qui servait
à bouillir le linge, il fallait plusieurs jours pour que chacun de nous ait eu
son tour de lessivage, laps de temps suffisant pour permettre à la vermine de
se propager et de se multiplier. Une seule fois, le 21
janvier 1941, on procéda à notre désinfection dans une caserne de Stettin. Journée
inoubliable ! Il gelait à pierre-fendre, la couche de neige était de 40 cm. et
nous étions en sabots. Nous quittions le kommando à 5
heures du matin, après avoir brûlé la paille de nos grabats. Nous nous étions
chargés de tout ce que nous possédions en matière de linge, couvertures, toile
de paillasse, etc. Le trajet dura 2 heures et demie et transis de froid, on
nous enferma dans une salle non chauffée et complètement dévêtus. On se lava dans
une eau plutôt froide que tiède et, détail comique, on se rinçait l'un l'autre,
par le moyen d'un arrosoir. Cela dura environ deux
heures, après quoi nous nous acheminions vers le kommando,
dont les baraques, elles aussi, avaient été désinfectées par le soufre. Le soir,
certains camarades retrouvaient dans leur linge, quelques « toros
» échappés à la destruction. On pouvait recommencer Néanmoins, par le grand
souci que nous avions de vouloir nous débarrasser de cette obsession qu'était
la, vermine, par des lessivages répétés et par un excès de propreté, compte tenu
de nos difficultés en ce domaine, nous finirons par exterminer le dernier pou.
Jusqu'au jour, en 1945, où vivant dans des circonstances semblables à celles du
début nous verrons les poux réapparaître. Détail amusant ! Le
prisonnier s'ingéniait à faire partager ces mêmes ennuis par les sentinelles
allemandes. Et je revois ce gardien qui, à l'annonce que nous lui faisions de
la découverte de poux chez nous, s’était reculé avec dégoût et peu rassuré. Il
ne, devait pas tarder, à son tour, d'éprouver les mêmes chatouillements que les
prisonniers. Ce fut à l'occasion d'une
douche qu'il venait prendre au moment où nous finissions de prendre la notre.
S'étant dévêtu, il avait tiré le rideau qui le masquait à nos yeux ; ce que
voyant, un camarade en profita pour faire la chasse aux poux et déposer ceux-ci
délicatement sur la chemise du schleuh. Et alors !... Dans certains kommandos, les sentinelles se payaient le luxe d'employer
un prisonnier comme ordonnance, au même titre qu'un Hauptmann. La vanité les
avait bien mal inspirés car, dans les baraques, on songeait à la vengeance. Le
gibier que l'on trouvait sur les chemises, le soir, lors de la chasse
quotidienne, était enfermé dans des boîtes à allumettes et déversé le lendemain
matin, dans les lits des sentinelles. C'était commercial, nous leur étions
redevables de cette vermine, nous les remboursions à la petite semaine. Dès 1942, nous devions
connaître une autre invasion : celles des puces, à laquelle nous accordions toutefois
moins d'importance, mais n'en était pas moins désagréable. A différentes
reprises, on dut procéder à la désinfection des baraques, mais sans arriver
jamais à un résultat positif, si ce n'est empester nos couvertures et nos
palliasses. Une conséquence dangereuse
de la piqûre des puces fut surtout la provocation de plaies ulcéreuses aux
jambes, amenées par le grattage. Un peu de sang apparaissait tout d'abord et on
ne s'en souciait pas, puis les chairs se décomposaient sans que le sang, vicié
par un régime alimentaire trop pauvre, ne puisse y remédier. La furonculose
sévissait aussi parmi nous, à cette époque, sans que je veuille toutefois
l'attribuer à la même cause. Nous avions acquis une
certaine dextérité pour attraper les puces et cela se faisait d'une façon si naturelle
et tellement courante, que personne n'y prenait garde : Un gars se baissait,
glissait un doigt mouillé sous sa chaussette sans qu'il faille y jeter les yeux
et ramenait une puce qu'il broyait entre le pouce et l'index. Personne ne s'inquiétait
de la présence des puces, alors qu'il en allait différemment lorsque nous étions
pouilleux. Les punaises aussi se
mettront de la partie et leur apparition fera naître beaucoup de craintes parmi
les prisonniers dans le kommando, ce ne sera pas la
grande invasion, néanmoins, il fallait souvent désinfecter les bois de lit pour
éviter la propagation de ces bestioles. Dans un Lazarett où j'ai
séjourné pendant plusieurs semaines, chaque lit était infesté de punaises et il
était normal qu'un nouvel arrivant, avant de prendre possession de sa
couchette, détruise deux à trois cents punaises réfugiées sous la paillasse et
ce, en l’espace de quelques minutes. La nuit, c'était un
continuel va-et-vient dans les chambres. Après avoir fait la lumière, les couvertures
étaient rejetées et on se livrait de bon cœur au massacre des punaises qui
avaient commis l'imprudence de venir se promener sous les « draps ». Il s'en
dégageait une odeur peu faite pour nous plaire, mais que nous ne pouvions
éviter. D'autres se servaient d'une poudre insecticide qu'ils avaient réussi à
se procurer par le système D et délogeaient les punaises qui s'en allaient
chercher refuge dans les lits voisins. Pour enrayer ce fléau, ces
lits ont été démontés des centaines de fois, mais pour arriver à un résultat appréciable,
il eût fallu démonter les plinthes et les boiseries des murs, chose que nous ne
pouvions risquer sans nous attirer les foudres d'un Feldwebel toujours à
l'affût pour nous chercher noise. Au kommando,
cependant, nous serons un jour débarrassés de toute cette vermine, de même que
des rats qui rongent le plancher de nos baraques, la nuit ; mais, il faudra une
catastrophe que nous redoutions intensément : un bombardement qui réduira en
cendres les baraques et tout ce que nous possédions. XIV CANARDS ET
BOUTEILLONS. Comme on le sait, on donne
le nom de « canards » aux fausses nouvelles qui se répandent dans le public à
propos de choses ou d'événements auxquels chacun se passionne ou s'intéresse. C'était aussi le terme
normal par lequel le prisonnier accueillait toute nouvelle, fausse ou vraie, qui
parvenait jusqu'à lui dans les stalags et les kommandos.
Les prisonniers français, dans leur idiome argotique, lui donnait le nom de «
bouteillon », ce terme impliquant sans doute mieux la « mise en bouteille »
de ceux dont la naïveté accorde un trop facile crédit aux nouvelles
fantaisistes. Les canards existaient
chez les prisonniers à l'état endémique, en ce sens que les uns ne disparaissaient
que pour faire place à d'autres. Ils se propageaient avec une rapidité
croissante, atteignant de lointains kommandos isolés
dans un minimum de temps, mieux et plus sûrement que le tam-tam des nègres. Pendant les douze premiers
mois de la captivité, le canard-type le plus répandu était, certes, celui qui
traitait du renvoi des prisonniers dans leurs foyers. Nous étions en Bochie depuis 3 jours que, déjà, de vagues chuchotements
d'un retour probable se percevaient. A notre arrivée à Neubrandenbourg,
après avoir croisé des prisonniers hollandais qui regagnaient leur pays, les
nombreux commentaires que l'on fit à leur sujet, se transformèrent rapidement
pour prendre la forme ailée que l'on sait. Au stalag
d'immatriculation, des camarades « bien renseignés » affirmaient que les
formalités auxquelles nous étions soumis, étaient rendues nécessaires par le
court séjour que nous devions faire en Allemagne, c'est-à-dire le temps
d'effectuer la fenaison et la moisson. Après quoi, on serait heureux de se
débarrasser de nous, encombrants que nous serions, en hiver, chez les fermiers.
Le foin était au fenil et le grain battu, lorsqu'on nous rappela qu'il y avait
d'immenses cultures de pommes de terre en Poméranie, à l'arrachage desquelles nous
étions indispensables et que viendrait ensuite celui des betteraves, travaux
qui pouvaient nous conduire jusqu'à la mi-décembre. Alors, seulement. on
penserait à nous rapatrier. En novembre 1940, les
premiers échos de la libération des prisonniers nous parviennent à l'usine où
nous venons d'être affectés. Et de fait, quelques journaux nous arrivant, en
décembre, relatent la rentrée de prisonniers au pays. Un espoir sérieux nous
envahit et cela nous vaut, pour quelques jours, un moral porté au zénith. Les semaines passent, les
espoirs se renouvellent constamment sous l'effet de bouteillons toujours les
mêmes : notre libération est en voie de réalisation. Les 8 et 11 février 1941
les flamands réservistes, au nombre de 191, quittent le kommando
de Stettin-Bredow au milieu des adieux touchants de
ceux qui restent. A quand notre tour ? Une crainte subsiste malgré tout et on
n'ose leur dire : « A bientôt ». Heureusement, car pour
nous, ce sera tout, alors que dans d'autres stalags, les départs se
poursuivent. Les 21, 22 et 23 mai 1941, les trois derniers convois emporteront
5630 prisonniers vers la Belgique et, avec eux, notre dernière illusion.
L'annonce du conflit entre la Russie et l'Allemagne, le 20 juin, anéantira en
nous toute idée de retour, sinon par le seul moyen des trains sanitaires, car
nous sommes toujours à la veille d'un accident de travail ou de la maladie. Il faut reconnaître que,
jusque là, les canards, vrais ou faux, ont influencé considérablement le moral
du prisonnier. On se raccrochait à une bonne « nouvelle » avec l'espoir du noyé
qui vient de toucher le bras sauveteur. Tout était prétexte pour commenter
favorablement toute allusion même indirecte, à notre retour. La vie morale du
prisonnier, pendant la première année, fut un long film d'espérance dont les
images s'arrêtaient de temps à autre pour laisser apercevoir un large trou noir : c'était le cafard
dans toute sa crise désespérante. Puis, on se reprenait à vivre sur un simple
renseignement dont on ignorait la source. C'était ridicule, mais normal ; notre
déficience mentale, autant que physique, en était la cause involontaire et nous
en souffrions tellement. Qui ne se rappelle la
rentrée dans les baraques, chaque soir, après une longue journée sur le
chantier : « Pas de canards ? Rien de nouveau ? » On espérait ! C'était de
l'obsession collective ! Les Allemands ne
manquaient pas d'exploiter cet état d'esprit pour un rendement meilleur du
travail étant donné l'influence moralisatrice de l'idée du retour et la plupart
des bobards venaient d'eux. A notre tour, nous
arrivions parfois à exploiter les canards au détriment des sentinelles ou des
ouvriers allemands, dans le but de leur nuire, comme aussi à l'effet de sortir
d'embarras. Tel l'exemple qui va suivre : Lorsque, le travail
terminé, nous arrivions sur le quai de la petite gare de village où nous
attendions le train qui nous ramènerait à Stettin, nous devions nous placer par
rangs de cinq hommes. Un soir, alors que, à dix prisonniers, nous avions pris
place sur les bancs du quai, s'amena l'Oberfeldwebel Bartholomé,
notre bête noire. Nous n'y coupions pas, son long sabre allait encore une fois
nous chatouiller les côtes et les reins. Nous nous étions levés et avions pris
la position qui convient. Un camarade nous dit à mi-voix : « Laissez-moi faire »
et s'avançant vers le soudard, se cale en position et lui dit : – Adjudant, puis-je vous demander un
renseignement ? – Pien sûr, répond le
Fe1dwebel. – On dit, reprit le prisonnier,
que les Belges vont bientôt rentrer chez eux. Nous aimerions connaître votre
avis, car vous êtes certainement bien renseigné sur la question. – Il y a, en effet, du
frai tans ce que fous racontez. Ch'en ai entendu
parler dans les pureaux du Kontrollstell. Mais pour
les Pelches seulement, pas les Français. – Merci, adjudant. – Ce n'est rien. Vous pou
fez fous asseoir. On n'était pas plus
aimable. Plutôt que de nous octroyer la bastonnade, le sbire préférait affecter
une amabilité excessive et ne pas détruire en nous l'illusion du retour.
Survint ensuite un groupe de prisonniers français que le feldwebel fit ranger
par cinq, d'une façon autoritaire. Et tout cela se passait à
une époque où nul prisonnier n'espérait plus un retour prématuré car, la
première année écoulée, l'illusion avait disparu et un bouteillon traitant du
retour était accueilli avec scepticisme par les uns et indifférence par les autres.
On acceptait la nouvelle sans y attacher d'importance, on verrait plus tard si
le renseignement se vérifiait, sans plus. A partir de juin 1941, les
canards avaient trait principalement aux événements stratégiques ou
diplomatiques et si ceux-ci contenaient habituellement un fonds de vérité, il
faut reconnaître qu'ils étaient bien souvent en avance de plusieurs semaines sur
la réalité. On pratiquait la méthode anticipative et cela nous aidait
puissamment à tenir le coup, à espérer. Je me souviens que, un
camarade, dans un but purement expérimental et sans mauvaise intention, lança,
un jour, une balourdise de dimension. Il s'agissait d'un événement qui, à
l'époque, était pratiquement irréalisable. On y crut ferme pendant deux jours,
on en douta le troisième, puis on n'en parla plus. La réflexion tardive avait
conclu à l'inanité de pareil canard. Mais, je le répète, on s'accrochait à tout
ce qui pouvait nous être favorable. Dès 1943, la diffusion des
nouvelles prendra une évolution plus sérieuse et il sera plus rarement question
de canards ou bouteillons, car la radio clandestine fonctionne dans de nombreux
kommandos et, par elle, nous obtenons des
renseignements précis et pouvons suivre les événements au fur et à mesure de
leur développement. L'inquiétude du début a
fait place à une sérénité d'esprit qui nous permet d'apprécier les nouvelles à
leur juste valeur. Et ce n'est plus, dès lors, qu'une longue attente, que toute
victoire des alliés vient raccourcir d'un bout. Aussi, la deuxième période
de la captivité peut être citée comme exemple de la patience. XV LES ALERTES
DU DÉBUT. FATALITÉ. Nos cinq années de
captivité furent marquées fréquemment par des alertes aériennes, dont
quelques-unes ont laissé en nous d'impérissables souvenirs, en raison de leur
violence ou de la fatalité qu'elles engendraient. Pendant ces années, nous
avons enregistré des centaines d'alertes, les unes sans grande conséquence, les
autres catastrophiques. Il est bien peu de prisonniers dont les nerfs n'aient
été mis à l'épreuve au cours de dangereux bombardements et qui n'en conservent
les traces par une tension nerveuse qui peut paraître exagérée à certains, mais
qui n'est que la conséquence fatale des dangers courus. Au début de juin 1940, les
sirènes se firent entendre à plusieurs reprises au cours des six jours passés du
vélodrome, de Dortmund et, une nuit, deux bombes anglaises sont tombées en
plein centre de la ville, détruisant trois immeubles. En août, septembre et
octobre de la même année, des alertes encore, quelques bombes lâchées au
hasard. Une nuit, cependant, les avions anglais visent un objectif précis : le
pont sur l'Oder, à Retzowsfeld, point de départ de
l'autostrade Stettin-Berlin. On a l'impression que ces bombardements légers, que
l'on peut qualifier d'inoffensifs, si on les compare à ceux des deux dernières
années, sont entrepris en vue de démentir les paroles du Maître de l'Allemagne
: « Les dispositions de défense aérienne sont prises, de telle sorte qu'aucun
avion ennemi ne pourra violer le territoire allemand ». La défense du port de Stettin est organisée
rapidement et, dès novembre 1940, une DCA nombreuse est installée sur les
coteaux qui bordent la ville, voire même dans les faubourgs, là où il existe des
surélévations de terrain, Les quartiers Nord sont particulièrement bien garnis,
de nombreuses pièces pointent leurs tubes vers le ciel, afin de défendre non seulement
les usines situées le long de l'Oder, mais aussi les sous-marins abrités dans
leurs refuges, ainsi que l'usine d'essence synthétique de Pôlitz. Le 28 novembre, une alerte
sérieuse nous convaincra que tout a été fait pour défendre le port. Les canons,
par centaines, crachent le feu à plein tube pendant plus d'une beure. Grimpés
au haut d'une tourelle, nous assistons à un spectacle féérique, le ciel éclate
en mille endroits, les lueurs qui apparaissent et s'éteignent brusquement sont
mille fois répétées par une DCA déchaînée. Quelques bombes au sol, peu de
victimes, peu de dégâts. Ce sera la dernière alerte de l'année. Et le temps s'écoulera
jusqu'au début d'août 1941 dans une accalmie qui fait présager le pire. En
effet, dès le mois d'août, les. sirènes retentiront chaque jour et jusqu'à cinq
fois en une seule nuit, compromettant ainsi notre repos et notre sécurité jusqu'au
mois de décembre. Nous sommes, à cette
époque, au kommando de Stettin-Bredow,
installés, comme il a été dit, le long de la ligne de chemin de fer qui relie
la ville à la Mer Baltique et sur laquelle se fait Un trafic intense pour
desservir les usines bâties le long de l'Oder. Les avions anglais viennent
régulièrement viser la voie ferrée, dans le but certain d'enrayer le trafic et
retarder l'acheminement des produits et munitions de guerre vers les centres de
répartition. Il faut reconnaître que ces bombardements n’influencèrent guère le
déplacement régulier des convois, là ligne n'ayant jamais été touchée. Quant aux
usines, elles ne servirent d’objectifs qu’à partir de 1944. Chaque nuit, un train
blindé venait se placer à hauteur de nos baraques, se trouvant ainsi à mi-chemin
du centre de la ville et de l’usine de Pölitz, prêt à
un déplacement rapide vers les points menacés. Notre situation à
proximité de cette voie, devait fatalement amener un drame qui, hélas ! se
répétera plus tard à plusieurs reprises. Tout d'abord, la nuit du 30 septembre
1941, nous aurons à connaître l'alerte la plus longue ; elle dura cinq heures.
Une bombe tombée à 70 mètres de la sortie Est du kommando,
n'éclata pas. Et ce n’est que le matin. en nous rendant, au travail, que nous pûmes
nous rendre compte du danger auquel nous avions échappé. La nuit suivante fut
marquée du sceau de la fatalité. Peu avant minuit, les sirènes beuglent l'alerte.
Dans le camp qui comprend une population de 508 prisonniers belges et français,
personne ne s'émeut, on a l'habitude. Peu d'hommes se lèvent pour courir aux
tranchées creusées dans le sable et pour cause, les gardiens nous enlèvent, chaque
soir, nos pantalons et nos chaussures afin d enrayer les évasions qui sont
nombreuses à cette époque. La DCA entre en action,
les pièces du train blindé, dont chaque coup secoue nos baraques, tirent sans
relâche ; on entend, au loin, plusieurs détonations. Tout à coup, trois
détonations successives viennent ébranler la baraque, une vitre vole en éclats.
La déflagration ressentie permet de croire que trois bombes sont tombées dans
l'enceinte du kommando. Les hommes se précipitent
vers les tranchées. Nous restons à cinq dans la chambre. Le calme se rétablit ;
seule la DCA manifeste encore. Au dehors, des cris : des appels se font
entendre. Sortis de la chambre, nous percevons aussitôt des gémissements
partant de la baraque en face de la nôtre, à 60 mètres. La visibilité est
rendue difficile, malgré la lueur rouge des fusées éclairantes qui descendent lentement
dans le ciel par un brouillard épais de fumée et de sable qui masque les
baraques. Et nous croyons deviner, plutôt que voir, leur état de difformité et
d'effondrement. A deux, nous nous
précipitons vers la chambre d'où partent des appels angoissants. Du 2ème
étage de son lit, un camarade se laisse choir dans nos bras, nous l’emportons à
l'extérieur où nous pouvons le reconnaître ; le pauvre Théo présente au côté
droit une plaie béante d'où le sang sort à flots. Nous le transportons dans la
baraque qui sert à nos réunions récréatives et le couchons sur le plancher. Un
premier blessé, que nous ne reconnaissons pas, y est déjà étendu. Retourné aussitôt sur les
lieux du sinistre, j'y retrouve trois camarades. Nos efforts conjugués
permettent de sortir, avec beaucoup de difficultés, un deuxième camarade, de la
chambre 4, au milieu d'un enchevêtrement de poutres et de planches. Le
malheureux, Adrien V…, a les deux jambes coupées au-dessus des genoux ; il
présente une lucidité d'esprit extraordinaire, il me reconnaît à ma voix. Il décédera une heure après, exsangue.
Nous le transportons sur une paillasse, au moment où un avion, à 200 mètres
d'altitude, mitraille le kommando ; les traces de
balles que nous découvrirons, le matin, dans le fronton de la chambre 6,
prouveront que le kommando était visé. Le 3ème
corps retiré était celui de Henri Van C… ; notre pauvre ami était mort, les
mains comprimant les entrailles qui lui sortaient du ventre. L'alerte a pris fin et chacun
se met fiévreusement à l'ouvrage pour dégager les blessés et les morts.
Il faut faire vite, car une quatrième bombe, non éclatée, se trouve enfouie
dans le sable, à quelques mètres de là. Elle explosera environ trois heures après
sa chute, alors que tout dégagement était terminé. Nous pouvions faire le
triste bilan de cette nuit fatale : 20 morts, 14 blessés, tous belges. C'est la
consternation générale dans le kommando, la Mort y
règne maîtresse ; on ne se parle qu'à mi-voix, une tristesse inouïe nous
envahit. Nous pleurons nos morts. Le soir du même jour, avec
mon jeune ami, Marcel D…, j'aurai la douloureuse et pénible corvée d'effectuer
la mise en bière de tous ces corps déchiquetés et nos malheureux camarades
iront désormais reposer au cimetière de Wendorf, en
terre étrangère et ennemie, tués par les armes de ceux dont ils souhaitaient si
ardemment la victoire. La fatalité a joué son
rôle néfaste sur les meilleurs d'entre nous, innocentes victimes d'un Devoir qu'ils
voulaient accomplir jusqu'au bout. Albert, Michel, Léonard,
Adrien et tous les autres s'en sont allés ! Morts pour la Patrie ! XVI LA
NOURRITURE. La question nourriture fut
un long problème à résoudre et, pendant trois années au moins, resta la grande préoccupation
au prisonnier de guerre. Chacun de nous craignait
la faim pour en avoir trop connu les affres au début de la captivité et l'état
de faiblesse dans laquelle elle nous avait entraînés. Aussi, tous les moyens
étaient mis en œuvre pour parer à l'insuffisance de nourriture, tant quantitative
que qualitative, qui constituait la ration du prisonnier. La Convention de Genève
prévoit que la nourriture des prisonniers sera celle du soldat des troupes d'intendance
du pays détenteur. Etait-ce vrai pour nous ? On pourrait l'admettre dans un
sens, c'est-à-dire que la quantité distribuée pouvait être égale à celle de nos
gardiens et nettement insuffisante pour les uns comme pour les autres, mais la qualité
différait totalement. Et si l'on compare en plus l'oisiveté dans laquelle se
complaisaient nos sentinelles, avec le travail forcé obligatoire auquel nous
étions soumis, l'insuffisance se marquait mieux encore et notre casse-croûte
pouvait se prévaloir des temps de disette. En outre, le soldat allemand pouvait
acheter des produits comestibles non rationnés, chose qui nous était
difficilement permise. Le casse-croûte comprenait
un quart ou un cinquième de pain – j'ai connu le sixième de pain dans
une ferme domaine – une rondelle de saucisson et un léger cube de margarine,
celui-ci étant remplacé deux fois par semaine par une cuillerée de marmelade,
de fromage blanc ou de fromage coulant, produits erzats.
La rondelle de saucisson était parfois remplacée par un morceau de pâté puant
la bête crevée. Bref, c'était mince et l'appétit le plus léger n'y trouvait pas
son compte. Cependant, il fallait en tirer de quoi faire 3 ou 4 repas suivant
la longueur de la journée de travail. Le morceau de pain lourd n'était pas bien
gros, aussi les deux tartinettes qui composaient un
repas étaient-elles amincies à leur plus simple expression. A partir de 1943, on
donnait le nom de pain a une brique quelconque dans la composition de laquelle
il entrait principalement de la fécule de pommes de terre, de la farine de
marron et très peu de farine de seigle. Ce pain était entouré de sciure de bois
ou de paille hachée, qui lui permettait de maintenir sa forme avant la cuisson
; pain-mastic lorsqu'il était frais, pain à la mie rugueuse qui râpait la
langue lorsqu'il était rassis. Un repas chaud nous était
servi chaque jour, repas qui faisait bien souvent notre désolation. Il s'agissait
de pommes de terre en robe des champs, accompagnées d'une louche de sauce faite
de farine brûlée ou, le plus souvent, d'une soupe claire dont il est
intéressant de connaître la variété. La soupe aux rutabagas
était celle qui faisait, le plus fréquemment, nos délices. Tout le monde connaît
cette espèce de gros navet à chair rose dont la culture, chez nous, sert à
l'alimentation du bétail. En Allemagne, il semble que le rutabaga est le légume
commun que l'on rencontre sur toutes les tables. Cela peut encore se concevoir
lorsque ce légume reçoit une préparation appropriée, mais lorsque la soupe
n'est qu'un long brouet, baignant de larges cubes de ce légume, cuit ou pas cuit,
c'est détestable. Et comme cette soupe nous revenait à une fréquence
désespérante, c'était exécrable, au point que l'odeur nous incommodait. A noter
que les légumes qui étaient destinés aux prisonniers étaient toujours de dernier
choix et, en hiver, le rutabaga gelé était utilisé, d'où il s'ensuivait des coliques
et la diarrhée chez la plupart, comme ce fut le cas encore dans les trois
premiers mois de l'année 1945. La soupe au chou blanc
était d'usage également ou la soupe saumâtre à la choucroute. Il y avait aussi
la soupe aux kohlrabis (légume inconnu chez .nous)
sorte de navet blanc qui quelque peu vieilli, subit une transformation qui le
faisait ressembler à la fibre de bois, ce qui nous donnait motif de dénommer le
brouet : soupe au triplex. Mais il y a mieux ! En
1942, à différentes reprises, on nous a servi la soupe au lait de sauret, la
seule qui fut très épaisse, mais c'était infect et rares étaient ceux qui
pouvaient absorber cette mixture. C'était le seul repas dit « consistant » et
il fallait s'en passer. Un soir, les sentinelles
nous firent sortir des baraques par la force pour aller quérir l'indigeste pitance
qui aussitôt servie, prit le chemin des « Abort ». On
soupa d'un morceau de pain d'épices, de galettes et autres douceurs de nos
colis. Dans un stalag où j'ai
séjourné plusieurs mois, le bol de soupe se réduisait à un demi-litre et
consistait en un brouet tellement clair que le fond de la gamelle était visible
; on pouvait y apprécier la soupe aux feuilles de betteraves et celle aux
graines de soja. Je revois encore les trois
énormes tas de feuilles de betteraves sur le terre-plein faisant face aux
cuisines. De larges fourches emportaient les mesures vers les douches où elles
étaient déversées après un lavage sommaire ; un seau de patates pour compléter
et il ne restait plus qu’à laisser bouillir. Cette lavasse aigrelette et le
cinquième de pain démontrent aisément que le coût de la vie, dans un stalag, n'était
pas un problème. Le soja est une plante
oléagineuse dont les orientaux emploient les graines comme légume ou les
utilisent comme tourteau à donner au bétail ; après en avoir extrait l'huile.
En Bochie, où les ressources culinaires sont infinies
lorsqu'il s'agit de nourrir les prisonniers, le tourteau de soja servait à la
préparation d'un excellent potage dont nous nous « régalions » et qui avait
reçu le surnom de soupe aux allumettes, eu égard aux nombreux bouts de bois que
cette soupe contenait. Il serait superflu
d'allonger davantage ce chapitre. Mais si l'on sait qu'un Lagerführer
percevait 1,20 Mark par jour et par homme pour la nourriture de ses
pensionnaires, le nom d'économe lui convenait mieux… adjectivement. Et on ne s'étonnera pas si
les prisonniers, sous des apparences de santé satisfaisante, sont minés par
diverses affections, parmi lesquelles les vices du sang et les ulcères à
l'estomac sont les plus nombreux. Au kommando de Stettin-Bredow, il n'était pas un prisonnier qui était exempt de
furoncles, flegmons ou anthrax. Mais grâce à nos familles
et à certaines institutions de charité, le pire fut évité. XVII LES LETTRES. Quel est le prisonnier qui
ne se rappelle le moment où la sentinelle se présenta au kommando,
tenant en ses mains quelques lettres venant du pays ? Les premières lettres ! Il n'yen a pas pour tous,
mais chacun espère et l'appel des noms est entrecoupé d'exclamations joyeuses
de ceux que la chance a désignés. Une émotion intense s'est
emparée de nous et bien des larmes jaillissent des yeux. Fébrilement, ceux qui
ont été privilégiés prennent connaissance de la lettre bénie qui vient de leur
être remise, tandis que les autres, non favorisés et dont le désappointement se
lit sur le visage, se retirent à l'écart pour respecter le silence religieux
dans lequel sont plongés leurs camarades. Pour les uns, ce sera un
nouveau coup de l'adversité ; pour les autres, un mélange de joie et de tristesse
à la fois, car si la première lettre contenait de bonnes et rassurantes
nouvelles, elle faisait mieux mesurer aussi l'éloignement dans lequel nous nous
trouvions vis-à-vis des êtres aimés dont on lisait les tendres appels. On put voir ensuite la
plus charitable camaraderie se manifester. Les lettres passaient de main en
main, étaient lues et commentées par chacun. Les traits se rassérénaient, les
regrets disparaissaient progressivement. Chacun puisait dans les précieuses missives
le baume rénovateur qui convenait à son âme ulcérée. De ces lettres où, seul le
cœur parle, on retirait une nouvelle force régénératrice des sentiments qui
nous animaient envers ceux qui nous manquaient, il naissait des espoirs fous et
des projets dangereusement prématurés sur le retour au foyer. Pauvres diables ! Gare à
la chute lorsque, le lendemain, les esprits auront repris leur saine raison, car
l'occasion est propice au cafard et il est malaisé de lui échapper. Les mois, puis les années
passeront et le temps adoucira quelque peu nos transes. Les lettres nous seront
distribuées de façon assez régulière. Mais, quelle que soit l'époque, il est un
sentiment louable qui ne nous quittera jamais, c'est celui qui nous faisait
aspirer ardemment après une lettre des nôtres, de préférence à un colis. C'était
chose remarquable ! Le prisonnier ne manquait
pas d'utiliser tous les moyens possibles pour faire parvenir, en Belgique, des
lettres clandestinement. C'était le travailleur civil qui, retournant en congé,
était sollicité par de nombreux prisonniers ; j'en ai connu qui s'en revenaient
au pays avec plus de 200 lettres camouflées dans le double fond d'une valise.
D'autres écrivaient à leur famille en employant le nom et l'adresse d'un civil
belge ou français et la correspondance retour se faisait par le même procédé.
Ces lettres étaient soumises à la censure civile, il fallait donc être prudent
dans les termes. Mais cela nous permettait d'ajouter copieusement aux 27 lignes
réglementaires qui nous étaient accordées tous les 15 jours et, de faire la
nique aux Allemands. D'autres encore étaient
affectés au travail dans certaines usines où des expéditions de colis se
faisaient à destination de notre pays ; ils glissaient leurs lettres dans les
ballots en les accompagnant d'une formule, demandant à la personne qui les découvrirait,
de bien vouloir les affranchir et les poster. Ce système s'avéra excellent ! Il y avait aussi la
correspondance établie entre prisonniers. Elle permettait de toucher un ami
très cher, à son kommando éloigné. Le seul moyen employé,
au début, était le suivant : La lettre était passée furtivement à un prisonnier
connu ou inconnu, d'un kommando voisin qui, à son
tour, la transmettait à un autre et ainsi de suite. Une filière s'établissait
ainsi et la lettre parvenait sûrement à son destinataire. A ma connaissance, le
record de la distance fut détenu par un prisonnier français qui, de Stettin,
adressa une lettre à son frère en kommando dans les
environs de Vienne. Cette lettre parvint à destination en un laps de temps de
48 jours. Il était dangereux de
conserver ces lettres par devers soi, car les fouilles étaient nombreuses ; mieux
valait les détruire après en avoir pris connaissance. A moins toutefois d'y
apposer un cachet de censure parfaitement imité et fabriqué avec du linoleum
dérobé dans les cabines de serre-freins des wagons de transport de marchandises. Plus tard, un autre
procédé donne d'excellents résultats. On employait le papier réglementaire du stalag
et on adressait la lettre à son ami en ayant soin de porter le même nom comme
expéditeur, le prénom seul étant différent ; la lettre débutait par « Mon
cher frère », la réussite était certaine. Pour le retour, l'adresse que l'on
devait obligatoirement apposer sur la lettre-annexe était gommée et votre ami
pouvait, lui aussi, employer le même procédé, en utilisant votre nom comme
expéditeur. Les lettres clandestines
nous parvenaient aussi par le moyen des colis, soit dans le tabac, dans le sirop,
voire dans des noix. C'est ainsi qu'un camarade recevait régulièrement, dans
chaque colis adressé par son père, un véritable journal par l'abondance des
renseignements. Ceux-ci étaient écrits sur de minces feuilles de papier pelure
et glissées dans des tubes de macaroni, puis l'emballage était proprement refermé.
Ce camarade ne prenait possession de son colis que lorsqu'il était certain que
le gardien préposé à la fouille et à la distribution, n'était pas très
regardant et n'avait de souci que d'en terminer rapidement. Rentré dans sa
chambre, notre ami s'empressait de briser les tubes en leur milieu et tous les
billets apparaissaient. Il ne restait plus qu'à en faire la lecture, l'un après
l'autre, suivant le classement obtenu par un numérotage de chaque billet. Quelques mots parfois
suffisaient pour faire connaître une appréciation sur les événements, tels les
nom et prénom de l'expéditeur d'un colis et qui étaient tout-à-fait fantaisistes
: Yvon Piette. Naturellement, le prisonnier qui reçut
ce colis de sa femme, en 1942, lut immédiatement : « I vont piète ». Ou encore
une histoire de famille ou de voisins dont les censeurs n'auraient rien pu
discerner de répréhensible et constituait nettement la suite des événements à
prévoir. Cela devenait un jeu et beaucoup s'y exerçaient. Dans un Stalag, on ne se
gênait pas pour mettre noir sur blanc des choses qui pouvaient attirer de très
graves ennuis à leurs auteurs ; mais ces lettres, étaient glissées parmi
d'autres qui avaient été censurées avec la complicité du prisonnier préposé au nettoyage
des bureaux de la censure. L'échange de lettres avec
nos familles eut pour effet, cela se conçoit, de maintenir un moral excellent parmi
les prisonniers, d'alimenter des espoirs sur l'idée du retour au foyer et de
créer une volonté tenace de tenir le coup jusqu'au jour final ! La
correspondance entre amis supprimait les distances et permettait de parfaire à
l'extérieur la cohésion totale qui existait entre nous dans l'enceinte des
barbelés. Quelles que soient les
nouvelles qu'elle contenait, bonnes ou mauvaises, une lettre était toujours
chose sacrée chez les prisonniers. XVIII LES COLIS. Le prisonnier de guerre
qui était affecté au travail sur les chantiers, dans les usines et dans les domaines,
peut affirmer, sans crainte d'être contredit, que sans l'aide providentielle
des colis, il avait peu de chance de rentrer au pays autrement que par un
convoi sanitaire. En effet, on a pu lire
dans un précédent chapitre, comment les schleuhs
traitaient leurs prisonniers au point de vue de la nourriture, après les avoir affamés
dans les stalags. Aussi, chacun de nous se
remémore aisément les sentiments de joie, d'attendrissement aussi, qui nous
envahirent à la réception du premier colis. Certes, il est bien minuscule, car
il ne peut excéder le poids de 500 grammes, mais si le contenu est d'une
réduction ca1culée, il est riche de promesses et d'espoirs. Les nôtres pensent à nous
et le premier colis a autant de valeur morale que la première lettre. On s'extasie
devant l'unique paquet de cigarettes Belga, le bâton de chocolat et les
quelques riens du colis. On en est là ! Hommes et grands enfants ! Le colis suivant est
énorme à nos yeux et son poids de 5 kilos nous paraît exagéré. Nous réalisons
mal encore notre situation, en raison des espoirs qui nous restent malgré tout,
que notre captivité sera abrégée sous peu. Quoiqu’il en soit, ce colis est le
bienvenu et nous permet enfin, une première fois, de manger à notre faim. On aurait tort de croire
que la remise des colis se faisait en grande simplicité. Non il fallait, au préalable,
assister au rite d'une fouille sévère et destructrice. C'est ainsi que, en
1941, l'unteroffizier qui présidait aux destinées du kommando de Stettin-Bredow, rigoriste
à l'extrême, mettait un acharnement malsain
à détruire le contenu de nos colis, a l’effet d'y découvrir de la correspondance
clandestine, mais aussi pour assouvir une rage bien personnelle. En procédant à la fouille,
il se découvrait les dents en un rictus haineux et ses petits yeux fureteurs
laissaient apparaître le malin plaisir qu’il prenait dans sa tâche de
destruction. Le pain d’épice était découpé en plusieurs morceaux ; les biscuits,
le chocolat, le macaroni étaient rompus plusieurs fois et jetés, en un geste
désinvolte, dans le bassin à lessive que nous apportions avec nous, comme il était
recommandé. Le paquet de tabac ou de cigarettes
était ouvert sans aménité et sans souci de préserver, la nourriture sur
laquelle tombait le tabac arraché. Il ne nous permettait pas d'emporter les boites
de conserves, mêmes ouvertes et il les déversait dans notre plat à soupe, sans
considération du mélange. C'est ainsi que dans ce récipient ; se mélangeaient
la confiture, les sardines et le lait. Nous assistions, impuissants,
à ce travail de boche. Un mot de protestation équivalait à un coup de botte
cloutée et ne changeait rien à la méchanceté démoniaque de ce triste individu. Plus tard, une chambre
sera affectée à la distribution des colis et les boîtes de conserves pourront y
rester entreposées jusqu'au jour de leur consommation. Mais il fallut, de
nombreuses réclamations avant de recevoir ce qui était, à l'époque; une faveur. Les colis de la
Croix-Rouge de Belgique nous viendront en aide et soulageront un peu nos
parents et nos épouses dans les difficultés qu'ils éprouvent à se procurer des
aliments, vu la rareté des produits et les prix exorbitants au marché noir. On tirait profit de tout,
des bonbons à la cassonade, de la soupe Valiska, du
Sirop d'Or, du massepain et du pain d'épices. Pour ce dernier, il arriva quand
même un moment où il fallait se faire violence pour l'absorber, car nous en
étions saturés. Bien souvent, certaines
marchandises arrivaient avariées pour avoir séjourné trop longtemps en boîte close.
En effet, si nous avions parfois la chance de recevoir un colis 3 semaines
après son envoi, il était fréquent qu'ils mettent 6 à 8 semaines à nous
parvenir en kommando. Et à de multiples reprises, le désespoir
dans l'âme, on assistait au déballage de fruits pourris, de galettes moisies,
de conserves dont les boîtes étaient gonflées comme des outres et dont le
contenu giclait dès que l'on introduisait l'ouvre-boîte. N'y regardant pas de
trop près, on récupérait ce qu'on pouvait en retirer ; nos estomacs, jamais
rassasiés, n'étaient pas difficiles à contenter. En 1942, nous recevons des
vivres de pays amis, mais en si minime quantité que cela ne pouvait constituer
un secours, mais plutôt un avant-goût de choses oubliées depuis longtemps.
C'est ainsi que nous recevons du jambon de Turquie, un morceau gros comme deux
doigts de la main ; des raisins secs d'Égypte, quatre cuillerées à soupe ;
aussi 5 cuillerées de riz, une demi-cuillerée de cacao, quelques cigarettes
américaines. D'autres fois, il n'y en a pas pour tous, on doit procéder à la
distribution par tirage au sort. Il nous faut atteindre
l'année 1943 pour recevoir le colis mensuel américain. Dès ce moment, avec le
système de « ménages » instauré chez nous, l'entr' aide
fraternelle dont nous sommes animés et les vols auxquels nous nous livrons,
nous pouvons défier le boche et son infecte nourriture. Nous pouvons même venir
en aide à d'autres prisonniers malheureux, Russes et Italiens qui, autant que nous,
vouent le plus profond mépris, sinon de la haine, à l'allemand. En ce faisant,
nous les aidions à considérer leur situation moins amèrement et à refuser toute
sollicitation à un enrôlement dans l'armée allemande. D'autre part, les journaux
hitlériens commentaient en larges colonnes, certaines restrictions faites en
Amérique sur des produits de première nécessité, tels que la viande, la
margarine, le tabac, etc., nous avions beau jeu de détruire cette légende
auprès de nos gardiens et des civils, arguant que ces restrictions nous
auraient atteints bien certainement si elles étaient effectives. Raisonnement
trop simple que pour ne pas être compris. Au moment où la population
allemande voyait réduire ses rations, elle constatait une confiance morale
accrue chez les prisonniers par l'apport matériel des colis américains ; cela
ne manquait pas d'influencer considérablement le civil et le soldat, au point
qu'il nous fut interdit de sortir du kommando pour
aller au travail avec les produits provenant de ces colis et que le kommandofiihrer appelait, « nourriture de luxe ». Certes,
d'autres facteurs intervenaient dans cette démoralisation mais nous ne négligions
rien pour y apporter notre contribution. Nous combattions avec les armes mises
à notre disposition et le colis américain en était une d’importance
considérable. Après la libération de
notre pays alors que nous venons d'être sinistrés, les. colis ne nous
arriveront plus et nous, revivrons la dure période du début de la captivité.
Les huit derniers mois seront pénibles, rendus plus dur encore par une vie
nomade imposée par les événements, mais jamais plus, cependant, notre moral ne
faiblira, car nous voyons approcher a grands pas le terme de notre esclavage. Toute notre, gratitude va
à nos parents, nos épouses, nos amis qui, au milieu des difficultés dans lesquelles
ils se débattaient eux-mêmes, se sont imposé mille sacrifices pour nous venir
en aide. Il en est de même pour les organismes de Croix-Rouge et autres qui,
bien renseignés sur notre situation malheureuse, ont mis tout en œuvre pour
nous éviter le pire. Grâce à eux tous, nous
avons pu rentrer au pays dans un état de santé relativement satisfaisant. Eux tous : Parents, amis,
bienfaiteurs… Providence ! XIX LES
FOUILLES. S'il est une corvée à laquelle se soumettait de mauvaise grâce le prisonnier de guerre, c'est bien à celle de la fouille, étant donné le caractère humiliant et avilissant de celle-ci. Et cependant, combien de fois le P. G. n'a-t-il pas dû subir cette opération au cours de la captivité ? Vingt, cinquante, cent fois et plus suivant l'importance des kommandos et le bon plaisir des unteroffiziers et des feldwebels. A lui seul. le kommando de Stettin-Bredow fut servi plus qu'honorablement, surtout grâce aux irruptions trop souvent répétées du Feldwebel de contrôle, sbire alsacien de la pire espèce, dont la conscience professionnelle ne reposait que sur des exercices de ce genre. Cet homme avait le don de se trouver, partout à la fois, en ce sens qu'il venait surprendre les prisonniers sur les lieux de leur travail en maints endroits, chaque jour, se déplaçant au Nord de la ville aussitôt après avoir signalé son passage dans le Sud. Avec cela, brutal, on le craignait. Certes, la force de l'habitude avait doué le prisonnier d'un art nouveau, celui du camouflage. Et même une fouille opérée par surprise ne donnait aucun résultat appréciable, bien souvent, sinon ce que voulait le P. G. lui-même en guise de moquerie, telle la pièce de 1 pfennig trouvée au fond de sa poche et qui lui avait permis de déclarer qu’il possédait de l'argent allemand. Nous avons connu les fouilles dominicales pratiquées par le sous-off'., chef de kommando. Chaque dimanche, au début de 1’après-midi, ce peu intéressant personnage dont j’ai parlé dans le chapitre précédent, faisait la tournée des baraques. Il variait chaque fois son travail et si, aujourd’hui, i1 visitait les poches et les portefeuilles, le dimanche suivant il fouillait les valises, pour passer ensuite au contenu des armoires, etc. C'était sa distraction hebdomadaire. Il y avait aussi les fouilles du soir qui se pratiquaient, à une certaine époque, à la cadence de 3 ou 4 par semaine. Elles avaient lieu au kommando, à la rentrée des équipes de travail et étalent, bien souvent le fait du Feldwebel de contrôle. Il s agissait pour lui de mettre la main sur les « bons Marks », de déceler la correspondance prohibée et de visiter les besaces dans lesquelles on trouvait de la marchandise honnêtement acquise ou pas. Mais rien ne faisait reculer le prisonnier pour conserver son bien et les deux anecdotes qui vont suivre prouveront à suffisance de son esprit rapide de décision, outre la note gaie qui s’en dégage. Un soir, les prisonniers, en colonne, rentrent du travail. A l'entrée de la première baraque, un prisonnier avertit d'une voix forte : « Attention ! Barthe est là ! il y a fouille ! » Dans les, rangs, un prisonnier, a fait sauter sa besace de l'épaule et, en arrivant a hauteur du prisonnier complaisant, attire son attention par un « Hop ! » retentissant et lui lance la besace qui paraît exagérément gonflée. Le camarade la reçoit habilement dans les mains, mais voyant une sentinelle s'élancer vers lui pour se saisir du colis litigieux, il se retourne vers l'intérieur de la baraque et accomplit le même geste vers un camarade qui s'amenait dans le couloir. Puis, il se place résolument à l'entrée et se laisse bousculer par le gardien avant de lui livrer passage, histoire de lui faire perdre quelques secondes. De mains en mains, la musette a disparu et le gardien réapparaît bientôt en grognant ; autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Après la fouille, le propriétaire de la besace n'eut qu'à parcourir quelques chambres pour retrouver son bien. C'était un veinard, il avait réussi un coup magnifique. La besace contenait 62 œufs, pas un seul ne s'était cassé en cours de, .. manipulation. Un autre soir, toujours à la rentrée des prisonniers au kommando, le Feldwebel visite les besaces. Il se presse et frappe de la main sur les besaces au fur et à mesure que les prisonniers, au nombre d'environ 450, passent devant lui. Ce geste suffit pour déceler la marchandise un peu volumineuse qui encombre certaines besaces et c'est ainsi qu'il rafle, ce jour-là, environ 25 pains civils. Dès qu'il en découvre un, il s'en saisit de la main droite et le rejette derrière lui. La fouille terminée, il appelle un gardien et lui donne l'ordre d'emporter les pains. Ce disant, il se retourne et reste sidéré : il n'y a que deux pains sur le sol, les autres s'étaient volatilisés au fur et à mesure qu'ils y étaient jetés. Les prisonniers qui assistaient aux manœuvres de récupération, étaient restés impassibles ; aucune fibre de leur visage ne trahissait leur joie intérieure. Et Bartho, pris de court, n'insista pas et s'empressa de quitter le kommando, s'efforçant de ne pas laisser paraître la rage qui 1’avait envahi. Viennent ensuite les fouilles générales qui, commencées à 8 heures, pouvaient se terminer au début de l'après-midi, vu l'ampleur de l' entreprise. Les prisonniers étaient invités – si l'on peut dire – à sortir « tout » des baraques, hormis le mobilier, et à se parquer à l'endroit et dans l’ordre désignés. C'était alors la fouille sévèrement contrôlée par des unteroffiziers et feldwebels, du linge, des valises, couvertures et paillasses, des loques qui nous vêtaient, voire même des chaussettes que l'on nous faisait enlever et retourner. Tout objet ou linge quelconque resté dans la baraque était emporté par des sentinelles affairées dont le zèle exagéré démontrait bien la crainte, trop raisonnée peut-être, du supérieur. Enfin il y avait aussi les fouilles individuelles au kommando ou... dans la rue. La fouille, au kommando, d'un seul prisonnier pouvait se faire à la suite d'un fait répréhensible ou soi-disant tel, soit une affaire de vol, la trouvaille d'un écrit clandestin, soit encore à l'intervention des censeurs n'ayant pas leurs apaisements sur les termes employés dans la correspondance adressée à la famille. Dans ces cas, la fouille était habituellement suivie d'une peine disciplinaire : quelques jours de cachot ou de strafkompagnie, ou même la comparution de l'intéressé devant le Conseil militaire pour les cas réputés graves ; c'était alors le séjour de plusieurs mois dans la forteresse de Graudenz, si le prisonnier ne pouvait donner d'explications franches et plausibles. Les fouilles individuelles dans la rue étaient, elles, pratiquées uniquement par le fameux Feldwebe ! Il était particulièrement dangereux pour le prisonnier muni d'un « aussweis » de rencontrer l'alsacien dans la rue car, tombant sous sa surveillance, immédiate, il ne pouvait trouver le temps propice au camouflage des missives et de l'argent dont-il pouvait être porteur. Le fe1dwebe1 l'entraînait vers une maison à porte cochère – nombreuses dans la ville – priait les habitants de se retirer et se mettait en devoir d'ausculter le P. G., la plupart du temps, après l'avoir fait déshabiller. C'était comique et on en faisait des gorges chaudes dans les baraques au récit de ces rencontres. Au début, la fouille dans la rue était fructueuse mais par la suite, les précautions étaient prises et le résultat était nul ou négligeable. Cette fouille donna lieu aussi à certains gags amusants, tel celui-ci qui révèle bien l’astuce dont étaient doués les prisonniers pour se tirer d'embarras. Deux camarades allaient au travail lorsque, au loin, ils aperçoivent le fe1dwebel venant dans leur direction. Pas de rue transversale permettant de prendre la tangente. Après rapide concertation nos deux prisonniers se dirigent vers lui et se présentent en tenant la veste largement ouverte des deux mains s'offrant ainsi volontairement à la fouille. Notre soudard, interloqué, les renvoie d'un ton furieux : « Allez, je ne fous ai rien temanté ». Il valait mieux ainsi, car nos deux amis possédaient un nombre assez respectable de « bons marks » Après un an de captivité, les fouilles ne valaient plus guère la peine que les schleuhs mettaient à leur réussite, celle-ci devenant caduque. Je me souviens d'une fouille générale qui eut lieu le premier dimanche d'avril 1942 et qui fut suivie, le lendemain de deux évasions. Le premier dimanche du mois suivant, nouvelle fouille générale par surprise et il faut reconnaître que les feldwebels et unteroffiziers, mobilisés à cette occasion, firent une ample moisson ce jour-là. Pas un coin ne fut épargné et il est jusqu'aux toits des baraques qui reçurent la visite de ces apôtres zélés du Grand Reich. Ce qui n'empêcha nullement trois camarades de prendre le large au cours de la nuit suivante, munis de costumes civils. Cependant, il y aura relâchement, dès 1944. Le kommandoführer, conscient de l’inanité de ces opérations nous laissera en paix. Seules, la Gestapo et la Banhpolizei feront de temps en temps une incursion dans nos baraques, mais on s’aperçoit très bien que leur conviction est établie d'avance et que les délits dont les prisonniers se sont rendus coupables resteront dans le dossier des affaires à classer, faute d'éléments probants. D'ailleurs, les sourire goguenards des prisonniers et les réflexions qui accueillent ces messieurs, doivent suffire à leur faire perdre tout espoir dans leurs recherches. A cette époque, les prisonniers ne cherchent même plus à cacher la variété d'outils prohibés dont ils sont... propriétaires. A quoi bon ? Ce qu’on pourrait leur confisquer aujourd’hui, serait remplacé dès demain. Et on verra même des gardiens venant leur emprunter, soit une hache, une pince, un marteau, ou tout autre outil qu'il leur est défendu de détenir et.. , le leur rapporter. Les fouilles n'avaient plus que la valeur d'une distraction et le prisonnier possédait des ressources infinies de récupération dont il valait mieux ne pas favoriser la pratique. En cette partie, le prisonnier domine ses geôliers. Il s'est affranchi de cette humiliation dont il souffrait en raison même de sa servitude. XX LES EVASIONS. Ce chapitre, à lui seul, pourrait faire l'objet d'un volume, non seulement par la multiplicité des évasions qui se sont produites au cours des 5 années, mais aussi par la diversité des moyens employés. Mais je me bornerai ici encore à un strict résumé de la question. En avril 1942, on pouvait lire dans le « Pommersche Zeitung », comme très probablement dans tous les quotidiens du Grand Reich, un article sur les Kgf en rupture, de ban et qui commençait à peu près en ces termes : « S'il est un devoir pour le prisonnier de penser s'évader, il en est un autre, très pressant, pour la population du pays, de signaler aux autorités militaires et policières les allées et venues de gens qui peuvent paraître suspects. N'oublions pas que, journellement, 40. 000 prisonniers en état d'évasion, parcourent les routes d'Allemagne et que ce nombre imposant d'évadés constituent un grand danger à des points de vue divers, etc... » Quarante mille ! De nombreux, indices nous permettaient d'admettre la véracité de cette information quasi-officielle, ne fût-ce que par les mesures prises par les autorités allemandes pour enrayer ce mouvement vers la liberté, mesures qui s'avèrent iniques à une certaine époque et en opposition formelle avec la volonté de la Convention de Genève. Par milliers, de parfaits prisonniers sont dirigés sur le camp de représailles de Rawa-Ruska, Graudenz et autres lieux de misères qui, sous bien des aspects, n'ont rien à envier aux sinistres camps de concentration tant réprouvés. En 1940, les évasions seront rares. Il faut, au prisonnier, le temps de se ressaisir, de mieux connaître sa situation par-dessus les misères qui l'accablent, de faire face à l'allemand et de reprendre le dessus, moralement et matériellement. Seuls, ceux qui ont pu être immatriculés dans un stalag assez proche des frontières belges ou françaises, pourront tenter une escapade. De Stettin et plus loin encore, les tentatives d'évasion seront nulles au début de la captivité, en raison des difficultés énormes auxquelles il faut faire face ; il est à peu près certain que tout essai serait voué à un échec. C'est en 1941 que l'idée de fausser compagnie à nos « protecteurs » prendra corps et que les évasions se multiplieront à une cadence industrielle. Les départs du kommando sont nombreux ; ils ont lieu, habituellement la nuit ou dès le réveil, lorsqu'il fait nuit encore ; repérer la sentinelle, cisailler les barbelés et la cage est ouverte. Evidemment, la défroque du prisonnier a été abandonnée, pour revêtir des vêtements civils que l'on s'est appropries, bien souvent, par des moyens dits inavouables, dans la vie normale mais qui, là-bas, n'étaient qu'un exploit de plus à l'actif des prisonniers. Lorsque des évasions étaient prévues, tout le monde s'en mêlait pour procurer aux camarades le nécessaire qui devait assurer la réussite : vêtements, vivres, argent. Plus tard, on s'enfuira du kommando plus malaisément car, chaque soir, on nous retire nos pantalons et nos chaussures, pour ne nous les restituer qu'au matin. Mais la difficulté est aussitôt tournée, on s'évade du lieu de travail, ce qui donnait l'avantage de faire un nombre respectable de kilomètres avant le moment de la découverte. C'est ainsi que des camarades partis du chantier, à l'aube, avaient pris l'express Stettin-Berlin, puis Berlin-Hambourg et se trouvaient dans cette dernière ville et peut-être plus loin encore, avant que l'alarme soit donnée. A Stettin, une agence polonaise et une autre luxembourgeoise fonctionnent dans la clandestinité et, moyennant rétribution, aident les prisonniers à s'évader, leur apportant un précieux concours dans la confection de papiers « dûment en règle », au même titre qu'un étranger civil regagnant son pays pour un congé de deux semaines. En 1942, des filières s'établiront, mais les difficultés s'amplifieront aussi, car les longs déplacements en chemin de fer sont soumis à un contrôle très sévère et nécessitent la possession de passeports spéciaux, documents que le prisonnier ne peut se procurer sans la complicité de civils belges ou français ; mais la complaisance requise présente trop de dangers pour ces civils et ils acceptent rarement les marchés proposés. Il est bien compréhensible que les évadés n'avaient qu'un but : rentrer chez eux. Mais, à partir de 1943, il n'en fut plus toujours ainsi. Il y eut des prisonniers qui, après plusieurs évasions, et devant l'insuccès et certains dangers courus, renonçaient à leur but, mais s'enfuyaient néanmoins avec la seule idée de mettre fin au travail forcé. Et, dans les baraques, on pouvait entendre parfois ce dialogue : – Un tel a mis les voiles, ce matin. – Il a bonne idée ? – Non, il veut seulement faire son petit tour d'Allemagne. J'en ai connu qui ont ainsi voyagé pendant 3 ou 4 mois avant de se faire reprendre. C'était des durs ! Les Allemands s'inquiétaient beaucoup de connaître la provenance des nippes civiles qui revêtaient le prisonnier en état d'évasion, mais celui-ci, une fois repris, ne leur fournissait que des renseignements d'un caractère ambigu, qui ne leur apprenaient rien et ce, malgré les sévices dont il fût l'objet, à certaines occasions. En 1941 et 1942, les prisonniers recevaient des colis de linge civil, mais les pantalons et les vestes ne leur étaient remis qu'après qu'il eût été apposé sur chacun de ces effets, l'inscription des deux lettres K G, au moyen d'une couleur huileuse de teinte vive qui s'imprégnait dans le tissu. Ces deux lettres étaient marquées dans le dos de la veste, tandis que le genou droit du pantalon portait la lettre K et le genou gauche la lettre G. Et, à ce sujet, je ne puis m'empêcher de conter la petite histoire ou plutôt la méprise qui arriva au kommandoführer de la Stoewerwerk (Usine de montage des autos Stoewer), à Stettin. Un prisonnier avait eu l'occasion d'inscrire lui-même les deux lettres réglementaires mais avait interverti celles-ci, de façon qu'en le voyant venir, on lisait G K au lieu de K G. Le sous-off', chef de kommando, fut pris d'un fou-rire en le rencontrant, un jour, à l'usine et lui fit remarquer son erreur. – Mais, dit le prisonnier, ces lettres sont bien placées. – Pas du tout, reprit le boche, vous deviez mettre K G. – Et moi, je soutiens que c'est G K. – Mais non, c'est K G qui veut dire : Krieggefangene. – C'est possible, dit le prisonnier, mais pour moi, G K veut dire : Germany kaput. A ces mots, l'unteroffizier entra dans une colère folle, botta le derrière de notre prisonnier, fit un rapport au Krontrollstell, d'où le Hauptmann infligea au P. G. trois jours de tôle. C'était pour rien ! Il est intéressant, me semble-t-il, de faire suivre ces commentaires par la relation de quelques cas typiques d'évasion ; on pourra mieux se rendre compte de la variété de moyens employés. Au Stalag IIC, le P. G. qui porta le titre de « Roi des Evasions », avait plus de trente escapades à son actif, sans avoir jamais réussi à passer la frontière. Repris à Hambourg, lors de sa 26ème évasion, on lui dépêcha deux sentinelles pour le ramener au stalag, eu égard à la valeur spéciale de l'intéressé. A quelques dizaines de kilomètres du stalag, à Pasewalk, pour être précis, les trois hommes devaient changer de train pour la dernière fois avant l'arrivée à destination. Le prisonnier profita de l'encombrement des quais à l'arrivée d'un train de voyageurs pour jouer la fille de l'air une fois de plus, sans, que les gardiens s'en aperçoivent sur le champ. Un autre rentra en France, par la Suisse. Pour sa réussite, il s'était affublé d'un uniforme de soldat allemand et s'était entouré la tête de bandages qui lui rendaient le visage à peine visible. Grand blessé dont on avait pitié et qui, d'un geste las, faisait taire les curieux. Il somnola dans un coin du compartiment durant tout le voyage et descendit à 20 kms de la frontière suisse, qu’il réussit à passer au cours de la nuit suivante. A l'Ile de Rügen, sur la mer Baltique, onze prisonniers se rendent au travail tous les matins, accompagnés d'un gardien et de deux civils, par le moyen d'une barque à moteur. Le jour J arrivé, nos camarades mettent à la raison les trois schleuhs, les embarquent et les forcent à se diriger droit vers le Nord. Ils ont la chance de ne pas rencontrer les vedettes en patrouille et ils atteindront les côtes suédoises, en moins d'une journée, où ils seront reçus à bras ouverts par la population. Quant aux Allemands, ils furent réembarqués et sont rentrés à leur point d'attache pour s'entendre condamner en vertu d'une saine justice distributive. Que dire de ce prisonnier qui, parti de Stettin, poussant devant lui une brouette, prit la direction de l'Ouest et ne se fit « ramasser » qu'après avoir accompli 450 kms. Le métier de ramoneur est très lucratif en Allemagne et des firmes ayant ce genre d'entreprises, avaient également des prisonniers à leur service. L'un de ceux-ci, vêtu de la salopette noire, portant la courte échelle sur l'épaule, cordes et boule hérissée, quitta ses maîtres en vélo et on ne le revit plus. Des nouvelles parvenues plus tard, nous apprirent qu'il avait abandonné tout son matériel à quelques kms de la frontière et… avait réussi. Un prisonnier belge en état d'évasion, risquant le tout pour le tout, était arrivé en gare d'Herbesthal. Deux Feldgendarrnes se présentent pour la vérification des passeports. Il n'y a qu'un autre civil dans le compartiment. D'un geste furtif, le prisonnier désigne l'autre civil, faisant comprendre qu'il s'agit d'un suspect. Les deux Allemands se dirigent vers l'homme désigné, mais notre P. G. n'en attend pas plus, ouvre la portière, saute du train et disparaît par les souterrains. Il est rentré. Un camarade, rappelé en Belgique en sa qualité de fonctionnaire, s'empressa de prendre nos adresses dans l'intention de rendre visite à nos familles et leur donner de nos nouvelles de vive voix. Il quitta le kommando le 1erseptembre 1941 et passa deux ou trois semaines au stalag, avant d'être rapatrié. Aussitôt rentré en Belgique, il se mit en devoir de tenir sa promesse et commença ses visites. Il se rendit à Liège, dans la famille de son camarade G... et à l'épouse de celui-ci qui le reçut aimablement, il exposa le but de sa visite. Madame G. le remercia et l'introduisit dans le salon où, dès le seuil, il crut tomber à la renverse : son camarade était là, qui l' attendait avec un sourire amusé. Évadé la nuit du 5 septembre, il était rentré chez lui moins de 48 heures après. Que d'autres encore ont réussi à se faire rapatrier par train sanitaire, après avoir joué la comédie pendant des mois dans les Reviers et Lazarett ! Les cas sont innombrables et on n'en finirait pas à les conter. La résistance du prisonnier de guerre fut agissante en toute circonstance et les évasions en ont consacré les plus belles pages. Qu'un hommage soit rendu à ceux qui s'en sont montrés les plus dignes, à ceux qui ont maintenu parmi nous l'idéal de liberté, en une terre d'exil où cette liberté était sacrifiée entièrement à l'asservissement. XXI LA
PROPAGANDE NAZIE. Il est compréhensible que, dans une guerre d'idéologie comme celle que nous venons de connaître, la propagande du vainqueur ne se manifeste pas seulement envers les populations des pays occupés, mais cherche à atteindre tous les individus, allant même au-delà des zones d'influence, comme il a été constaté. Notre condition de prisonnier de guerre nous plaçait en quelque sorte dans une zone d'influence directe, mais la propagande nazie n'obtint pas le succès escompté auprès de nous. Il est une chose à reconnaître ; le prisonnier de guerre sut maintenir sa dignité de soldat au-dessus des contingences idéalistes vers lesquelles on voulait l'entraîner. Quoique ne désarmant pas, les Allemands comprenaient que la propagande parmi les prisonniers de guerre était inopérante et que ceux-ci avaient fait leur, avant eux, le slogan très répandu, en Allemagne : « Feind bleibt Feind » dont les affichettes se retrouvaient dans tous les endroits publics. L'ennemi reste l'ennemi ! Incontestablement, ces trois mots visaient les prisonniers de guerre et incitaient le public à la prudence vis-à-vis d'eux. Le fait de se côtoyer journellement, pendant des mois, des années, fait naître une certaine familiarité entre les individus, pouvant aller jusqu'à l'oubli des motifs qui les ont réunis. C’était vrai pour tous, mais combien plus dangereux pour les Allemands. Et s'il faut reconnaître que le prisonnier de guerre, en général, ne perdit rien à ce contact permanent avec les civils, il n'en était pas de même pour ces derniers, ébranlés bien souvent par nos raisonnements et nos comparaisons d'existence sur l'avant-guerre. Canons ou beurre ! Il suffisait parfois de propos enfantins pour réduire un peu ce feu fanatique qui couvait chez tout ouvrier allemand. Un deuxième slogan vint renforcer le premier, dès les premiers mois de 1942. « Vorzicht ! Feind hôrt mit ». ce qui revient à dire que tout allemand doit se méfier des étrangers, même des prisonniers de guerre. Il faut s'abstenir, non seulement de parler avec eux, mais aussi d'engager des conversations en présence d'étrangers. Mais leur propagande n'en continuait pas moins, en dépit de leurs slogans incitant à la méfiance. A la mi-juin 1940, alors que nous « crevons » dans un stalag de passage, à Neubrandenbourg, nous recevons le n° 1 de l'infecte feuille « Le Trait d'Union ». Avant d'y jeter les yeux, le mot « propagande » s'entend déjà dans les groupes, ce qui fait augurer qu'on n'est pas décidé à se laisser berner. L'état de faiblesse dans lequel on nous entretient dans ce stalag du diable n'est que de caractère physique et ses conséquences n'ont pas atteint nos facultés mentales ; nous ne sommes pas mûrs pour le cabanon et encore moins pour l'ordre nouveau. Des nouvelles diffusées par la radio du camp nous font connaître, chaque jour, la marche des événements qui, pour désastreux qu'ils étaient à l'époque, n'en affectaient pas nos sentiments de mépris à l'égard des schleuhs ; notre ressentiment envers eux, au contraire, s'en accroissait singulièrement. 1914 est si près encore ! Et l'uniforme gris qui circule dans nos groupes, laisse en nous la plus pénible impression, car il y a des forfaits qu'on ne peut oublier. Feind bleidt Feind ! ... Le Trait d'Union nous poursuivra jusqu'au dernier mois de notre captivité. De mensuel qu'il était au début, il deviendra hebdomadaire et finira par nous être distribué deux fois par semaine, avec édition spéciale wallonne. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, il semble qu'on veuille précipiter les choses, comme si la propagande perdait ses fruits entre deux tirages trop espacés. Qu'espèrent-ils donc ? nous gagner à leur cause ? Peine perdue ! Le Trait d'Union traîne sur les tables comme un objet que l'on est habitué d'y voir et auquel on n'accorde plus d'attention. Si par ennui ou désœuvrement, un camarade en fait la lecture, il est extrêmement rare qu'il en fasse des commentaires. Si la propagande de ce journal fut nulle parmi nous, il n'en reste pas moins que le Trait d'Union eut son utilité, mais dans un domaine d'ordre ... plus pratique, dont nous ne parlerons pas. Il est toutefois regrettable de constater que quelques prisonniers français, gagnés au Pétainisme, aient mis leur plume au service du nazisme pour vanter les bienfaits de l'ordre nouveau. La propagande se poursuivit par la présentation de films cinématographiques dont la tendance manifeste amenait le sourire sur toutes les lèvres. Au kommando de Stettin-Bredow, il y eut trois séances, dont l'opérateur et commentateur était le sonderführer du stalag. Un bon nombre de prisonniers assistaient à la première, heureux de trouver là une distraction qui faisait diversion à la longue journée de travail qu'ils venaient d'accomplir contre leur gré. La deuxième séance fut un four, quelques prisonniers seulement y assistaient. Aussi, à la troisième, le kommandoführer obligea tous les prisonniers à y assister, après les avoir réunis à l'appel. A cette occasion, l'esprit P. G. se manifesta encore, la grande majorité des prisonniers ne trouvant pas, dans leurs poches, les 10 pfennigs de Lagergeld qui leur étaient réclamés à l'entrée de la salle ; Il fallut bien leur accorder la gratuité de l'entrée. Et lorsque se déroula le film, les réflexions fusèrent de partout, réduisant à néant les prouesses des stukas, minimisant la valeur des panzers ou prédisant la croix de bois au soldat allemand qui venait de recevoir la croix de guerre. Le sonderführer, comprenant que toutes ces plaisanteries douteuses compromettaient sérieusement le but à atteindre, n'insista pas : on ne le revit plus. En 1943, les journaux embochés venant de Belgique nous apportent les premiers échos de certaines mesures qui pourraient être prises envers nous ; les prisonniers belges, à l'instar de ce qui se fait pour les français, pourraient passer dans la catégorie des travailleurs civils. Ce ne fut jamais qu'un projet, les organismes allemands s'étant rendu compte, très probablement, de l'insuccès auquel était voué pareil essai de dissociation des prisonniers belges. Et en fait, ceux-ci n'en discutèrent pas tellement, outrés qu’ils étaient qu'on puisse mettre en doute leur qualité de soldat. Plus tard encore, on amena dans les stalags certains prisonniers dont les convictions politiques, avant la guerre, auraient pu faire croire à un retournement facile des idées – sinon en faveur de l'Allemagne, tout au moins en adversaires du bolchevisme – pour les inciter à prendre du service dans l'armée légionnaire. Les huées qui accueillirent Pevenasse et sa bande démontrèrent sans tarder que la couleuvre ne passerait pas et que les prisonniers rejetaient avec mépris la vie dorée que l'on faisait miroiter à leurs yeux. En effet, dans certains stalags, les prisonniers appelés connurent une vie de prince pendant quelques jours, c'était pour eux la grande liberté, les mets fins et le champagne. Ces agapes généreuses ont bien fait rire nos camarades qui, faut-il le dire, ont fini par retrouver leur escorte et réintégrer leurs kommandos respectifs. En 1944, le même essai fut tenté, dans les kommandos importants, à Bredow notamment, sur nos camarades français. Ceux-ci, les bras croisés, les yeux rivés sur les légionnaires, avaient pris une attitude de juge et leur dédain muet en imposa immédiatement. Après ces essais infructueux, on nous laissa en paix. Seul, le T'rait d'Union subsistait, mais on sait qu'il n'apportait rien de sensationnel dans notre vie de captifs. En général, les prisonniers de guerre surent conserver une dignité d'âme qui leur fait honneur et si quelques rares P. G. montrèrent quelque faiblesse passagère, il n'y a pas lieu de leur en tenir rigueur, car on doit tenir compte que la force de résistance ne peut se manifester chez tous, avec la même intensité. Cinq années s'écoulèrent sans que, jamais, le prisonnier ne cesse de répéter : « Peind bleibt Feind ! » XXII KRANKENREVIER. Le sujet est d'importance, car on se doute bien qu'il n'était pas possible de passer cinq années dans les conditions déprimantes de la servitude, sans avoir fait connaissance avec l'infirmerie. Il n'entre pas dans mes intentions de généraliser ce qui va être détaillé plus loin, je me bornerai tout simplement à relater les faits, tels que je les ai connus et vécus. A Stettin, l'infirmerie était installée sur le champ de manœuvres à proximité des casernes, dans le faubourg Sud de Krekow, c'est-à-dire en situation opposée au kommando de Bredow. La Krankenrevier se composait de baraques en tôle et en panneaux-bois, tout comme le plus vulgaire kommando. De l'internement à l'infirmerie, je n'en parlerai pas, n'en connaissant que peu de choses, mais m'attacherai aux visites médicales pures et simples. Au cours de l'hiver 1940-41, particulièrement rigoureux, les malades du kommando se rendaient à pied à la visite du docteur ; c'était voulu par le kommandoführer qui ne prenait aucun souci de l'affection dont on se réclamait. Cela faisait un bout de chemin, par raccourci, qui prenait une heure et demie de temps pour s'y rendre et autant pour en revenir, si le groupe ne contenait pas d'éclopés. On s'imagine aisément par ce détail combien, était pénible la situation du malade qui devait recourir aux soins d'un médecin. Plus tard, on nous permit de prendre le train qui nous conduisait à une gare située à 25 minutes de marche de l'infirmerie. A la Revier, les malades étaient parqués dans la plaine et attendaient patiemment d'être appelés auprès des médecins. On pouvait être certain de piétiner la neige pendant un laps de temps minimum de 3 heures. On y affrontait une bise âpre qui sévit toujours dans cette région et si l'on se rappelle, qu'au cœur de l'hiver, le thermomètre marque de 30 à 38 degrés sous zéro, pendant la journée, on se rendra compte que le malade pouvait trouver là une aggravation de son affection, plutôt que la guérison. Mais on y allait cependant, avec l'espoir que quelques jours de repos seraient accordés, c'était la seule compensation au sacrifice d'un tel déplacement. Avant de se présenter devant les médecins, on se déshabillait dans une petite place attenant à la. salle des visites. Quarante hommes et plus étaient encaqués dans ce réduit de 12 m², s'exerçant à une gymnastique savante, au milieu des bousculades, pour se dévêtir. Il n'y a que quelques crochets pour pendre les vêtements ; aussi, la majorité doit-elle se résoudre à les déposer par terre ; il faudra tout bouleverser pour retrouver ses frusques, après la visite. Si le temps est pluvieux ou neigeux, les loques auront absorbé la boue et l'eau amenées du dehors par nos sabots. Et enfin, on pouvait pénétrer déchaussés, dans la salle des visites et comme on y était admis par groupes de 10 malades, certains pouvaient attendre une demi-heure avant d'y passer à leur tour. Tant pis pour les bronchiteux ! Une fois là, obtenait-on satisfaction ? Etait-on sûr d'y être soigné, après auscultation consciencieuse ? Hélas, pas toujours ! Car, si parmi les médecins qui se sont succédé à la Krankenrevier de Stettin, il en est dont il faut reconnaître le meilleur esprit de dévouement, il en est d'autres qui méritent le déshonneur d'un blâme, pour ne pas dire plus. Ce médecin, exerçant à l'infirmerie au début de la captivité, qui gueulait comme un putois, à propos de tout, comme à propos de rien, qui vous faisait mettre en position pour avoir négligé de l'appeler par son grade, puis vous renvoyait sans soins. Cet autre qui répudiait le malade flamand pour le motif qu'il ne comprenait pas son langage, alors qu'il ne manquait pas d'interprètes autour de lui. Ce troisième encore qui donnait ses ordres aux infirmiers, sans abandonner la lecture d'un roman d'amour qu'il tenait en main. Il en était de meilleurs, heureusement, auxquels les malades doivent d'être rentrés chez eux et qui se sont dévoués dans la plus digne abnégation. A ceux-là qu'un sincère et vibrant hommage leur soient rendus ! Pour être admis à séjourner à l'infirmerie, il fallait recevoir l'approbation du médecin allemand. Beaucoup de « Herr Stabartz » se sont succédé à la Revier au cours des cinq années et il faut dire que la plupart étaient, avant tout, soldats, suant l'orgueil dans leur uniforme d'officier allemand et oubliant la mission humanitaire que leurs fonctions imposent. Ils étaient raides et durs ! Au cours de la visite, les malades non internés, étaient classés dans trois catégories et annotation était faite au registre du kommando. Il y avait tout d'abord les « Arbeit » qui étaient désignés pour la reprise immédiate du travail. Ensuite, les « Lagerarbeit », auxquels les médecins défendaient tout travail lourd, ne leur permettant qu'un, travail léger au camp. Et enfin, les « Arbeitunfahig » qu'on ne pouvait employer à aucune besogne, même légère. Au kommando de Stettin-Bredow, les Lagerarbeit étaient employés à des travaux qui n'avaient rien à envier à ceux des chantiers, le kornmandoführer cherchant à décourager les malades et à les inciter à reprendre le travail, plutôt qu'à se rendre encore aux visites prévues au registre. Et, à ce sujet, je citerai un cas personnel qui démontrera jusqu'où pouvait aller le travail léger dans ce kommando disciplinaire. Un jour, comme d’habitude, le départ des malades avait eu lieu à 7 h. 15 et après la longue station debout à la Revier, nous rentrions au kommando, à 13 heures. L'unteroffizier qui veillait à notre sécurité avec un soin hargneux, nous rappela à 13 h. 30 et se mit en devoir de distribuer la besogne aux Lagerarbeit. Celle qui me fut confiée consistait à se rendre à Wenndorf – localité située à plus de 10 kms de notre camp – pour y chercher des effets d'habillement. Pour ce faire, il fallait utiliser une charrette à bras. J'avais des plaies ulcéreuses aux jambes et la cheville gauche était enflée à trois fois, son volume normal. Que pouvais- je faire, sinon protester véhémentement contre cette décision abusive de m'envoyer faire ce déplacement, alors que j'étais esquinté déjà par celui du matin. Mes protestations ne servirent qu'à me faire octroyer quelques coups de botte au bas des reins et l'homme de confiance lui-même ne put rien changer à la volonté de notre honnête teuton. Chaussé de sabots, j'effectuai les 20 à 22 kms du parcours et je rentrai au kommando à 9 heures du soir. C'était du travail léger pour éclopé. L'immonde brute avait aussi imaginé de n'accorder la visite qu'à un nombre de malades n'allant pas au-delà de 10 % d'abord, 8 % ensuite, de l'effectif du kommando. Il s'ensuivait que des prisonniers malades voyaient leur demande rejetée et étaient contraints de se rendre au travail, dans des conditions parfois bien malheureuses. Cette façon de procéder continua encore après que ce soudard eut quitté le kommando et passé la main à un confrère. En contre-partie, le malade évincé aurait pu rester au lit et ne pas se rendre au travail, dira-t-on ; mais ce moyen n'était admis que si le thermomètre que l'on vous appliquait sous les aisselles, marquait 38,5 de température, si non, une sentinelle vous conduisait au travail, non sans vous avoir préalablement débité un chapelet d'injures, parmi lesquelles le « Schweinhund » revenait le plus souvent. J'ai connu pas mal de cas où l'état du malade nécessitait l'internement à la Revier, sans que l'intéressé puisse être admis à la visite, en raison de ce pourcentage et cela durait jusqu'au jour où la chance le favorisait enfin de se présenter dans les premiers pour obtenir son inscription. Si, en plus, on sait que les médicaments faisaient défaut et que les pansements étaient faits au moyen de bandes de papier-crêpe qui ne tenait pas, on comprendra que l'emploi de la méthode Coué était plus recommandable. Mais dès lors, il n'y a pas lieu de s'étonner si bon nombre de prisonniers sont rentrés au foyer, handicapés dans leur santé. XXIII DANS UN
LAZARETT. La ville de Stettin ne possédait pas de Lazarett pour prisonniers de guerre ; seule la Krankenrevier existait pour les quelques milliers de prisonniers répartis dans les kommandos de la ville et de ses faubourgs. Ce qui explique pour une part également, le manque de soins et les difficultés auxquelles se heurtaient les malades pour être internés à la Revier, celle-ci pouvant contenir 150 à 200 couchettes. Il existait cependant des cas où le transfert du malade ou du blessé était nécessaire, notamment en vue d’opération chirurgicale. Le patient était alors dirigé vers la Revier du Stalag, à Greifswald ou transféré au Lazarett de Stargard ; parfois aussi, mais plus rarement, vers l'hôpital du Stalag IIA, à Neubrandenbourg. 
Un groupe de P.G. à Stargard. François est le 3eme assis à partir de la gauche Stargard est une petite ville de 35.000 habitants, située sur l'Ilhna, affluent de l'Oder, à 34 kilomètres de Stettin. Sa principale industrie consiste dans la construction de locomotives et on peut y voir de vastes dépôts pouvant contenir 2000 machines de ce genre. A l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire fin 1943, la ville de Stargard possédait d'innombrables Lazarett dans lesquels étaient soignés principalement les blessés du front russe. C'est ainsi que l'on rencontrait fréquemment, dans les rues, les amputés des bras et des jambes. Mais plus nombreux encore étaient ceux qui avaient un membre ou un organe gelé. Parmi tous ces hôpitaux, un seul était réservé aux prisonniers de guerre d'une vaste région, dans les locaux d'une école désaffectée pour la cause, la Schroederschule, et pouvait contenir 350 lits environ. Quel accueil le malade y recevait-il ? J'y ai connu un chirurgien hongrois, deux docteurs français, un serbe et un Italien tous prisonniers de guerre. Et il faut reconnaître hautement que les qualités de dévouement et d’abnégation de ces cinq hommes, forçaient l'admiration de tous les hospitalisés. Ces médecins apportaient aux malades le remède excellent de la confiance dans l'issue d’une pénible épreuve qui s'ajoutait aux autres. Le chirurgien hongrois W…, modeste soldat de 2ème classe à la Légion étrangère, était en kommando dans un domaine, sans que jamais, il ait fait valoir ses qualités de praticien, lorsqu’on ramena, un jour, un prisonnier russe se tordant de douleur. Le médecin l'examina et pronostiqua une appendicite dont l'urgence de l' opération nécessitait une intervention immédiate. Par des moyens de fortune et devant la sentinelle éberluée ; le chirurgien entreprit l'opération, une lame de rasoir remplaçant le bistouri. Il sauva le malheureux. Ce fait valut au chirurgien de devoir s'expliquer devant les autorités allemandes et, après. confrontation avec des médecins allemands, il lui fut confié la mission d'exercer son art au Lazarett de Stargard. Travaillant de jour et de nuit, cet apôtre se dévouait sans cesse et on peut dire que des centaines de prisonniers lui sont redevables de la vie. Les boches voulurent même s'assurer le précieux concours de cet homme incomparable dans leurs hôpitaux, mais toujours, il s'y refusa. Un médecin français, actuellement médecin-chef de l'Hôpital militaire de Rennes, à qui les Allemands offraient le retour en France, car ils avaient la possibilité de pourvoir à son remplacement, leur répondit avec la même simplicité qu'il en mettait dans son dévouement : « Je suis prisonnier et le resterai jusqu'à la fin, avec mes malades ». Il en fut ainsi et il continua l'œuvre d'apostolat que, chrétiennement, il s'imposait depuis le début de la captivité. Et ce médecin italien qui, pour réconforter un de ses jeunes compatriotes découragé, se pencha sur lui et l'embrassa affectueusement, en lui prodiguant des paroles de réconfort. Geste sublime de charité, d'amour et de dévouement. Toute la vie de captivité de ces cinq hommes se trouve auréolée d'actes de ce genre, se multipliant sans cesse pour sauver des corps, et des âmes. Des malades, ils étaient les frères, les amis, leur apportant le sérum de l'optimisme et de la foi, à défaut du médicament dont ils pouvaient être dépourvus. Et ils guérissaient aussi sûrement en insufflant à leurs malheureux clients le baume de la volonté, infaillible en pareille circonstance. Hommages, gratitude, prières ! C'est tout ce que nous pouvons laisser en menue monnaie pour payer tant de services. Le « Stabartz » lui-même, quoique conservant rigoureusement ses distances vis-à-vis de nous n'était point mauvais et accomplissait son rôle en conscience. Pas ou peu de reproches à lui faire. Tout aurait été pour le mieux – si l'on peut dire – dans ce Lazarett, si le diable ne s'en était mêlé sous les traits d'un Oberfeldwebel, dont la mission était de veiller à la bonne ordonnance des locaux et au respect de la discipline. Hélas ! ce feldwebel était devenu tout-puissant et abusait arbitrairement de ses droits. Certains l'ont connu en 1940 déjà, alors que, simple soldat, il laissait peu de repos aux malades par ses apparitions intempestives dans les chambres. Il acquit ses grades l’un après l'autre, sans jamais quitter l'hôpital, grâce à l'appui de plusieurs officiers supérieurs avec lesquels il « bambochait » régulièrement, au Lazarett même. La nourriture était infecte et nettement insuffisante ; aussi, fallait-il y suppléer par des colis supplémentaires que des œuvres de charité nous faisaient parvenir par l'intermédiaire de la Croix-Rouge Internationale. Mais le trop fameux Feldwebel avait soin d'y prélever ce qui pouvait lui convenir pour organiser ses banquets. On le redoutait comme un despote et on évitait de le rencontrer dans les couloirs du vaste bâtiment. Lorsque, de nuit, il pénétrait dans une. Chambre, il trouvait toujours un prétexte pour justifier le geste crapuleux qu'il méditait et qui, bien souvent consistait à projeter sur le plancher le contenu du seau destiné aux besoins naturels des malades arrosant ainsi chaussures, chaussettes et valises qui se trouvaient sous les lits. Plein d'une colère feinte… il ordonnait alors, à grand fracas de sa voix de braillard, de nettoyer la chambre. C’était pour lui une heure de distraction malsaine qui convenait parfaitement à ses goûts. D'autres fois, avec la même fureur ; il lançait sur le plancher le contenu des tiroirs des petites commodes installées à côté des lits et tout se mélangeait pêle-mêle. Il ne restait plus, après son départ, qu'à faire l’inventaire et à reconstituer ce que chacun croyait être ses biens. Mais il y avait plus ! Combien de prisonniers, gravement atteints par une affection qui les mettait hors service, se sont vu retirer le D. U. (Dauernunfähig – incapable de durer) libérateur que leur avait remis le médecin allemand. Il suffisait de déplaire à ce Feldwebe1 pour être l'objet d'une surveillance toute spéciale de sa part jusqu'au moment où il parvenait à vous prendre en défaut. C'était alors le renvoi en kommando, d'où il fallait repartir à zéro pour retrouver plusieurs mois après, le « Dauernunfähig » qui vous renverrait au pays. Combien de malades, ayant subi une intervention chirurgicale, se sont vu transportés sur une civière, le lendemain ou le surlendemain de l'opération, et enfermés dans le cachot du Lazarett pendant plusieurs jours, dans le froid, presque sans soins et sans nourriture, sur les ordres donnés par ce soudard inhumain. Cet homme ne connaissait que le mal et s'évertuait à détruire ce que les médecins mettaient de patience à nous guérir. Bien des incidents et des rébellions éclatèrent, sans autre résultat que le retour des délinquants au kommando. Et toutes les réclamations auprès des autorités supérieures restèrent lettre morte. Néanmoins, cet Oberfeldwebel recevra son châtiment : En mai 1945, reconnu par un prisonnier français, sur la route de Stettin. non loin de Neubrandenbourg, alors qu'il faisait partie d'un convoi de prisonniers allemands sous la garde des Russes, ce camarade n'hésita pas à le dénoncer et il fut pendu sur le champ à l'un des arbres qui bordaient la route. Justice sommaire ! Expiation rapide ! Mais châtiment mérité ! XXIV VEILLÉES FUNÈBRES. La mort ! Bien rare fut le prisonnier qui ne vécut avec l'appréhension de la mort, par accident ou maladie, sous les bombardements ou lorsqu'il se trouvait dans la zone du front. Le prisonnier fut hanté par la pénible obsession de devoir mourir en terre ennemie. Hélas! plus de 8.000 des nôtres devaient payer ce tribut suprême à la cause qui leur était chère. 
A Stettin. Honneurs militaires des Allemands avec grand décorum En juin 1940, à Neubrandenbourg, à quelque 200 mètres du stalag, une soixantaine de petites croix de bois marquaient l'emplacement où dormaient autant de prisonniers polonais. C'est là que nous avons suivi des yeux, avec un serrement de cœur, le premier convoi funèbre qu'il nous a été donné de connaître au début de la captivité : l'enterrement d'un soldat hollandais que ses camarades en larmes, allaient devoir abandonner au Krieggefangenen Friedhof du camp. 
A Stettin. Au bord de la fosse commune en présence de nombreux officiers allemands Moins de cinq années après, nous retrouverons ce cimetière qui forme, cette fois, un immense quadrilatère où des milliers de prisonniers de guerre de toute nationalité sont inhumés. Des tertres imposants, ressemblant à d'immenses silos, contiennent les restes de 11.000 prisonniers russes et des milliers de croix de bois, portant les noms et matricules de prisonniers belges, français, serbes, etc. 
A Stargard. Hommage simple des P.G. A Stettin, combien de milliers de corps de prisonniers sont venus s'ajouter à ceux de 1914-18 et combler les espaces vides de ce cimetière militaire de Wenndorf, l'un des plus vastes de l'Allemagne. 
A Stargard. Fosse commune dans un cimetière de 1914-1918 Il faut rendre cette justice aux autorités militaires allemandes, dans les villes de garnison tout au moins, les honneurs militaires étaient rendus à nos malheureux camarades que la Mort avait emportés. Un peloton de 12 hommes tirait une triple salve sur le bord de la tombe encore ouverte et une couronne, portant l'inévitable croix gammée, était déposée au nom de l'armée allemande. Il ne faut voir dans ce fait, rien que de très naturel et bien dans le cadre des coutumes de la guerre. Néanmoins, nous reprochions à nos ennemis d'user d'un cérémonial flairant trop la propagande lorsque, après un bombardement, les prisonniers qui en avaient été les victimes, étaient conduits à leur dernière demeure, au son de marches funèbres exécutées par une fanfare militaire et escortés par de nombreux officiers allemands. Nos malheureux amis eussent préféré plus de discrétion, certainement, et moins d'honneurs aussi de la part de ceux qui, la veille encore, les maltraitaient. Jusque dans les plus tristes événements, la propagande nazie trouvait ses droits. A Stargard (Stalag IID), le cimetière des prisonniers de 14-18 existait toujours. Naturellement envahi par les mauvaises herbes. Il fut proprement nettoyé par les prisonniers français et remis en état de recevoir décemment, ceux d entre nous que le destin accablait. Trois monuments se dressaient encore, parfaitement conservés : roumain, serbe et russe, ce dernier très imposant et conçu sans style. Un monument français vint s'y adjoindre et, soi-dit en passant, son inauguration, qui eut lieu le 1er novembre 1942, fut l'objet d'un cérémonial de propagande pétainiste, sans conteste .•Scapini en personne y assistait, de même qu'un général français gagné à la cause et qu'on avait tiré de son Oflag, pour cette occasion. Le lendemain soir, un autre événement venait détruire tout l'effet de cette propagande. Un train, formé de wagons à bestiaux, était entré en gare et, dès l'ouverture des portes à glissières, le troupeau humain qui en débarqua attira immédiatement les regards de pitié et des paroles de commisération de la part des spectateurs. Plusieurs centaines de prisonniers belges et français, hâves, déguenillés, dans un état de santé manifestement déficient, s'en revenaient du sinistre camp de Rawa-Ruska où ils avaient séjourné durant plusieurs mois. Des civières furent requises pour le transfert des plus affaiblis au Lazarett, tandis que d'autres gagnaient la Hauptrevier du stalag pour y recevoir des soins. Là aussi, la mort était passée et trois corps furent emportés sur une charrette. Par trois fois, il m'échut la triste corvée de creuser la fosse destinée à recevoir les corps de prisonniers français et d'emprunter ainsi la profession de fossoyeur. La profondeur de ces fosses qui, réglementairement, devait être de 1 m. 80, n'alla jamais au-delà de 1 m. 30 car, à ce moment, nous nous trouvions à hauteur de deux cercueils datant de l'autre guerre et dont le bois vermoulu cédait sous notre poids. Ainsi reposaient en ces endroits, deux soldats russes et un soldat français, réunis en la même tombe, à 25 ans de distance, pour avoir lutté contre le même envahisseur. Dans une chambre du Lazarett, dix-huit hommes occupent les lits. Dans un coin, un homme jeune encore, le visage contracté par la souffrance, gémit faiblement. Huit jours auparavant, il a subit une opération très grave et une complication inattendue a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale qui met ses jours en danger. Ses camarades veillent sur lui à tour de rôle, pour l’empêcher de faire tout mouvement qui compromettrait ses chances de guérison. Le plus grand silence est imposé et on l'observe rigoureusement ; on marche sur la pointe des pieds et la porte de la chambre ne s'ouvre et se referme qu’avec une extrême prudence. Malgré ces sages précautions, Jean A ... est décédé. Là-bas, quelque part dans le namurois, sa femme et sa petite fille l'attendront vainement. Le jour suivant, l'aumônier du Lazarett, assisté de son acolyte seulement, célèbrera la messe, des morts, à laquelle personne n'est autorisé à assister vu l'heure trop matinale. Au cours de la matinée, le cercueil, porté sur les épaules de six personnes, est amené dans l'avant-cour de l'hôpital ; le couvercle est disjoint par suite de la mauvaise qualité du bois et on aperçoit le linceul. L’aumônier récite les prières rituelles qui précèdent le départ vers le cimetière et la bière est ensuite déposée sur le corbillard des pauvres, simple plate-forme que tire un vieux cheval noir. Le cercueil est recouvert du drapeau français, le seul autorisé. 
Le monument français dans le cimetière des P.G., à Stargard. Le personnage du centre est Georges Scapini, ambassadeur du gouvernement de Pétain. Suivi d'une vingtaine de camarades, le convoi traverse la ville sous l'œil indifférent des passants ; pas un seul ne se découvre au passage, le respect aux morts n'existe pas en Poméranie. Et ce sera enfin l'inhumation dans le non moins pauvre cimetière des prisonniers où une petite plaque de ciment rappellera le nom et le numéro matricule de notre camarade. Le même jour, une valise contenant les quelques souvenirs du défunt sera expédiée à la famille. Il est difficile de donner à l'enterrement d'un prisonnier, le nom de cérémonie et cette extrême simplicité ne varie pour aucun d'entre eux ; il n'y a pas de considération de grade. Il en sera de même pour ce vieux colonel français, qui s'était attiré toutes les sympathies au Lazarett, par sa bonhomie, son allure paterne, son patriotisme et son ardente conviction dans la victoire finale. Lui aussi nous a quittés simplement en pauvre, n'emportant avec lui que les regrets unanimes de ceux qui l'avaient connu. Funérailles discrètes qu'accompagnent la réelle affection et les regrets sincères de tous ceux qui, en même temps, reportent leurs pensées vers ces mères, ces femmes, ces enfants qui, au pays, attendent patiemment l'absent et sont loin de se douter que la Camarde fauche impitoyablement dans les rangs des prisonniers. Des milliers de petites croix de bois se dressent pauvrement dans de nombreux cimetières d'Allemagne. Un nom, un numéro, une date. C'est tout ! Un homme est couché dans l'éternelle demeure pour avoir, un jour, pris les armes pour défendre sa Patrie envahie. Otage et esclave, ce soldat n'a plus connu que l'amère dérision d'une vie de souffrances, avant de céder au sacrifice suprême. Ses yeux se sont fermés sur la dernière vision d'un décor familial où des êtres aimés tendent vers lui des bras impuissants. Son âme s'en est allée dans l'Au-delà, emportant l'image de ceux auxquels il a tant crié des mots d'espoir, dans ses missives toutes pleines de résignation. Pour nous, que le destin a épargnés, nous conservons au cœur, le souvenir ému de tous ces frères de captivité que les pressentiments n'ont pas trompés et dont les corps sont inhumés en terre ennemie. Leur disparition fut la conséquence directe du Devoir accompli envers la Patrie, la Civilisation et la Liberté ; ils ont droit à notre plus grand respect. Aussi, nous
devons garder intact le souvenir de ces obscurs P. G. ! Que l’oubli ne vienne
jamais ternir leur mémoire ! XXV LE RESPECT DE LA CONVENTION. Contrairement à ce que beaucoup de prisonniers croient actuellement encore, la Convention de Genève n'est pas née de l'après-guerre 1914-18. En effet, elle date du 22 août 1864 et fut révisée une première fois en 1906, puis encore après le conflit de 14-18 pour tenir compte de la puissance nouvelle des armes. Le protocole comprenait une série d'articles, réglant le sort des blessés et des malades, la situation des établissements sanitaires qui doivent être respectés par l'ennemi, le sort du personnel sanitaire en cas de capture, le signe distinctif de la Croix-Rouge qui permet aux belligérants de reconnaître les formations sanitaires, etc... Et enfin, le sort fait aux prisonniers de guerre, les obligations et les droits des pays détenteurs . Je suis persuadé que la plupart des sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats, prisonniers de guerre en Allemagne, n'ont connu de cette Convention au début tout au moins, que ce qu'ils en apprenaient par brides et incidemment, les laissant pendant longtemps dans l'incertitude du vrai et du faux. Et de fait, dans les baraques, les discussions à ce sujet avaient un effet contradictoire qui prouvait qu'on n'en connaissait rien ou peu. Aussi, il est un reproche à faire à nos instructeurs de la Défense Nationale, de n'avoir jamais abordé la Théorie sur la Convention de Genève au cours de l’instruction militaire. S'il y a conflit, il y aura immanquablement des prisonniers et ceux-ci doivent pouvoir connaître les moyens de se défendre en captivité contre les abus et les entreprises de l'ennemi. Il est une chose certaine, c'est que les Allemands appliquaient cette théorie, puisqu'ils dotaient le butin de leurs jeunes aviateurs d'un livret qui leur donnait des instructions à suivre, au cas où ils seraient tombés en pays étranger. Pendant de nombreux mois, les schleuhs ont exploité notre ignorance. Personnellement, je n'ai pu prendre connaissance de la Convention de Genève qu'en août 1942, par un petit livre qui circulait de chambre en chambre, sous le manteau, et qui disparut tout aussi subitement qu'il était apparu. L'affichage de cette convention dans les kommandos devait se faire dans la langue des prisonniers y internés ; nous n'avons jamais pu que constater dérogation à cette obligation. Ce manquement faisait l'affaire de nos garde-chiourmes mais non la nôtre. Que de temps fallut-il pour faire admettre les 24 heures consécutives de repos par semaine auxquelles nous avions droit, afin de satisfaire aux soins corporels et matériels que réclamaient un dur travail et notre condition même ? Indifféremment, les Allemands faisaient travailler leurs prisonniers tout aussi bien le dimanche, que les jours de semaine, voire même la nuit. Et, à ce propos, qu'il me soit permis de raconter cette petite anecdote : Un dimanche matin, deux prisonniers, Van D et M .. , voulant profiter de leur journée de repos et du beau temps, s'installent devant leur baraque pour y faire une partie de jacquet. Le jeu est à peine commencé qu'une sentinelle s'avance et désigne Van D... pour effectuer une corvée, nettoyer la chambre du sous-off' allemand. Le gardien reçoit un refus catégorique et la partie de jacquet se poursuit. Mis au courant, l'unteroffizier fait appeler Van D....et lui demande le motif de son refus. Le prisonnier déclare que, habituellement, il travaille les sept jours de la semaine et que si aujourd'hui il bénéficie d'un jour de repos exceptionnel, il ne tient pas à le gaspiller en corvées et qu'il maintient son refus. Van D ... est un flamand qui s'exprime librement dans la langue allemande. Le sous-off' renouvelle son ordre, exige et devient furieux, pendant que Van D... reste calme, moqueur et provoquant. Le kommandoführer s'empare du fusil de la sentinelle et applique un vigoureux coup de crosse au bas des reins de notre camarade. Touché au côté gauche, Van D... présente l'autre côté en disant : « Vous pouvez recommencer, rien ne me fera changer d'avis ». Et le boche renouvelle son geste brutal immédiatement, mais aussitôt, la consternation se peint sur son visage, pendant que Van D... part d'un franc éclat de rire. La crosse du fusil s'est cassée et le morceau est là, sur le sol, qui hypnotise la brute. Il va devoir s'expliquer auprès de ses supérieurs. Toujours riant, Van D… s'éloigne sans que le kommandoführer songe à le rappeler ; de la corvée, il n’est plus question. Ce fait, pris parmi d'autres, est rapporté afin que l'on note bien l'esprit rebelle du prisonnier envers les ordres qui lui paraissaient en contradiction avec les termes de la Convention de Genève. La question nourriture a déjà été soulevée dans un précédent chapitre et la Convention de Genève qui prévoit que les prisonniers recevront la nourriture des troupes d'intendance du pays détenteur, y était pas mal bafouée. Nous pouvions à ce sujet, faire la comparaison entre un litre d'eau et un litre de soupe. De la visite médicale que tout prisonnier est autorisé à passer mensuellement, il n'en fut jamais question et l'on a appris, dans un chapitre récent, comment les schleuhs procédaient avec les malades, n'accordant la visite qu'à un infime pourcentage. Si, pour un soldat et un caporal ou brigadier, le travail était obligatoire, il ne l'était pas pour un sous-officier, mais celui-ci se voyait bien vite contraint de l'accepter, s'il ne voulait connaître le confort entre 4 planches. Les boches avaient adopté la méthode de contrarier les intentions de ces « réfractaires » par des exercices ou corvées qui n'en finissaient pas et un rationnement plus que réduit les affaiblissait physiquement, au point qu'ils étaient amenés, malgré eux, à accepter le travail pour sortir d'une situation qui s'avérait dangereuse et fatale. Cela se-passait, naturellement, au début de la captivité ; ceux qui, par la suite, refusèrent de continuer le travail, furent envoyés dans des camps disciplinaires de Pologne, à Kobjercyn, notamment. La Convention considère qu'au prisonnier ayant contrevenu au règlement ou qui, pour une cause quelconque, était passible d'une peine disciplinaire, il ne pouvait lui être fait grief, une fois la punition accomplie, des motifs de la sanction. Les peines d'incarcération pouvaient aller jusqu'à 21 jours au maximum : Dès lors, pourquoi les allemands laissaient-ils traîner des prisonniers pendant plusieurs mois dans les Strafkompagnies ? Pourquoi aussi envoyer les évadés malchanceux à Rawa-Ruska où, à plusieurs milliers, ils connurent toutes les misères. Situé à l'intersection des frontières de Pologne, de Roumanie et de l'U. R. S. S., le camp de Rawa-Ruska fut vite renommé et la télégraphie P. G. eut vite fait de nous le faire connaître sous son aspect réellement pitoyable ; la faim, le froid, la saleté, la vermine, les maladies, les mauvais traitements. Véritable camp de concentration pour prisonniers de guerre auquel, heureusement, il fut mis fin après plusieurs mois, grâce à l'intervention des autorités de la Croix- Rouge Internationale de Genève. A ceux des nôtres qui furent internés à la forteresse de Graudenz – il y en avait 42.000 en 1943, – il n'était pas permis de recevoir une lettre ou un colis. Les commissions de Genève se voyaient refuser l'entrée de cette forteresse redoutée et il fallut à ces délégués de la Croix-Rouge une forte dose de persévérance pour qu'on apporta enfin un léger soulagement au sort des malheureux qui croupissaient en ce lieu maudit. La Convention stipule également que le prisonnier ne peut être l'objet de sévices en guise de représailles. Voici un cas flagrant qui démontrera combien les Boches se souciaient fort peu de cette convention diplomatique au bas de laquelle ils avalent apposé leur signature. En janvier 1944, j'ai connu 734 soldats et sous-officiers canadiens qui avaient été faits prisonniers lors du débarquement de Dieppe et aux poignets desquels on pouvait encore voir des traces de fers et de chaînes. Pendant 18 mois, ces braves restèrent enchaînés. Au début, une courte chaîne de 20 cm. reliait leurs poignets ; ensuite, on allongea ces liens quelque peu pour permettre un peu plus d'aisance dans leurs mouvements. Le gouvernement canadien connaissait le sort qui était fait à ses fils et leur avait envoyé un wagon chargé de laines et tout un matériel de tricotage, afin que ces prisonniers puissent exercer un travail qui les tire de l'avachissement dans lequel ils devaient sombrer fatalement. Aussi, on pouvait les voir vêtus de chandails et de pullovers de toutes nuances qu'ils avaient tricotés eux-mêmes et coiffés de bonnets multicolores. Cet enchaînement avait été voulu en représailles d'un fait de guerre dont nos camarades canadiens ne pouvaient être rendus responsables. Autre cas : Lorsque l'armée de von Paulus dut se retirer devant Stalingrad et se replier sur une succession de « positions préparées à l'avance », le courroux des allemands ne connut plus de bornes et les malheureux prisonniers russes étaient sans cesse en butte aux mauvais traitements de la part de leurs gardiens. Heureusement pour eux, par les ondes, la voix de Staline vint avertir les brutes que si ces sévices ne cessaient pas, l'aviation russe laisserait tomber, sur les grandes villes du Reich, des bombes vivantes, en l'occurrence, des prisonniers allemands. Cet avertissement eut son effet immédiat et, dès ce moment, on pouvait voir les prisonniers russes mieux traités que les prisonniers belges et français. La Convention de Genève interdit également la punition collective, lorsqu'un coupable refuse de se découvrir. Quel est le kommando qui peut se vanter de n'avoir jamais connu les punitions collectives ? C'était courant et cela se rencontrait même lorsque le coupable d'un fait jugé punissable, était connu ; supplément qui atteignait la collectivité des prisonniers pour les engager à se tenir cois. Ce qui n'avait l'heur de surprendre personne, cette façon d'en imposer pour se faire craindre, étant bien dans les mœurs boches. Pourquoi les allemands ont-ils maintenu, jusqu'à la fin, des kommandos de prisonniers dans les grandes villes qui, par leur importance stratégique ou industrielle, devaient nécessairement être soumises à des bombardements intensifs ? Mieux encore, des kommandos étaient établis au centre des usines de fabrication d'engins de guerre, les rendant ainsi plus vulnérables aux attaques aériennes. La Convention de Genève prévoit, cependant, que les prisonniers de guerre ne peuvent être employés à des travaux ayant pour but des objectifs de guerre et que les kommandos doivent se trouver à une distance respectable des villes. Pour en terminer, citons encore le maintien des prisonniers dans la zone du front en 1945 et leur affectation à des travaux de défense et ce, malgré leurs vives protestations. Il serait vain de continuer. Durant cinq années, les allemands s'embarrassèrent très peu de la Convention de Genève qui fut traitée, suivant leur habitude, comme un chiffon de papier. XXVI RESISTANCE
PATRIOTIQUE. Dans un petit journal dinantais qui prit naissance au lendemain de la libération, on a pu lire en finale d'un article ayant trait à la liberté reconquise, une phrase libellée à peu près en ces termes : « Et maintenant, songeons à nos prisonniers qui furent nos premiers résistants et qui mènent encore le bon combat ». Le jeune journaliste, résistant reconnu, ne savait pas si bien dire. Les sentiments patriotiques qui animaient les prisonniers de guerre en captivité, étaient remarquables et chacun d'eux peut retrouver parmi ses souvenirs, bien des faits prouvant leur attachement à l'idéal qu'ils conservaient par devers eux comme une relique sacrée. Si, au cours de discussion, un camarade se laissait aller à prononcer des paroles impudentes, jusqu'à dénier en lui tout sentiment patriotique (cela se rencontrait rarement), il ne fallait pas longtemps et bien peu de chose parfois pour lui prouver que les mots inconsidérément prononcés n'étaient que le fait d'une lassitude passagère ou du cafard. Un acte, une idée ou un souvenir démontrait que le prisonnier était animé des meilleures intentions patriotiques, son jugement primaire n'ayant porté que sur l'aspect ordinaire de la question. Il nous était défendu de porter des insignes aux couleurs belges et, cependant, déjà en 1941, quel est le prisonnier de Stettin qui n'affichait le sien sur sa veste rapiécée ? Dans un kommando voisin du nôtre, un camarade passait uniquement ses soirées à la fabrication d'insignes tricolores à épingle et la distribution se faisait par le truchement des malades se rendant à la Revier. Là, se rencontraient les prisonniers de tous les kommandos et la diffusion des insignes se faisait ainsi dans un minimum de temps, pour une vaste zone. Certes, il y eut des insignes arrachés par un quelconque Feldwebel dont la hargne était à la mesure de son grade, mais ils étaient remplacés immédiatement. Le port des insignes continua donc en dépit de la défense qui nous était faite et, bien vite, on ne parla plus, que de loin en loin, de certaines interventions boches à ce sujet. De même, il était défendu de chanter les hymnes nationaux des pays alliés et, à plus forte raison, de les exécuter sur des instruments de musique. Au kommando de Bredow, on avait réussi à grouper une phalange de 22 musiciens qui, sous la direction d'un camarade expérimenté, adoucissaient nos pénibles moments et raccourcissaient nos longues soirées. Je me souviendrai toujours de ce soir du 21 juillet 1942, alors que les diverses équipes du kommando viennent de rentrer du travail. L'avis circule de baraque en baraque que, à l'occasion de la Fête Nationale belge, l'orchestre donnera un concert exceptionnel. Il faut savoir que les jours de semaine étaient réservés aux répétitions. A l'heure prévue, la baraque qui nous sert de salle de spectacle est archi-comble, plus de 300 prisonniers s'y entassent. Tout à coup, au premier mouvement du chef d'orchestre, tous les prisonniers se lèvent brusquement et restent figés en un garde-à-vous impressionnant. Sur les visages, on peut voir bien des traits trahissant une émotion intense et que, en homme, on tâche de refouler. Cette Brabançonne, exécutée en « forte », dans ce cadre et dans ce milieu, a bien plus de valeur qu'aucune autre entendue au pays en temps de paix. Ce tressaillement jusqu'au plus profond de nous-mêmes, cette émotion peinte sur nos visages et ces sentiments intérieurs qui nous poussent à la révolte, à la résistance, tout cela ne peut être perceptible que dans les circonstances spéciales que nous vivons. Alors seulement, on apprécie toute la portée patriotique et toute la valeur morale de l'hymne national. Notre résistance à l'ennemi se manifestait bien aussi dans le fait suivant. Pour nous rendre au travail, comme pour en revenir, on exigeait de nous la marche au pas militaire ; c'était normal, reconnaissons-le, puisque nous étions soldats. Eh bien ! jamais, aucune sentinelle n'a pu obtenir la parfaite exécution de cet ordre. Et nous cheminions avec une diversité de mouvements qui démontrait bien notre intention de résister à leurs commandements. Il n'en fut plus de même lorsque, au printemps 1942, on mit à la tête de chaque colonne un sous-officier belge, dont les commandements étaient exécutés militairement. On le conçoit, ces manifestations de notre mauvaise volonté irritaient nos gardiens, en même temps qu'elles faisaient nos « beaux jours » en captivité. Et nous avions à cœur de les renouveler à toute occasion, comme une pratique sportive ; les unes exigeaient parfois une entente préalable, les autres naissaient de la spontanéité. Citons deux exemples qui illustrent les moyens employés pour manifester ouvertement nos sentiments patriotiques derrières les barbelés. En septembre 1943, le jour de la capitulation de l'Italie, la bonne nouvelle a circulé rapidement parmi la gent P. G. A 6 heures, le soir, à la rentrée au kommando, dans les baraques, les prisonniers manifestent bruyamment leur joie, entrevoyant une victoire alliée plus rapprochée et, partant, une réduction du temps d'épreuves. Dans la cour, un trompette sonne le rassemblement des musiciens et ceux-ci se mettent bientôt en marche en exécutant le chant bien connu des prisonniers : « Dans l'cul », dont le titre grivois résume bien notre opinion sur l'issue des événements. Les baraques se vident et les prisonniers emboîtent le pas aux musiciens, en entonnant le fameux chant. De l'autre côté des barbelés, le feldwebel est sorti de son bureau et les sentinelles apparaissent sur le seuil et aux fenêtres de leur baraque, amusés par cette manifestation burlesque dont ils ne comprennent pas le motif. La cérémonie s'achève et chacun rentre « chez soi », après avoir ainsi fêté, à la manière P. G., un événement dont la répercussion heureuse n'est pas douteuse. Le lendemain, à la même heure, les sentinelles envahissaient les baraques et confisquaient les instruments de musique. Ils avaient compris... avec 24 heures de retard Autre fait typique : En octobre 1943, dans un stalag où je me trouvais à cette époque, quelque 20.000 italiens, amenés comme prisonniers après 'la capitulation de leur pays, ont été immatriculés. Leurs baraques se trouvent séparées des nôtres par des fils barbelés et les sentinelles montent une garde vigilante pour empêcher tout contact avec ces nouveaux venus. Un dimanche après-midi, environ 5.000 italiens ont été rassemblés sur le terre-plein. Devant eux, des officiers allemands et italiens ont déposé sur des tables plusieurs rames de papier imprimé. Il s'agit de recruter, parmi ces nouveaux prisonniers, des engagements pour la reprise des armes contre les Soviets. Et les discours se succèdent, en allemand d'abord, en italien ensuite. De l'autre côté de l'enceinte, un attroupement d'environ 300 prisonniers s'est formé (les anciens) et ceux-ci suivent de tous leurs yeux les opérations de recrutement. Enfin, un officier italien invite les « purs » à sortir des rangs et à venir se ranger devant lui. Dix, vingt secondes passent, pas un seul ne quitte les rangs. Au bout de ce court laps de temps, les prisonniers spectateurs, avec une spontanéité parfaite, battent des mains en des applaudissements frénétiques. Cela dure peu, il est vrai, car plusieurs officiers allemands ont sorti leur revolver et s'avancent menaçants, mais suffisamment pour faire comprendre aux italiens qu'ils recevaient toute notre approbation et que la mésestime dans laquelle on les tenait depuis leur arrivée au camp, disparaissait subitement devant leur résolution de ne plus combattre aux côtés des boches. Et, dès ce moment, ce fut la grande fraternisation entre eux et nous. Des centaines de cas seraient à citer, notamment les effets de démoralisation parmi les civils, dont il a déjà été question précédemment et, surtout, les cas beaucoup plus concrets des actes de sabotage. Par ces actes de résistance patriotique, le prisonnier de guerre peut franchement revendiquer la qualité de premier résistant. Soldat désarmé, il sut se servir des armes psychologiques qui se présentaient à lui et continuer à combattre l'ennemi par Devoir patriotique. Le mot « SERVIR » résume bien les qualités du prisonnier tout au long de ses 5 années de captivité. XXVII LE SABOTAGE. La main-d’œuvre étrangère, en Allemagne, apportait un appoint productif précieux par le nombre, à l'économie du pays et l'industrie se trouvait considérablement renforcée par cet accroissement impressionnant de travailleurs de toute nationalité, dont la grande majorité était composée de déportés. Dans les usines de guerre, la main-d'œuvre « prisonniers de guerre » était plus rarement employée ou de façon moins apparente, afin de ne pas constituer ouvertement un déni à la Convention de Genève, tout au moins en ce qui concerne les prisonniers belges. Mais cette question était facilement détournée en incorporant des prisonniers de guerre dans des usines dont on ignorait l'usage des pièces mises en fabrication, mais qu'un secret trop absolu faisait supposer que la destination finale pouvait être attribuée au montage d'engins de guerre. L'emploi de cette nombreuse main-d’œuvre devait nécessairement amener des « abus », soit par un rendement déficient de la production par une entente tacite entre les travailleurs, soit encore par des actes de sabotage et ce, malgré une surveillance intensive et une sévérité extrême. Chez les prisonniers de guerre, rares sont ceux qui ne se sont pas livrés à des actes de sabotage lorsque l'occasion se présentait, chacun suivant ses possibilités et selon le travail auquel il était affecté. Au début, les prisonniers agissaient avec prudence, craignant les représailles ; mais, par la suite complètement adaptés à leur situation, ils manœuvraient avec expérience et avec une sûreté parfaite d'exécution. Au kommando de Stettin-Bredow, les prisonniers étaient affectés à la construction d'une seconde ligne de chemin de fer, avec tous ses à-côtés et notamment la construction de viaducs. Au travail, le bris de manches de pioches et de pelles ne se comptait plus et il me souvient d'un jeune camarade qui, en janvier 1941, nouvellement arrivé sur le chantier, cassa 5 manches de pioche en moins d'une heure, ce qui lui valut d'être accusé de sabotage, mais il prétexta son inexpérience pour sortir d'embarras. En 1942, un talus qui avait été achevé quelques mois auparavant, dut être démoli. Au cours du déblaiement, on retrouva, enfouies dans la terre, 7 pioches, 12 pelles et 2 brouettes. Au cours de bétonnage, lorsque la bétonneuse était confiée à des prisonniers, combien de fois ceux-ci reçurent-ils un rappel à l'ordre, parce que les proportions de mélange de gravier, sable et ciment n'étaient pas respectées. Et mieux à la construction de la pile centrale du viaduc, alors que celle-ci s'élevait déjà à 40 cm. du sommet, une poche fut creusée et remplie d'une vingtaine de litres d'eau. Si on sait que, dans cette région, la température hivernale atteint 40 degrés sous zéro, on se rendra compte du désastre que pouvait provoquer cet acte de sabotage, sur une ligne sillonnée quotidiennement par de nombreux convois de charbon et d'essence synthétique. Lorsqu'un convoi s'arrêtait à proximité d'une équipe de prisonniers au travail sur la voie ferrée, ce qui arrivait fréquemment, quelques prisonniers interpellaient chauffeur et mécanicien d'un côté de la locomotive pour retenir leur attention, pendant que, de l'autre côté, des P. G. tranchaient au couteau les tuyaux en caoutchouc du Westinghouse, ce qui privait le train de ses freins et donnait aux prisonniers la matière nécessaire au renforcement de leurs semelles. Un jour, une équipe préposée à la pose des voies, profita de l'absence du contre-maître pour poser un aiguillage à l'envers. Ils s'ingéniaient à demander conseil à leur sentinelle qui n'y connaissait rien et approuvait toutes les explications qui lui étaient données. Le lendemain, le « dompteur » (c'était le surnom donné au contremaître) entra dans une rage folle en voyant que le travail avait été fait à rebours, mais les prisonniers jouèrent les innocents et le renvoyèrent auprès de leur gardien qui, selon eux, était la cause de tout le mal. Un autre fait, très simple, démontrera aussi que l'idée de saboter prenait corps à toute occasion. Au kommando, au cours de l'appel, un dimanche, on nous interdit de jeter dans les latrines, les déchets de nourriture ou restants de soupe, mais de les déposer dans un tonneau que l'on venait de placer près des cuisines. Au cours de la semaine qui suivit, on remarqua qu'un fermier des environs venait enlever le tonneau à demi-plein et le remplaçait par un autre, vide. Nous contribuions donc à l'engraissement de ses porcs. Mais il ne se passa pas 15 jours avant que le kommando fut menacé d'une punition collective, si on trouvait encore dans les déchets, des lames de rasoir de sûreté. Conclusion : le jeu continua, le kommando n'eut pas à subir la rigolade collective, les tonneaux ne furent plus remplacés et les déchets reprirent le chemin des latrines. Dans une usine de construction d'autos, à Stettin, qui dira les milliers de kilos d’alésoirs et autres outils de précision mis à la ferraille par l'unique volonté des prisonniers de guerre ? Dans l'immense dépôt de locomotives de Stargard, les prisonniers affectés aux réparations ont pratiqué le sabotage avec une assurance professionnelle et sur une telle échelle qu'ils en étaient arrivés à engager entre eux des paris sur la longévité probable des réparations. Prenant note du n° matricule de la locomotive et du jour de sa remise en marche, le prisonnier réparateur prévoyait un maximum de x... jours avant la prochaine panne, étant donné la malfaçon intentionnelle apportée à la réfection de la machine : de là, partaient les paris. Les prisonniers avaient le talent de prolonger la durée des réparations, allant parfois jusqu'au triple du temps qu'il eût fallu normalement, en employant des procédés brevetés PG qui donnaient tout apaisement à leurs auteurs, au cas où cela eût pu paraître étrange aux chefs de service allemands. Rappelons-nous aussi, en 1944, les nombreux obus de D. C. A. qui retombaient et n'éclataient qu'à leur arrivée au sol. Sabotage ! Il faut bien reconnaître que le sabotage était entré dans nos mœurs et que le prisonnier en accomplissait les actes en pleine conscience patriotique. Et c'est ainsi que, en 1945, lors de l’approche des armées alliées, là où la possibilité lui était offerte, le prisonnier redevint le soldat du front, en accomplissant certains actes héroïques qui n'en sont pas moins restés dans l'ombre. Citons le cas de ce camarade, qui, aidé de ses amis de kommando, détruisait un barrage antichars, alors qu'ils se trouvaient entre les feux des américains et des allemands. Sous la violence du combat, ses camarades abandonnèrent la partie pour se mettre à l'abri ; lui, seul, continua jusqu'au moment où un malheureux accident dû à l'arrivée d'un char américain, l'étendit par terre. Il dut vraisemblablement la vie à un de ses camarades qui, sous les balles, revint vers lui, le chargea sur le dos et le ramena en un endroit plus sûr. Ce prisonnier écopait de 4 fractures du bassin et fut traité dans un hôpital de campagne américain où il reçut tous les soins que réclamait son état Ce sabotage de dernière heure n'est-il pas l'accomplissement héroïque du Devoir ? N'a-t-il pas été déclaré que, si le pont de Remagen n'avait pas sauté, on le devait à un prisonnier de guerre qui s'était enfermé volontairement dans la casemate bétonnée qui contenait le système électrique de déclenchement qui devait faire sauter le pont ! A l'arrivée des troupes américaines, le prisonnier fut libéré et se perdit anonymement dans la masse des soldats libérateurs et des soldats libérés. Quel nom donner à cette initiative hardie et dangereuse ? Et combien son auteur était à féliciter et à citer à l'ordre du Jour de l'Armée ! Faits graves ou actes bénins, peu importe, ces sabotages n'en étaient pas moins la conséquence heureuse de la lutte continue que livraient les prisonniers à l'ennemi abhorré. Et, dans cette partie qui se jouait sournoisement, les mérites des prisonniers sont indiscutables. XXVIII VOLS ET
RAPINES. Directement du fabricant au consommateur ! Telle fut la devise adoptée, dès les premiers temps de leur captivité, par les prisonniers de guerre. Nécessité fait loi, dit-on, mais rien n'est plus vrai lorsque, comme nous, c'est à l'ennemi que l'on fait tort, car bien des scrupules s'effacent au moment du geste indélicat et, l'habitude aidant, tous les systèmes de « récupération » sont mis en avant sans qu'une arrière-pensée vienne vous effleurer. Notre santé en dépendait et un souci constant d'améliorer notre ordinaire nous poussait à la kleptomanie. C'était devenu chronique. Au début, on ne songeait qu'à s'approvisionner en nourriture, mais, au cours des années, les nécessités varièrent et les choses les plus invraisemblables prirent le chemin du kommando. Certes, cela ne marcha pas toujours seul et on fut l'objet de fouilles sévères de la part de nos gardiens, de la Bahnpolizei, voire même, en certaines circonstances, des types de la Gestapo. Mais ces derniers étaient désarmés par notre sourire ironique et notre tranquillité apparente ; généralement, ils ne trouvaient rien. Le prisonnier était passé maître dans l'art du camouflage et dès qu'une marchandise avait passé le seuil du kommando, elle était acquise tout à son nouveau propriétaire ou à la communauté. Au cours de l'hiver 1940-41, certains travaux ne pouvant se continuer par suite des fortes gelées, on employa les prisonniers au débardage des navires. Les bonnes fortunes étaient nombreuses, on le conçoit, et les autorités du port n' étaient pas sans remarquer les nombreuses fuites, facilement contrôlables par la détérioration de caisses ou de sacs. Ce fut le cas, un jour, alors que l'on déchargeait des caisses d'oranges et de boîtes de sardines. Une heure avant la cessation du travail, un mouvement inaccoutumé de sentinelles et de schupos avertit les prisonniers qu'une fouille était imminente. C’était plus de temps qu'il n'en fallait pour camoufler ce que les prisonniers avalent « confisqué » et, à la sortie du port, la fouille ne donna rien… Les oranges et les boîtes de sardines se balançaient au bout de ficelles sous la planche des cabinets et on n'eut qu'à les reprendre le lendemain, journée calme. Une autre fois, un camarade affecté au déchargement de poissons frigorifiés, s'était approprié l'un de ceux-ci, un poisson respectable d'une vingtaine de kilos. A la sortie du port, il y eut fouille. Le camarade se trouvait en queue de colonne. Le poisson fut fixé par les ouïes et suspendu dans le dos du prisonnier au moyen d'une corde et celui-ci passa devant les fouilleurs en ouvrant largement son manteau, leur faisant voir d'un coup que son manteau n'était nullement gonflé par une marchandise prohibée. Le soir, dans la baraque, toute la chambrée se régala de poisson bouilli ; c'était un supplément appréciable. Tout au long de cinq années, le prisonnier chercha à s'assurer le complément de nourriture qui lui était nécessaire pour se maintenir en condition de santé relativement satisfaisante. Pillant les wagons de chemin de fer qui attendaient leur départ pour le front russe, mettant en coupe réglée les jardins qui se trouvaient à proximité du lieu de travail et jusqu'à l'escamotage des tartines du contremaître, le vol se pratiquait sur une grande échelle et avec un tel esprit de naturel et d'innocence que nos gardiens préféraient ne rien voir et jouer les innocents, eux aussi, pour s'éviter des ennuis. Une autre question très importante restait aussi à l'ordre du jour chez les prisonniers : le chauffage. Dans ces contrées du Nord de l'Allemagne, battues continuellement par une bise mordante qui s'infiltrait dans les baraques par les interstices des planchers et des panneaux, il fallait penser à l'approvisionnement en charbon. En plein hiver, nous recevions 2 petits seaux à marmelade de charbon ou de briquettes au cours de la première année et un seul petit seau de coke les années suivantes. Les « stubes » avaient à peine le temps de se réchauffer que le seau était vide. Travaillant le long d'une voie ferrée sillonnée journellement par de nombreux convois de charbon, il était tout indiqué que les prisonniers en retirent un profit appréciable. Et, chaque soir, en rentrant du travail, on pouvait les voir déverser le contenu de leurs poches ou de leurs besaces dans la caisse avoisinant le poêle. En été on constituait des réserves sous le plancher, en prévision des difficultés qui pourraient surgir en hiver et empêcher l’approvisionnement journalier. A deux reprises, un vol de liqueurs dans un wagon plombé à destination du front russe, attira chez nous les gestapistes, mais ils en furent pour leurs frais, la cachette ne révéla pas son secret. En 1944, d'énormes futailles de vin épais étaient chargées en gare de Stettin-Grabow, toujours destinées aux combattants du front de l'Est. Les prisonniers ne pouvaient faire qu'y goûter les premiers. Chaque jour, les fûts étaient mis en perce au moyen d'une petite vrille et les gourdes remplies. La mise en bouteille se faisait, le soir, au kommando où, après avoir essayé le vin, on constituait les stocks de réserve au-dessus du plafond cartonné de la baraque. La cuistance personnelle du prisonnier se faisait sur le petit poêle-colonne dont chaque chambrée était pourvue et avait tour de priorité sur les lessives, ce qui, pour celles-ci, constituait un handicap sérieux. En effet, des lessives pouvaient attendre jusqu'à 8 jours avant de passer sur le foyer. Plus tard, par la formation de petits groupes mettant en commun le contenu de leurs colis et le produit de leurs rapines, on parvint à gagner du temps, mais c'était encore insuffisant. Aussi fallut-il penser à une autre solution. Le problème fut résolu et, après quelques mois, on pouvait voir, adossés à la clôture des barbelés, une quarantaine de foyers de toutes formes et de toutes dimensions. Les uns sont neufs, ils ont été fabriqués par les prisonniers eux-mêmes avec du matériel de la Reichbahn ; les autres sont usagés et, pour la plupart, ont été enlevés dans les cabines et maisonnettes qui s'élèvent le long des voies. Afin de ne pas attirer l'attention du Feldwebel, à la rentrée au Kommando, ces foyers ont été ramenés en pièces détachées et remontés sur place. Installés en plein air, cela faisait un joli effet de campement de romanichels affairés autour de la popote. Ce n'était pas du tout déplaisant et cette façon de cuisiner entra dans nos mœurs jusqu'au dernier jour de la captivité, mais bien souvent avec des moyens de fortune, mais très ingénieux, dont il y a lieu de citer plus spécialement « la choubinette ». C'était un petit foyer construit avec deux boîtes à conserve emboîtées l'une dans l'autre et dont le principe de fonctionnement était basé sur l'air chaud qui, plus léger, tend à s'élever rapidement au-dessus des couches froides et entraînait avec lui, par aspiration, une très petite flamme. Ce petit foyer avait l'immense avantage d'être très économique et un journal, découpé en menus fragments, suffisait pour bouillir un litre d'eau en moins d'un quart d'heure ; un morceau de bois, large et épais comme la main, détaillé en morceaux de la grosseur d'une allumette, cuisait la ration de pommes de terre de trois hommes, aussi rapidement que le feu de nos foyers modernes. Toujours prête à fonctionner, la choubinette nous a rendu des services appréciable Mais, revenons au sujet ! Fréquemment, nous nous sommes trouvés dans la zone de bombardement de la ville et, chaque fois, par la chute de bombes dans le kommando ou dans le voisinage, les vitres volaient en éclats. Il s'agissait de les remplacer en employant le système D. car les vitreries de la ville ne pouvaient suffire à remplacer les carreaux brisés aux maisons d'habitation et il y avait pénurie de cette marchandise. A leur baraque, les sentinelles remplaçaient les vitres brisées par des carrés de carton dur ou de bois triplex. Chez le prisonnier, la vitre manquante était remplacée par une autre, dès le lendemain. Mais on pouvait voir le vide fait aux châssis des fenêtres des baraques de la Reichbahn, le long de la voie ferrée. Rien n'était devenu impossible. Et lorsqu'un camarade posait la question : « Qui peut me procurer telle chose pour demain ? » il y avait toujours une voix pour répondre : « Deux minutes peur et tu l'auras ». C’était l'application de ce que le prisonnier avait coutume d'appeler : le système de récupération par la voie directe. Cependant, le jeu était dangereux, nous en avions la certitude et combien ont payé leur audace d'un séjour à Graudenz. Aussi, avions-nous soin de circonvenir nos sentinelles en les plaçant dans une situation équivoque. Le règlement était formel, les gardiens ne pouvaient rien accepter des prisonniers et une punition redoutée, toujours la même, était infligée à ceux qui se faisaient prendre à transgresser cet ordre et qui pouvait se résumer par ces trois mots : « Nach Sovietische Front ». Ainsi il ne s'agissait pour nous que de leur faire accepter une cigarette de temps en temps et nous les tenions indéfiniment sous notre coupe. Nos gardiens le savaient, mais la tentation était trop forte et ils ne pouvaient se résoudre à refuser l'aubaine d'une cigarette. Ils savaient aussi que nous n'avions pas l'intention de les dénoncer s'ils nous laissaient agir en toute tranquillité et, au moment opportun, on pouvait les voir disparaître, voire même se rendre complices en faisant le guet. Notre renommée était bien établie et, pour l'étayer, citons encore un de ces cas naturels... Emmenés en corvée, à 8 hommes, dans une caserne de Stargard, par un froid matin de décembre 1942, on nous fait transporter des planches et des madriers dans une cave du mess des officiers. Un rapide coup d'œil nous fait voir qu'il n'y a que des pommes de terre à glaner et aussitôt, les besaces dissimulées sous nos manteaux sont remplies de tubercules. Mais après quelques voyages, l'un de nous décèle deux pots de grès déposés dans l’encoignure d'une petite cave laissée dans l'ombre. Après avoir enlevé la vessie de porc qui recouvre le premier pot, nous constatons qu'il contient des œufs en conserve. Aussitôt, nous procédons à un nettoyage en règle et chacun s'en retourne au camp, avec son quarteron d'œufs. Mais je dois dire aussi que la corvée s'acheva péniblement, les œufs enfouis dans nos poches ne nous permettant plus que des gestes mesurés et prudents. Les civils nous accueillaient avec méfiance, lorsque le hasard ou les circonstances nous mettaient en contact avec eux ; ils savaient, par ouï dire ou par expérience, que nous avions la main alerte et légère et notre présence les inquiétait. Voici une anecdote assez significative à cet égard. Dès le début de 1943, les allumettes se faisaient rares et les civils eux-mêmes ne pouvaient en obtenir que trois boîtes à la fois, dans les magasins. Un jour, après avoir effectué une corvée en ville, avec quelques camarades, je demandai à la sentinelle qui nous accompagnait, l'autorisation de me rendre dans un magasin d'alimentation pour y faire l'achat de quelques boîtes d'allumettes. Lorsque je pénétrai dans le magasin, une trentaine de ménagères faisaient leurs emplettes ou attendaient leur tour d'être servies ; cinq ou six serveuses s'affairaient le long d'un immense comptoir. A mon entrée, l'une d'elle se détache aussitôt et vint s'enquérir de ce que je désire. – Des allumettes, répondis-je. Passant la main sous le comptoir, elle en ramena trois boîtes qu'elle me présenta. – Ce n'est pas suffisant, dis-je, car la sentinelle m'autorise à faire cet achat pour mes camarades qui stationnent devant la porte et je voudrais aussi en rapporter à d'autres prisonniers qui en sont dépourvus, au stalag. – Alors, combien vous en faudrait-il ? – Dix paquets ! (100 boîtes). – C'est beaucoup, dit la serveuse ; pour cette quantité, je dois en référer au patron. Elle sortit par une petite porte qui communiquait avec un couloir. La minute suivante, elle réapparaissait, tenant dans les bras les 10 paquets demandés. Pendant que je cherchais mon argent – de bons marks – une petite vieille qui se trouvait à mes côtés, interpella la serveuse et je lui entendis faire ce reproche : – Mademoiselle, il y a 20 minutes que j'attends que vous veuillez bien vous occuper de moi et ce prisonnier, dès son entrée, a été servi promptement. C'est inimaginable ! Et la réplique vint aussitôt, qui me remplit d'aise : – Je sais, Madame ; mais ce prisonnier, s'il doit rester ici, comme vous, pendant 20 minutes, pour combien, croyez-vous, m'aura-t-il volé pendant ce temps ? C'était net. Et, indirectement, on ne me l'envoyait pas dire ! Je me contentai d'encaisser le coup en souriant, pendant que je réglais mon achat. Ce sont les circonstances qui forcent des hommes à accomplir des actes que l'on juge soi-même hautement répréhensibles en temps normal. Ils sont d'ailleurs disparus de nos mœurs, dès notre libération. XXIX MOMENTS
DE LOISIR. En kommando, les moments de loisir étaient peu nombreux ; le temps passé au travail sur le chantier, le lessivage et le raccommodage du linge, les soins corporels, la « cuistance » personnelle et autres corvées laissaient bien peu de place aux moments de détente. Néanmoins, le prisonnier devait faire la part du délassement, s’i1 ne voulait pas laisser vagabonder son esprit trop au-delà des barbelés, où les images chères qui lui apparaissaient, insaisissables et lointaines, pouvaient le plonger dans la détresse du cafard. Le seul divertissement qui nous fût permis au début de la captivité, fut le jeu de cartes ; quelques-uns en possédaient dans leurs valises et ils furent bien accueillis. En janvier 1941, alors qu'il gelait tellement dur que le travail était impossible, j'en ai connu qui se donnaient au jeu de réussites à longueur de journée, pendant que d'autres s'escrimaient au combat naval. Enfin, quelques-uns s'essayaient au jeu de mots et racontaient des histoires drôles. Les bouquins étaient rares et ceux qui avaient échappé à la fouille, lors de notre passage dans les stalags, passaient de main en main, étaient lus et re1us puis finissaient lamentablement leur existence dans les bas-fonds d'un « abort », victimes le la pénurie de papier. 
L’orchestre classique du Kommando de Stettin-Bredow C'est toutefois au cours ,de cette même année 1941 que l'on commença à s’armer sérieusement en vue de notre défense anti-cafard. Des jeux divers furent confectionnés, plus ou moins artistement ; on put voir, notamment, des jeux de jacquet, de dames et d'échecs sur les tables. On organisa des concours inter-baraques ou individuels qui duraient plusieurs semaines, en raison du temps restreint dont nous disposions. Un concours d’échecs, eut particulièrement un grand succès, étant donné la valeur du premier prix : un pain de 3 livres que le gagnant s'attribua lui-même en le dérobant à la cuisine. Les cartes affluaient dans les colis et chacun posséda son jeu. Petit à petit, les livres nous arrivaient, mais à un rythme assez lent car ils devaient subir les rigueurs de la censure et ce ne fut qu’à la fin de cette année qu'on put constituer une bibliothèque avec, pour tout meuble, une caisse peu encombrante. Un bibliothécaire bénévole se tenait à la disposition des camarades tous les soirs. Plus tard, au début de 1942, il fut créé un cercle d'études qui n'obtint pas le succès escompté, le temps et la documentation nécessaires à la préparation des sujets faisant défaut. Des conférences sur le droit et sur des questions médicales furent données avec le concours de deux camarades, l’un, notaire de sa profession et l’autre, ex-étudiant en médecine. Ces réunions furent très suivies et très appréciées. 
L’orchestre de jazz Que1ques autres prisonniers organisèrent des cours de langue : français, flamand, anglais, italien et allemand, ainsi qu'un cours de comptabilité. Au début, ces cours furent assez régulièrement suivis, mais la plupart des élèves ne disposaient pas du moyen de prendre des notes et celles-ci étaient d'ailleurs confisquées au cours des fouilles. C'était décourageant ! L'idée de former un orchestre et une troupe théâtrale prit naissance assez tôt, c'est-à-dire après une petite soirée récréative donnée dans la chambre exigüe d'une baraque le 31 décembre 1940. Le modeste orchestre qui figurait sur l'estrade se composait d'un harmonica, d'une batterie faite de toutes pièces et d'un mirliton. Cette soirée fut marquée d'un peu de joie, grâce aux camarades qui se firent entendre dans des chants et monologues et aussi par la création d'un sketch où Hitler était dignement représenté dans une attitude grotesque, emballant bruyamment son public par une harangue enf1ammée A cette occasion, il fallut user d'un subterfuge pour éloigner une sentinelle trop curieuse que les rires avaient attirée dans la chambre et qui s'obstinait à y demeurer. Un orchestre ne prit définitivement son essor que 4 mois après cet embryon de spectacle, mais ce fut pour nous un régal, en même temps qu'un réconfort, d'écouter ces 22 musiciens qui, avec une parfaite homogénéité, nous faisaient entendre les airs populaires de chez nous et les morceaux plus artistiques d'opéras et d'opérettes. Plus tard, un orchestre de jazz fut créé, à l'intention des jeunes qui le réclamaient avec insistance. En même temps que l'orchestre, débuta une troupe théâtrale dont les éléments eurent à se débattre sur les planches d'une scène parfaitement ordonnée, quoique montée avec des moyens spécifiquement P. G.. Des artistes peintres ont brossé les décors et certains de ceux-ci, d'un modernisme sans outrance, ont suscité l'admiration des spectateurs. Grâce à l'imagination de machinistes amateurs, un éclairage adéquat illumine la scène, en même temps qu'il donne une lumière discrète sur les partitions des musiciens. 
Une vue de la scène du petit théâtre des P.G. de Bredow. François est debout au centre de la photo. Les costumes et les robes sont parfois prêtés obligeamment par des civils qui ont leur occupation au kommando et qui ne sont pas, comme nous, sujets à la fouille ; mais, bien souvent, il fallut couper et tailler des robes dans le papier crêpe. Et les scènes de music-hall, ballets et comédies, sont suivies avec attention et intérêt par les quelques 250 spectateurs que peut contenir la baraque mise à notre disposition et magiquement transformée en un lieu de gaieté et, de distraction. Parfois, les allemands chicanaient. Un jour, je fus interrogé longuement par le Sonderführer de Stettin qui, notamment, voulait avoir des précisions sur nos ressources, attendu que les séances étaient gratuites. Je ne pouvais tout de même pas lui dire que les trois-quarts du matériel nous avaient été procurés par des camarades possédant le don d'une très habile dextérité et je m'en tirai en le fatiguant à lui donner toujours les mêmes réponses et en feignant de mal interpréter ses questions. De même, voulut-il connaître le motif de l'appellation anglaise que nous avions donnée à notre cercle. N'arrivant à aucun résultat, il m'envoya quérir le secrétaire, de la troupe, mais celui-ci, mis au courant pendant le trajet, joua le même jeu. On ne revit plus le Sonderführer. En juin 1944, après le débarquement, au cours d'une matinée donnée dans un kommando voisin, avec l'appoint de notre orchestre, assistait un Hauptmann dont je ne connais pas très bien les fonctions, accompagné d'un sous-off' allemand qui lui servait d'interprète. A mi-séance, le Hautmann se leva, interrompit les acteurs, et, déclara, sans autre explication, qu'il était obligé d’écourter la séance. Mais nous en connaissions la raison et si cette décision amena des protestations, elle fit naître aussi des éclats de rire parmi les prisonniers. C'est que, en effet, la séance avait débuté par une marche américaine, suivie d'une mélodie anglaise ; après le sketch, le speaker avait annoncé un pot pourri d'œuvres, russes, puis encore l’ouverture d’une opérette typiquement française et ainsi de suite. Après l'exécution de ces morceaux, l'assistance applaudissait jusqu'à l'exagération, eu égard à la personnalité qui s'était invitée et à laquelle nous faisions l'honneur de présenter un programme de choix. Pas un lied allemand ! Alors ! 
Affiche publicitaire pour "La soirée de la Joie", prévue à Bredow pour le 28/06/1941 Les répétitions se faisaient chaque jour, après la rentrée du travail, malgré la lassitude des camarades qui se dévouaient à cette cause, malgré les ennuis et tracasseries de nos gardiens et les nombreuses difficultés matérielles auxquelles on se heurtait inévitablement. En hiver, dans la baraque non chauffée, les répétitions avançaient péniblement et il fallait l'appât d’un plat de « rabiot » pour réveiller l'ardeur des musiciens et des acteurs. Pour réaliser ce qui peut paraître, aujourd'hui encore, un tour de force, il fallait tout simplement un peu d argent et beaucoup de patience, un peu d’imagination et un don très poussé à la kleptomanie, de même qu'une volonté tenace. En été, les concerts donnés en plein air, dans l’enceinte du kommando, obtenaient un très grand succès. Et l'on pouvait voir les prisonniers entourant l’orchestre ou assis devant les baraques savourer avec appréciation les flots d'harmonie qui se déversaient sur le kommando. C'était de bon repos et une excellente diversion à notre sort. 
Spectacle de clowns à Stargard Les allemands avaient tenté deux essais de divertissement à notre intention, mais ils ne poussèrent pas les choses plus avant. C'est ainsi que les prisonniers de Stettin purent assister à une séance de cinéma – rendue obligatoire – dans une salle de la ville et à un spectacle de cirque, tous deux donnés un dimanche à 8 heures du matin. Et peut-être, ces jours-là, l’U. F. A. a-t-il pu développer un film où la Propaganda Abteilung trouvait son compte, en vantant le séjour merveilleux des prisonniers de guerre au paradis des nazis. En 1943 et 1944, on put recevoir quelques ballons, voire même quelques paires de chaussures, nécessaires à la pratique du football, par l’entremise de la Croix-Rouge de Belgique et d'autres organismes bien-intentionnés. Des tournois inter-kommandos furent organisés ; ceux-ci nous donnaient l'occasion de nous évader du milieu fermé dans, lequel nous végétions, le dimanche. Certes, étant donné l'état physique déficient des joueurs et la composition disparate des équipes, il n'était nullement question d'assister à du beau sport, mais le fait de se trouver en dehors de la ville et de s'étendre sur l'herbe fraîche, suffisait amplement à nous satisfaire. On ne pouvait se montrer difficile. Il y eut même des compétitions de natation dans un bassin à proximité du kommando, mais, disons-le, tout cela ne suscitait pas grand enthousiasme parmi nous ; c'était un prétexte pour trouver un changement de décor. La fin de la captivité sera aussi marquée par la pratique du sport pédestre, volontairement adopté par tous, de jour et de nuit, sur les routes allant en direction de l'Ouest. Mais ceci est une autre histoire ... XXX CHOSES RELIGIEUSES. Lors de notre passage au stalag d'immatriculation, la question était posée à chacun de nous sur la religion pratiquée. Et le mot « catholique » se trouvait répété pour un taux de 98 % sur la bande de papier rose que l'on nous remettait et qui contenait d'autres renseignements encore. Les Allemands s'étaient ainsi mis en règle, administrativement, bien entendu, avec certain article de la Convention de Genève qui traitait de cette question. En pratique, il n'en était pas de même et le camarade qui devait décéder dans un kommando écarté de la ville, était certain de ne pas recevoir la visite du prêtre... malgré ses demandes répétées. Pour une région vaste comme la Belgique, une trentaine de prêtres, pour la plupart français, apportaient aux prisonniers le réconfort de leurs offices et de la bonne parole. C'est dire que leur présence dans les kommandos, le dimanche, se répétait 3 fois l'an, pas plus. Certains kommandos n'ont jamais reçu la visite d'un prêtre pendant les cinq années. Dès le début de notre arrivée en kommando, nous avons sollicité l'autorisation d'assister à la messe dans une église catholique; nous n'avons reçu que des promesses, jamais exécutées. Et ce n'est qu'après dix mois de captivité que, un dimanche, une partie du kommando de Stettin-Bredow, put entendre la messe, pour la première fois. Malheureusement, de nombreux camarades étaient au travail et n'eurent pas cette satisfaction. Le dimanche de Pentecôte 1941, une messe fut chantée en plein air, dans l'enceinte du kommando. Un autel avait été dressé contre une baraque et nos couvertures et le linge blanc dont nous pouvions disposer cachaient toutes les imperfections d'une construction hâtive, ayant été prévenus au dernier moment. Quelques fleurs suppléaient à la pauvreté de cette installation en donnant à l'ensemble une présentation qui pouvait suffire. Une grande croix en carton dur surmontait l'autel. Mais il était une chose riche d'enseignement, la présence de quelque trois cents hommes, vêtus d'uniformes rapiécés, loqueteux, qui, les bras croisés et la tête inclinée sur la poitrine, silencieux et recueillis, adressaient leurs plus ardentes prières à Celui qui daignait descendre parmi eux pour s'offrir en holocauste. Trois cents hommes ayant vécu, depuis un an, dans les conditions déprimantes de l'esclavage, ayant connu toutes les misères humaines et subi toutes les avanies. Trois cents hommes au caractère aigri par la souffrance morale et la déficience physique, venant chercher le repos de l'âme au pied d'un autel rustique et puiser la force nécessaire à la résistance corporelle. Point de respect humain parmi les prisonniers, il n'y avait qu'à voir les chapelets suspendus au-dessus des couchettes pour s'en rendre compte. Et les esprits forts ne risquent pas un sourire malin ou ironique en face d'eux ; ce serait chose trop délicate et toute discussion de leur part au sujet de la religion tournerait à leur déconvenue. Il est défendu aux prêtres de faire leurs sermons, de même d'entendre les confessions, mais on s'imagine qu'il n'y avait aucune difficulté à contourner le règlement. Cela se faisait aisément pendant que quelques camarades montaient une garde vigilante pour signaler toute approche douteuse et avertir par un « 22 » retentissant. Chaque jour, les fidèles du kommando se réunissaient, en fin de journée, pour réciter le chapelet en commun et l'appel était donné haut et clair dans toutes les baraques, à l'heure de la réunion. Le dimanche, à 10 heures, lorsque le prêtre n'était pas là, un camarade prenait la parole, faisant office de prédicateur ; l'évangile du jour était lu et commenté. Plus tard, les offices au kommando auront lieu toutes les 3 ou 4 semaines, dans la salle du théâtre et on pourra leur donner un plus grand éclat, en raison de l'agencement de l'autel, de la formation d'une grégorienne et de l'accompagnement des chants par un pianiste et un violoniste. Dans les derniers mois de la captivité, la messe se disait tous les dimanches par un prêtre français faisant partie du kommando et avait lieu à 4 heures de l'après-midi, lorsque tous les prisonniers étaient rentrés du travail. La communion était distribuée aux assistants, alors que la plupart venaient de prendre la soupe, car nous avions reçu la dispense du jeûne, motivé par le travail qui nous était imposé le dimanche. Les allemands mettaient parfois des entraves à la pratique religieuse chez les prisonniers et je me souviens de cet excellent camarade, homme de confiance français du kommando de Bredow, qui fut destitué de ses fonctions et transféré dans un autre camp de travail, pour avoir tenu tête au kommandoführer qui nous défendait d'assister à la messe, un dimanche ; c'était en 1944. A cette même époque, nous étions logés dans les écuries d'une caserne, les sentinelles nous empêchaient, le soir, de nous rendre dans une baraque à demi-sinistrée, pour la récitation du chapelet, mais, dans l'obscurité, les prisonniers arrivaient à tromper leur surveillance. Qui redira toute la valeur spirituelle de cette cérémonie de piété ; le jour du Vendredi-Saint 1942, au cours de laquelle une garde d'honneur, composée de 4 prisonniers et relayée toutes les demi-heures, encadrait le crucifix, dans un garde-à--vous impressionnant, pendant que d'autres venaient se recueillir dans la prière ! Quelle grandiose cathédrale peut rivaliser avec ce petit réduit aux murs nus de la Revier du Stalag II D, qui pouvait à peine contenir une vingtaine de prisonniers, mais dont la valeur spirituelle qui s'en dégageait, à l'heure des offices, atteignait des sommets inconnus ! Quelle grandeur revêtait cette messe de minuit de Noël 1944 ! la seule qu'il nous ait été donné de connaître au kommando. Dans une baraque non achevée qui devait servir de lavoir, un magnifique autel a été dressé, reposant sur des colonnes imitant à la perfection le marbre gris à veines bleues. Des fleurs partout en papier, naturellement ; d'énormes chandeliers surmontés de longues chandelles en carton blanc, mais dont le sommet cache une petite boîte contenant de l'huile de paraffine et laisse apparaître une petite flamme bleuâtre. Trois encensoirs ont été confectionnés, l'un recouvert de dorure, les deux autres argentés, mais tellement bien imités que l'on pourrait se méprendre sur leur authenticité. De son côté, notre camarade aumônier a pu se procurer de l'encens chez un prêtre catholique de Stargard. Un ostensoir en bois du Congo, blanc et noir, a été sculpté de façon vraiment artistique, en l'espace de quelques jours ; c'est un véritable objet d'art. Au côté droit de l'autel, un arbre de Noël agrémenté de filets argentés reçus la veille des avions alliés, et de divers ornements dus à l'ingéniosité de l'un et de l'autre. Au côté gauche, la crèche avec ses personnages et ses animaux parfaitement découpés dans du triplex ; à droite de la crèche, quelques P. G. en miniature appuyés sur la pelle ou à genoux, tandis qu'à gauche, on voit un intérieur complet de cuisine avec 4 personnages : la maman et 3 enfants, les yeux tournés vers l'Enfant-Jésus et priant pour l'absent. Tableau suggestif qu'il est inutile de commenter ! Des bancs, placés en gradins, remplissaient la baraque. Tous ont apporté leur collaboration à la réussite de cette fête religieuse : croyants, incroyants et non-pratiquants. Mais où s'est-on procuré le matériel nécessaire à cette réalisation ? Pour beaucoup, cela reste un mystère qu'on ne cherchera jamais à percer ; c'est la méthode P. G. Et cette nuit-là, c'est l'âme entière de tout un kommando qui élèvera vers Dieu, ses chants et ses prières, sa foi et ses espérances. Paix aux hommes de bonne volonté ! Le réconfort spirituel dans la pratique religieuse, en captivité, fut, pour la plupart des prisonniers, le baume adoucissant de toutes les douleurs. La foi ardente qui les animait, maintenait en eux une sérénité d'âme qui leur donnait tous les espoirs dans l'avenir, tout en les préparant au pire. Et chaque jour, le prisonnier redisait dans ses prières : Domine, fiat voluntas tua ! XXXI VUES D'UN
STALAG. Chez la plupart des prisonniers, le Stalag exerça toujours un attrait fascinant et nombreux étaient ceux qui cherchaient à y entrer, dans l'espoir de mettre à profit leur séjour en cet endroit pour trouver le filon d'un rapatriement ou, plus modestement, parvenir à s'introduire dans les services du camp et mettre fin ainsi au travail productif en kommando. Personnellement, l'occasion ne me fut jamais donnée de revoir le Stalag où j'avais été immatriculé en juin 1940 et dans lequel j'avais séjourné exactement 42 heures. Mais le hasard d'un changement de kommando me fit faire la connaissance d'un autre stalag (le IID, à Stargard). Aucun belge n'y avait été immatriculé et je devais m'y trouver seul belge parmi des centaines de prisonniers français, serbes, russes et, plus tard, italiens et canadiens. Le 7 octobre 1942, je débarquais en gare de Stargard. Les quais sont encombrés de voyageurs. Un autre prisonnier est descendu du train, un soldat serbe de très haute taille, mais d'une maigreur effrayante. Il sait à peine se mouvoir, ses genoux s'entrechoquent en marchant et ses pieds s'entremêlent ; ses yeux fiévreux ne remarquent pas le public qui, peu charitablement, sourit sur son passage. Il serait infailliblement tombé si la sentinelle qui l’accompagne, ne le soutenait. Au passage, je lui adresse un petit signe amical encouragement, qu'il n'a pas dû remarquer. Et je le devance rapidement car mon gardien me pousse, la main dans le dos. Mon schleuh bourru et peu sociable, ne m a pas adressé une parole depuis mon départ. Nous nous engageons dans une rue qui mène au Stalag. Nous passons devant la Grenadieren Kaserne ou, Rote Kaserne, parce qu'entièrement construite en briques rouges, où j'aurai à effectuer, plus tard, de ridicules corvées. Nous empruntons bientôt un chemin pavé qui nous amène devant de nouvelles casernes comprenant une dizaine de blocs séparés. Sur le premier de ceux-ci, on peut lire : STAMMLAGER HD – KOMMANDANTUR. Après avoir passé la grille devant laquelle une sentinelle est de faction, mon gardien me laisse dans la cour, où d’autres prisonniers français et serbes attendent également et disparaît dans les bureaux. Au bout de deux heures, il réapparaît enfin et c’est par un geste bref qu'il m'engage à l'accompagner. Un chemin sablonneux nous conduit au camp ou nous arrivons après quelques minutes de marche. De loin, avec ses petites constructions, ses baraques et ses arbustes, le camp ressemble singulièrement à un immense jeu de bergerie autour duquel se trouvent naturellement, une double clôture de fils barbelés et les gardiens du troupeau faisant les cent pas. A front de route, un long bâtiment à étage unique très bas, coupé en son centre par un porche qui, mène à l’intérieur du camp. Cette construction abrite les services allemands du Stalag : bureaux d'administration, de l'officier de justice, contrôle, etc. Le commandant du camp est le général Obèse, assisté des Hauptmann Mickey et Crapaud Vert, tous très justement nommés et, dans les grades subalternes, le Stabfeldwebel Nenoeil, dont les yeux sont quelque peu divergents et les Unteroffiziers : l'imposant « Armoire à Glace », le Lion, le Russe et quelques autres. Nous nous trouvons dans l'avant-camp. Faisant suite, en carré ouvert, aux bureaux déjà nommés, nous trouvons à gauche, les bureaux occupés par les services de l'Abwehr de la Censure, de la Kartei, des Colis, de l'Homme de Confiance, ainsi que différentes baraques servant d'entrepôts. A droite, les baraques des sentinelles, les cachots et, plus avant, la baraque de la fouille. C'est vers cette dernière que mon gardien me conduit. Tout prisonnier entrant ou sortant du camp, doit passer par la fouille et le règlement en la matière est de stricte observance. J'attends patiemment et lorsque vint mon tour, je pus constater que l'unteroffizier, préposé à cette corvée, avait des aptitudes de policier pour organiser une fouille en règle. Celle-ci se fit au détriment du bon arrimage des biens contenus dans ma valise et je voyais, avec rage et avec regret, tout mon linge déplié et rejeté pêlemêle sur une table voisine, en même temps que mes maigres provisions et tous autres objets qui venaient s'y mélanger, sans égard aucun pour leur fragilité et sans le moindre souci de propreté. Après ce coup dur, il me fallut ré-entasser tout cela dans la valise sans prendre aucun soin car, à son tour, mon gardien grognait, pressait et devenait menaçant. Une barrière sépare l'avant-camp du camp proprement dit ; encore une sentinelle. A deux mètres, un mirador s'élève impressionnant, au haut duquel on aperçoit deux canons de mitrailleuses braqués sur le camp et deux schleuhs toujours prêts à les faire fonctionner. Une longue allée centrale macadamisée, aux deux côtés, quelques fleurs et des arbustes. A gauche, les baraques des prisonniers serbes à droite celles des prisonniers français ; à l'extrême-droite les latrines et la baraque des douches. Au fond de l'allée, la cuisine et la cantine où, dans l'une comme dans l'autre, on ne sert rien de tentant. Enfin, nouvelle barrière de barbelés derrière laquelle on aperçoit l’immense camp russe. Parallèlement à celui-ci, un vaste terrain que les prisonniers ont aménagé en stade des sports. Auprès du mirador, un chemin longe une baraque transformée en salle de spectacles, et qui nous conduit vers l’infirmerie. Avant d'y pénétrer, nous découvrons une nouvelle rangée de baraques isolées par un réseau de barbelés et qui sont destinées à recevoir le trop-plein de prisonniers, à certaines occasions. L'infirmerie se compose de quatre baraques pouvant contenir 5 a 600 malades. La première est réservée aux serbes pour une moitié, l'autre partie étant occupée par le personnel sanitaire. La deuxième baraque contient uniquement des malades français. Ensuite, la Hauptrevier avec ses salles de visites, bureau. du médecin allemand (Stabartz), bureau d’administration et une salle unique pour malades réclamant des soins spéciaux. Enfin, l'Isolierbaracke qui, comme, on s'en doute, est la baraque réservée aux prisonniers atteints de maladies contagieuses ; c'est le meilleur endroit de la Revier car les malades y coulent des jours heureux et tranquilles, tenant compte qu'aucun schleuh, même le Stabartz, n'y met jamais les pieds. Les deux premières baraques sont les plus populeuses. Ça grouille de boiteux, de gens atteints de furonculose, d'ulcères, de plaies de toutes sortes, de pauvres diables ayant sombré dans la folie, etc. Une description ? Quatre murs, blanchis il y a longtemps déjà ; en large et en long, des traverses en bois soutenant un vaste toit ; une porte à deux battants et quelques petites fenêtres par où la lumière pénètre en tamisé. En moins de mots, cela ressemble à une grange qui pourrait paraître propre. Comme mobilier, quelques bancs et tables boiteuses, insuffisant pour tout le monde et ... des lits. Des lits à 3 étages, assemblés par groupes de 12 couchettes et, sur chacune de celles-ci, une paillasse ou, mieux, un grabat. En un an et demi, la paille fut remplacée une seule fois. Si l'on considère le nombre de malades se succédant au même lit pendant ce laps de temps et que l'on tienne compte des affections diverses que l'on soigne en ce lieu, on ne sera pas étonné d'apprendre que ces paillasses sont sales et puantes. Pas de draps, deux couvertures seulement. Il y a des gens propres, d'autres qui le sont moins. Et c'est dans cette promiscuité que vivent les malades et les blessés. C'est aussi dans ces conditions insalubres que trois médecins français s'efforcent de les guérir. Aussi, ne nous' étonnons pas si beaucoup de prisonniers, désireux d'entrer au Stalag pour y trouver la « planque », cherchent au plus tôt à en sortir pour retrouver leur kommando que, cependant, ils maudissaient. XXXII MAFFIA ET
COUR DES MIRACLES. La population des camps présentait un curieux mélange d'individus de nationalités diverses et sous des aspects les plus bizarres Au stalag IID, environ deux mille prisonniers s'y prélassaient : français, russes, serbes, canadiens, italiens et un ou deux belges égarés là par le hasard des circonstances. Malgré les différences de race, de langage et de classe sociale, le visiteur n'eût pas manqué d'être frappé par le caractère sentimental qui se dégageait de cette promiscuité internationale. La plus grande camaraderie, dominée par un très large esprit d'entr'aide, régnait entre les prisonniers. Néanmoins, on pouvait classer ceux-ci en deux catégories bien distinctes : les prisonniers sédentaires et les nomades. Les premiers faisaient partie de ce que l'on avait coutume d'appeler : la maffia. C'était des « arrivés », pour la plupart sous-officiers, parmi lesquels s'étaient glissés quelques sous-offs de promotion stalag, c'est-à-dire de simples ploucs qui, à l'aide d'intelligences dans la place, avaient réussi à faire renseigner sur leur carte matricule le grade de sous-officier. Ils étaient occupés dans les bureaux de la Kommandantur, de l'Arbeitseinzats, de la Kartei, etc. ou occupaient des emplois de second ordre, tels que les cuisiniers et les infirmiers. Tous ces prisonniers pouvaient se croire à l'abri du travail en kommando. On les reconnaissait aisément par leur présentation vestimentaire soignée qui, il faut le reconnaître était d'un contraste criard avec les nomades dont nous parlerons plus loin. Etant à la source des arrivages de vêtements, par l'amitié qui liait entre eux, tous ces P. G. de stalag et aussi, parfois, par certaines compromissions regrettables, ces favorisés du sort obtenaient plus facilement que les autres, des vêtements neufs faits à leur taille. Dans ces conditions, ce ne fut pas long avant de voir certains prisonniers du type « maffia » afficher un snobisme ridicule et s'affubler d'un battledress découpé dans une couverture et confectionné par un tailleur du camp, après avoir été teint dans un ton des plus rococo. Tout comme les autres prisonniers, c'étaient de bons camarades, mais ils affichaient un air de supériorité qui n'était pas de mise et on trouvait déplorable leur tendance marquée à se rassembler entre eux uniquement. C'était bien, ce que l'on peut appeler, sans méchanceté aucune, des « arrivés » genre nouveaux riches, dont la fierté des manières, n’était nullement seyante en cet endroit. Toutefois, leurs façons distantes ne les empêchaient pas de se rendre agréables et utiles envers leurs camarades moins favorisés et on n'a qu'à se louer des bons rapports que l’on entretenait avec eux. En général, ils étaient serviables et amicalement. charitables. Dans son livre « Les Grandes Vacances » Francis Ambrière a critiqué vertement l'activité peu digne de ses compatriotes faisant partie de la maffia, mais il faut qu'on sache bien qu'une grave question divisait les prisonniers français et que, chez eux, on était pour ou contre Pétain ; que ces opinions ne visaient que la personnalité du Marechal, car les prisonniers français étaient contre le gouvernement français de l'époque et, surtout, adversaires farouches de Laval. 
Chant à la gloire de Pétain Les porteurs de francisque n'étaient pas toujours pétainistes, mais usaient de ce subterfuge pour s’introduire dans les services du camp. Certes, ce moyen manquait de dignité et est répréhensible en lui-même, mais il faut admettre que ceux qui portaient le fameux insigne ne l'utilisaient pas dans le sens critiquable. Parmi les prisonniers du camp se rencontrait aussi ce que l'on pouvait appeler la petite maffia et qui comprenait les aide-cuistots, les tailleurs, les cordonniers et ceux affectes a l’entretien du camp. Ils s'accrochaient à leur emploi, eux aussi, mais éprouvaient plus de difficultés à le conserver, car ils n'étaient pas exempts du kommando et, à chaque rafle, ils devaient manœuvrer adroitement pour se maintenir au stalag. C'était, pour la plupart, des prisonniers venant des kommandos et qui, avec la complaisance de camarades de la maffia, avaient réussi à entrer dans les services du camp et y restaient jusqu'au moment où les hasards d'une rafle les renvoyaient en kommando. Bien souvent, leur séjour au stalag n’était que de quelques mois. Il y avait enfin les nomades, parmi lesquels on rencontrait les « durs », ceux que rien ne rebutait, décidés à terminer la captivité sans avoir rien accordé aux boches, les évadés, les tire-au-flanc. C'était d'excellents camarades dont la longue captivité ne faisait que renforcer les sentiments patriotiques dont ils étaient animés. Cent fois, ils sont passés par l'infirmerie ou la strafkompagnie. C'étaient les réfractaires au travail utilisant les mille et une combines pour atteindre le but qu'ils s'étaient assigné. Avec eux, on trouvait les malades de la Revier, les vrais, ainsi que les blessés et les estropiés. Eux aussi inquiétaient d un retour trop rapide en kommando et utilisaient tous les moyens pour retarder ce moment, notamment en freinant leur guérison. Tous les prisonniers de la catégorie des nomades se reconnaissaient facilement à leurs vêtements dépenaillés, et rapiécés ; ils étaient, pour la plupart, chaussés de sabots ou de clapettes. Pendant leur séjour, au camp, ils cherchaient à renouveler leur garde-robe, mais ils n'y parvenaient, bien souvent, qu’en procédant à des échanges commerciaux. A chacun des appels, qui avaient lieu trois fois par jour, il était curieux et amusant de retrouver tous les éclopés des pattes, sur un seul front au premier rang. A tort ou à raison, ils s'appuyaient sur une canne ou un bâton. Une fois rentrés dans la baraque, ils abandonnaient leur soutien, se mêlaient aux autres camarades et vaquaient à leurs occupations personnelles, dont la principale était la préparation de la tambouille. De temps à autre, le Feldwebel préposé à l'appel, s’exaspérait de voir cette lignée de cannes qui, de jour en jour, devenaient plus nombreuses. Furieux, il faisait enlever et briser toutes ces béquilles improvisées. Le lendemain, il aurait pu recommencer, car d’autres bâtons réapparaissaient en grand nombre au premier rang. Et chacun s'en amusait ! Derrière eux, sur quatre rangs, prenaient place les autres prisonniers et on pouvait y voir des furonculeux incomplètement guéris, des blessés au visage marqué d’une croix de sparadrap ou les membres enveloppés de bandages de papier-crêpe et quelques-uns, plus malheureux, ayant perdu, la raison. Tous ces gens attendent, soit leur renvoi au kommando, soit un rapatriement possible. Ces derniers patienteront de longs mois avant que leur retour au pays soit décidé. J'en ai connu, qui ont traîné 22 mois au stalag avant d'être mis définitivement A. U. (Arbeitunfahig). En attendant, ils ont été mis hors de l'infirmerie et transférés au camp, pour faire place à de nouveaux arrivants. Naturellement, il y a de nombreux simulateurs, dont l'intérêt est de prolonger leur séjour au camp et ceux qui usent de tous les moyens psychologiques pour s'y maintenir. Tous ces prisonniers vagabonds formaient une Cour des Miracles que la Esmeralda n’eut pas désavouée. Vêtus d'uniformes loqueteux provenant d'une armée étrangère, telle que danoise, norvégienne ou yougoslave ; le bleu et le rouge des fantassins français de 1914 ressortaient des autres teintes, de même que le vert, des anciens uniformes serbes. Tout cela criait la misère, la pitié et, cependant, c'était parmi cette catégorie de prisonniers ,que l’on découvrait le plus grand dévouement et l’esprit le plus élevé de fraternelle camaraderie. Un sentiment de mutuelle compréhension, auquel la providence n'était pas étrangère, les aidait à supporter, vaillamment les mauvais coups du sort et à se réjouir en commun des bonnes fortunes qui pouvaient échoir à l'un ou à l'autre. C'est surtout dans cette communauté que l'on retrouvait les « durs » toujours en quête de coups à faire et de sabotages à organiser. Leur captivité ne fut pas qu'un long terme d'attente, car ils étaient animés par la volonté d'accomplir leur devoir jusqu'au bout. XXXIII COSMOPOLITISME. La population des camps était composée, comme il a été dit déjà, d'individus de diverses nationalités, dont il était assez intéressant d'analyser les mœurs et les caractères propres à la race et à la nationalité. Je me bornerai toutefois à brosser quelques traits sur les prisonniers que j'ai eu l'occasion de côtoyer au stalag IID. Le prisonnier français était certes celui qui pouvait être considéré comme étant le plus débrouillard. Qu’il soit Parisien, Ch’timi du Nord ou gars du Midi, le français en imposait à l'allemand par sa franchise, son bagout et sa faconde. Sa principale préoccupation quotidienne était la composition du menu qui assurerait sa subsistance et, chaque jour qui passe le voit occupé à fricoter sur un foyer de fortune que le marchand de ferraille négligerait, mais dont l'utilité révèle un certain art dans la fabrication. Le français parvient toujours à se procurer les éléments nutritifs rares qu'il a rêvé de s'approprier aux dépens de l'un ou l'autre civil boche et ce, sans égards pour la victime qu'un tableau de rationnement en chute progressive oblige à diminuer le nombre de crans à la ceinture. Aussi, on pourrait dire des prisonniers français ce que l'on disait ; des prisonniers belges, « On peut les mettre, nus, dans le désert ; une heure plus tard, on les retrouvera en smoking, faisant des frites ». Le Français rappellera le bon temps qu'il prenait à la vie, avant la guerre et redira cent fois qu'elle était sa ration journalière de pinard et ses espoirs d'y recourir au plus tôt. Il parlera d'évasions, formera des plans et aidera le camarade qui se décide à tenter l'aventure. Avec grande facilité d'élocution, il discutera des événements et, telle une pythonisse, fera connaître ses oracles sur leur aboutissement logique. Bon organisateur, le Français a doté le stalag d'une salle de théâtre où, le dimanche, on peut assister à des représentations où les pièces de Sacha Guitry alternent avec celles de Molière ou de de Flers et Caillavet ; ainsi qu'à des séances de music-hall et des réunions pugilistes. Il existe un terrain des sports où l'on peut suivre une course-relai, un match de football, de basketball et volley-ball. Il a creusé une piscine dans le même terrain et, en été, les épreuves de natation sont très appréciées, de même que les compétitions de water-polo. Le Français ne se lasse pas du jeu de poker et de la belotte ; les méridionaux marquent cependant leur préférence pour la « pétanque ». Une importante bibliothèque fournit une matière abondante et diverse aux passionnés de la lecture et des conférences sont organisées, chaque semaine, sur les sujets les plus variés. Sans souci du lendemain, le prisonnier français vit dans l'abondance, aujourd'hui et se contente d'une croûte sèche le jour suivant, sans qu'il en soit autrement affecté. Dans l'une ou l'autre situation, son esprit gouailleur y trouve toujours son compte. Le prisonnier serbe, lui, vit de façon plus discrète. Il se confine dans sa baraque et celle-ci est moins bruyante que nulle autre. Le jeune citadin se distingue aisément par ses manières distinguées et son intelligence ; tous parlent l'allemand avec grande facilité et beaucoup s'expriment dans un français correct. Les vieux montagnards (j'en ai connu qui avaient 60 ans), ont le visage rude et taillé à la hache ; ils résistent avec vigueur aux assauts du temps et des privations. Une sorte de fatalisme leur fait accepter sagement l'épreuve de la captivité. Ils ont la haine du boche, mais leurs manières obséquieuses et serviles étonnent. Lorsque, le soir venu, on longe les baraques des prisonniers serbes, on se croirait égaré dans les ruelles d'un port maritime, où les volets fermés des cabarets laissent passer les sons cacophoniques de quelconques instruments de musique et les chants braillés de matelots en bordée. Ici, un prisonnier s'essaye péniblement sur un accordéon ; là-bas, un autre pince les cordes d'une viole d'amour ; plus loin encore, une guitare plaintive entraîne un groupe de chanteurs dans une de ces mélopées nostalgiques dont les slaves ont le secret. Les premières mesures sont lâchées dans un ralenti qui impressionne, comme à regret, tandis qu'un soliste scande les paroles ; puis, sans aucune transition, le chœur au complet s'élance sur un rythme accéléré et, tout aussi brusquement, s'arrête, pour reprendre bientôt sous une forme mélancolique. Au demeurant, les serbo-croates sont de braves types et on conserve un excellent souvenir des relations, peu nombreuses, il est vrai, qu'on avait avec eux. Il y avait aussi des prisonniers russes, très nombreux, séparés de nous par un réseau de barbelés et des sentinelles, rendant ainsi nos relations avec eux quasi nulles. Ils étaient très malheureux, ce n'est pas souvent qu'on les voyait rire. Seuls, les commissaires politiques qui s'étaient vu attribuer les fonctions de policiers, se livraient à des exubérances que nous jugions de très mauvais aloi, parce que sans égards pour leurs camarades moins favorisés. Lorsqu'un prisonnier russe réussissait à franchir les barbelés pour venir récolter quelque nourriture dans nos baraques, il était certain de ne pas échapper à la bastonnade à sa rentrée au camp russe, que lui infligeaient ses camarades policiers et qu'il acceptait sans fuir. C'était dégradant, mais pour expliquer cela, c'est toute une politique qu'il faudrait dénoncer. Certainement, de tous les prisonniers, le russe est bien le seul qui soit resté passif devant sa situation malheureuse, ne cherchant guère à prendre les initiatives que réclame sa condition d'esclave. On trouve en lui l'habitude de l'asservissement et de la punition corporelle. Les russes asiatiques, aux yeux bridés, nous regardaient haineusement et si, à leur passage, nous parvenions à leur remettre quelques biscuits ou quelques cigarettes, ils se contentaient d'empocher sans mot dire, sans manifester aucun signe de satisfaction. Le russe reste pour nous une énigme. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que, d'une façon générale, il manquait d'intelligence et ne se prêtait pas aux sentiments de camaraderie que nous aurions voulu leur voir partager. Les prisonniers italiens que la capitulation de septembre 1943 nous a donnés comme camarades, nous étaient sympathiques. A notre contact, ils s'adaptèrent à leur nouvelle situation, en moins de temps que nous en avions mis à nous y faire. Leur captivité dura relativement peu, une vingtaine de mois. Il est avéré que l'on pouvait trouver chez eux… ce bon esprit P. G. qui régnait parmi nous et, à maintes occasions, ils le prouvèrent par le dévouement et l'abnégation. Leur caractère différait peu du nôtre et, dès le début, l'entente put se réaliser automatiquement. Mis au courant des manigances allemandes au sujet du travail des prisonniers, ils ne se laissèrent pas facilement manœuvrer et leur esprit da résistance se manifesta très tôt. L'allemand leur était antipathique au suprême degré et ils nous racontaient des histoires qui démolissaient la bonne entente entre les pays de l'Axe, tant vantée par les allemands. Malgré les promesses alléchantes qui leur furent faites pour les ramener dans le giron de l'Axe… désaxé, les prisonniers italiens restèrent sourds à toute sollicitation et notre sympathie envers eux s'en accrut. Et enfin, les prisonniers canadiens, les derniers venus au Stalag IID. C'était de fiers lurons, aux allures libres et aux exigences jamais assouvies ; ils assaillaient le Haupmann de leurs prétentions et celles-ci étaient souvent bien accueillies, car les autorités du camp prenaient en considération le fait que de nombreux prisonniers allemands se trouvaient au Canada et elles craignaient les représailles envers eux, si l'on se refusait à écouter ceux d'ici. Les Canadiens ne se faisaient pas faute d'exploiter le filon. Inutile de dire que, comparativement, nous étions les parents pauvres. Détail amusant : les Canadiens, au cours de leur séjour au Stalag, s'ingéniaient à ridiculiser les allemands, soldats et civils et ils y parvenaient avec une habileté extraordinaire. Lorsque, en groupe, ils s'en allaient en ville pour effectuer une corvée, leur marche au pas accéléré faisait courir derrière eux la sentinelle boiteuse préposée à leur garde et ils s'en amusaient. Arrivés dans l'artère principale de la ville, ils lançaient des cigarettes aux civils circulant sur les trottoirs, pour le plaisir de les voir se disputer cette aubaine et porter ainsi atteinte à la dignité des habitants du Grand Reich. Ce fait seul en dit long sur l'état d'esprit qui animait ces prisonniers, mais ajoutons qu'ils avaient les possibilités, les moyens de se permettre une telle prodigalité. XXXIV LES RAFLES. Il était amusant de constater combien la population d'un stalag augmentait journellement pour atteindre, en l'espace de quelques semaines, le double, voire le triple de l'effectif normal que le camp pouvait compter. Un grand nombre de resquilleurs, recrutés en majeure partie dans la catégorie des malades imaginaires sortis de l'infirmerie après un séjour plus ou moins court, venaient se faufiler parmi les travailleurs du camp ou, mieux, se contentaient de jouer les pères flemmards. Ah ! qu'il est bon de ne rien faire. Les autorités allemandes du camp n'étaient pas du même avis ; aussi, périodiquement, s'avisaient-elles de réduire cette densité compromettante pour l'espace vital des « planqués » officiels et, surtout, pour la victoire finale du Grand Reich que tant de bras croisés retardaient. Et c'était alors la rafle qui réservait aux malchanceux un prompt retour en kommando. Le jour même de mon arrivée à l'infirmerie du IID, nous étions alignés devant la baraque pour rappel de 17 heures. Celui-ci se prolongeait démesurément car, dans le camp, des sondages étaient faits par des sous-offs et feldwebels, en vue de repérer les prisonniers en rupture de kommando. Des rangs, s'échappent cinq prisonniers qui, de toute la vitesse de leurs jambes, gagnent l'infirmerie ; quatre d'entre eux en ressortent par l'autre bout, traversent l'espace libre en direction des latrines et pénètrent dans les aborts. Un fe1dwebel et un unteroffizier y entrent à leur tour, mais après deux minutes, nous les voyons réapparaître, seuls ils n'ont rien trouvé. Ces latrines n'ont cependant qu'une seule issue et nos prisonniers ne peuvent en être ressortis. S'il .avait été donné un peu plus de perspicacité à ces deux sbires, ils auraient pu dénicher nos quatre 1ascars suspendus par les mains à un rebord de briques sous la planche des cabinets. On peut imaginer la position peu commode de ces camarades, entre la lunette et la ... mélasse, et la catastrophe qui eût résulté pour celui qui eût lâché prise. Le cinquième, un prêtre français, eut moins de chance. Il se fit repérer au 3e étage d'un lit, par la teinte trop vive de son pantalon rouge de fantassin 1914 qui dépassait sous la couverture trop hâtivement tirée. Il fut renvoyé dans les rangs, non sans avoir reçu un violent coup de poing à la face, que lui asséna l’une des deux brutes. Il est assez intéressant de rappeler les divers moyens employés pour échapper à ces rafles et alors que, à l'époque, cela ne nous faisait même pas sourire, on rigole aujourd'hui, au souvenir des mille et un tours qu'on a pu jouer à nos seigneurs et maîtres. En février 1943, une rafle doit épurer le camp de tous ses parasites. Chaque jour, à 14 heures, cent prisonniers sont conduits à la Hauptrevier où le Stabartz (médecin allemand), après auscultation très superficielle, les désigne « bons pour le kommando », le plus souvent. Quelque 25 sentinelles entourent le baraquement pour empêcher toute fuite. On ne peut se rendre aux latrines que sous la conduite d'un gardien et un deuxième ne peut y aller à son tour que lorsque l'autre en est revenu. Garde sévère qui n'empêchera pas, le premier jour, 63 prisonniers de se débiner sous ses yeux, au cours des deux heures d'attente précédant l'arrivée du médecin. Pour arriver à ce résultat, on s'y est pris le plus simplement du monde, assurés toutefois de la complicité des infirmiers. Le bras gauche orné du brassard de la Croix-Rouge, deux infirmiers passent le barrage des sentinelles; celles-ci s'effacent pour livrer le passage à ces deux P. G. dont les fonctions nécessitent les allées et venues d'une baraque à l'autre de l'infirmerie. Par une autre issue, deux autres infirmiers s'en vont également, puis deux autres encore, puis deux toujours..., mais il n'en revient jamais qu'un seul, le vrai, pour rendre le même service à un autre copain. Et ce jeu dura jusqu'à l'arrivée du toubib allemand. Trente-sept hommes passèrent la visite, ce jour-là. En avril de la même année, la rafle s'effectua de la même manière. Sur le groupe de cent hommes dont je fais partie, 96 passeront devant le Stabartz. Des quatre autres, deux réussissent à se glisser dans deux lits vides de la Hauptrevier et deux autres pénétreront par la fenêtre dans une chambre de l'Isolierbaracke, occupée par deux prisonniers serbes atteints de fièvre typhoïde. Ils en sortiront quelques heures plus tard, lorsque tout danger sera écarté. Comment était-il procédé pour le renvoi en kommando ? Lorsque le médecin allemand vous jugeait apte au travail, vous passiez devant son scribe qui prenait note de votre numéro matricule. En fin de journée, la liste de ces numéros était transmise à l'Arbeitsamt qui, à son tour, ordonnait aux chefs de kommandos intéressés, de venir reprendre les pères peinards pour les remettre au banc d'épreuve. Pour moi, étranger en ce stalag, lorsque je fus au courant du système, je jugeai opportun de me faire confectionner une fausse plaque matricule et, dès ce moment, je pus affronter les rafles en toute confiance. Je dois reconnaître que, à cette occasion. je fus d'un égoïsme intégral, car je ne dévoilai jamais le stratagème .à mes camarades, étant certain d'avance que ce truc ferait faillite, dès sa vulgarisation. Un jour d'octobre, alors que des rafales de neige mi-fondue nous cloîtraient tous à l'intérieur des. baraques, les schleuhs s'avisent de faire une rafle à laquelle on ne s'attendait guère. Ce n'était qu'une fausse alerte, car il s'agissait de nous employer à la construction de silos à patates, chez un fermier des environs. Il fallait, à ce bauer, une main-d'œuvre nombreuse pour terminer ses travaux, étant donné le mauvais temps subit et imprévu. Mais ce fut aussi pour le même motif que les prisonniers manifestèrent une mauvaise volonté à se laisser embrigader dans cette affaire qui ne leur disait rien qui vaille, par ce temps détestable, et les boches rencontrèrent une très vive résistance. Les coups n'y pouvaient rien, ce qui décida nos anges gardiens à faire appel aux chiens policiers du camp, molosses que le prisonnier craignait. Je me tins caché derrière une lignée de manteaux suspendus à un fil et un des chien passa à deux mètres sans me flairer, occupé qu’il était à poursuivre un prisonnier qui, en courant, put me lancer ce bref et sage conseil : « Cache tes pieds ». Ce jour-là, les neuf dixièmes des prisonniers français du camp, écopèrent à la corvée. J'ai conservé un souvenir agréable de la dernière rafle que je connus dans ce stalag, par le côté désopilant d’un truc spontané qu'elle fit naître. C'était un dimanche, vers la mi-novembre 1943. Dans l'allée centrale, l'appel de 9 heures venait de se terminer, lorsque le Hauptmann, au lieu de se retirer comme à l'habitude, ordonna d'effectuer un quart de tour et nous dirigea vers le terrain des sports. Aussitôt, quelques prisonniers sortent des rangs et, à demi-courbés, foncent vers les baraques les plus proches. Les schleuhs n'ont rien vu. Ces camarades ont eu du flair, car c'est bien d'une rafle qu'il s'agit. Sur le terrain, on nous fit mettre en carré, français et serbes. Le Hauptmann, hautement proclame qu'il était décidé à user de tous les moyens pour remettre au travail les récalcitrants et que, aujourd’hui, il tenait à faire la rafle lui-même, pour être certain qu’elle donnerait des résultats meilleurs que les précédentes et que le stalag serait ainsi purgé de tous les paresseux. Pauvre Hauptmann. De ses prétentions, il ne devait pas tarder à en rabattre. Un employé des services de la Kommandantur fut chargé d'énoncer clairement les noms des Kgf de la maffia, dont on lui remit la liste. Ceux-ci devaient se placer au centre du terrain, ils étaient hors-concours. L'appel commença, lentement d'abord, puis à un rythme plus rapide. Dès le début, nous avions pu constater que les gars sortaient des rangs à une cadence assez louche ; le Hauptmann aussi, car il de manda à être renseigné sur le nombre de prisonniers appelés. Il lui fut répondu : 45. Au centre du terrain, 81 types rigolaient. Le Hauptmann resta impassible, pour masquer son dépit d'être joué et fit continuer l'appel des noms, mais très lentement, cette fois. L'appel terminé, il ne restait plus qu'à s'assurer de ceux qui possédaient un billet de convalescence signé du médecin allemand, les autres se voyant d'office désignés pour le kommando. Un Oberleutnant fit remarquer au chef de camp qu'on avait omis d'appeler les employés du « Service Pétain » ; celui-ci comprenait une dizaine de prisonniers. Prié de s'en charger, le lieutenant, en un français très. pur, cria : « Messieurs du service Pétain, veuillez sortir des rangs, s'il vous plaît, et vous ranger en face de moi ». Une soixantaine de prisonniers répondirent à son appel. Le Hauptmaan n'avait rien vu et l'Oberleutnant s'esclaffait de tout son saoul. Ce jour-là, n'étant pas en possession de ma fausse plaque matricule, je me bornai à présenter la véritable au Hauptmann, le pouce posé sur l'indicatif du stalag. Il nota mon numéro et passa à un autre ; j'étais sauvé une fois de plus. Mais, à cette occasion, je pus remarquer que bon nombre de prisonniers possédaient un faux papier de convalescence identique à ceux qui étaient délivrés : par le Stabartz. La signature était habilement imitée et une date assez récente du dernier passage à la visite du médecin allemand s'y trouvait inscrite. Ils avaient donc la faculté de renouveler ce papier, au moins mensuellement. Tous ces réfractaires au travail constituaient un véritable défi aux autorités du camp. Celles-ci le savaient, mais ne sont jamais parvenues à enrayer ce qu'elles considéraient comme une plaie du stalag. XXXV VIE DE
BARAQUE. On s'en doute bien, la vie de baraque n'offre rien de bien réjouissant et l'atmosphère de monotonie qui s'en dégage crée une ambiance de lassitude, voire de paresse, que l'on ne peut concevoir sans l'avoir vécue. Au Stalag, il y avait deux espèces de baraques. Tout d'abord, les baraques en bois divisées en « stubes » de 20 à 26 hommes, avec lits à deux étages et qui étaient occupées par les prisonniers russes. Ce genre de baraque se rencontrait dans toute l'Allemagne, dans la plupart des kommandos quelque peu importants et toutes construites suivant un même gabarit. Il y avait alors les longues bâtisses en briques, contenant deux immenses chambres séparées par un lavoir et dont chacune pouvait contenir jusqu'à 150 hommes. Des lits à 3 étages montés par blocs de 12 couchettes. Entre les lits, une travée qui permettait à deux hommes de se croiser de biais. C'est dans ces baraques qu'étaient logés les prisonniers français, serbes, italiens et canadiens. Les murs intérieurs de ces baraques sont blanchis à la chaux. Huit petites fenêtres laissent passer la lumière avec parcimonie. Il fait sombre là-dedans, car ces ouvertures sont, en partie obstruées par les lits mastodontes d'une part et par deux énormes foyers en brique de 2 mètres de hauteur sur 2 mètres de longueur. Au-dessus de nos têtes, point de plafond, mais une charpente aux multiples chevrons ; entrecroisés, soutenant un long toit angulaire. Comme mobilier, quelques tables boiteuses, une dizaine de bancs, c'est tout ! Toutefois, les prisonniers ont tenu à le compléter par cinq ou six foyers économiques construits avec des seaux à marmelade qui leur permettent de faire cuire la popote. Chaque lit est pourvu d'une paillasse que l'usage a aplatie. Elle est remplie d'une paille de bois dont beaucoup de prisonniers ne verront pas le renouvellement, l'occasion leur étant très rarement offerte. Des dizaines de prisonniers se succèdent sur la même couchette en dépit de toute condition hygiénique, des maladies et épidémies qui peuvent en résulter. La paillasse est posée sur un fond de planchettes disposées en claire-voie, la plupart d'entre elles ayant été utilisées à des fins calorifiques. Chaque prisonnier possède deux couvertures en laine… de verre, qui n'ont aucune des propriétés que nous connaissons à celles de chez nous. En Allemagne, dans le commerce ces couvertures coûtaient 4 marks 95 pfennigs. A ce prix, on ne pouvait être difficile. Pour accéder, aux couchettes supérieures, il faut se livrer à un exercice d'assouplissement qui n'exclut pas la pose des pieds sur les lits inférieurs ; aussi, ceux-ci portent constamment des traces de boue, d'humidité et de poussière. Le matin, au réveil, les deux couchettes inférieures sont littéralement couvertes de paille hachée tombée des couchettes supérieures et qui picote les yeux, obstrue les narines et racle la gorge. Le prisonnier ne possède pas d'armoire ; aussi. malgré la défense qui lui est faite, peut-on voir de rustiques étagères à la tête et au pied de chaque couchette, sur lesquelles le prisonnier dépose son cinquième de pain, sa rondelle de saucisse et son minuscule carré de margarine. On y trouve, en outre, son gobelet, son nécessaire à barbe, son savon et des boîtes diverses voisinant avec des photos logées en des cadres fantaisistes et les souvenirs les plus hétéroclites qui soient et dont il faudra peut-être se débarrasser dès le premier départ en kommando. Une infinité de clous sont plantés dans les chevrons des lits, lesquels servent à suspendre, non seulement les vêtements, mais aussi des louches, des poêles à frire, des casseroles et tous autres objets pratiques que le prisonnier s'est appropriés ou s'est confectionnés lui-même. En un jour de hargne, un feldwebel envahira la baraque avec ses hommes, auxquels il donnera un ordre destructeur mieux en convenance avec les règlements. Le prisonnier en sera quitte à recommencer ses étalages, dès que les sbires se seront éloignés. Sous les lits, le fourbi est autrement sérieux encore : godasses, sabots, clapettes, valises, charbon, bois, pommes de terre et que sais-je ? Tout cela voisine pêle-mêle sur le sol humide. Un bon arrimage ne sert à rien car 'il est compromis par des camarades que le souci de l'ordre ne tourmente plus depuis belle lurette. En hiver, comment sont chauffés ces locaux ? La question du chauffage ne fut jamais un problème pour les autorités du camp. Aux jours les plus froids, les allemands distribuaient, dans chaque baraque, une dizaine de kilos de racines d'arbres, pour alimenter deux foyers énormes. Négligeant de parler des jours creux, où aucune distribution n'était faite, il est clair que tout commentaire serait superflu concernant l'insuffisance de chauffage. Alors, on se chauffait avec le bois que l'on trouvait, le charbon que l'on volait et on faisait feu de tout le matériel que l'on détruisait sciemment. Ces trouvailles servaient à alimenter les petits foyers économiques que les prisonniers s'étaient construits, qui étaient en action la journée durant et sur lesquels mijotait la cuistance. Certes, ce n’était pas la douce chaleur rêvée, mais une sensible atténuation du froid. D'autre part, le prisonnier portait sur lui tout l'équipement vestimentaire dont il était pourvu, depuis le réveil. jusqu'au moment de se mettre au lit. En été, les « piaules » étaient quasi désertes, tout le monde était dehors. On saisissait l'occasion de se refaire les poumons, de respirer librement jusqu'à ce que la sonnerie du couvre-feu vienne intimer l'ordre de réintégrer les baraques. En hiver, tout ce monde grouillait à l'intérieur des baraques et l'espace vital s'y trouvait réduit au cm². L'air est empesté de fumée que dégagent les foyers économiques auxquels, dans leur hâte, les prisonniers n'ont pas pensé à pourvoir d'un système de récupération des gaz. L'odeur âcre du bois qui se consume et le gaz carbonique se mêlent aux relents d'une cuisine douteuse et à la tabagie qu'un cabaret de dernier ordre ne désavouerait pas. Le soir, deux ampoules de 40 bougies diffusent une faible clarté qui permet de s'entrevoir et de se diriger. Sur toute sa longueur centrale, la baraque est occupée par des groupes de prisonniers qui discutent le coup, ressassent les événements, commentent les nouvelles reçues du pays ou se remémorent les souvenirs déjà lointains de l'avant-guerre. Entre ces groupes, c'est un va-et-vient fatigant de gens jamais en place, de camarades des baraques voisines venus rendre visite aux copains ; d'hommes pressés (?) aussi qui bousculent tout sur leur passage. Tout ce monde parle bruyamment, des exclamations fusent de partout, des interpellations criardes se font entendre d'un bout à l'autre de la baraque, jurons et altercations s'entrecroisent au diapason élevé. Les joueurs de belote et de Poker sont installés aux tables et s'adonnent à leur jeu favori avec le sérieux de messieurs du Cercle. Cet air leur convient parfaitement, car ce sont des gens très entourés. Il n'est pas rare, entre deux joueurs, de trouver un lecteur dont les yeux alternent du livre à la table de jeu. Peut-être n'a-t-il pas voulu céder sa place ou se fait-il le complice d'un joueur avec qui il partagera les gains. Dans le fond de la piaule, un accordéoniste amateur tâche de tirer le meilleur parti de son instrument, tandis que, dans un coin, un autre s'escrime sur un piston ou une clarinette. Plus modestement, un troisième s'essaye sur un harmonica à bouche. Toute cette cacophonie, tout ce brouhaha, ne gênent en rien les gars qui, juchés au 3e étage des lits, écrivent la lettre ou la carte hebdomadaire qu'ils adresseront à leur fiancée, leur épouse ou leurs parents. Grimpés-là pour mieux y voir, couchés sur le ventre, ils s'appliquent à trouver des phrases mille fois répétées et restent indifférents à tout ce bruit qui monte vers eux. Autour des foyers de fortune, c'est le grand branle-bas où des cuistots d'un genre nouveau s'affairent à la réussite d'un mets inconnu de la tante Rosalie ou à la confection d'un gâteau devant lequel BrilIat-Savarin aurait dû s'incliner. Peu importe que l'on se moque, si l'estomac y trouve son compte. La diversité des menus provient surtout de l'art d'accommoder les patates car, en Poméranie, la pomme de terre fut toujours le plat de résistance des prisonniers. Mais le couvre-feu vient mettre un terme à cette journée, comme toutes les autres, monotone. On s'installe sur les couchettes après y avoir accumulé couvertures, vestes, pantalons et manteaux. Chacun cherche, dans le sommeil, un peu d'oubli. Cependant, toute vie n'a pas cessé chez les prisonniers, car la voix de rêveurs tourmentés, certains bruits incongrus et des ronflements sonores, témoignent encore de leur existence. XXXVI RETOUR EN
KOMMANDO. Dix-huit mois ont passé dans ce stalag où, accueilli par les prisonniers français comme un des leurs, j'ai pu apprécier la franche camaraderie de tous. Avec l'aide de quelques amis du début, mis au courant de mes intentions, j'étais devenu un honnête trouffion de 2ème classe, qui se mua bientôt en sous-off d'une promotion imaginaire, comme il s'en rencontrait d'ailleurs beaucoup en pareil lieu. Ainsi transformé et par la mise en application du système D, je pus distraire un an et demi de mon temps d'épreuve de l'attention des autorités schleuhs de mon stalag d'origine. Mon passage dans un Lazarett mit fin à cette situation. Ce 10 mars 1944, en plein midi, un jeune soldat allemand vint me rappeler à meilleure convenance et m'emmena avec lui, après avoir hâtivement rassemblé mon fourbi et abandonné aux copains tout ce qui faisait mes commodités matérielles et le bric-à-brac superflu dont, généralement, est doté tout prisonnier implanté au stalag durant un laps de temps sérieux. Et je suivis mon gardien en maugréant, nanti de cette mauvaise humeur qui accompagne toujours nos déménagements. Quand donc cette vie prendra-t-elle fin ? Chargé de mon barda, dont les lanières me coupent les épaules, les mains mourantes sous le poids de mes valises surchargées, les yeux rivés sur la chaussée, je reste indifférent à ce qui se passe autour de moi. Lorsque, tout à coup, le gardien me pose une question : – Wenn die Kriegende ? (Quand la fin de la guerre). J'y réponds aussitôt, d'un ton convaincu : – Dans six mois, lorsque les Russes seront ici. Ce jeune hitlérien n'a pas l'air d'apprécier mon opinion. Cela jette un froid ! Je le regrette, car j'aurais voulu, à mon tour, lui poser une question pour connaître quelle allait être ma nouvelle destination. Mais il presse le pas et je ne parviens à le suivre que très péniblement. Il se venge ! Un train nous emporte en direction de Stettin. Toutes les voitures sont encombrées de voyageurs et il n'est pas possible de trouver une place libre. Mon schleuh et moi restons plantés au centre du compartiment. Je suis le point de mire de tous ces gens qui me détaillent sur toutes les coutures. Histoire de leur en imposer, je fume cigarette après cigarette ; ils ne peuvent en faire autant et cela me console. C' est peu charitable, il est vrai, mais j'enrage ! Hauptbahnof de Stettin ! Tout le monde descend ! Tiens, la gare a dérouillé, il ne reste debout que des murs calcinés. Dans les rues avoisinantes, des ruines, beaucoup de ruines ! C'est étonnant ce que le décor peut changer en un an et demi. Ce spectacle me laisse toutefois une appréhension d'insécurité, qui ne tardera pas à se vérifier, d'ailleurs. Mon Wachtmann me fait monter dans un tramway. Il y a longtemps que je n'ai plus utilisé ce moyen de locomotion et ce sera la seule fois en ces cinq années. Tant bien que mal. j'arrime mes bagages sur la plate-forme, non sans créer des remous parmi les occupants, soulever des injures et des imprécations à l'égard de cet intrus étranger, de ce Schweinhund dont l'encombrement réduit les aises. Un mot de mon gardien les fait taire : « Ruhe ! » En cette circonstance, je me plais à reconnaître que la discipline allemande a du bon. J'affiche le sourire de celui qui ne se sent nullement intimidé par des incidents de cette nature et je constate que, parmi les voyageurs, je me suis fait un allié ; un long type, au visage émané, dont la casquette à visière émerge du groupe, me fait comprendre d'un clin d'œil furtif qu'il est avec moi... moralement. Ils deviennent nombreux, ces gens dont le feu sacré s'éteint au fur et à mesure de l'accentuation des défaites allemandes. Mes pensées en restent là car, à un nouvel. arrêt, la sentinelle m'invite à descendre, ce que je fais aussitôt, encombré de mes bagages. Les grognements recommencent. Mais où suis-je ? Il me semble que le paysage m'est devenu familier. D'un mot, j'interroge le gardien : Bredow ? Il acquiesce d'un signe de tête. Malheur ! Et moi qui craignais tant d'y revenir. La chance ne joue plus ! Je n'avais supporté la vie de ce kommando que par la vertu de cette camaraderie qui nous liait tous l'un à l'autre, mais alors que j'en étais sorti. il me déplaisait souverainement d'y rentrer. Le sort en est jeté ! Les baraques sont là qui viennent d'apparaître, le gros Lagerführer est sur le seuil de sa porte, une sentinelle s'ennuie le long des barbelés, quelques prisonniers promènent leurs sabots sur le terre-plein du kommando. A quelques mètres au-delà, la fameuse voie ferrée qui fut tant l'objet de notre infortune. Rien n'est changé. Un lit est libre à la chambre 16. J'y retrouve une majorité d'anciens et, à mon entrée, leur accueil chaleureux me fait apprécier hautement la valeur d'un réconfort fraternel auquel dans mes désillusions, j'étais loin d'attribuer encore des vertus curatives. Je me sens tout ragaillardi par la présence de ces bons camarades et aussi, je dois l'avouer, par l'effet de quelques verres d'un vin épais qu'on est allé dénicher sous le toit de la baraque, pour fêter mon retour ; un vin garanti d'origine, venant en droite ligne des futailles chargées sur wagons en gare de Zabeldorf et qui attendaient leur départ pour le front de l'Est. Il allait de la réputation des prisonniers d'en goûter avant les combattants allemands et d'effectuer d'amples réserves au-dessus du plafond de la baraque. A cette époque, le kommando de Stettin-Bredow se compose de 360 prisonniers belges et français, auxquels est venu s'adjoindre depuis peu un groupe d'une centaine de prisonniers italiens. Ces derniers, sans ressources, encore mal adaptés à la vie dure du prisonnier, reçoivent de nous tout l'appui nécessaire, tant matériel que moral. Cela leur permet de résister plus aisément à l'emprise du cafard et de supporter leur sort avec plus de résignation. L'entente est parfaite entre tous les prisonniers. Comme précédemment, les prisonniers sont répartis entre diverses firmes ayant l'entreprise de construction, de réfection et d'entretien des voies de chemin de fer. Ces travaux sont durs et fatigants, on le sait, mais cela n'empêche nullement les autorités allemandes d'emprunter sur les moments de repos pour employer les prisonniers à des travaux de déblaiement des quartiers bombardés de la ville. Il est arrivé à maintes reprises, de mobiliser les prisonniers du kommando, dès leur rentrée, le soir, pour les transporter en des lieux fraîchement sinistrés qu'ils avaient à déblayer durant la nuit. L exécution des ordres, en pareil cas, ne se faisait pas sans heurts, évidemment, mais la raison du plus fort, est toujours la meilleure et les prisonniers se voyaient bien contraints de sortir des baraques et se ranger en colonne, car les sentinelles se faisaient menaçantes. Néanmoins il faut admettre que la discipline intérieure du kommando s'était fortement relâchée et les prisonniers n'obéissaient plus que mollement, lorsqu'ils n'opposaient pas un refus catégorique à certains ordres. Ce n'était, ni de l'aplomb, ni de l'audace, mais plus simplement une volonté de résistance que la longueur du, temps de captivité et des espoirs certains dans la victoire finale des alliés, faisaient évoluer favorablement. Tandis que le camp adverse perdait à coup sûr toute sa raison d'en imposer. En 1944, nous étions « gouvernés » par un Feldwebel qui se confinait entièrement dans la gérance du kommando et ne cherchait pas les contacts avec nous. Son second, un Unterfeldwebel que nous avions baptisé « Le P'tit Roi » ou encore « Victor-Emmanuel », en raison de sa très petite taille, n’a jamais su s'imposer parmi nous. Cette assertion s’affirme par les exemples qui suivent : Lorsque, le soir, à l'heure de cadenasser les portes, il faisait irruption dans les chambres, suivi d’un Gefreite et d'une sentinelle et se mettait en devoir de faire le nombre, les prisonniers continuaient à vaquer à leurs occupations sans se préoccuper de sa présence. Si, parfois, un « Achtung » retentissait dans la baraque, c'était par moquerie, car personne ne se mettait au pied des lits. Le va-et-vient dans la baraque plaçait le P'tit Roi devant de sérieuses difficultés et son compte ne se faisait qu'au prix d'un effort laborieux. D'autres fois, à l'appel de 19 heures, on pouvait voir des prisonniers se présenter avec leur plat de soupe et achever le repas qu'ils avaient dû interrompre sur l'ordre de l'appel, sans aucun souci du garde-à-vous. Et si la corvée prenait du temps, les prisonniers rentraient dans la baraque, l'un après l'autre, sans .attendre la fin. Cela faisait très république ! C'est donc dans cette atmosphère de résistance que je repris contact avec le kommando de Stettin-Bredow. XXXVII LES
BOMBARDEMENTS. Bombardement ! Le fait de prononcer ce mot fait renaître chez la plupart des prisonniers, de bien pénibles souvenirs. Cette évocation rappelle inévitablement les heures poignantes et cruelles de cette phase de la guerre dont les prisonniers furent les victimes inconscientes. Les prisonniers dont les kommandos étaient établis dans les villes principales et dans les secteurs industriels du Grand Reich, eurent à souffrir énormément des bombardements aériens, peut-être même à un degré supérieur à celui de la population civile, en raison de ce qu'ils ne possédaient pas d'abris assez résistants pour assurer leur sécurité. En effet, ces abris étaient faits d'une tranchée recouverte de rondins et d'un léger monticule de sable qui menaçait d'ensevelir les occupants à chaque secousse. Stettin, ville portuaire et industrielle importante, ne pouvait être épargnée et le kommando de Bredow, par son emplacement le long d'une voie ferrée, par la proximité même de certaines usines et aussi par le voisinage de plusieurs batteries de D.C.A., devait fatalement connaître des moments tragiques. Les raids aériens étaient nombreux et pouvaient se diviser en trois catégories. Tout d'abord… les raids de harcèlement qui avaient pour but de paralyser toute activité. Par centaines, les formations aériennes alliées s'amenaient au-dessus de l'Allemagne et, à un point déterminé, s'éparpillaient dans toutes les directions, ce qui provoquait une mise en état d'alerte générale. L'immense ruche guerrière s'arrêtait, ses habitants se garaient. Ce fut principalement en 1944, que l’on connut ces raids de harcèlement et nous pouvions suivre des yeux les forteresses volantes, encadrées de nombreux avions de chasse qui, plus rapides, caracolaient dans tous les sens pour demeurer dans le voisinage de leurs protégés. De temps à autre, une bombe se détachait, un peu au hasard, mais qui aidait puissamment à la réalisation du but assigné. On comprend de suite les conséquences de cette stratégie tactique sur la production, dont la chute était considérable, alors qu'un super-maximum de main-d’œuvre était utilisé en vue de l'accroissement du potentiel de guerre. Aussi, les dirigeants de la Gross Deutschland durent-ils prendre des mesures draconiennes pour limiter la perte de temps et, entr'autres, celle interdisant l'abandon du travail lors de la pré-alerte ; celle-ci ne devenait plus qu'un simple avertissement du danger futur. Cependant, le tort causé à l'immense machine guerrière par les raids de harcèlement, ne suffisait pas. Il fallait aussi que les bombardements viennent parfaire la besogne par la destruction d'objectifs bien déterminés et tout d'abord les usines de guerre, les voies ferrées et les navires ancrés au port. Tel était le but des bombardements de jour. Une première formation de bombardiers se présentait au-dessus de l'objectif repéré et la première forteresse de commandement désignait l'endroit à assaillir, au moyen de deux bombes indicatrices qui, dans leur trajectoire, laissaient derrière elles une double traînée blanche allant jusqu'au sol. Les autres formations qui se succédaient toutes les deux à trois minutes, n'avaient aucune peine à déverser leur charge explosive sur l'objectif Toute vie était arrêtée dans la ville ; on n'entendait que le vrombissement lourd des quadrimoteurs alliés, le vacarme indescriptible des explosions et le claquement sec des obus de la D. C. A.. Impassibles et allégées, les forteresses poursuivaient leur chemin à quelque 3 à 4 mille mètres d'altitude. Parfois, l'une d'elles, touchée de plein par un obus, s'arrêtait, tournoyait, piquait du nez dans une longue gerbe de feu et s'écrasait au sol dans un fracas épouvantable. Les prisonniers des kommandos de Stettin eurent la fréquente occasion d'assister à ce pénible spectacle. Qui ne se rappellera le bombardement de la Pommersche Motor, usine de construction de moteurs d'avions, habilement camouflée dans les bois entre Stettin et Altdamm et dont la surface entière des bâtiments était recouverte d'un filet métallique supportant des branchages et du feuillage. En une heure, cette importante usine, au sein de laquelle œuvraient des gens, hommes et femmes, de 18 nationalités, était mise dans la plus complète incapacité de produire encore. La destruction était totale. L'attaque ayant eu lieu par surprise, les victimes furent nombreuses. On se rappellera également les nombreux bombardements qui eurent pour objectif la fameuse usine d'essence synthétique de Pôlitz qu'on ne parvint jamais à détruire totalement, étant donné son étendue et que l'organisation Todt remettait en état de fonctionner en un laps de temps record. En quelques jours, dix mille ouvriers, soldats de la Wehrmacht, SS, déblayaient, bâtissaient, remplaçaient la machinerie détruite et toute l'usine se remettait en mouvement jusqu'à la suivante destruction partielle. La ligne de chemin de fer qui desservait cette usine, malgré des destructions sérieuses, ne subissait jamais qu'un arrêt du trafic de quelques heures. L'arrêt le plus long qu'il nous a été donné de constater fut, en août 1944, de 24 heures. Ces bombardements faisaient inévitablement des victimes parmi la population et, aussi, malheureusement, parmi les déportés étrangers et les prisonniers de guerre. Le samedi, 13 mai 1944, dès le début de l'après-midi, les équipes de prisonniers viennent de rentrer du travail, le kommando est presque complet. Lorsque, à 14 heures et demie, les sirènes beuglent la pré-alerte, suivie de près par l'alerte. Les prisonniers gagnent les frêles abris qui se dessinent en zigzag derrière les baraques et à peine y sont-ils installés qu'un bruit bien caractéristique leur signale un lâcher de bombes, dont la chute n'ira pas au-delà de quelques centaines de mètres du kommando. En effet, juchés sur le petit monticule de sable qui recouvre l'abri, nous pouvons assister à une suite successive d'explosions et constater que l'objectif atteint est la gare de Zullchow, située à 600 mètres. Une colonne de fumée ou de poussière noire, monte à plus de cent mètres de hauteur, mais semble s'éclaircir rapidement. Nous apprendrons plus tard qu'un convoi de charbon qui stationnait dans cette gare, a été touché. Mais, à ce moment, nous n'avons pas le loisir de nous rendre compte des motifs de ce phénomène, car des sifflements qui vont en s'accentuant, nous avertissent que, cette fois, le kommando est visé. D'un saut, nous réintégrons l'abri et sommes à peine installés à l'entrée, qu'un vacarme assourdissant d'explosions nous déchire le tympan ; l'abri tangue dangereusement et nous recevons en plein visage une volée de sable projeté avec une puissance extraordinaire et qui provoque sur la peau des milliers de picotements. Le calme renaît. A quelques-uns, nous nous risquons dehors. A 20 mètres, un énorme entonnoir nous donne l'explication de la gifle. Le sol est strié de petites crevasses et notre baraque a chancelé, les panneaux sont disjoints. Mais à cela se bornent nos regards. A l'autre bout du kommando, des appels à l'aide se font entendre, on nous réclame avec pelles et pioches. Quinze bombes sont tombées dans l'enceinte du kommando, une longue baraque est complètement démolie. L'une de ces bombes a atteint un abri et est venue semer le deuil parmi les prisonniers. Le bilan est terrible : 26 morts ! 26 corps déchiquetés ! Tandis que 20 autres camarades sont transportés à l'infirmerie pour y recevoir des soins. Par deux fois, les travaux de dégagement sont interrompus par le passage de nouvelles formations aériennes qui, à nouveau, laissent choir de nombreuses bombes dans le voisinage. Les corps de nos malheureux camarades ont été déposés côte à côte dans une baraque désaffectée, en attendant leur transfert au cimetière militaire de Wenndorf. Dans les baraques, c'est la consternation ; on ne se parle qu'à mi-voix, dans le respect de ceux qui viennent de nous quitter si tragiquement. Cette fin de semaine ne connait pas le va-et-vient habituel du samedi ; on en oublie la toilette corporelle, le nettoyage des chambres et le lessivage ; l'heure de la soupe passera sans que la plupart s'en soucient. On ne sort des chambres que pour se rendre à la baraque mortuaire, prononcer un religieux et dernier adieu a ces infortunés compagnons, parmi lesquels chacun possède un meilleur ami, un camarade plus particulièrement affectionné. Pour la seconde fois, Bredow pleure ses morts ! Il en est encore parmi nous qui ont connu la première tragédie du 1er octobre 1941, au cours de laquelle 4 bombes sont venues nous ravir 20 camarades. La tristesse muette qui nous étreint est empreinte de la plus complète résignation, car la fréquence des bombardements nous fait appréhender d'autres malheurs. Impuissants, chacun de nous attend sa fin ! XXXVIII TERRORBOMBARDEMENT. Nous avons dit que les raids aériens pouvaient être classés en trois catégories et avons décrit succinctement les raids de harcèlement et les bombardements d'objectifs ou bombardements de jour. Ceux de la troisième catégorie pourraient s'appeler « Reids de bombardement de nuit » ou, comme les allemands les dénommaient « Terrorbombardement ». Il est, en effet, très exact, que ces bombardements de nuit avaient pour but de semer la panique et la terreur parmi la population des villes et, du même coup, jeter la démoralisation dans les centres populeux et lutter, par ce moyen moderne, contre la propagande nazie que Goebbels orchestrait si savamment pour maintenir de vains espoirs dans la victoire finale du Reich. Il est très peu de villes d'Allemagne qui n'aient pas souffert de la violence de ces bombardements de nuit. Les ruines s'accumulaient et les victimes se dénombraient difficilement dans l'ampleur des désastres. Aux Allemands qui venaient se plaindre auprès de nous et reprochaient aux alliés ce moyen cruel et inhumain de faire la guerre, nous avions beau jeu de rétorquer que toute l'initiative des bombardements de terreur revenait à l'Allemagne qui, en 1940, jurait de « Coventryser » toute la Grande-Bretagne, si celle-ci ne voulait capituler. A cette époque, les Allemands enregistraient le fait avec satisfaction ; aujourd'hui, ils n'acceptaient pas les représailles de même nature. Il fallait être beau joueur ! Dass ist Krieg ! Comme il a été dit précédemment, nous en souffrions aussi, mais, devant eux, nous ne voulions pas le laisser paraître et nous affections une assurance calme qui les déroutait. Cependant, les nerfs étaient mis à une rude épreuve par la fréquence des alertes et des bombardements de nuit ; d'autant plus que nos heures de repos se trouvaient singulièrement abrégées et nos faibles moyens de récupération ne parvenaient pas à réparer les effets de la fatigue que nous ressentions inévitablement. Mais comment les Alliés effectuaient-ils un bombardement de nuit ? Il serait vain de croire que les forteresses volantes lâchaient leur cargaison de bombes au hasard de leur situation au-dessus des villes. Non, cela se pratiquait selon un processus bien établi et dont l'exécution visait uniquement une partie bien déterminée de la ville qui en était l'objectif. Les Pathfinders (éclaireurs) s'amenaient en premier lieu et laissaient choir quatre fusées, chacune suspendue à un parachute : ces fusées formaient un carré ou un rectangle qui délimitait la surface à bombarder. Cela fait, d'autres avions à leur tour, emplissaient ce carré ou rectangle de centaines de fusées identiques aux premières et dont la lueur rouge, se balançant à quelque trois ou quatre cents mètres du sol, assurait une visibilité parfaite des choses. Ces fusées, avant d'atteindre le sol et de s'éteindre, avaient un pouvoir éclairant de durée pouvant aller de 15 à 20 minutes, après lequel il était remplacé par la lueur des incendies au sol car les bombardiers avaient suivi et leur travail de destruction se faisait sans relâche. Pendant une heure, deux heures et même plus, c'était un vacarme indescriptible d'explosions, du tac-tac des mitrailleuses de défense, d'immeubles qui s'écroulent ou craquent dans les flammes, pendant que, dans le ciel, le vrombissement des quadrimoteurs ne se percevait plus dans l'éclatement fulgurant de milliers d'obus de la D. C. A. Mille, quinze cents, deux mille avions sont passés et s'en retournent à l'aise, allégés des trois ou quatre tonnes de bombes que chacun d'eux transportait, suspendus sous la carlingue. Sur la terre, un calme subit a succédé à l'infernal tonnerre. Le crépitement des incendies, un toit qui s'effondre et même l'explosion isolée d'une bombe à retardement, ne sont plus de nature à éveiller l'attention, tout cela est devenu bruit léger que notre oreille enregistre à peine. La tension à laquelle nous avons été soumis, devrait nous mettre dans un certain état d'agitation. Il n'en est rien, cependant, le calme est revenu. Nous regagnons nos baraques et la couchette qu'il a fallu quitter précipitamment et nous nous endormons, comme si rien ne s'était passé. Dans la ville, il y a peut-être des milliers de victimes, personne n'y pense. A quoi attribuer cet état mental ? Le prisonnier, qui a vécu sous la hantise de nombreuses alertes et des bombardements meurtriers, répondra que, à la longue, il en était arrivé à une forme de fatalisme et, à vrai dire, ne se faisait pas d'illusions sur le sort qui lui était réservé. Aujourd'hui encore, il avait échappé au danger, mais peut-être demain, retrouverait-on son corps pantelant dans une profonde excavation de bombe. Les bombardements étaient devenus trop fréquents, la catastrophe nous paraissait inévitable. La nuit du 16 au 17 août 1944, un nouvel événement vient entretenir nos appréhensions. La « Voralarm » vient de nous prévenir d'une menace de bombardement. Depuis longtemps, nous avons pris la précaution de sortir nos valises et nos effets, dès l'annonce de l'alerte et de les parquer sur le terre-plein du kommando, ceci afin de les sauver d'une destruction totale si nos baraques étaient atteintes. Par leur dissémination sur le sol, on a grande chance de n'encourir qu'une destruction partielle. Nous aurons l'occasion de vérifier la sagesse de cette précaution. Une fois fait ce transfert, nous gagnons les abris. Personne n'y pénètre car tout est calme. Seuls, les phares fouillent le ciel et troublent la noirceur de cette nuit d'encre. Assis par terre ou adossés à une baraque quelques prisonniers se rendorment ; d'autres ont entamé des conversations, de cette voix épaisse qui indique la torpeur du sommeil interrompu. Les minutes passent et il ne paraît pas que cette alerte aura des suites. Beaucoup pensent a réintégrer les baraques, à l'insu des sentinelles. Plus d'une demi-heure s'est écoulée lorsque, du côté de la Baltique, les canons de défense côtière se font entendre, nous apercevons les éclairs dans le ciel au loin. Quelques minutes encore et un bruissement continu, qui va en s'amplifiant, nous annonce que les avions alliés sont là ; ils longent la ligne de l'Oder. C'est pour nous, comme nous avons coutume de dire, quoique le manque de fusées rouges dans le ciel soit un signe rassurant. Pour notre sécurité, nous pénétrons dans les abris. Tout à coup, le bombardement se déclenche. Il ne sera pas long, les formations aériennes sont peu nombreuses. Il semble toutefois que le faubourg de Bredow est visé spécialement, ainsi qu'une partie du quartier de Zabeldorf. Ce bombardement comporte surtout un lâcher de bombes incendiaires à essence ; nous ne les craignons pas. Mais qu'est-ce ? Une clarté anormale embrase le kommando et un crépitement insolite nous parvient jusqu'à l'entrée de l'abri. Des baraques sont la proie des flammes ! Dès la fin, de l'alerte, nous nous précipitons hors des abris et constatons que l'incendie dévore, les appartements du Lagerführer, la cuisine principale et la grande chambre y attenant, où logent des prisonniers français. Un espace de 4 mètres sépare cette longue baraque de celle des lavoirs et des douches. Par les flammèches qui retombent sur cette dernière, l'incendie se communique sans qu'il soit possible de rien tenter pour la préserver, Seule, une autre baraque voisine pourra être sauvée. Nous regrettons que le sinistre ne soit pas complet et n'ait anéanti le kommando, cela nous aurait fourni l'occasion de changer d'air et de risquer la chance d'être internés à, un endroit moins vulnérable. Tandis que la situation qui nous est faite à la suite de ce dernier bombardement, ajoute encore à notre misère. Il faudra sur-peupler les baraques pour loger les camarades sinistrés. En outre, une seule cuisine devra pourvoir à l'alimentation de tout le kommando, ce qui implique fatalement une diminution des rations. D'autre part, les canalisations d'eau potable sont atteintes et la majeure partie du faubourg de Bredow se trouve sans eau ; la population est ravitaillée par camions-citernes. Pour nous c'est moins commode, nous tirons l'eau à 500 m. du kommando, ce qui exige une corvée de porteurs d'eau du matin au soir. Mais l'homme le plus à plaindre est, assurément, le « gros » (Entendez par là, le Lagerführer) qui ne retrouva dans son coffre-fort, que des liasses de billets calcinés et sans valeur. Cet homme, insensible à la misère d'autrui, aura dû surprendre bien des sourires narquois sur les lèvres des prisonniers. Son infortune ne touchait même pas nos gardiens qui le détestaient ouvertement. Et la vie continua en ces lieux, avec un peu plus de misères et, dans l'attente de la catastrophe. XXXIX LA FIN DE
BREDOW. Nous sommes dans notre cinquième année de captivité et quoique nous en ayons pris notre parti depuis longtemps, nous éprouvons quand même plus de lassitude depuis la destruction partielle du kommando. Deux semaines se sont écoulées depuis cette dernière illumination, il semblait que plus rien ne pouvait nous bouleverser et, cependant, nous ressentons la fatigue du travail et des nuits sans repos. Cela n'en finit plus. Les alertes et les bombardements de jour et de nuit se succèdent à une cadence accélérée. La plupart du temps, nous sommes avertis 48 heures à l'avance de l'entreprise d'un bombardement sérieux. Le matin, entre 8 et 9 heures, alors que nul bruissement d'avion ne se perçoit, la D. C. A. tonne en différents endroits de la ville et les flocons de fumée dûs à l'éclatement des obus nous renseignent. On peut alors apercevoir une longue traînée de vapeur de condensation à l'arrière de l'avion de reconnaissance qui est l'objet de cette attaque ; celui-ci est à peine visible à l'œil nu en raison de son altitude très élevée et de sa rapidité. On prétend que sa mission est de photographier les lieux pout déterminer l'emplacement qui sera l'objet d'un prochain raid de bombardement. Le 28 août 1944, nous assistons une fois encore à ce spectacle matinal. L'avion allié passe et repasse au-dessus de la ville, traçant son chemin le plus souvent parallèlement au cours de l'Oder. Par sa vitesse, il se joue aisément de la D. C. A. dont les obus éclatent loin derrière lui. Après une demi-heure d'allées et venues, il disparaît au Nord et tout s'apaise. Ce préalable avertissement devait confirmer, une fois de plus, le sujet de nos inquiétudes Le 30 août, après une journée très chaude, les prisonniers sont rentrés du travail, ont procédé à leur toilette, préparé leur cuistance personnelle, subi l'appel traditionnel au cours du rassemblement général et, après un peu de parlottes ou de lecture, se sont glissés sous la couverture. Les vêtements ont été déposés sur les lits, à portée de main car bien souvent, dès l'annonce des sirènes, il faut faire vite. Un dernier appel a été fait par chambre, les sentinelles ont cadenassé les portes et les volets des baraques, les lumières se sont éteintes. Tout bruit a disparu, c'est le calme de la nuit. Il est minuit et demi ! Brusquement, nous sommes réveillés par le « chant des sirènes ». Tout en nous habillant fébrilement, on compte : un... deux... trois... quatre... on ne continue pas ; c'est l'alerte directe, il y a danger immédiat. A Stettin, c'est courant, les avions alliés s'amenant par les pays scandinaves et bifurquant, tout à coup en direction de la ville. Au dehors, nous entendons les pas précipités des sentinelles qui viennent nous ouvrir les portes. Nous saisissons nos valises pour les parquer sur le terre-plein du kommando, mais dès le seuil de la baraque, le premier regard dans la nuit fait naitre cette pensée angoissante : « C'est pour nous ». En effet, les Pathfinders ont déjà laissé choir les quatre fusées rouges qui marquent l'emplacement à bombarder et dans lequel notre kommando se trouve être au centre à peu de chose près. Sont visés, les faubourgs de Frauendorf, Zullchow, Bredow et Zabeldorf. Nous sommes à peine sortis des baraques que le ciel s'éclaire de toutes parts, que des centaines de fusées propagent leur lueur rouge jusqu'au sol où tout apparaît soudain. Et tout aussitôt aussi, le vrombissement sourd des moteurs des lourdes forteresses aériennes se perçoit au-dessus de nos têtes et une série de sifflements nous prévient de l'imminence du danger. Les abris sont à peine atteints que en cent endroits, les bombes explosent en un vacarme assourdissant. Il ne s'est pas écoulé deux minutes depuis le moment où les sirènes ont annoncé l'alerte et la première chute de bombes. Celle-ci est suivie par d'autres sans discontinuité, sans aucun répit d'accalmie. Le sol est secoué brutalement et notre léger abri tangue dangereusement et menace de s'effondrer. De l'entrée, on peut apercevoir déjà de nombreux bâtiments en flammes un peu partout et ces foyers sont activés par un vent d'Est assez fort qui envoie, dans notre direction, des nuages de fumée noire et de poussières qui nous sèchent la gorge. Il m'est donné d'apercevoir deux avions alliés volant à très basse altitude (1000 à 1500 mètres) et que poursuivent les balles traçantes des mitrailleuses installées au port. La D. C. A, déchaînée, ajoute encore au vacarme infernal des explosions et de l'écroulement des immeubles. Une bombe soufflante vient de tomber, pas bien loin certainement, car notre baraque vient d'être secouée violemment sur toute sa longueur, les volets se sont ouverts avec force, les vitres se brisent. Cette bombe est suivie d'une deuxième qui, elle, vient éclater à quelques mètres de l’entrée Ouest du kommando et, avec un craquement sinistre, toutes les baraques se déboîtent et se couchent sur le sol, ainsi qu'il serait fait d'un château de cartes. La nôtre recouvre presqu'entièrement l’entrée de l'abri où nous sommes terrés On craignait ce genre de bombes pour les ravages mortels qu'elles exercent. Les victimes de la bombe soufflante ne portent, habituellement, aucune trace de violence, la mort est provoquée par l'éclatement des poumons ou de la vessie. Dans l'abri. plusieurs camarades sont couchés à plat-ventre, la bouche et le nez dans leur mouchoir, afin de parer au mieux aux mortels effets de la bombe soufflante. Lors de la chute de la deuxième bombe, nous avons senti passer son souffle puissant. Ceux qui se trouvaient au premier rang se virent décoiffer prestement et reçurent une volée de sable au visage avec une telle forcé que cela donnait l'impression d'avoir reçu plutôt une pelote d'aiguilles et ce, malgré le barrage que formait la baraque entre le point de chute et nous. Les formations aériennes se succèdent sans interruption et lâchent leur cargaison d'explosifs sur la ville, à laquelle s'ajoute une véritable pluie de phosphore. ,C'est le « Parket bombing » comme jamais la ville de Stettin n'a eu à connaître. A l'une des extrémités de l'abri, des appels pressants se font entendre : « Fuyez ! Livrez passage ! L'abri est en feu ! » A l'endroit où nous nous trouvons à l’entrée du centre de l'abri, nous constatons aussi que le phosphore fait son effet et que la baraque qui recouvre l'entrée vient subitement de s'enflammer. Mon voisin, un jeune italien, s'écrie : « Una minuta di piu, sono perduto » et il s'échappe avec une telle rapidité qu'il ne m'est pas possible de voir comment il s'y est pris. Un moment d'hésitation et je me décide à mon tour, après en avoir averti mes voisins. Les risques sont grands ; les baraques recouvrant l'entrée en biais, il est permis seulement d'emprunter deux marches de l'escalier et la tête se trouve alors placée à hauteur des flammes. Les doigts crispés dans le sable, un prompt rétablissement qu'il me serait impossible de réaliser si le danger n'existait pas, me jette littéralement hors de l'abri et je me laisse rouler jusqu'à la clôture des barbelés, proche de deux mètres. Je suis sauf, sinon, quelques légères traces de brûlures dans le cou et à l'oreille droite. La plupart de ceux qui me suivront par cette voie paieront cette hardiesse de quelques mois d'hôpital, atteints de brûlures à la face et aux mains. Le spectacle qui s'offre à mes yeux – comme une vision d'enfer – est hallucinant. Les quatre faubourgs déjà cités sont entièrement la proie des flammes : les immeubles s'effondrent dans un brouillard de fumée et de poussières que le vent emporte et dissémine à perte de vue, des flammèches retombent partout. Au loin, un dépôt de munitions est touché et les obus explosent les uns après les autres ; des flammes mauves entourent le clocher d'une église. Dans l'enceinte du kommando, toutes les baraques flambent comme des torches et il est jusqu'aux pieux des barbelés qui, éclaboussés de phosphore, se consument à leur base. Çà et là, des valises brûlent. Des ombres passent en fuyant et disparaissent dans la direction de l'abri des sentinelles, le seul qui puisse éprouver de la résistance, parce que protégé par la masse de terre d'un talus. D'autres prisonniers, à plat-ventre, attendent l'accalmie avant de traverser le kommando. Le bombardement continue avec la même intensité, le fracas est effrayant. Du côté de la défense, plusieurs batteries ne répondent plus. A peine, parvient- on à entendre encore le bruit des moteurs d'avions. Cependant, les formations de bombardiers sont très rapprochées les unes des autres et nous apprendrons, en effet, que ce raid a été effectué par 1.200 forteresses ; que le temps écoulé entre le début et la fin de l'alerte est de 35 minutes. Nous pouvions ainsi nous rendre compte que le passage des formations se faisait à un intervalle moyen de 21 secondes, ce qui, pratiquement, constituait un cortège ininterrompu, si l'on sait que la distance entre l'avion conducteur et le dernier en longueur est de 900 mètres. Les sirènes ! La fin d'alerte ! Nous sortons d'un cauchemar ! Jamais, au cours des nombreux bombardements que nous avons connus, aucun n'a eu l'ampleur de celui-ci. Un enfer ! Pour éviter la chaleur suffocante des incendies, les prisonniers se sont retirés dans un endroit écarté. On se cherche, car on n'ose espérer que, dans ce déluge de fer et de feu, il n'y ait pas de victimes. Nos craintes se vérifient : on amène une civière sur laquelle est étendu Henri T…, atteint par le phosphore dans le bas du corps ; ce brave petit bastognard décédera quelques heures plus tard. Un autre camarade encore sera trouvé le long des barbelés, le corps nu et carbonisé. Il faut procéder à l'appel pour savoir qu'il s'agit du français P. Mais cet appel nous assurera qu'il n'y a pas d'autres victimes Pour la troisième fois, le kommando est endeuillé ! La fatalité s'abat sur lui avec l'acharnement que met la Mort à poursuivre les membres d'une famille. En sortirons-nous jamais ! 
Tombe d'Henri Thirion Mais oui, car, malgré tout, ceux qui restent éprouvent, aujourd'hui, une immense satisfaction que deux corps déjà raidis empêchent d'extérioriser bruyamment. Le kommando de Stettin-Bredow n'est plus ! Il n'en reste que des cendres chaudes que le vent entraînera et éparpillera dans toutes les directions, faisant place nette de ce qui fut, à une certaine époque, le kommando disciplinaire de Stettin. Le Kontrollstell aura la tâche de chercher à nous caser ailleurs et, peut-être, aurons-nous la chance de « bien tomber ». En ville, le désastre est important. Dans le faubourg de ZuIchow qui compte plus de 20.000 habitants, 16 habitations restent debout ; à Bredow, 1800 personnes seulement, pourront trouver un logement dans des maisons à demi-sinistrées. Mais nous avons la satisfaction d'apprendre que, dans les autres kommandos importants, tels que : Gollnow, Vulcan, Nordenham, etc., quoique complètement sinistrés, Il n’y a pas de victimes à déplorer parmi les prisonniers. Seul, Bredow avait payé son tribut au dieu de la guerre. Et c'était bien assez ! XXXX CRISE DE LOGEMENT. Bredow n'est plus ! Dans la nuit illuminée par des milliers d'incendies, les prisonniers du kommando se sont étendus sur le sol, recherchant dans le calme recouvré un peu de repos. Ils ne dorment pas, ils chuchotent à mi-voix de las commentaires sur l'événement de cette nuit, en attendant que paraisse le jour. Nos baraques ont été rapidement consumées ; il ne reste plus que quelques braises incandescentes qui s'obstinent à rougeoyer. Seuls, les abris vomissent encore des flammes. Nos gosiers sont secs, on boirait n'importe quoi. On éprouve un grand regret en regardant l'emplacement de la baraque aux colis. Là se trouvaient nos petites provisions, elles ont disparu, comme tout le reste. Notre ruine, à nous, c'est la disparition de ces quelques boîtes de conserves contenues dans le dernier colis américain, ce sont ces galettes de chez nous que l'on consommait à un rythme de longue durée et c'est aussi ce paquet de lettres que nous conservions précieusement, depuis la première reçue en 1940, jusqu'à celle de la veille. Le phosphore a tout ravagé ! Le soleil se lève, mais sa chaleur perce difficilement le nuage gris qui s'étend au-dessus de nos têtes. La lumière du jour, quoique pâlie, vient changer l'aspect des choses et le spectacle ne présente plus cet attrait hypnotique de la nuit incendiée. Les prisonniers promènent leur fatigue sur le vaste emplacement du kommando ; certains recherchent dans les cendres déjà refroidies, l'un ou l'autre ustensile qui pourrait servir encore. Sous nos pas, de petites flammes bleues s'élèvent brusquement, provenant du phosphore enfoui dans le sable et que notre passage a mis à découvert et au contact de l'air. Mais quoi ! on siffle ! Rassemblement ! Appel ! On s'en va ! Adieu, Bredow ! pour toujours ! Dès la sortie du kommando, on nous fait prendre la direction de Frauendorf, par un chemin de campagne où ne se rencontre nulle habitation. Ce chemin est transformé en ruisseau, les canalisations de la distribution d'eau sont crevées et on rencontre des mares bouillonnantes, un peu partout. Nous passons devant la batterie de D. C. A. qui, depuis quatre ans, n'a pas quitté les lieux. Les servants, de jeunes gamins de 12 à 15 ans, s'affairent au nettoyage des affûts, qui sont couverts de boue. Deux gosses ont été tués au cours de l'alerte, nous dit-on. Plus loin, une famille de polonais a élu domicile dans un petit abri plongeant dans un champ moissonné. Deux femmes passent, la plus âgée pleure ; l'autre, une jeune fille, a le visage noirci et ses yeux hagards, dans lesquels se lisent encore l'angoisse et la terreur, semblent refléter un état de démence. Mais nous voilà arrivés à destination, on nous dirige vers un énorme bâtiment, la « Mutterheim » (Maternité) de Frauendorf. Les visages se renfrognent, on avait espéré mieux ! Certes, les locaux sont faits pour nous convenir, cela vaut mieux que des baraques, mais la région est peu sûre. Nous, sommes toujours dans le voisinage de l'Oder, de la voie de chemin de fer et des usines. Nous ne sommes d'ailleurs qu'à deux kilomètres au nord de Bredow, et Frauendorf n'a guère été épargné cette nuit. Tant pis ! On en prend son parti ! Déjà, sans avoir reçu d'ordre, la plupart ont pris possession des chambres et les godasses cloutées ont imprimé leur marque sur le parquet ciré. D' autres ont envahi les sous-sols et font une rafle dans les cuisines, ramenant casseroles, poêles à frire et tous ustensiles dont-ils sont démunis depuis quelques heures. Le butin est d'importance si l'on en juge par les sourires qui renaissent sur les lèvres des réquisitionneurs. D'un air las et désabusé, nos sentinelles se contentent de hausser les épaules et feignent ne rien voir pour ne pas avoir à rendre des comptes, le cas échéant. Elles connaissent les prisonniers et savent parfaitement que rien n'empêchera ceux-ci d'arriver à leurs fins. A midi, on sort des valises le morceau de pain d'épices ou quelques biscuits qui sera notre première collation car, jusqu'alors, personne n'a pensé à se sustenter. Il est vrai aussi que les vivres sont rares et que le casse-croûte distribué la veille, s'est volatilisé en fumée. Un ordre ! On part, de nouveau ! Allons-y ! Nous refaisons en sens inverse le chemin parcouru le matin et au bout duquel on retrouve l'emplacement du kommando de Bredow. On commence à la trouver amère, ce petit jeu est désespérant. Craignons-nous vraiment qu'une sorcière, d'un coup de sa baguette, vienne ressusciter nos baraques ? On ne peut donc pas se résoudre à l'abandonner, ce kommando du diable ! La soif se fait sentir de plus en plus, de même que la fatigue : On s'allonge sur le sol, le bonnet avancé sur le visage pour le protéger des rayons brûlant du soleil de midi. On cherche dans 1a rêverie et le sommeil, une diversion à nos pensées saugrenues. Vers 16 heures, un coup de sifflet nous remet sur pied. Nous reprenons nos bagages et nous voici cheminant dans la campagne longeant la ville. Les schleuhs évitent de nous faire traverser celle-ci, afin de ne pas nous faire connaître l'étendue du désastre. Le chemin que nous empruntons est bordé de petites villas qui se dressent à 50 mètres les unes des autres. Pas une d'elles n'est intacte et on peut les voir avec le toit enlevé, les portes et les châssis de fenêtres arrachés, des baies dans les murs, les plafonds pendant lamentablement. Ravages causés par les bombes soufflantes. Nous arrivons à la gare de Zabeldorf qui paraît abandonnée. Le bâtiment est incendié, des wagons sont éventrés, d’autres renversés, des locomotives sont couchées sur le flanc, des rails se dressent ou décrivent des courbes géométriques. Rien n'est épargné ! A partir de là, le trafic est suspendu vers la Battique. Un train est à notre disposition, qui va nous conduire inévitablement vers le Sud de la ville. En effet, après quelques arrêts, nous descendons à Pommerensdorf, faubourg situé au Sud-Est de Stettin. Et on marche ! La fatigue alourdit nos pas et la promenade à travers les rues est interminable. Un sentier entre deux haies nous conduit vers un bâtiment que beaucoup d'entre nous connaissent pour y avoir « habité » en 1940 et 1941 ; c'est l'ancien kommando de Kosakenberg (Mont des Cosaques). On nous introduit dans un vaste hall qui sert d'entrepôt aux voitures Micheline de la Reichbahn. Et là, quoi ! Il faut décider soi-même, car nos gardiens ont assez à s'occuper de leur installation et ils restent invisibles. On se dispose à passer la nuit sur le ciment des quais, sous l'immense verrière dont les vitres ont été aux trois-quarts brisées lors d'un bombardement antérieur qui eut pour effet la destruction totale du Sanität Park (Parc sanitaire) de Stettin, situé à quelques dizaines de mètres de l'entrepôt. Et la tête reposant sur la besace ou la valise, les prisonniers passent une nuit calme, prenant à peine souci d'une alerte qui vint les réveiller au milieu de la nuit. Le lendemain matin, courbaturés, nous piétinons sur place, attendant la décision qui doit être prise à notre égard. La faim nous tenaille à présent ; la veille, le casse-croûte ne nous a pas été distribué. Cela fait deux que l'on perd. Enfin, vers midi, l'ordre est donné d'évacuer les lieux et de se ranger pour un nouveau départ. On nous impose deux heures de marche pour nous rendre aux casernes de Krekow, faubourg Sud de la ville. Dans les casernes ! Comme de vulgaires schleuhs de la Wehrmacht ! Sous la coupe directe du hautain Hauptmann Schwarz, du hargneux feldwebel Bartholomé et de l'ineffable Unteroffizier Schneider qui présida aux destinées du kommando au cours des années 1940 et 1941. En outre, ne faut-il pas s'attendre à ce que les casernes, à leur tour, subissent le sort qui fut celui de Bredow il y a moins de 48 heures ? Plus on y réfléchit, plus nous trouvons que notre nouvelle situation n'a rien d'enviable et que nous tombons de Charybde en Scylla. Et peut-on espérer que nous allons trouver, dans ces casernes, un logement un peu plus confortable que dans les baraques ? Ah, ouiche ! C'est vers les écuries que l'on nous dirige. Avant de prendre possession des box, il faut sortir le fumier et le crottin qui s'y trouvent entassés. Puis, après un rapide coup de balai, on étendit un peu de paille sur le sol encore humide d'urine. C'est là tout l'aménagement qu'on nous réserve. Les bacs et les râteliers contiennent nos valises et le casse-croûte qui vient enfin de nous être servi. Pour en terminer, on procède à l'occultation des petites lucarnes, opaques de crasse, qui se trouvent à deux mètres au-dessus de nos têtes. Le soir, à 19 heures, appel général dans la cour, après lequel on nous fait réintégrer l'écurie et les portes se referment sur nous. 360 prisonniers belges et français s'apprêtent à pioncer sur la paille, sous laquelle l'inégalité des pavés forme un tapis dur et bosselé qui nous brise les côtes et les reins ; dans le répugnant voisinage des rats dont on entend la course précipitée à chaque mouvement que l'on fait ; dans l'odeur ammoniacale qui se dégage du pavement. 360 prisonniers qui ne connaissent de la liberté que les droits qu'ils se confèrent à l'insu et en dépit des autorités ennemies qui les administrent. Demain, à 4 heures, il fera nuit encore, le sifflet les réveillera. Los ! Arbeit ! XXXXI A MADËSEE. Notre séjour à la « Stall 6 » (Ecurie n° 6) des casernes de Krekow, s'est prolongé jusqu'au 14 novembre 1944. Pendant deux mois et demi, les prisonniers de l'ex-kommando de Bredow – qui continuera d'ailleurs à être connu sous cette appellation – ont vécu des jours misérables. Sans feu, sous la lumière falote de deux petites ampoules et... sans vivres personnels, il ne pouvait en être autrement. La libération du pays s'est faite au moment précis où nous avons tout perdu dans le bombardement. Les colis belges ne nous arrivent plus, et pour comble, le colis mensuel américain ne nous est plus distribué régulièrement à cause de la raréfaction des transports par le fait du manque de matériel roulant. En septembre, les camarades du Stalag et des kommandos voisins nous vinrent en aide, tant en linge, qu'en vivres. Ce beau geste de solidarité, quoique très appréciable, ne pouvait nous être d'une très grande efficacité matérielle ; nous étions trop nombreux à prétendre au partage et, bien souvent, il fallait procéder par tirage au sort pour décider de l'octroi d'une chemise ou d'une boîte de conserves. Nous couchions entièrement vêtus sur une mince couche de paille, enveloppés dans une seule couverture. Bien rares étaient les nuits où les sirènes oubliaient de fonctionner, les alertes ne cessaient pas. Nous restions avec la crainte des bombardements et tout particulièrement au cours de ce mois, plusieurs alertes sérieuses de jour, aussi bien que de nuit, vinrent semer la panique dans le faubourg. Les autorités du Kontrollstell nous avaient réservé un abri situé sur le champ de manœuvres, mais nous n’avions plus confiance en ce système de protection trop fragile. Nous ne pouvions oublier que, le 13 mai, 26 camarades avaient trouvé la mort dans les abris de Bredow et que, le 30 août, il s’en était fallu de peu que la moitié de notre effectif y périsse. Aussi, nous usions d'un stratagème pour nous garer plus sûrement du danger. Les casernes étaient entourées d'un treillis de 2 m. 50 de hauteur, nous avions cisaillé le fil tendeur qui raidissait le treillis à la base et il suffisait de le soulever pour prendre aisément la clé des champs. Dix minutes de course nous amenaient à la sortie de la ville et nous nous enfoncions dans les champs à bonne portée des endroits vulnérables. A notre retour, il nous suffisait de remettre tout en place dans les hautes herbes qui croissaient à l'endroit choisi. Nos gardiens, cependant, étaient au courant de nos escapades, mais jugeaient prudent de fermer les yeux et n'en rien voir ; cela leur évitait de dresser un rapport au Hauptmann et, probablement de se voir incriminés par celui-ci pour relâchement de surveillance. Cette vie incertaine, toute faite de misère, créait une animosité rebelle chez les prisonniers et les conflits s'élevaient nombreux entre eux et les sentinelles, ainsi qu'avec les ouvriers et contremaîtres allemands. Les demandes de visites médicales étaient jugées excessives et on notait des abandons de travail pour les motifs les plus futiles, Les Allemands menaçaient, sans résultat notable. On ne se privait pas de leur dire que cette situation durerait aussi longtemps que subsisterait le kommando d'écurie. Le Hauptmann intervint personnellement, rien n'y fit. A cette époque, la mobilisation des vieux pour la formation de la Volksturm était en cours et leur arrivée à la caserne suscita les quolibets et les moqueries des prisonniers au vu et au su des feldwebels et sous-officiers. De même, la rentrée de jeunes soldats combattants revenant de Bretagne, nippés d'uniformes en guenilles et qui, eux-mêmes, se montraient rétifs à l'exécution des ordres de leurs supérieurs, n'étaient pas un spectacle pour prisonniers. En effet ceux-ci s'amusaient ouvertement de ces incident et souhaitaient ardemment qu'ils prennent de plus amples proportions, comme en témoignaient leurs gestes approbateurs vers les mutins. Ce fut là autant de motifs qui décidèrent les schleuhs à nous transférer en un lieu plus calme et plus discret. La construction d'un nouveau camp fut décidée et, le 14 novembre, à 7 heures du soir, les 360 prisonniers de Bredow s'en venaient prendre possession des nouvelles baraques, à Moritzfeld, près de la gare de Madüsee. Madüsee est un petit village poméranien, situé à 27 kilomètres de Stettin et à 7 kilomètres de Stargard, sur la grand-route Stettin-Dantzig. Ce village n'a rien de particulier, sinon de se trouver à proximité du lac du même nom – Madüsee, mer de Madü – et qui est en quelque sorte une petite mer intérieure comme il s'en rencontre plusieurs, au Nord de l'Allemagne. Ce lac s'étend sur une vingtaine de kilomètres de longueur et cinq de largeur. C'est là que, en 1942, les allemands procédaient aux essais de lancement des V 1. La vie dans ce kommando fut sans histoire. Entendez par là qu'on y roupillait la nuit, sans crainte d'être dérangés et cela seul comblait nos vœux. Le matin, à 5 h. 30, les prisonniers gagnaient Stettin par le train et s'en revenaient le soir. A moins que le convoi prévu ne fasse défaut à l'horaire et se présente avec plusieurs heures de retard, obligeant les prisonniers à piétiner la neige pendant deux ou trois heures, après quoi ils étaient ramenés au kommando. Il faut dire que la situation était telle, en décembre 1944 et plus encore en janvier 1945, que les trains affectés au service des voyageurs étaient peu nombreux. L'horaire n'était plus respecté et pour cause, les foyers des locomotives étaient alimentés par du combustible ne possédant pas les qualités calorifiques requises et il ne fallait pas s'étonner de voir les trains stationner durant des heures dans la campagne, mettant ce temps à propos pour une nouvelle condensation de vapeur. Lettre écrite, par François, d'Allemagne, le 7 janvier 1945 Mes
tout chéris, je reviens de la messe où, en suivant l'office avec ferveur, j'ai
été demander à Dieu le baume consolateur qui fera
disparaître le chagrin de mon cœur. Car je suis triste ! Plus ardemment que
jamais, je demande à notre Père des Cieux la fin de nos misères ; qu'il fasse
descendre sur ses pauvres créatures, une Paix si durement achetée et la
compréhension pour toutes les âmes, de nos devoirs envers Lui. Je suis triste,
je suis angoissé ! Pourquoi ? Ce cafard du début de notre captivité, qui nous
embuait le cerveau jusqu'à l'obscurcir tout à fait, va-t-il nous reprendre dans
ses tenailles ? Chacun
de nous le sent venir et n'y échappera pas facilement, malgré de vives
réactions physiques et morales. La saine joie disparaît de nos visages et le
rire qui nous échappe parfois sur une boutade est un rire forcé, qui ne dure
pas. Le jour de Noël, il y eut une petite soirée récréative : peu d'entrain,
pas d'enthousiasme. Qu'a-t-il donc fallu dans notre vie de prisonnier pour
changer les choses à un point pareil ? Un simple fait, mais qui, à nos yeux,
revêt la plus grande importance au point de vue moral : l'absence totale de vos
nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe, nous demandons à
recevoir une petite carte qui parlera de notre famille, de notre ville, de
notre pays. Sans nouvelles, nous vivons une vie désertique contre laquelle le raisonnement le meilleur et le plus logique ne nous est d'aucun secours. La patience ne nous manque pas, mais notre courage est mis à une rude épreuve. Recevoir une lettre de vous, mes tout chéris, ce serait un bonheur immense qui me tomberait du ciel, et j'y aspire de toutes mes forces, de toute mon âme. Et je l'attends si impatiemment ! Millions de baisers de votre (+ signature). D'autre part, l'avance accélérée des troupes soviétiques vers la Poméranie nécessitait la réquisition des convois pour le transport des populations évacuées de la zone de front, à l'exclusion de tout autre, sinon militaire. Les voitures n'étaient pas chauffées et ces trains mettaient 3 à 4 jours pour un parcours de 4 ou 5 cents kilomètres, tenant compte des nombreux arrêts imposés par la médiocrité du combustible et par le passage en priorité, des convois de troupes et de matériel se dirigeant vers l'Est. Il ne faut donc pas s'étonner si les prisonniers, travaillant en gare de Stettin, eurent maintes fois la désagréable corvée de retirer de ces voitures, des cadavres d'enfants et de vieillards, morts de froid. Il est à noter que si l'hiver 1944-45 fut relativement court, il fut particulièrement rigoureux en décembre et en janvier. D'autres fois, revenant du travail, le soir, le train s'arrêtait à Altdamm pour n'en plus repartir. Les prisonniers s'enfilaient alors 10 kms pour rejoindre le camp. Souvent, la nuit, un bombardement de la ville de Stettin parvenaient jusqu'à nous. Malgré l'éloignement, les baraques tremblaient. Nous assistions, de loin, à la descente féérique des lumignons rouges dans le ciel, puis à l'éclatement fulgurant des bombes à leur arrivée au sol. De là aussi, vers 22 heures, chaque soir, on pouvait assister au départ des V1 et des V2 de la rampe de lancement de Penemünde. C'était atroce de penser que ces engins sournoisement meurtriers étaient destinés à apporter le deuil et la destruction dans notre pays, choses que la radio et le communiqué allemands confirmaient chaque jour. L'avance von
Rundstedt dans les Ardennes nous plongea
dans un de ces cafards dont nous avions
perdu le souvenir. Certes, nous nous rendions bien compte que le sursaut de la bête
nazie n'était pas. durable –
mille indices nous rassuraient – mais que
de ravages et de victimes n'allait-il pas entraîner ? Nous passons le cap du nouvel an dans les baraques de Madüsee, dans une atmosphère de monotonie, de tristesse et de résignation. Bien sûr, de grands espoirs sont permis, mais une certaine inquiétude les domine. Dans quelles conditions, les Russes nous accueilleront-ils, lorsqu'ils nous auront rejoints ? Et quelle sera l'attitude des boches vis-à-vis de nous, au moment où ils seront acculés ? Ces questions sont discutées et les avis sont diversement évasifs. Les prisonniers venant de l'Est nous racontent des histoires peu rassurantes sur le comportement des Russes envers eux. Pour parer à toute confusion la Croix-Rouge Internationale de Genève a exigé l'apposition d'un indicatif triangulaire de couleur vive sur les genoux de nos pantalons et au dos de nos vestes et de nos manteaux. La Poméranie est envahie par les troupes soviétiques. Celles-ci, délaissant la côte de la Baltique, s'avancent à une centaine de kilomètres au Sud de la mer et se livrent à des manœuvres d'encerclement dont les courbes se dirigent, elles aussi, vers le Sud. Il ne fait pas de doute que le but est d'atteindre l'Oder et de descendre son cours jusqu'à la Baltique, de façon à isoler une vaste région pauvre de Poméranie, d'où l'ennemi ne pourra faire mieux que se rendre pour éviter son extermination qui serait la conséquence fatale d'une résistance inutile. Schneidemühl est atteint, à 120 kms à vol d'oiseau de Madüsee et de violents combats se livrent dans la ville, les Russes rencontrent une résistance opiniâtre de la part des troupes allemandes. Ils subissent là un temps d'arrêt, pendant que, à 20 kilomètres plus au Nord, une nouvelle pointe avancée essaye de rejoindre Deutsch Krone. Lorsque ces flèches se remettront en mouvement, il ne fait aucun doute qu'elles atteindront bien vite la région de Stargard, ce qui nécessitera notre transfert en un autre lieu. Aussi, nous attendons-nous à revivre bientôt des heures agitées. XXXXII EVACUATION. La deuxième quinzaine de janvier voit une recrudescence de mouvements sur terre et sur rails. La région regorge de colonnes de réfugiés en déplacement vers l'Oder. Sur la route Stettin-Dantzig, on peut assister à un défilé ininterrompu de chariots et de carrioles de tout genre, dans lesquels s'entassent malles, valises, matelas, couvertures, objets ménagers, etc. C'est plein à craquer ! Et de ce bric-à-brac, on peut voir sortir des bustes d'hommes, de femmes et d'enfants, vêtus de lourds vêtements et la tête enveloppée d'épaisses écharpes ou entourée d'une couverture d'où le nez émerge à peine. Tout cela croise un important charroi militaire qui se dirige vers l'Est. Sur les côtés de la route, des tanks légers et des chenillettes sont garés, attendant l'ordre d'intervenir en renfort ou en remplacement sur des points menacés de la zone de combat. Tous les cent mètres, des sentinelles vêtues d'uniformes gonflés et chaussées de volumineuses bottes en paille tressée, l'arme à la bretelle, vont et viennent d'un pas lourd et nonchalant. Les allemands connaissent la guerre chez eux et ils paient durement. La voie ferrée vers Dantzig supporte un trafic intense dû aux évacuations économiques et transports stratégiques des provinces orientales. Mais ce trafic éprouve toutefois de sérieuses difficultés dans l'acheminement à destination, comme il a été dit précédemment. 
Charrettes fabriquées par les P.G. après la fin de Bredow Les jours succèdent aux jours ; nous arrivons fin janvier. Les troupes soviétiques ont percé et
avancent rapidement en notre direction. Le front se situe à présent par
une ligne passant entre Arnswalde (Oflag IID)
et Stargard (Stalag IID) et se dirigeant vers Bahn, en direction de Schwedt. De violents combats se livrent aux environs de Pyritz, de même que
sur l'Ihlna, petite rivière comparable à la Sambre et que les Russes doivent franchir
pour s'attaquer à la ville de Stargard. Il n'est pas encore question de notre évacuation ou, du moins, rien ne transpire de ce qu'on peut avoir décider à notre sujet. Deux prisonniers belges, rencontrés parmi les réfugiés, nous racontent avoir été rejoints par les tanks russes au-delà de Schneidemühl, mais les soldats soviétiques, après les avoir fouillés et s'être emparé de leur montre et de leur argent, les ont renvoyés vers les allemands. Le 2 février, à 0 heure 30, munis de lampe tempêtes les sentinelles font irruption dans les baraques, nous ordonnent de nous lever et de nous préparer à évacuer le kommando. Les Russes se rapprochent dangereusement. Combien de fois avons-nous connu cette fièvre du réveil brusqué, dans la torpeur du premier sommeil ? Nous en avons l'habitude. Mais, aujourd'hui c'est sans idée de retour, nos couchettes resteront abandonnées. Et chacun se met en devoir d'arrimer ses bagages dans les valises et les sacs, dédaignant ce qui pouvait être une charge inutile et encombrante. A 5 heures, alors qu'il fait toujours nuit, la colonne de prisonniers quitte le kommando de Madüsee. Sincèrement, on regrette le trop court séjour dans cette campagne poméranienne où chacun avait trouvé enfin un peu de repos et de quiétude. Quel sera, à présent, notre destin ! Le temps est froid et pluvieux ! On nous fait traverser des terrains labourés pour rejoindre la grand-route, en raccourci. Nous pataugeons dans l'eau et dans la boue qui pénètrent dans nos chaussures et humectent nos pantalons jusqu'à mi-jambes. Nous gagnons la chaussée de Dantzig. Tout est calme apparemment ; seules, les sentinelles font les cent pas. Préposées à la garde du matériel se trouvant sur les accotements, elles sont nombreuses. Nous stationnons longtemps sur le chemin, avant de repartir. On attend des ordres. Mais voici le P'tit Roi qui vient lever la halte. Après quelques centaines de mètres, nous quittons la chaussée pour emprunter une route pavée ; celle-ci est glissante, car la pluie, qui continue à tomber, a lavé la neige et a fait apparaître une couche de glace qui s'étend sur toute la largeur du chemin. Chargés de notre barda, nous marchons avec difficulté, les glissades sont nombreuses et les efforts que l'on fait pour éviter les chutes nous fatiguent énormément. Le moral est bon, les plaisanteries sont de bon augure, malgré le ton fatigué. Nous allons en direction de Pyritz. Dès que le jour paraît, on entend tonner le canon sans discontinuer ; les combattants sont aux prises dans cette ville qui tombera le jour même entre les mains des Russes. Nous allons depuis deux heures. La canonnade se rapproche. Mais nous trouvons sur notre droite, un chemin qui nous en éloigne. La marche est rendue moins pénible sur cette route caillouteuse de campagne, car on y a le pied ferme. Vers 9 heures, nous atteignons Neumark, gros bourg très populeux et qui présente au moment où nous le traversons, une effervescence peu ordinaire, causée par l'apparition, deux heures auparavant, de deux tanks russes à l'entrée du village. Après avoir stationné quelques instants, ils ont fait demi-tour et sont disparus dans la direction de Pyritz. Sur le seuil des maisons, les commères affolées font des commentaires apeurés. Des conseils nous sont donnés : « Pressez-vous, car ils peuvent revenir à tout moment ». Des réflexions aussi : « Que pensez-vous de l'organisation allemande, l'ennemi est à nos portes et nous attendons toujours l'ordre d'évacuer » ! A un carrefour, un camion automobile est chargé de civils décidés à prendre le large ; malheureusement pour eux, un Hauptmann de S. A. se rassure par voie de réquisition, ce qui ne se fait pas sans résistance de la part des civils, dont les femmes sont les plus âpres à défendre leur cause. Mais tout s'apaise subitement, lorsque l'officier, sortant son revolver, menace et s'écrie : « Le premier qui dit encore un mot, je l'abats comme un chien ». Et les civils de descendre docilement du camion et de débarquer leurs bagages. Après 28 kilomètres de marche, nous arrivons à 14 heures 30, dans un petit village dont le nom ne m'est pas resté en mémoire, C'est là que nous trouverons le gîte pour la nuit, dans les granges des fermes. Des officiers français s’y trouvent déjà, mais il est difficile d'approcher du bâtiment qui les abrite, car celui-ci est entouré de sentinelles. On se contente, de part et d'autre, de se faire de petits signes d'intelligence, invitant à la patience et au courage. A 2 heures de la nuit ; nous sommes réveillés par un tir de mitrailleuses. Plusieurs tanks russes se sont présentés à un carrefour situé à 300 mètres de l'entrée du village et s'en sont retournés après avoir envoyé quelques rafales vers les habitations. Le matin du 3 février, nous reprenons la route en direction de Greifenhagen. Le soleil se met de la partie, il fait bon, une véritable journée printanière. La pluie, tombée la veille, a nettoyé la route et on ne rencontre que, de loin en loin, un peu de neige. Sur les accotements, de nombreux traîneaux sont abandonnés ; nul doute que des prisonniers sont passés par ici et ont employé ce moyen plus commode de transport, durant le temps où ils étaient servis par la neige. Vers midi, des formations aériennes russes nous survolent et mitraillent des points environnants. Nous marchons à la file indienne sous le couvert des arbres qui bordent la route. Des avions déversent leur cargaison d'explosifs dans la région de l'Oder dont nous ne sommes plus très éloignés. A 13 heures, nous arrivons au village de Klebaut où un arrêt de 60 minutes nous permet de nous reposer et de nous restaurer d'un morceau de pain gris. Le village est envahi par les SS qui s'affairent à la construction de barrages anti-char et de chicanes. On rencontre peu de civils ; peut-être ont-ils déjà été évacués au-delà de l'Oder. A 15 heures, nous atteignons l'extrémité Nord du village de Retzowsfeld où nous pouvons voir une équipe importante de civils, hommes, femmes et enfants, armés de pelles et de pioches, construisant des tranchées de défense le long de la ligne de chemin de fer et du viaduc. Quelques minutes encore et apparaît la partie de l'Autobahn (autostrade) Berlin-Dantzig qui rejoint la rive gauche de l'Oder. Entre Greifenhagen et Stettin, les eaux de l'Oder s'étendent sur une largeur de 3 à 5 kilomètres, séparant une plaine agricole ondulée à l'Ouest, d'une région plus accidentée et boisée à l'Est. Le fleuve se partage en plusieurs bras larges et sinueux, contournant de hauts fonds ou de grandes îles marécageuses couvertes de taillis et de bosquets. Je connaissais particulièrement cette partie de la contrée, car là se trouvait mon premier kommando, en 1940. L'autostrade enjambe l'Oder sur une distance de 4 kilomètres ; sa largeur permet le passage de 4 véhicules de front – deux dans chaque sens – il existe deux pistes cyclables et deux trottoirs très larges pour piétons. Nos baluchons pèsent de plus en plus et la fatigue se fait durement sentir. Nous voudrions nous asseoir sur le macadam du pont, mais cela nous est refusé ; l'endroit est mal choisi, en effet, et il importe de gagner l'autre rive au plus vite, afin d'éviter le danger toujours possible de mitraillades par avion, car ceux-ci survolent toujours la région. Un groupe d'une centaine d'officiers polonais nous rejoint et nous devance. Ils sont escortés par de nombreux gardiens et des chiens dressés. Un chariot les précède qui transporte leurs bagages et quelques malades. Au passage, ils nous adressent quelques mots d'encouragement, en français : « Courage, amis ! Le dénouement est proche ! » Les 4 kilomètres sont couverts en une heure et quart, nous ne pouvons faire mieux. On nous accorde un quart d'heure de repos après 1equel il faudra encore tirer une traite de 8 à 10 kilomètres pour arriver à un petit village qui regorge déjà de légionnaires hongrois. Il fait nuit noire et on trouve difficilement à nous caser dans les fermes, en raison de la mauvaise volonté manifeste du bourgmestre de l'endroit, qui ne consent à nous héberger dans les granges qu'après avoir été menacé par nos gardiens. Le lendemain, 4 février, nous repartons vers Stettin, qui n'est plus très éloigné ; dix kilomètres à peine nous en séparent. Un peu avant midi, nous arrivons à Kosakenberg dont il a déjà été question, il y a peu, dans ce récit. Par détours, nous avions parcouru 65 kilomètres pour atteindre Stettin, alors que, par la voie directe, la distance est de 27 kilomètres. A Kosakenberg, nous prenons possession du bâtiment de la Reichbahn, non plus dans le hall des voitures Micheline, mais dans un corps de logis y attenant. Quelles aventures nouvelles nous attendent en ce lieu ? XXXXIII EN
SECTEUR D'ARTILLERIE. Le kommando de Bredow vient donc de s'installer dans un bâtiment de la Reichbahn, à quelques mètres de la voie double de chemin de fer qui, deux kilomètres plus loin, se subdivise en trois lignes allant dans les directions de Berlin, Hambourg et Dantzig. A cette dernière, les allemands ont donné le nom de ligne stratégique, vu l'importance du trafic qui se développe, depuis 1941, vers le front de l'Est. Entre le bâtiment où nous sommes logés et le talus situé de l'autre côté des voies, un train blindé se trouve camouflé, comportant des wagons plats avec réflecteurs, écouteurs et canons de défense aérienne et des wagons fermés et voitures comprenant les bureaux, cuisines et dortoirs de tout un personnel militaire de la D. C. A. Dès notre arrivée, on peut entendre des propos désobligeants à l'égard de ces indésirables, dont la présence va nous compliquer la vie à Kosakenberg. Aussi, envisage-t-on de suite les possibilités de se garer loin d'eux lorsqu'il y aura menace de bombardement car, certainement, ils seront visés par les avions de protection qui encadrent habituellement les bombardiers. Il faut, à notre entrée dans ces nouveaux locaux, procéder au nettoyage ; ceux-ci sont couverts de plâtras et de débris de verre, traces d'un bombardement dans le voisinage. La cuisine est remise en ordre et les douches doivent subir de sérieuses réparations, quoiqu'avec des moyens de fortune, afin de leur permettre de fonctionner encore. Dans les petites salles du rez-de-chaussée, du premier étage et sous les combles, chacun choisit sa place sur le ciment et s'installe sur la « dure ». Ce bâtiment, qui abrita tant de prisonniers depuis 1940, est toujours entouré de barbelés, mais l'espace extérieur est très restreint et le va-et-vient de 360 hommes est très malaisé. Les chambres exigües sont surpeuplées, les prisonniers y vivent entassés. Les valises et les sacs sont gênants et il faut les pendre le long des murs. Sur les tablettes des fenêtres, sont déposés les bols et les gobelets ; à la distribution de soupe, les prisonniers réprouvent le souci de ne pas reconnaître leur bien. Et vogue la galère… on a l'habitude de la misère. D'aucuns, cependant, se prennent à regretter les écuries des casernes. Après quelques jours, les événements restant stationnaires dans la réaction acharnée des allemands pour enrayer l'avance soviétique vers l'Oder, il sera permis à quelques-uns d'entre nous de se rendre a Madüsee avec un tracteur et sa remorque et de ramener quelques dizaines de lits et des provisions qui y avaient été abandonnées lors de notre évacuation. Mais, après trois voyages, on jugea prudent de ne pas insister, ces déplacements présentait un danger trop grand. En effet, la région était infestée par les Yak et les obus russes parsemaient la grand' route, dans le but évident de freiner le trafic militaire. Naturellement, dès le lendemain de notre arrivée à Kosakenberg, les équipes de prisonniers ont été remises au travail le long de la Eisenbahn, depuis Pommerensdorf jusqu'à Pülitz et ce, en dépit des alertes aériennes continuelles. Le dimanche, on emmenait les prisonniers dans les champs avoisinant l'Oder où, malgré leurs vives protestations, il fallait œuvrer au creusement des tranchées de défense. La nuit, les alertes sont nombreuses et avant que les sirènes donnent l'alarme, nous étions réveillés par le commandement bref des officiers du train de D.C.A. : « Feuerbereitschaft ». Le kommando nous est ouvert et nous nous répandons dans la campagne où nous allons chercher refuge sous les voûtes d'un aqueduc passant sous les voies de chemin de fer, à quelques centaines de mètres de là. La nourriture est infecte et le repas chaud consiste presque exclusivement en soupe aux rutabagas gelés. Aussi, connaissons-nous un ennui de plus : les coliques et la diarrhée. Ces conditions déficientes d'existence devaient fatalement engendrer d'autres misères, parmi lesquelles celle que nous redoutions intensément… la vermine. Et nous fûmes désagréablement obligés de refaire connaissance avec les poux. Cela dura peu, car les prisonniers mirent tout en œuvre pour s'en débarrasser rapidement par des lessivages répétés du linge de corps. Il n'en fut pas de même de nos sentinelles qui en étaient infestées et ne prirent pas les mêmes mesures pour enrayer le fléau. On le conçoit, la vie de ces derniers mois de captivité était comparable à celle que nous avions connue pendant les années 1940-41, sans avoir toutefois le même caractère déprimant car, aujourd'hui, le moral reste intact et n'est plus affecté par ces soubresauts cafardeux des deux premières années. Et quoique avertis du danger qui nous guettait, nous gardions confiance en nous-mêmes et en la Providence. Mais où en sont les événements ? Au cours du mois de février, d'âpres combats se livrent dans une vaste région au Sud de Stargard. A certain moment, nous apprenons que la légion de, Degrelle est encerclée par les troupes russes, mais qu'elle est parvenue à se dégager après trois jours d'efforts, pour se replier au-delà de l'Oder et s'installer à Scheune, à proximité de notre kommando. Les Russes sont devant Stargard, mais une flèche contournant la ville, le 1er mars, arrive à Moritzfeld, là où était installé notre kommando, à la pointe Nord du lac de Madüsee. Altdamm est harcelé, jour et nuit, par l'aviation et l'artillerie russes. Dès le 2 mars, le repli vers l'Oder des formations sanitaires allemandes qui étaient établies aux environs de cette ville, est ordonné. L'artillerie allemande s'installe nombreuse sur la rive Gauche de l'Oder et certaines déductions découlant de nos propres observations, permettent d'évaluer à un millier le nombre de canons affectés à la défense du port et de la ville de Stettin. Notre kommando se trouve placé entre les batteries d'artillerie et l'Oder, à 2 kilomètres du fleuve. Le 4 mars, vers midi, les troupes soviétiques réussissent à pénétrer dans la ville de Stargard et après 4 heures de sanglants combats de rues, la cité est définitivement abandonnée par les Allemands. La ville est en feu. En d'autres points, notamment à Streeren, Wittichow et Schneiderfeld, les Allemands fléchissent, ce qui provoque un repli général en direction de l'Oder. Les troupes allemandes qui combattent le long de la mer Baltique, à Greifenberg et à Kolberg, se trouvent isolées et doivent procéder à une évacuation par mer pour ne pas tomber aux mains des russes. Et ceux-ci, descendant brusquement en pointe vers Stettin, mettront en péril l'ennemi se trouvant dans la région de Altdamm, qui se voit soudainement menacée d'encerclement. Pratiquement, on peut dire que la première phase de la bataille de Poméranie est terminée. A part les troupes sacrifiées qui tiennent encore quelques positrons à Altdamm et les environs, les Allemands se retirent sur la rive gauche de l'Oder. Cela ne se fait pas sans pertes sanglantes, notamment au passage du fleuve, sur l'autostrade, que les avions russes viennent mitrailler sans répit. Par suite de la pénurie de carburant, la majeure partie du matériel motorisé est resté sur l'autre rive, entre Altdamm et Stettin ou embourbé dans les campagnes. La valeur combattive des Allemands ne représente plus grand chose et leur moral est durement atteint. Les désertions sont nombreuses dans leurs rangs. 
Charrettes fabriquées par les P.G. après la fin de Bredow La Pointe russe la plus avancée se trouve sur 1'Oder, à hauteur de Kosakenberg et de Scheune et suit l'Oder, en direction Nord, jusqu'à hauteur de ZulIchow. Nous sommes donc placés en position dangereuse et les Hommes de Confiance du Kontrollstell et des kommandos ne cessent de protester véhémentement auprès des autorités militaires allemandes pour obtenir notre déplacement vers l'arrière, dans une zone de sécurité, comme le prévoit la Convention de Genève. II en est de même pour ce qui concerne le travail des prisonniers aux tranchées. Mais, rien n’y fait ! Le général SS, qui commande la ville de Stettin, oppose un refus catégorique à toutes ces réclamations, tant que les tranchées de défense ne seront pas complètement terminées. Cela peut durer longtemps, car les prisonniers n'en font pas lourd et laissent cette tâche aux civils avec lesquels ils sont mélangés. Bien rares sont ceux qui ont rempli plus d'une brouette sur leur journée. Le travail n'avance guère, sinon sous la seule impulsion des civils. Un kommando de prisonniers belges et français est amené chaque jour sur les bords de l'Oder, où les Russes leur tirent dessus par delà le fleuve. Ils doivent accomplir trois heures de marche pour arriver à pied d'œuvre et autant pour rejoindre leur kommando, le soir. Leur volonté manifeste de se croiser les bras exaspère les S. A. qui les menacent à tout moment. Jusqu'au jour où le Hauptmann S. A., après avoir usé de la persuasion à coups de revolver tirés en l'air, et devant l'inanité de ses menaces, s'écria : « Emmenez ces gens ! Je ne veux plus les voir ! Et qu'on m'amène des prisonniers russes ». Jamais, on ne revit ce kommando. Les nôtres, au travail sur la voie ferrée, connaissent aussi de dangereux moments, notamment les prisonniers qui sont employés à l'importante gare de formation et de triage de Güterbanhof. Ils sont assaillis sans discontinuer par les obus russes. En effet, les troupes soviétiques se sont installées sur les hauteurs boisées du bourg de Finkenwald où ils disposent d'excellents observatoires plongeants, qu'ils mettent à profit pour harceler et entraver le trafic ferroviaire vers Berlin. Certains jours, les obus tirés de tanks russes, passent au large de Kosakenberg, à la cadence de 6 par minute et ce, pendant toute la durée du jour. Et il me souvient de ce camarade français qui fut renversé par la déflagration d'un obus éclatant à cinq mètres de lui et se releva indemne, tandis que six ouvriers allemands, travaillant à proximité, restaient étendus sur le ballast. Une autre fois, vers la mi-mars, dès 6 heures du matin, une véritable pluie d'obus s'abat sur le secteur de Scheune et de Kosakenberg. Une équipe de notre kommando est déjà au travail sur la voie, à Scheune et les prisonniers doivent se précipiter dans les bois environnants pour échapper à ce déluge de fer. Les premiers obus sont tombés dans le cantonnement des SS de Degrelle et y font maintes victimes. Vers 10 heures du matin, nous assistons à un véritable feu roulant, la plupart d'entre nous se réfugient dans les caves. Cent obus éclatent à la minute ; un obus traverse la verrière du hall des Micheline et explose dans les voies ; un autre éclate au pied du bâtiment, deux autres encore sur le talus du chemin de fer, un cinquième déracine un tilleul à 50 mètres du kommando. Partout, on n'entend que sifflements et explosions. Cela dura jusqu'à 16 heures, sans que l'artillerie allemande, nettement visée, ait répondu d'un seul coup de ses canons. Atmosphère lourde de dangers, mais moral excellent chez les prisonniers ; contrairement à nos sentinelles qui, elles, n'ont pas nos raisons d'espérer et se laissent aller à des confidences pessimistes et désespérées sur l'issue proche du conflit. XXXXIV ADIEU,
STETTIN ! Tout a une fin ! On ne peut nous tenir indéfiniment dans cette région où, il faut en convenir, nous deviendrons encombrants le jour où les Russes envahiront le port, la ville et l'embouchure de l'Oder. Cette éventualité est inévitable. Les Russes possèdent des effectifs et un matériel très importants, contre lesquels les Allemands doivent baisser pavillon. Ceux-ci d'ailleurs, éprouvent des pertes énormes tout le long du front de l'Oder et, en surplus, doivent distraire une partie de leur armement pour le transporter au front de l'Ouest. Nous nous apercevons très bien de cette déficience matérielle, notamment par les manœuvres continuelles de déplacement du train blindé qui a fini par nous fausser compagnie. On le voit passer chaque jour, soit se rendant à Schwedt, puis revenant se placer au Nord de Stettin et repartant pour Küstrin, suivant le hasard des points menacés. Le 18 mars, Altdamm est en feu. Les rescapés allemands ne peuvent faire mieux que se replier sur l'Oder et attendre l'ennemi à Podejuch et Finkenwalde. Le 19 mars, ces deux dernières localités sont écrasées par des bombardements terribles et les derniers défenseurs seront rares qui pourront gagner la rive gauche de l'Oder. Le 20 mars, vers 3 heures de la nuit, nous sommes réveillés par une violente explosion dont nous ne pouvons situer l'endroit précis, mais que nous devinons assez proche. Au cours de la journée, nous apprenons que le fameux pont-autostrade a sauté. La frontière Est de l'Allemagne est ainsi ramenée définitivement sur l'Oder. Mais les Russes, à cette date, ont déjà traversé le fleuve au Sud de Küstrin, dans la région de Brandebourg. La bataille pour Berlin est en cours et elle décidera du front de Stettin, comme de la guerre elle-même. On dit aussi que les troupes soviétiques ont traversé l'Oder, à Schwedt, situé à 50 kilomètres au Sud de Stettin et qu'elles suivent le cours du fleuve en direction de cette ville. Nous n'avons toutefois aucune précision au sujet de ce dernier renseignement. Quoi qu'il en soit, la ville de Stettin qui, paraît-il, serait défendue par une garnison militaire et navale forte de 30.000 hommes, doit s'attendre à subir le choc dans un temps plus ou moins proche. Déjà, les combats d'artillerie sont devenus plus violents et plus fréquents et l'aviation russe est très active. Le soir du 22 mars, en rentrant du travail, les prisonniers du kommando de Bredow (ou Kosakenberg, comme on veut), sont avisés d'avoir à boucler les valises et à se préparer au départ qui doit avoir lieu le lendemain, à 6 heures du matin. Alors, on peut voir les prisonniers se mettre à l'œuvre avec, une ardeur insoupçonnée, si on la compare à l'attitude paresseuse qu'ils ont adoptée dans le travail des tranchées et sur la Eisenbahn. C'est la grande joie, car on va retrouver, du moins, on l'espère, un peu de cette tranquillité disparue depuis Madüsee. Le jour final de la libération se présente déjà à leurs yeux, quoique suivi d'un énorme point d’interrogation. Dans les caves de Kosakenberg, on se livre à un étrange travail : on cloue, on scie, on s’interpelle bruyamment dans une demi-obscurité. Tous ces bruits affairés n'inquiètent pas nos gardiens qui, eux aussi, font leurs préparatifs de départ. Cependant, en cette belle journée du 23 mars !945, grande sera, la ,surprise des schleuhs lorsque, à 6 heures du matin, ils verront les 360 prisonniers belges et français, sortir du bâtiment de Kosakenberg, leurs bagages arrimés avec art sur une centaine de petites charrettes à 4 roues et, très à l'aise, se ranger pour le départ, tandis que les sentinelles sont embarrassées de leurs fusils, besaces et valises. Mais d'où provient tout ce matériel roulant et comment fut-il possible de le rentrer et de le camoufler au kommando où la place était déjà si restreinte ? Les difficultés rencontrées, ainsi que la fatigue éprouvée au cours de notre évacuation de Madüsee nous avaient rendus prudents et nous ne tenions pas à renouveler. cette expérience qui, pour peu qu'elle durât pouvait être désastreuse. Aussi, le mot d'ordre avait circulé parmi nous de se saisir a toute occasion propice, de ces petits véhicules que l’on rencontre partout, en Poméranie, et dont les habitants se servent de préférence à la brouette, étant donné la nature du sol sablonneux. C’est ainsi que, chaque jour, de petites charrettes étaient habillement, enlevées à leurs propriétaires, entièrement démontées et rentraient au kommando en pièces détachées, cachées sous le manteau des camarades. Une fois dans la place, ces morceaux étaient camouflés sous les lits, sous la paille des couchettes et dans les caves. Le secret fut bien gardé et les schleuhs n'eurent jamais connaissance de ces rentrées clandestines au kommando. Le premier moment de stupeur passé, l'unterfeldwebel prit le parti de rire, les gardiens firent chorus – évidemment – et l'ordre de départ fut donné. L'allure fut assez vive au début ; nous tenions à sortir au plus vite de la zone dangereuse, mais les Russes, au cours de cette matinée, se montrèrent d'un calme étonnant. Rien ne vint troubler notre promenade à travers champs, parcs et rues. Dans le faubourg de Krekow, où nous passons à proximité des casernes, l'animation est grande et la gent militaire est nombreuse. Nous grimpons une côte assez raide, flanquée, aux deux côtés, des dernières maisons de la ville, pour atteindre finalement un plateau sablonneux sur lequel se dresse un hangar à moitié rempli de paille. C'est là qu'on veut nous installer. A l'Hôtel du Courant d'air ! Les planches vermoulues laissent apercevoir des trous béants par lesquels le vent s'engouffre en sifflant. A l'intérieur, l'espace est si restreint que, avec la meilleure volonté, il serait impossible d'y caser 360 hommes. C'est ce que comprend aussi le chef de kornmando qui s'empresse de dépêcher un sous-ordre auprès du Kontrollstell pour faire part de la situation au Herr Hauptmann. Deux heures plus tard, l'estafette revient, apportant des précisions : les prisonniers français occuperont le hangar et les belges poursuivront leur chemin. Les sentinelles sont également réparties en deux groupes et on peut entendre celles préposées à la garde des prisonniers français, proférer des propos désobligeants à l'égard de l'inhumain Hauptmann qui les force, eux aussi, à loger dans cet antre inhospitalier. Toujours tirant nos charrettes, nous allons à travers champs et bois, vers le lieu qui doit nous accueillir et que nous atteignons après deux heures de marche. Nous sommes au petit hameau de Marienthal, à dix kilomètres de Stettin. Ce hameau se compose d'une ferme-domaine et de sept habitations. Les habitants ont été évacués, il y a quelques jours et les portes des maisons nous sont largement ouvertes. Toutefois, nous n'avons pas accès à la ferme, car celle-ci est occupée par les troupes SS. Cependant, on doit bien nous y laisser pénétrer pour les corvées d'eau, ce qui provoque de nombreux marchandages entre prisonniers et SS. Bon nombre de prisonniers reviennent avec du lait et du pain. Cela dura peu. Après trois jours, l'officier d'intendance trouva un déficit considérable dans ses pains, rassembla ses hommes pour les tancer vertement et s'en prit également aux prisonniers présents dans la cour ; ceux-ci, innocemment, firent semblant de ne rien comprendre au verbiage colérique de l'Oberleutnant. Le soir de notre arrivée, le groupe français vint nous rejoindre. Les sentinelles avaient eu gain de cause et, après la visite personnelle du Hauptmann, il fut jugé définitivement de l'incommodité de l'appartement, où les sentinelles devaient vivre dans la promiscuité des prisonniers. Il faudra se serrer un peu, mais nous préférons cela, plutôt que de savoir nos camarades français en de si mauvaises conditions de cantonnement. Notre premier soin, en prenant possession des maisons, est de faire un inventaire fouillé de tout ce qui peut être comestible. Mais on trouve peu de chose ; seules, les pommes de terre sont en quantité assez appréciable et vont nous permettre de parfaire à la sous-alimentation qui nous attend ici. Les cuistots se sont installés dans une buanderie et de la cuve servant à bouillir le linge sale, sortira notre soupe aux rutabagas, de même que les pommes de terre à la pelure. Car nous ne connaissons plus que ces mets depuis un bon moment : rutas, patates ; patates, rutas ! Dès le lendemain, 24 mars, les prisonniers sont remis au travail. On ne chôme pas, chez eux ! Le stoppage des voies de chemin de fer est pour toujours abandonné, pour entreprendre le travail de circonstance dont nous avons déjà parlé : le creusement de tranchées. Les prisonniers doivent se rendre sur les lieux du travail, mais ils en reviennent, nullement fatigués. Ils ont pris la résolution que leur travail journalier n'irait pas au-delà d'une brouette de terre et ils tiennent parole. Nos gardiens ne sont plus animés par le feu sacré du nazisme et se contentent d'exercer une surveillance toute platonique. Il y en a même qui approuvent les prisonniers et les engagent à ne rien faire. Seul, le P'tit Roi est devenu plus hargneux et entre souvent en conflit avec les prisonniers ; mais ceux-ci restent indifférents et regardent, en souriant, ce bout d'homme qui veut s'imposer à un moment vraiment inopportun. Notre passage à Marienthal fut bref, une huitaine de jours seulement, après lesquels une vie nomade allait nous être imposée. XXXXV EXODE
VERS L'OUEST. Dans ce petit hameau de Marienthal, le temps s'écoule sans que l'on sache déterminer le jour de la semaine et la date du jour que l'on vit ; il faut se livrer à une savante rétrospective du temps passé depuis notre départ de Stettin pour arriver à un résultat plus ou moins certain. Le 1er avril, dimanche de Pâques ? Qui le sait ? Ce jour ressemble à tous les autres et le Vendredi-Saint, dont les Allemands observaient si scrupuleusement la trêve du travail, ne nous a pas mis en éveil. Tous les jours, on travaille aux tranchées. Le p'tit Roi a formé deux équipes, la première travaille de 5 heures à 13 heures et la seconde de 13 à 21 heures. Comme il a été dit, ce travail ne fatigue personne car, pratiquement, il n'existe pas ; les Allemands eux-mêmes savent reconnaître que les Russes ont rencontré des obstacles autrement sérieux au cours de leur avance gigantesque depuis Stalingrad et que les batailles de tranchées sont jeux de gosses, aujourd'hui. D'ailleurs, qui occupera ces fossés ? La Volksturm ? Elle n'exista effectivement que pour donner le change et des espoirs vains à la population apeurée ! La Wehrmacht ? Ce qui en reste est disséminé partout à la garde des prisonniers. Les troupes SS ? Ceux du début, les purs, n'existent plus et ceux d'aujourd'hui ne sont que des fantoches sans conviction ! Alors, ces tranchées ! A quel jour sommes-nous arrivés ? Mercredi 4 avril ! On rassemble les prisonniers devant les quelques maisons de Marienthal, on fait l'appel, puis on sépare les Belges des Français. Il y a du nouveau ! – Prisonniers belges ! Préparez vos charrettes ! Vous partez au village voisin. Les prisonniers français resteront à Marienthal jusqu'à nouvel ordre. Une heure après, le départ était donné et, à la queue leu-leu, nous accomplissons les 3 kilomètres qui nous séparent du village de Wölchendorf, où on nous remet entre les mains de l'Unteroffizier qui est à la tête du kommando de la Zementfabrik de Zullchow. Nous retrouvons là, dans la cour de la ferme, non seulement les camarades de Zullchow, mais aussi ceux de différents petits kommandos des environs de Stettin. Nous rencontrons des camarades perdus depuis un, deux ou trois ans, on s'inquiète de l'un ou l'autre ami commun, des dernières nouvelles du pays reçues il y a quelques mois déjà ; chacun fait part de ses espoirs et de ses craintes, mais affiche un optimisme et un moral des plus réconfortants. Et que fait-on, dans ce patelin ? Eh ! mon Dieu, comme partout, on va aux tranchées. Comme nourriture ? Un bout de pain et un plat de soupe. Heureusement, nous avons encore nos réserves de patates et avons vite fait de détruire un mur de clôture de la ferme pour employer les briques à la construction de multiples petits foyers qui encombrent bientôt la cour. Chacun choisit son logement dans le fenil et dans les étables. Une nouvelle vie commence qui ressemble comme un frère jumeau à celle que nous avons abandonnée à Marienthal. Mais elle sera très brève ! Le dimanche, 8 avril, à 8 heures du matin, nous sommes alignés pour rappel et nos charrettes nous attendent. Un nouveau départ est prévu. Après avoir perdu une heure à rechercher 12 prisonniers qui ont jugé opportun de nous fausser compagnie et qui s'obstinent à rester introuvables, l'ordre du départ est donné. A la sortie du village, nous apercevons au loin, une colonne de prisonniers français qui prennent une direction quelque peu divergente de la nôtre. Ce sont nos amis de Marienthal qui, eux aussi, vident les lieux. Il fait un temps splendide ! Le soleil est de la partie ! Allègrement, nous tirons nos charrettes qui nous sont d'un très précieux appoint. Cette marche vers l'Ouest nous donne du cœur au ventre, on s'interpelle bruyamment, les rires fusent de partout. Il y a du bon ! Seuls, nos gardiens ne partagent pas notre enthousiasme, leur préoccupation est d'un tout autre genre. A midi un arrêt d'une demi-heure pour nous permettre de casser la croûte. Echelonnés sur une longueur de 4 à 500 mètres, les jambes dans le fossé, les prisonniers pique-niquent joyeusement et s'offrent une cigarette avant de reprendre la route. Vers 17 heures, nous arrivons en vue d'une usine pointant sa haute cheminée vers le ciel. Mais non, en approchant, nous constatons qu'il s'agit des dépendances d'un de ces vastes domaines agricole comme il en existe beaucoup dans le pays. Celui-ci comprend 3.000 hectares de terrains et forêts, après avoir subi un morcellement important quelques années auparavant, alors qu'il comptait une superficie de 18.000 Ha. Le soir tombe vite et il nous est impossible de préparer notre extra habituel. Un médecin italien et quelques infirmiers de même nationalité qui, je ne sais par quel jeu de circonstances, se sont joints à nous, sont installés sous le toit d'une échoppe et reçoivent la clientèle, lui prodiguant leurs conseils, à défaut de médicaments. Le lendemain, au point du jour, la vie reprend ses droits et, après avoir déjeuné d'une croûte et d'un quart de jus, nous repartons dans un frais brouillard, toujours tirant nos charrettes. En général, celles-ci se comportent bien et, à part quelques ennuis mécaniques, vite réparés, ces petits véhicules nous donnent entière satisfaction. Il est curieux de constater que, au cours de notre longue randonnée d',hier (environ 30 kms) et de même celle d’aujourd’hui, nous ne rencontrons rien, ni personne. Nous ne croisons quelques visages curieux que dans les rares petits villages que nous traversons. On se croirait en plein bled ! Même les champs sont déserts ! Toutefois, dans un village occupé par des troupes SS règne un peu d'animation. Sur les murs des bâtiments de fermes, fraîchement peintes à la chaux, nous lisons ces inscriptions : « Seul Hitler nous donnera du pain » ou encore « Hitler est notre sauveur, faisons-lui confiance ». Ça tient encore ces trucs là ? Nous nous permettons d'en douter de même que nos sentinelles que nous interrogeons du regard et y répondent par un léger haussement d'épaule. Le trajet est moins long aujourd'hui car, à 13 heures, nous arrivons dans un petit village où nous établissons la halte. Chacun s'empresse de décharger les charrettes et de transporter les bagages à l'intérieur des granges où l'on doit passer la nuit. Aussitôt après, les feux de camp. Partout, mijote la popote. Une brave paysanne voit, avec détresse, diminuer la tour de bois coupé qui se dressait devant sa porte et fait appel à une sentinelle qui consent à monter la garde devant le tas. Mais, pendant que le gardien fait la causette avec quelques prisonniers qui s'attachent à le distraire, d'autres font d'amples provisions de bois, cachés par la tour. A un autre endroit, les prisonniers détruisent les portes et les volets d'une porcherie, tandis qu'un autre s'acharne à la hache sur une échelle qui traînait le long d'un mur. A défaut de soupe aux rutas, le prisonnier aura sa purée de patates. Après quoi, il montrera un soudain intérêt au bétail et pénétrera dans les étables (oh, bien innocemment) pour en ressortir quelques instants après avec une gamelle de bon lait fumant, pendant que des camarades montent une garde vigilante sur le seuil, en affectant un tout autre souci ; celui-ci nettoie ses godasses et ces deux autres sont lancés dans une conversation très animée. Mais l'animation tombe. Repus, la plupart des prisonniers sont rentrés dans les granges et se sont affalés sur la botte de paille qui leur sert de couchette, pour y prélever un acompte sur le repos de la nuit. Quelques camarades se baladent encore et font le tour du propriétaire. Ce sont ceux dont les réserves s'épuisent et qui cherchent à regarnir leur besace au détriment de leur hôte. Inconscients du moment critique dans lequel se débat le Grand Reich, trois musiciens de talent se sont installés à l'ombre d'un porche à arcades et ces camarades accordéoniste, trompette et clarinettiste improvisent un petit concert qui débute par « Vers l'Avenir » et se poursuit par « Tout va très bien, Madame la Marquise ». 20 heures ! La nuit est venue. Seuls, quelques rôdeurs sont encore en mouvement. Les prisonniers sont vautrés dans la paille. 21 heures ! De multiples coups de sifflets et de nombreux appels nous convient à sortir. Alle mannen'raus ! Que se passe-t-il ? Rien que de très naturel ! On part ! Dans l'obscurité la plus profonde, il faut retrouver ses charrettes, sortir et arranger au mieux ses bagages. Partout, comme des feux follets, on ne voit que petites flammes de briquets et d'allumettes, et aussi quelques faisceaux lumineux de torches électriques. Comme les temps sont changés ! C'est très calmement que, les yeux bouffis de sommeil, chacun fait ses préparatifs. On se dispose à déguerpir presque joyeusement. Cette randonnée vers l'Ouest est d'un effet vraiment miraculeux. Optimistes et confiants, les prisonniers ne ressentent pas la fatigue dans leur hâte de se rapprocher du pays. Ce n'est que vers 23 heures que la caravane s'enfoncera dans la nuit. On ne se distingue pas à deux mètres et les prisonniers tiennent la liaison entre eux par des bavardages sans fin. Lorsque la tête de colonne s'arrête, un « Stop » retentissant en avertit le groupe suivant et est repris successivement par toutes les bouches jusqu'à la dernière charrette, ce qui n'empêche nullement les heurts et les bousculades de se produire, de la part de rêveurs dont la conviction sur l'ordre donné se fait tardivement, ce qui provoque les rires et les lazzis de la part des victimes. Après plusieurs heures, de marche, la nuit totale a fait place à la lueur naissante de 1’aube. Nous arrivons à l'entrée d’une localité importante, à en juger par les constructions massives qui se dessinent dans l'ombre. Un poteau nous renseigne : PASEWALK. Le monde est petit, pensons-nous ! Il y a un peu moins de 5 ans, le convoi qui nous emmenait au Stalag a fait arrêt dans cette petite ville de 12.000 habitants, bâtie sur les bords de l’Ucker et nous y ramenait dans les 48 heures, lors de notre envoi en kommando. On se souvient aussi que, dans cette ville, fut hospitalisé le Gefreite Adolf Hitler, en 1918 et 1919, pour y soigner ses blessures. Que devient-il, celui-là, aujourd'hui ? Nous traversons la ville endormie. Le bruit roulant de nos charrettes sur le pavé ameute les chiens qui viennent se dresser, en aboyant, contre les grillages des immeubles. Deux Polonais, se rendant au travail, nous lancent : « Bald fertig » en guise de bonjour. Il est 4 heures lorsque nous arrivons à la gare de Pasewalk. Les gardiens nous entraînent vers l'entrepôt de marchandises, Le jour paraît ! On s'accroupit le long des murs dans l’espoir de somnoler et réparer quelque peu les effets de la fatigue : mais le froid matinal nous force, après quelques minutes, à nous redresser et à faire les cent pas pour nous réchauffer. Enfin, le soleil se montre. Sur les quais, il y a un peu d'animation, des prisonniers arrivent au boulot, parmi lesquels nous retrouvons de vieilles connaissances. Des civils sollicitent l'autorisation de porter nos charrettes pour s'en servir lorsque 1’ordre d'évacuation leur sera donné. Nous refusons, car nous ignorons encore les raisons de notre arrivée dans cette gare et, peut-être, aurons-nous à reprendre la route. Mais nous croyons tomber des nues ! Là-bas, sur le quai, nous venons de reconnaître la longue silhouette de cette vieille fripouille de Bartholomé. Le Stabfeldwebel s'amène vers nous et d'un ton qu’il s’efforce de rendre familier, nous dit : « Un confoi est en brébaration et fa fous conduire à testination. Fous pourrez fous installer à 40 hommes par wagon. Toutefois, che fous engage à ne pas apandonner fos charrettes, car elles fous seront encore utiles ». Tant de sollicitude nous touche. Vraiment, l'alsacien veille sur nous avec une tendresse quasi maternelle. A quoi attribuer ce soudain revirement ? Serait-ce dû à l'absence de son long sabre ? car aujourd’hui, pour la première fois depuis 5 ans, nous voyons Bartholomé sans sa rapière. Il est 10 heures lorsqu'on nous invite à prendre place dans les wagons à bestiaux. Auparavant, nous transportons nos charrettes sur un long wagon plat qui est en queue du convoi. Et puis… je ne me souviens plus de rien. Assis sur ma valise, adossé contre la paroi du wagon je me laisse aller tout entier au doux sommeil qui s’empare de moi sans avertissement. Tout comme les autres, d'ailleurs. * * * Un choc brusque nous réveille. Le train vient de se placer sur une voie de garage dans une gare qui nous paraît être assez importante. A quelques mètres de nous, en contre-bas, une chaussée avec ses arbres, ses maisons. Brusquement, de différents côtés, on entend les sirènes. A un prisonnier français qui chemine paisiblement sur la chaussée, nous crions : « Presse-toi, pour l'alerte ! » – Pas la peine, répond-il, c'est la huitième alerte aujourd'hui et, jamais Neubrandenbourg n'a été bombardé. Quoi ? Neubrandenbourg ? Le hasard fait bien les choses ! Il y a un lustre, nous étions peu fiers d'y avoir séjourné ; aujourd'hui, c'est avec des regards de vainqueur que nous dominons la ville du haut de notre talus. Mais, trêve de tout cela, il y a branle-bas dans les wagons. Nous sortons nos bagages, nous amenons nos charrettes et la caravane se forme pour traverser la ville dans laquelle toute vie est suspendue de par la volonté de nos alliés qui se trouvent quelque part dans le ciel allemand. A la sortie de la ville, nous empruntons un chemin qui, après 10 kilomètres, nous amène à une ferme isolée. C'est là que nous passerons la nuit, après avoir grignoté un biscuit qui est, pour ainsi dire, notre seule nourriture de la journée. Le lendemain, 11 avril, notre Homme de Confiance se rend au Stalag IIA de Neubrandenbourg et, après avoir mis son collègue du camp au courant de notre situation, en revient avec un certain nombre de colis américains qui nous sont distribués à raison d'un colis pour 4 prisonniers. Cela va nous permettre de varier notre menu et satisfaire une fois aux exigences de notre estomac. On reprend la route, tournant le dos à l'Est dont on ne sait plus rien. Aucune nouvelle concernant les événements ne nous parvient. Après deux heures et demie de marche, nous abordons au quelconque petit village de Bassow, bâti à flanc de colline. Le bas du village comprend les habitations des paysans, tandis que le haut est occupé par de nombreuses familles polonaises qui vivent misérablement dans de petites constructions en boue séchée. A mi-côte, une ferme-château, avec ses vastes et nombreuses dépendances. C'est là que nous nous arrêtons pendant que Feldwebel et Unteroffizier vont parlementer avec la comtesse X..., propriétaire du domaine, des conditions de notre hébergement. Pendant ce palabre, l'intendant, s'adressant à nous, demande quelques volontaires pour décharger à la fourche environ 2000 kilos de pommes de terre qui se trouvent sur un long chariot et que des valets polonais viennent d'amener à l'entrée d'une petite construction en briques. Des volontaires ? Il y en a trop qui se présentent, l'intendant doit en refuser, une dizaine suffiront à la tâche. Et il s'éloigne, pendant que nos camarades se mettent à la besogne. Et quelle besogne ! Pauvre intendant qui avait compté sur la probité du prisonnier. Certes, le travail fut promptement exécuté, en moins d'un quart d'heure, le chariot était délesté, mais il n'y en avait guère plus dans le petit hangar. Le stock s'était volatilisé dans les sacs et les besaces des prisonniers, vraiment ravis que cette aubaine se présentât d'une façon aussi simple. Les conséquences furent celles que l'on attendait : colère de l'intendant, rires des prisonniers, gestes d'impuissance des sentinelles. Après deux heures d'attente, on nous fait entrer dans une vaste grange, abondamment fournie de paille, où nous prenons nos quartiers. Notre exode vers l'Ouest subit un temps d'arrêt. Les jours passent sans qu'il soit question d'un nouveau départ. Nous avons retrouvé à Bassow, dans cette ferme, une centaine de prisonniers français venant de Stettin et parmi lesquels de nombreux camarades, anciens du kommando de Bredow. Ce séjour prolongé, permet le rétablissement des campements. Chaque soir, le long d'un talus. On retrouve les feux et les ustensiles ménagers usuels ; on cuisine ferme. Certes, les Allemands nous approvisionnent chaque jour et, à midi, nous connaissons le plat unique, en l'occurrence, la soupe aux rutabagas déshydratés. Nous recevons également une ration de pain qui, certains jours, fera défaut. Ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi les prisonniers se confectionnent un plat, le soir, qui la plupart du temps, se compose de purée de patates, d'une bouillie de farine de seigle (la pape) ou bien de crêpes. Les silos de pommes de terre sont assez nombreux et les provisions ne risquent pas d'être entamées. Quant au seigle, il est à notre disposition à discrétion, dans la grange où nous avons pris logement. Nous puisons largement dans les énormes sacs ventrus qui sont là entreposés. Il est aussi curieux de constater le nombre impressionnant de moulins à café dont disposent les prisonniers et qui fonctionnent du matin au soir, pour moudre le seigle, ce qui ne manque pas d'être fatigant ; aussi, nous nous relayons de quart d'heure en quart d'heure. La présence de ce seigle avait créé un besoin nouveau et, après 48 heures de notre arrivée à Bassow, les moulins étaient en nombre suffisant pour satisfaire à toutes les exigences. Est-à-dire que c'était là notre seule occupation ? Mais non, chaque jour, les prisonniers vont au travail, des tranchées, naturellement. Les Allemands avaient la fièvre des tranchées, que nous dénommions la « tranchéite ». Les prisonniers sont répartis en deux équipes qui, à tour de rôle, s'en vont au travail, le matin et l'après-midi. Le Feldwebel qui a pris le commandement de ce kommando nomade n'est pas très commode et fait passer volontiers sa mauvaise humeur en accablant d'injures les prisonniers, au cours des deux appels quotidiens. On s'en méfie, car ses gestes sont ceux de la brute. Un jour, cependant, il devra en venir à plus de modération et refouler sa bile. Voici à quelle occasion, on dut ce changement subit : Une nuit, les aviateurs russes lancèrent des tracts au-dessus de la région. Rédigés en langue allemande, ils disaient, en substance, que tout prisonnier qui aurait été l'objet de sévices de la part de soldats, sous-officiers ou officiers allemands, devait dénoncer ceux-ci dès que l'avance soviétique le lui permettrait et que les auteurs de ces brutalités seraient châtiés sévèrement. Plusieurs de ces tracts tombèrent entre nos mains ; on s'empressa d'en remettre un exemplaire à notre interprète avec mission de le transmettre au Feldwebel. Celui-ci ne manqua pas d'interroger : – Les prisonniers ont-ils eu connaissance du contenu de ce tract ? – Parfaitement, dit l'interprète, ce papier est passé dans toutes les mains. Dès ce moment, la transformation fut complète chez notre kommandoführer. Nous passons à Bassow 2 semaines absolument calmes. On entend bien, chaque nuit, le vrombissement lourd des forteresses, mais aucun incident ne vient éveiller en nous le moindre sentiment d'inquiétude. Des événements, pas de nouvelles ! Il y a bien, parmi nous, un camarade liégeois qui a monté un poste de radio à galène, mais, quelle déveine, il a perdu la galène dans la paille, dans les premiers jours de notre arrivée au domaine et toutes les recherches s'avérèrent inutiles. Le 27 avril, à l'appel du soir, les schleuhs nous préviennent que le réveil du lendemain aura lieu à 2 heures de nuit, en vue d'un départ très matinal. XXXXVI REJOINTS
PAR LES RUSSES. Ce samedi, 28 avril, vers 4 heures du matin, la caravane quitte le village de Bassow. Malgré l'heure matinale, les habitants sont sur le seuil des maisons et nous regardent partir avec un sentiment mêlé d'envie et d'angoisse. Le fait de notre départ, qu'ils ont appris la veille, implique que le danger se rapproche et ils voudraient s’en éloigner eux aussi ; mais ils restent partagés entre le désir de nous suivre et le devoir d'attendre l'ordre d'évacuation qui n'arrive pas. 
Charrettes fabriquées par les P.G. après la fin de Bredow D'impérieux motifs leur donnaient raison car, depuis quelques jours, les événements avaient pris une tournure nouvelle, savoir : Le 20 avril, à 7 heures du matin, les Russes, montés sur des embarcations légères, prenaient pied sur la rive gauche de l'Oder, à proximité de l'autostrade et réussissaient à établir une tête de pont à Schillendorf. Cette partie de la rive gauche était défendue par des troupes non aguerries ; ce point leur avait été confié en raison de l'escarpement de la rive où un essai de traversée du fleuve n'était guère prévisible. Trop confiant aussi, pour les mêmes motifs, le commandant de cette unité qui était formée principalement d'éléments policiers de la ville de Stettin, ne jugea pas utile d'établir des postes de surveillance et de défense adéquats à une position dangereuse. Ce manque de soucis lui coûta la vie, il fut fusillé sans autre forme de procès. Dès le 23 avril, la garnison intacte de la place forte de Stettin abandonnait, sans combat, la ville et l'embouchure de l'Oder et se repliait vers Pasewalk et Rostock. Et le 27 avril, soit la veille du jour qui nous occupe, Prenzlau, où se trouvait l'Oflag IIA, tombait entre les mains des Russes, vers 3 heures du matin. Les troupes soviétiques se trouvaient donc en marche vers Neubrandenbourg dont nous n'étions éloignés que de 20 kms. Bien entendu, ces renseignements ne nous furent connus que plus tard et sont cités ici à titre explicatif des motifs qui incitaient les Allemands à nous, évacuer de nouveau vers l'Ouest. Nos gardiens empruntent des chemins secondaires, afin d'éviter l'embouteillage des voies de grande communication. C'est ainsi que nous sommes amenés à prendre un chemin dans la forêt où nous parcourons une quinzaine de kilomètres avant d'en ressortir. Nos charrettes s'enfoncent profondément dans le sable, ce qui rend notre marche malaisée. Enfin, nous gagnons une voie principale qui traverse la ville de Treptow. A la sortie de la ville à un croisement de routes, nous devons forcément cheminer aux côtés d'un convoi très important d'évacués dont la colonne s'allonge interminablement. La file ainsi doublée prend toute la largeur du chemin. Dans ce convoi de civils, on trouve plus d'un genre de carrioles, depuis le tilbury jusqu'au long chariot de ferme, en passant par la charrette anglaise et le char léger du cultivateur. La plupart des véhicules sont surmontés d'un toit léger de planches hâtivement construit et recouvert de bâches. A l'intérieur, s'entassent pêle-mêle des couvertures, coussins et édredons desquels émergent des frimousses de gosses amusés, tandis que de pauvres vieilles, blasées et résignées, maudissent le sort qui leur est fait dans les derniers temps de leur existence. Autour de ces véhicules, les ustensiles les plus divers pendent à des crochets et brinqueballent à chaque tour de roue dans une résonnance de ferblanterie. On peut y voir des casseroles, des poêles à frire, de lourdes marmites, des moulins à café, des lampes d'écurie, etc. Dans ce bric-à-brac, il y a un choix nombreux pour le prisonnier et celui-ci ne se fait pas faute d'y prélever l'ustensile qui lui manque ou qu'il trouve à sa convenance. Honni soit qui mal y pense ! C'est la guerre, pour nous, comme pour eux ! Et il faut bien se rappeler que nous vivons de rapines. Ils ne connaissent l'épreuve que depuis quelques jours ; la nôtre dure depuis cinq ans. Ils sont encore chez eux et nous sommes en pays ennemi. Ils pourront recevoir de l’aide, le soir, à l'étape, tandis que nous devrons chercher les moyens de subvenir à nos besoins. Inévitablement, l'embouteillage se produit. Arrivant en sens inverse, un charroi militaire et des troupes allemandes s'engagent sur la route dont nous occupons la partie gauche : en dépit des règlements sur la circulation. Lorsque la rencontre se produit, chacun doit s'arrêter, au grand dam des officiers et des feldwebels qui conduisent la troupe et dont on peut mesurer l'état d'exaspération par les jurons qui parviennent à notre adresse. Le dégagement ne s'opère qu'avec cette nonchalance propre à la race bovine et adoptée par la gent P. G. depuis un lustre, ce qui prend un temps assez long et nous n'y parvenons qu'en nous infiltrant dans les rangs des évacués, dont la docilité est remarquable. Les bornes se succèdent et nous arrivons vers 16 heures au petit village de Scharpzow, à l'entrée duquel des SS, aidés de civils, sont occupés à la construction de barrages anti-chars. La localité est occupée par les troupes SS, les habitations regorgent de soldats et la population assiste, apeurée, aux préparatifs d'un combat prochain. Deux granges sont mises à notre disposition. La nuit est tombée, mais elle est troublée par le bruit incessant des moteurs de nombreux avions qui sillonnent le ciel dans toutes les directions. Les nues obscures se teintent de rouge ; à l'Est, la ville de Neubrandenbourg est en feu, tandis que, plus au Nord, la ville de Friedland est également la proie des flammes. Ce spectacle lointain nous maintient en état de veille et très peu de prisonniers pensent au repos ; ils ne gagnent leur botte de paille que tard dans la nuit. Le lendemain, 29 avril, dès 6 heures du matin, on se prépare pour l'étape du jour. C'est dimanche, mais nul ne le soupçonne. On ne sait comment on vit et le calendrier ne fait pas partie de nos bagages. Quelques heures de marche et nous entrons dans le village de Wolde. Il est 13 heures ! Une immense ferme-domaine nous accueille. Sur tous les instruments et machines agricoles, se lit le nom du propriétaire : Graf von Schwerin. Dès notre arrivée, chacun, se met en devoir de retenir son emplacement pour la nuit et, aussitôt après, installe quelques briques, au centre de la cour, qui serviront de foyer pour la cuisson de quelques Kartoffeln. Nous sommes arrivés d'un quart d'heure que, cherchant du bois derrière les bâtiments, je découvre les tripailles fumantes d'un porc, sur le fumier. Il a fallu peu de temps à quelques camarades pour occire un cochon et s'approprier ainsi un aliment de haute qualité. Munis de récipients les plus variés, d'autres pénètrent dans les étables, avec l'espoir d'y trouver une boisson de choix, mais les quelque 200 vaches qui peuplent ces lieux restent sourdes à toute sollicitation, et pour cause : elles meuglent à fendre l'âme du P. G. le plus endurci, les râteliers sont vides et les pauvres ont bouffé jusqu'à leur fumier ; les vaches ne présentent plus que des pis flasques, dont les doigts les plus experts ne peuvent extraire la moindre goutte de lait. Même les bêtes subissent la grande épreuve, victimes inconscientes du désarroi qui règne dans le pays. Au cours de l'après-midi et jusqu'à la tombée du jour, nous assistons à un va-et-vient continuel de petits avions russes qui, prenant leur virage au-dessus de nos têtes, mitraillent et bombardent en piqué une route située à 2000 mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Toutes les dix minutes, on est certain de voir apparaître ces formations qui, leur coup fait, disparaissent à l'Est. A 17 heures, des soldats SS garnissent les habitations de drapeaux blancs, indiquant par là que le village ne sera pas défendu et qu'on désire éviter sa destruction. De nombreux combattants fuient par la route et à travers champs ; beaucoup sont sans armes et sans casques. Deux d'entre-eux m'interpellent et me disent que les Russes sont à deux kilomètres du village, qu'ils peuvent occuper celui-ci d'un moment à l'autre. Les prisonniers, ajoutent-ils, feraient bien de prendre le large au plus tôt. Je leur répondis que nous n'avions pas les mêmes raisons de nous presser. Ils s'éloignent sans insister. A 19 heures, l'ordre nous est donné de préparer les charrettes, le départ est fixé à 21 heures, c'est-à-dire dès la disparition du jour. C'est, en effet, à cette heure que la, caravane se met en route, empruntant le chemin qu’avaient, pris les SS. Nous marchons lentement, car l’obscurité est complète et nous nous guidons sur la lueur des cigarettes qui font une trouée dans la nuit. Peu avant minuit, l'interdiction nous est faite de fumer encore car, à 1500 mètres ,environ sur notre gauche, un autre chemin qui doit rejoindre le notre quelques kilomètres plus loin, est occupé par les avant-gardes soviétiques. Au loin, devant nous, un incendie nous fascine : une meule de paille, vraisemblablement. Mais il nous faudra marcher deux heures encore, avant de connaître la réalité, A ce moment les deux routes se rejoignent, formant un angle aigu à l’entrée de la petite ville de Stavenhagen. A 50 mètres de cette pointe, un Tigerpanzer est posté en défense , des SS sont allongés sur les trottoirs ou dorment debout dans l'encoignure des portes. Le bruit de nos charrettes ne les réveille même pas, nous traversons la Grand-Place ; à notre droite, débouche une rue commerçante dont tout un côté est la proie des flammes ; d'un immeuble portant enseigne de cinéma, sortent des gerbes d'étincelles. C’est la tout le secret de la meule brûlant sans arrêt. Nous poursuivons notre randonnée dans 1a nuit. La fatigue se fait sentir, mais aucun prisonnier ne se plaint. Enfin, à 5 heures, nous arrivons au village de Grapzow et pénétrons dans l’enceinte d’une ferme domaine aux proportions « kolossales ». Après avoir déchargé nos charrettes, nous gagnons les granges et les fenils et nous nous allongeons, enfin, sur la paille. * * * Raus ! Le mot est répété par nos sentinelles à l'entrée des bâtiments occupés par les prisonniers. Nos montres marquent 9 heures et, déjà, il faut repartir. Les Russes raccourcissent la distance qui nous séparait d'eux après l'étape de cette nuit. Que faire, ? sinon se résoudre à accepter l'ordre, réembarquer nos bagages et attendre le moment du départ. Mais un événement inattendu, quoique possible, vint modifier nos intentions. Un bruit de moteurs nous fait lever la tête et nous apercevons une formation de Yak arrivant en droite ligne dans notre direction. Nous ne nous inquiétons pas car, la veille, à Wolde, nous avons assisté à ces apparitions incessantes des avions russes, sans que le moindre incident marque leur passage au-dessus de nos têtes. Mais quoi ! Au-dessus de la ferme, ils décrivent de vastes cercles et baissent d'altitude. Celle-ci est relativement peu élevée, 800 mètres environ. Nous comprenons le danger auquel nous sommes exposés et nous nous précipitons pour trouver refuge dans les granges. Trop tard ! Les mitrailleuses crépitent et tonnent les canons de bord. A trois reprises, les rafales balaient l'immense cour, puis les avions s'éloignent, reprenant la direction d'où ils étaient venus. Il y a des victimes. Six camarades ont été touchés par les éclats, dont notre ami, François M…, mortellement atteint à la tête. Soigné par un médecin italien, il survivra quelques jours encore, avant de nous quitter pour toujours. Afin d'éviter que pareil fait se renouvelle, nous nous empressons d'arborer les drapeaux blancs tous les bâtiments de la ferme. Bien nous en prit car à peine un quart d'heure après cette agression, une nouvelle formation de Yak nous survolait à nouveau et, après avoir entrepris leur infernal carrousel, s'éloignait en direction Est. Nous ne devions plus les revoir. Ce grave et regrettable incident eut une inf1uence telle que la plupart des prisonniers prirent la décision de fausser compagnie à leurs gardiens. Et on put voir les rangs s'éclaircir rapidement, des prisonniers gagnaient la forêt proche, d autres se cachaient dans les bâtiments de la ferme et quelques uns encore se faufilaient derrière les pierres tombales du petit cimetière local. Nous ignorions que, même nos schleuhs étaient divisés sur la question d'un départ ou de l'attente des troupes russes ; beaucoup jugeaient inutile de poursuivre un voyage qui s'avérait dangereux et dont l'aboutissement ne pouvait être retarde que de quelques heures, quelques jours au plus. Parmi ceux qui plaidaient en faveur de cette théorie, se trouvaient le P'tit Roi et les sentinelles de Bredow qui, comme par hasard, étaient arrivés la veille avec les prisonniers français dont ils avalent la garde. Ainsi, après quatre semaines de séparation, les prisonniers belges et français du kommando de Bredow, se trouvaient à nouveau réunis. A 3 heures de l'après-midi. une vingtaine de sentinelles remettaient leurs armes entre les mains de ceux dont ils avaient la garde depuis 5 années et se constituaient prisonniers, à leur tour. Les rôles se renversaient. Cette même journée du lundi, 30 avril, devait être fertile en événements de toutes sortes. Dans la forêt, à quelques centaines de mètres du village, une double voie de chemin de fer traçait son chemin. Une halte y était construite, ainsi qu'un long quai de déchargement. Au cours de la matinée, un train de marchandises avait été attaqué par les avions russes et une bombe bien placée avait fait sauter la locomotive des rails, immobilisant ainsi tout le convoi. Les wagons regorgeaient de marchandises les plus variées : farine, haricots secs, pois, liqueurs, viande en conserve, tabac, cigarettes, allumettes, pipes, etc. etc. Comment les prisonniers eurent-ils connaissance de la bonne aubaine qui les attendait en ces lieux inconnus ? Chi lo sa ! Toujours est-il que, dès midi, ce fut la ruée vers le train providentiel et chacun s'en revenait avec d'abondantes provisions. Le pillage fut marqué de plusieurs incidents provoqués par les SS qui, eux aussi, voulaient profiter de cette manne céleste et tiraient des coups de feu en vue d'éloigner les intrus que nous étions. Avertis tardivement, un camarade et moi, ne pouvions que ramener les restes qui, en l'occurrence, étaient encore copieux et ce, après une altercation avec un SS degrellien. Notre butin se composait de 4 bouteilles de cognac et 5 de rhum, une caisse contenant 24 boîtes de 800 grammes de viande, 10 paquets d'allumettes et 3 cartons de 100 paquets de tabac, dont un avait été « barboté » sur le porte-bagages du vélo qu'un SS avait dressé contre un arbre. Dans la forêt, de nombreux soldats allemands étaient étendus sur le sol, ivre-morts. C'était un spectacle, écœurant de voir ces hommes qui, il y a quelques jours encore, maintenus par une discipline rigide, continuaient à opposer à l'ennemi une résistance jusqu'au-boutiste, malgré la pauvreté des moyens et qui, aujourd'hui, abandonnés par leurs chefs, se livraient à l'orgie la plus dégradante, alors que l'ennemi les talonnait. * * * Il est 16 heures ! Le calme est revenu ! Les dernières pétarades des motos de SS fuyards se sont tues au tournant du bas de la côte. Le village semble abandonné. Seuls, quelques prisonniers conversent sur l'accotement de la grand-route qui traverse la localité. Tout-à-coup, l'un d'eux s'écrie : « Les voilà ! Ils arrivent ! » Chacun peut voir, en effet, une série de petits tanks légers apparaître l'un après l’autre, au sommet d'un raidillon qui longe le cimetière, et bifurquer vers la grand-route. Ils sont une soixantaine qui se suivent à quelques mètres et s avancent au pas de marche. Les prisonniers agitent les bonnets de police. Du premier tank, la tourelle s’ouvre et laisse apparaître le buste d'un jeune officier ; celui-ci fait quelques signes de la main, puis se retire à l'intérieur du char. Brusquement, tirée du premier tank, une rafale de mitrailleuse passe au-dessus des têtes ; aussitôt les prisonniers s'aplatissent sur le sol, comprenant par cet argument peu goûté ce que le jeune officier attendait d'eux. Douze tanks passent et poursuivent leur chemin ; le suivant s'arrête et immobilise derrière lui toute la colonne. En descendent, officiers, sous-officiers et soldats, de même aussi qu'apparaît une femme en uniforme, que les soldats appellent « Adjudan'te ». Tout ce monde s'approche des prisonniers et veut entreprendre de converser avec eux, mais c'est peine perdue, personne ne se comprend. Vers 17 heures, un soldat soviétique se présente à la ferme où nous sommes rassemblés et vient prendre livraison de nos prisonniers. Et nous voyons partir le P'tit Roi et ses subordonnés, tête basse et inquiets, vers leur nouvelle destinée. Malgré tout, nous ne pouvons que les plaindre pour avoir connu, durant cinq années, le sort qui les attend. Peu avant la tombée du jour, un groupe de prisonniers entourant un lieutenant russe et un jeune civil ukrainien, attire mon attention. Par le truchement d'un camarade français qui, né en Russie, possède la langue russe à la perfection, nous pouvons suivre la conversation entre les deux hommes. La finale est celle-ci : – Depuis combien de temps êtes-vous en Allemagne ? demande l'officier. – Deux ans, répond l'ukrainien. – Vous n'aviez donc pas été mobilisé? – Si, mais j'ai été fait prisonnier, me suis évadé des colonnes et suis parvenu à rentrer chez moi. C'est là que, certain jour, la Feldgendarmerie est venue me cueillir pour me faire prendre le chemin de l'Allemagne. – Où donc avez-vous combattu ? – A Stalingrad ! – C'est là que vous avez été fait prisonnier ? – Parfaitement ! – Mais, dit l'officier d'un ton sévère à Stalingrad, vous le saviez, vous ne pouviez pas être fait prisonnier. Venez avec moi ! A ces mots, le jeune ukrainien blêmit et, d'un pas mal assuré, suivit l'officier. L'issue de cette conversation jette un froid dans notre groupe et fait naître un doute sur la réalité de notre libération. Nous connaissons d'autres histoires racontées par des prisonniers russes isolés et nous ne manquons pas de faire un rapprochement avec celle dont nous venons d'être les témoins. Réellement, sommes-nous libres, parmi ces hommes qui sont incapables d'en épeler le mot ! Mieux vaut n'y pas penser et attendre la suite des événements, confiant notre destinée en la divine Providence qui nous a protégés jusqu'à ce jour. * * * Brisés de fatigue, nous regagnons nos granges, nos fenils… XXXXVII VIE DE
CHATEAU. Ce mardi, 1er mai, chaque prisonnier se réveille et se lève à son gré. Depuis 59 mois, c'est bien la première fois qu'il ne connaît pas le réveil brusqué par un coup de sifflet ou par un ordre hurlé : « Aufstehen ». Cela nous paraît invraisemblable et nous nous faisons difficilement à l'idée que notre situation a subi, depuis quelques heures, de notables modifications. Où donc sont passés notre microscopique feldwebel et ses sous-ordres ? Pour le savoir, il n'y a qu'à se rendre sur la grand-route, ils se trouvent dans l'importante colonne de prisonniers que des soldats soviétiques emmènent vers l'Est. Leurs regards tristes et désabusés indiquent qu'ils connaissent, à leur tour, les affres de l'angoisse devant l'incertitude de nombreux lendemains. Notre dévoué homme de confiance nous prévient de préparer notre départ, les Russes voulant nous refouler vers l'arrière pour nous écarter de toute attaque possible due à un revirement des Allemands. Avant le départ, un groupe d'une centaine de prisonniers se réunit dans une grange pour y réciter le chapelet en commun. Et à 9 heures, l'ordre du départ est donné. Un chariot rempli de paille transporte les blessés de la veille et leurs bagages. Nos petites charrettes, bien graissées, semblent plus légères à tirer ; il est vrai que le seul fait d'arpenter la route librement, sans être accompagnés de ces éternels garde-chiourmes nous vaut une ardeur revigorée et un moral tout à fait neuf. Nous refaisons, en sens inverse, le chemin parcouru depuis Stavenhagen l'avant-dernière nuit. Jusqu'à l'entrée de la ville, la route est quasi déserte. Il en va tout autrement lorsque nous pénétrons dans la localité où de nombreuses troupes russes sont cantonnées et se livrent à un pillage en règle de tous les magasins. Ne prenant même pas la peine de forcer les portes, les soldats brisent les vitrines pour se livrer aux instincts malsains du vainqueur. Les marchandises les plus diverses sont chargées sur des camions automobiles qui stationnent le long des trottoirs. A la sortie de la ville, nous laissons à notre gauche le chemin que nous avions suivi, il y a peu, et nous empruntons la chaussée de Neurandenbourg. A partir de ce moment, nous croisons un long charroi hippomobile qui n'en finit pas. Pendant deux heures trois heures, ce n'est qu'un défilé au galop de lourds chevaux trapus, tirant de petits chariots légers et vides. De temps en temps vient s'intercaler un camion Ford dont le modèle est vieux de 15 ans et dont l'écusson de la marque sur le radiateur, reproduit le nom en caractères russes. Quelques tanks lourds du type Sherman dominent ce cortège de leur masse imposante. Devant nous, six prisonniers russes se sont infiltrés dans notre colonne et nous sommes étonnés de voir qu'aucune joie ne se manifeste sur leur visage et que, au contraire, ils n'ont pas l'air rassurés : leurs regards évitent de se rencontrer avec ceux de leurs compatriotes qui les croisent. Vraiment, sont-ils libérés ? Parfois, un soldat russe passe, devant nous, juché sur un vélo qu'il ne parvient à maîtriser qu'au prix de la vitesse acquise et dont les dangereux zigzags compromettent l'équilibre de l'audacieux amateur. Amusés, nous suivons les évolutions acrobatiques de ces néo-pédaleurs. Mais nous reprenons vite notre sérieux lorsque nous rencontrons, au bord du chemin, un ou deux soldats russes, la mitraillette dans les mains et qui attendent l'occasion de détrousser l'un ou l'autre d'entre nous. Ces aimables alliés s'en prennent à notre montre, à notre alliance, voire même aux boutons « blinquant » de notre veste et que nous devons leur abandonner à contre-cœur, sous la menace de leurs armes. Plusieurs prisonniers furent l'objet de cette désagréable fouille et se virent délestés de ces objets auxquels ils tenaient tant notre homme de confiance en fut lui-même victime. Certains russes exigent même l'échange de notre veste contre la leur. Aussi, jugeons-nous prudent de resserrer les espaces entre les groupes et de nous suivre de très près, afin d'éviter l'isolement toujours favorable aux exploits de ces gangsters. Aux carrefours des chemins, nous constatons que les flèches des poteaux indicateurs ont été remplacées par d'autres dont les inscriptions sont en caractères russes. Cette fois, plus moyen de s'y reconnaître, mise à part la direction de Neubrandenbourg qui se devine par la longueur du nom. Une « adjudan'te » en courte jupe kaki règle la circulation. Dans le fossé ou dans la campagne, des tanks détruits attirent les regards. Peut-être, ces épaves d'acier renferment-elles encore les cadavres grillés de ceux qu'elles conduisaient au combat. Se rencontrent aussi des chariots inutilisables qui servaient aux évacués civils ; dans les brancards, le vieux cheval sur lequel reposaient tous les espoirs d'un rapide éloignement, gît, les yeux vitreux, les pattes en l'air et le ventre gonflé. Autour du véhicule le linge et la vaisselle sont épars, déchiquetés ou détruits. Nulle part, un cadavre humain. Cependant, nous venons de bifurquer à droite sur une route de campagne située à proximité d'un corps de garde russe et là, à l'orée du bois qui borde un côté du chemin, le cadavre d'un soldat allemand est étendu dans l'ombre des arbres, les bras en croix. C'est le seul que nous ayons rencontré au cours d'une longue étape. Nous poursuivons notre chemin, une pente assez vive au bas de laquelle se dressent un village, son église, son château. Nous y atteignons bientôt et sommes dirigés vers le château. Celui-ci comprend de nombreuses dépendances qui peuvent suffire à héberger les 1.100 prisonniers belges et français de la caravane. Notre premier souci est de repérer tout ce qui est comestible et apte à modifier notre ordinaire. Loin de nous la pensée de toucher encore à la soupe aux choux, aux rutabagas et aux kartoffel-pelt ; Il nous faut du raffiné, renouer des relations avec les plats de chez nous et nous refaire une personnalité en mangeant comme des hommes et non plus comme des pourceaux. Ce jour-là même, le poulailler est dévasté et notre premier repas au château est vraiment de qualité. Nos boîtes de pâté provenant du tram pillé, la veille, contiennent suffisamment de graisse pour frire la volaille et quelques gras morceaux d'un jambon fumé déniché, dans une grange, ajoutent encore au fumet odorant qui se dégage de nos marmites. Personnellement, mon plus beau coup fut la découverte d'un seau rempli de sel de ménage. Car il faut bien dire que, malgré tout, nos aliments manquaient de saveur, en l'absence d'assaisonnement. Les trouvailles étaient nombreuses et variées et, pour une poignée de sel, on obtenait d'un autre, ce qu'on n'avait pu se procurer soi-même. C'était une monnaie d'échange idéale. Dès le lendemain, nous apprenons que nous sommes au village de Schwandt, localité ne présentant aucun intérêt par elle-même, sinon que le château où nous prenons nos aises, appartient à une famille illustre d'Allemagne et que, nous autres, belges, nous connaissons particulièrement, c'est-à-dire la famille du général von Schlieffen. Nous occupons donc la demeure de celui qui fut, pour une bonne part, la cause de nos malheurs en 1914-18. On se rappelle, en effet, que ce fut le général comte Alfred von Schlieffen qui fut l'auteur des plans de guerre contre la France, alors qu'il était chef d'Etat-Major général (1891-1905), et ces plans prévoyaient le passage des armées allemandes par notre pays. L'intérieur du château est mal en point. Les prisonniers russes, de même que les civils polonais, affectés aux dépendances agricoles du château, se sont livrés, avant de quitter les lieux, à des actes de vandalisme dictés par un esprit de vengeance. Ils étaient, paraît-il, rossés à la cravache, lorsqu'ils étaient pris en défaut pour la malfaçon ou l'inexécution de leur travail. Les portraits en pied des ancêtres, qui surplombent l'escalier monumental conduisant à l'étage, sont lacérés. Dans la galerie du premier étage, de nombreuses vitrines qui devaient faire l'orgueil d'un savant géologue, sont brisées et les milliers de petits cailloux de toutes espèces se mélangent pêle-mêle sur le plancher. Au rez-de-chaussée, on foule des débris de verre et de vaisselle rare. Une magnifique bibliothèque est restée intacte, on y découvre quantité de livres d'auteurs français réputés et beaucoup d'entre nous en feront leur profit au cours de notre séjour au château. On y trouve également un recueil de lettres aux feuillets jaunis, datant de l'époque de la Révolution Française et écrites par de jeunes émigrés. Sous la direction de l'Homme de Confiance, notre vie s'organise. Partout, au château, comme dans les dépendances, on effectue un nettoyage en règle, on s'aménage au mieux. Le ravitaillement est instauré de façon telle que les rations dépassent souvent les besoins. Six prisonniers ex-bouchers ou six bouchers ex-prisonniers, comme on voudra, abattent, chaque jour, le bétail nécessaire pour la distribution de 500 grammes de viande par homme ; les pommes de terre existent en abondance. Que faut-il de plus. ? La population du village qui, évacuée, commence à rappliquer, reçoit la même ration de viande pour deux personnes, mais elle est dans l'obligation de fournir des prestations pour l'entretien des lieux. Il y a, dans ce domaine, de quoi subvenir à nos besoins, pendant de nombreux mois : une centaine de bêtes à cornes, une centaine de porcs, et un millier de moutons. Véritablement, le prisonnier est gavé de viande et de graisse ; aussi, s'en ressent-il au cours d'une épidémie de diarrhée qui le surprend après 3 ou 4 jours de ce régime auquel il n'est plus accoutumé. Dans les écuries, les box, vides à notre arrivée, commencent à retrouver des locataires. De nombreux chevaux y sont l'objet de soins attentifs, par prévoyance des services appréciables qu'ils seront appelés à nous rendre, dans l'avenir. Après quelques jours, les camarades français nous quittent, pour se rendre en un lieu de rassemblement situé à Malchin. Nous les envions, car cette étape vers l'Ouest les rapproche de leur pays d'une bonne centaine de kilomètres. Or, nous envisageons que notre retour prendra au moins trois mois, étant donné les millions d'étrangers qui sont à rapatrier vers tous les pays d'Europe. Le 8 mai. au soir, nous apprenons que l'Allemagne a capitulé. Cette nouvelle ne produit pas l'effet qu'on serait en droit d'escompter, tant il est vrai que, pour nous, la guerre était pratiquement terminée le 30 avril. Le 10, Fête de l'Ascension ! Qui le savait ? Il fallut l'arrivée d'un prêtre français, à 6 heures du soir, pour que nous en soyons informés. Un office religieux, avec communion, fut célébré à 20 heures. La petite église de Schwandt était insuffisante à contenir les prisonniers qui avaient tenu à assister à cette pieuse cérémonie. 
Le château de Schwandt J'ai omis de dire que, pendant toutes ces journées, un commandant russe veillait à demeure sur notre destinée. Type du colosse bourru et mal éduqué, il n'inspirait pas confiance. Par deux fois, il fit procéder à une distribution de cigarettes et de pain ; les premières furent bien accueillies, mais le pain fut immangeable, on n'eût pu dire de quoi il était fait. Le soir, les soldats russes faisaient une incursion dans le village et se livraient à des actes que je me refuse à exposer ici. Nous évitions leur contact car, de toute évidence, aucun geste de camaraderie ne leur était permis vis-à-vis de nous et, bien au contraire, ils avaient constamment le doigt sur la gâchette de leur mitraillette et nous dévisageaient avec méfiance. D'une façon générale, leur formation culturelle était nulle, il nous a été donné de le constater à plusieurs reprises. Je me bornerai à citer un exemple avant la fin de ce récit. Cela nous faisait, dire qu'ils étaient en retard de plus d'un siècle sur notre civilisation occidentale. Le dimanche, 13 mai, à 4 heures de l'après-midi, alors que rien ne faisait prévoir l'ordre donné, nous sommes priés de rassembler nos bagages et nos munitions et de nous préparer à un départ très proche. Le lieu de destination est connu : Neubrandenbourg encore. Toujours vers l'Est ! Les apprêts sont depuis longtemps terminés lorsque, à 6 heures, la colonne s'ébranle. Celle-ci, aujourd'hui, n'est plus composée uniquement de petites charrettes, car de nombreux attelages sont venus s'y adjoindre. Nous gagnons la grand-route. Au carrefour, la circulation est toujours réglée par un soldat en jupons. Environ 25 kilomètres nous séparent de Neubrandenbourg. Le parcours se fait sans histoire et il est plus de minuit lorsque nous arrivons à l'entrée de la ville. Les premières habitations sont éclairées à giorno et, par les fenêtres ouvertes, on peut voir soldats et officiers russes aller et venir dans toutes les pièces ; 1a température est modérée et ils ne peuvent se résoudre à se mettre au lit. Mais la lumière crue des lampes électriques fait bientôt place à l'obscurité. On y voit encore, car nous sommes favorisés par un clair de lune splendide. Nous entrons dans la zone bombardée le 28 avril ; partout, des décombres et des pans de murs branlants. Les rues n'ont pas encore été dégagées et, en certains endroits, nos charrettes ne trouvent un passage qu'en zigzaguant d'un côté à l'autre de la rue. La ville est littéralement écrasée, il n'en reste que des ruines. La traversée est lente. Vers 1 heure, nous atteignons la côte qui mène au stalag. A mi-chemin, se place un incident ; quatre soldats soviétiques, ivres et armés de mitraillettes, se mettent à fouiller quelques charrettes et leurs conducteurs, dans l'espoir d'y trouver des bijoux et du clinquant. L'intervention inopportune de ces rôdeurs nous fait perdre une heure et le jour n'est pas long à paraître lorsque nous atteignons le plateau, à proximité du stalag et des casernes qui étaient en construction en juin 1940. Nous nous installons dans une baraque très spacieuse dont nous ne définissons pas bien l'affectation et dans les chambres d'une longue baraque qui devait héberger, il y a deux semaines encore, les sentinelles allemandes du camp. Le jour même de notre arrivée, un pieux devoir nous attendait : rendre un dernier et religieux hommage à notre malheureux compagnon, François M., qui, blessé lors de l'attaque à Grapzow par les avions russes, avait été transporté de Schwandt au stalag de Neubrandenbourg et était décédé au cours de son transfert. En juin 1940, du stalag, nous pouvions apercevoir une soixantaine de croix indiquant l'emplacement d'autant de prisonniers polonais décédés ; aujourd'hui, près de 14.000 prisonniers y dorment leur dernier sommeil. De longs tertres recouvrent les restes de 11.000 prisonniers russes. Aujourd'hui encore, le camp ressemble à une énorme ruche bourdonnante, toutes les baraques sont pleines à craquer. Les casernes, comprenant 10 blocs imposants à 3 étages, sont remplies jusqu'aux combles. Dans chaque salle, les anciens prisonniers vivent entassés. A combien de dizaines de milliers d'hommes sommes-nous là ? La population est très variée et comprend des ex-prisonniers américains, anglais, belges, canadiens, français et hollandais. Chacun d'eux porte sur le bras gauche un insigne rappelant sa nationalité. En ville, plusieurs incidents s'étant produits entre russes et anciens prisonniers, un major belge juge nécessaire d'inviter ses compatriotes à la plus grande circonspection et à se confiner dans le camp et les alentours immédiats, par l'apposition de petites affichettes manuscrites, en plusieurs endroits du camp. Ce n'est pas un ordre, mais un conseil qui, je dois le reconnaître, fut apprécié et respecté par les Belges. Le 18 mai, notre groupe, qui se compose encore d'environ 600 hommes, tous belges, est appelé à se présenter devant une espèce de commission où siègent le commandant et trois femmes russes, ex-déportées, dont deux bafouillent un peu le français. A tour de rôle, nous déclinons notre identité qui est consignée dans un registre. Nous constatons que l'inscription de nos noms, prénoms, adresses et autres, se fait en caractères d'écriture slave, suivant l'euphonie des mots. Il suffit d'un « sky » ou d'un « off » ajouté à notre nom, disons-nous, pour être russifié tout-à-fait. Nous apprenons que ces opérations sont les préliminaires d'un départ prochain, à destination finale. 
Carte d'errance des P.G., d'août 44 à fin 45 Zurück nach haus ! comme auraient dit ces Allemands que nous voyons passer au bas de la colline, pâles et défaits, en colonnes serrées, sous la conduite de sentinelles russes. XXXXVIII LE RETOUR. Ce samedi, 19 mai, est assez animé ! Il n'est nullement question de s'attarder sur la paille, de faire la grasse matinée. Le motif ? On part dans deux heures ! On ne peut s'empêcher de faire la remarque que notre commandant russe s'est occupé de nous avec la plus grande célérité puisque, arrivés les derniers au Stalag, nous en partons les premiers. La veille, de nombreux camions américains ont emmené le contingent de prisonniers américains, anglais et canadiens qui se trouvaient dans les casernes, mais aucun canard ne faisait prévoir que les Belges, les Français et les Hollandais devaient suivre bientôt. Seul, notre groupe avait bénéficié de cet espoir, après la comédie administrative de la veille. Peut-être, à bien y songer, le commandant russe tenait-il à nous prouver sa reconnaissance de la manifestation dont il avait été l'objet, un jour, au château de Schwandt. Des ovations hypocrites, exemptes de cette spontanéité dictée par la sincérité, 1ui avaient été adressées pour une cause dont j'ai perdu le souvenir, mais dont chacun de nous comprenait très bien qu'il s'agissait d'un coup monté. Je me plais à le déclarer, sans fausse honte, car ces agissements étaient rendus nécessaires, à l'instar d'une action diplomatique, envers nos libérateurs dont nous redoutions les exploits de conquérants. L'animation est grande parmi nous. Avec une hâte fébrile, nous sortons nos valises et nos sacs pour les installer sur... nos petites charrettes, pensez-vous ? mais non, sur des véhicules à 2 et à 4 roues, attelés de chevaux. A présent, tous les prisonniers sont propriétaires des attelages abandonnés sur les routes par les évacués, lorsque le danger forçait ceux-ci à quitter ce qui leur restait encore. II ne nous fallut pas une demi-heure pour être prêts, mais le départ, qui devait avoir lieu vers 10 heures, fut singulièrement retardé, sans que nous en connaissions la cause. Ce ne fut, en effet, qu'à 5 heures de la soirée, que le convoi se mit en marche. On s'en doute, l'étape fut courte, ce jour-là. Une douzaine de kilomètres ! Les journées qui suivirent n'apportèrent rien de nouveau. L'étape comportait 25 à 30 kilomètres, chaque jour, au pas lent de nos chevaux ; une heure, à midi pour casser la croûte, donner le picotin aux chevaux et les abreuver. Le soir, logement dans les granges d'un quelconque village. Au départ, un camion-auto bâché emportait ceux des nôtres dont l'état de santé ne permettait pas la marche. A l'étape, on rétablissait les foyers de fortune pour préparer le repas du soir et le « Frühstück » du lendemain. Le mercredi, 23 mai, nous atteignons le bourg de Goldberg, vers 13 heures. Une halte assez prolongée est prévue, à notre insu. Pour la première fois, le commandant russe nous convie à une distribution de soupe ; bientôt, on va le quitter et il veut que nous rentrions, dans notre pays, avec une excellente impression de l'hospitalité russe. C'est très charmant, il faut l'admettre ! Malheureusement, cette bonne opinion est contrariée par une pluie qui tombe sans discontinuer depuis le matin. Ce frugal repas nous est servi à la Rathaus (Maison communale}, mais la distribution n'est faite que par groupes de 100 convives, car le matériel de cuisine est insuffisant et, d'autre part, le projet tardif de l'invitation n'a pas permis de satisfaire aux préparatifs massifs de cette réception, si modeste soit-elle. La pauvreté de l'organisation nous force à séjourner sous la pluie durant cinq heures et demie, alors que le but de l'étape n'est distant que de 6 à 7 kilomètres. Nous eussions préféré terminer l'étape et subvenir nous-mêmes à nos besoins. Certes, nous ne mésestimons pas la valeur de l'intention, mais nous réalisons aussi que les conditions étaient peu propices à la reconnaissance. Quant à la soupe, elle était faite d'un brouet de patates et de macaroni ! Elle était chaude, elle fut excellente ! Au cours de cette attente prolongée, se place un petit intermède que je m'en voudrais de ne pas conter : A l'entrée de la Rathaus, se trouve une sentinelle russe, montant de faction. A ses côtés, un jeune soldat russe, aux yeux bridés, aux pommettes saillantes, aux cheveux noirs de jais, qui dénoncent le métis le plus parfait ; il dirige les opérations d'accès à la Rathaus et lorsque la centaine est atteinte, il fait patienter les autres, au dehors. C'est ainsi que je suis refoulé, en même temps qu'un jeune sous-lieutenant liégeois, parce qu'un contingent complet vient de s'engouffrer dans les locaux. La conversation s'engage, avec le Russe, en langue allemande qu'il parle assez clairement. Après un moment, je lui dis : – Vous avez été prisonnier, en Allemagne ? – Moi ? dit-il. Mais non ! Quoi vous fait supposer que j'ai été prisonnier ? – Mais… parce que vous parlez allemand. – Comment ? Mais vous vous imaginez peut-être qu'on n'apprend rien dans les écoles de Staline ! J'ai été sept années à l'école et c'est là que j'ai appris la langue allemande. Puis sortant de sa poche, une énorme montre du type dit « chemin de fer », il me la met sous les yeux et me prie de lui dire l'heure. Il dut comprendre le sourire qui se dessina sur toutes les lèvres, car il s'enfuit aussitôt qu'il fut renseigné : nous ne devions plus le revoir. Pauvre. garçon ! Après sept années d'études, il ne pouvait lire l'heure à « sa » montre. Combien en avons-nous vu qui, possesseurs d'une montre qu'ils s'étaient appropriée au détriment d'un passant, portaient l'objet à l'oreille pour s’assurer de son tic-tac et qui, n'entendant plus rien, la lançaient loin d'eux, en grommelant. N'a-t-on pas vu, un jour, un soldat russe s'arrêter devant un poste de radio échoué sur le trottoir, sans doute au cours d'un pillage et, accroupi, se mettre en devoir de faire fonctionner l'appareil en tournant les boutons dans les deux sens, ignorant que celui-ci devait être relié au réseau électrique ; puis, après quelques minutes d'essais infructueux, se relever et, furieux, flanquer son pied dans la boîte à musique. Laissant ces pauvres gens à leur ignorance, nous poursuivons notre voyage, sachant bien que, au terme, nous retrouverons un foyer et une civilisation dont nous pouvons être fiers ! Le jeudi, 24 mai, vers 18 heures, nous traversons la petite ville de Crivitz, aux rues, si étroites que deux véhicules ne pourraient se croiser sans difficultés. Sur le seuil des maisons, les habitants nous interpellent : « Les camions anglais vous attendent. Cette nuit, vous dormirez en zone anglaise. Dans 48 heures, vous serez chez vous. Votre rapatriement se fait par avion. Nous vous envions, quelle chance est la vôtre de passer de l'autre côté de la barrière ». Notre joie éclate ! Il y a quelques minutes encore, nous ignorions combien de temps devait durer notre voyage à travers la zone russe, ne connaissant rien les conventions interalliées sur la division du pays. A Crivitz se termine l'avant-dernier épisode de notre captivité et, cette fois, nous allons bon train vers la liberté ! Au bord d'un lac immense, les camions anglais sont arrêtés, Nous abandonnons nos chevaux et nos chariots le long de la route et, après une tape amicale sur l'encolure de ces braves bêtes dont l'aide nous fut si précieuse, nous grimpons dans les camions. 35 hommes par véhicule ! Comme bagages, nous ne conservons que notre valise et notre besace. Nous partons à une allure assez vive et, après quelques kilomètres, nous nous trouvons devant une barrière que lève une sentinelle russe. Nous quittons définitivement la zone russe pour pénétrer dans le « no man's land » qui sépare les deux territoires. Nous retrouvons une sentinelle anglaise qui manipule également la roue qui lève la barrière pour nous livrer passage. Quelques centaines de mètres encore et le convoi s'arrête. Les convoyeurs anglais remettent aux occupants de chaque camion, une caisse de vivres qu'ils auront à se partager ; la distribution se fait sur le champ, car la nuit approche et, bientôt, on n'y verra plus. Puis, les camions s'envolent à du 100, 110 à l'heure, tandis que, petit à petit, les choses disparaissent dans la nuit. Cette course dans le noir est monotone et nous nous laissons aller à la torpeur qui s'empare de nous. Nous n'en sortons qu'au moment de traverser l'Elbe sur un pont de bâteaux pour admirer la féerie des feux de puissants projecteurs qui réveillent le fleuve et le paysage. Le camion qui nous précède vient de s'arrêter... un pneu crevé. Le nôtre stoppe également, comme il se doit de le faire, pour porter aide. Après un temps assez long nécessité par la réparation et après deux erreurs de parcours, nous arrivons aux casernes de Lunebourg. ville endormie et parcourue par de nombreuses patrouilles. Il est trois heures et demie. Après la désinfection expresse à la poudre insecticide, nous gagnons les dortoirs. A 7 heures, on nous réclame déjà pour le petit déjeuner, suivi aussitôt de notre inscription pour un départ en avion. Mais ce transfert par air ne sera pas général, car il ne peut être satisfait aux milliers de demandes. A 13 heures, des camions militaires viennent se ranger au centre de l'immense caserne et l'embarquement s'effectue en bon ordre. Nous traversons la pittoresque et vieille ville de Lunébourg ; à la sortie, nos camions s'élancent à fond de train sur la route libre, mais parsemée de fondrières. A certains endroits, des prisonniers allemands sont occupés à la réfection du chemin, sous la garde de sentinelles anglaises. Le voyage est sans histoire. Dans tant de villes et de bourgs traversés, les habitants nous regardent passer curieusement ; parfois, l'un ébauche un petit geste amical... Evidemment, c'est de bonne politique ! Nous sommes à Sulingen... Sur un vaste terre-plein, les camions se sont arrêtés. Le débarquement se fait méthodiquement et suivant les ordres donnés par haut-parleurs. Nous passons la nuit dans de petites granges, sur la paille tassée par le nombre important d'hébergés qui se sont succédé en ces refuges. Une forte odeur d'urine indique le peu de scrupules de certains occupants en fait d'observance hygiénique et dont les conséquences sont inévitables : nous retrouvons des poux. Le lendemain, 26 mai, à midi, un train formé de wagons à bestiaux nous emmène, emportant avec nous six civils dépourvus de pièces d'identité et qui ont bien dû avouer qu'ils faisaient partie des troupes légionnaires au service de l'Allemagne. Au passage, parmi tant de ruines, nous remarquons surtout Osnabrück, dont l'état de destruction dépasse l'imagination. Dans la gare et le long des voies sur une longueur de deux kilomètres, des milliers de locomotives, de voitures et de wagons sont éventrés, renversés, incendiés ; aucune voie n'est intacte et il a fallu frayer un passage parmi ces ruines pour la construction d'une voie unique sur laquelle se fait un trafic réduit. Le soir, à 8 heures, nous atteignons la ville de Burgsteinfurt. Le convoi s'arrête à l'entrée de l'importante gare, pour permettre à la population de venir nous ravitailler en eau fraîche. Les Allemands le font avec un empressement obséquieux et muet qui démontre bien qu'ils agissent par ordre. Dans la gare, nous rencontrons de jeunes soldats de la Brigade Piron, parmi lesquels on retrouve l'une ou l'autre connaissance. On nous sert un gobelet de café chaud et une couque ; après quoi, nous réintégrons les wagons qui, contre toute attente, font marche arrière et nous entraînent, vers des lieux déjà traversés. Il fait nuit noire lorsque le convoi stoppe à Rheine. Nous nous souvenons que c'est au champ d’aviation de cette ville que fut vaincu le fameux pilote de chasse allemand Nowotny, il y a environ deux mois, abattu par la chasse de la R. A. F., au moment où il effectuait son atterrissage à la base. Sur le quai de la gare, des officiers belges nous reçoivent et, à l'annonce que nous avons avec nous six indésirables, l'un d'eux s'écrie : « Que voulez-vous que j'en fasse, j'en possède déjà 54 autres, dont je ne sais que faire. Demain, vous emmènerez, ces soixante individus et les remettrez aux autorités judiciaires belges ». On nous conduit vers un bâtiment important, entouré d'un parc, où nous passons la nuit sur le pavement froid de salles nues. On nous dit que c'est là un asile d'aliénés désaffecté. Ce fut notre dernière humiliation dans ce sacré pays. Tard dans la matinée du 27 mai, un dimanche, nous repartons en avant. Nos wagons sont couverts de branchages et les drapelets aux couleurs des nations alliées flottent à toutes les portes et lucarnes. Un seul wagon reste obstinément clos, celui dans lequel 60 renégats cuvent leur défaite et méditent sur la disparition de leurs folles espérances. Le long des chemins en bordure de la voie ferrée, des jeeps nous accompagnent montées par de jeunes. soldats de chez nous qui, à cette occasion, font valoir toute l'exubérance de leur jeunesse. Nous traversons villes et villages en ruine ; où rien ne nous permet, bien souvent, de faire le point. Il en est ainsi de ce lieu où le convoi s'arrête à la tombée de la nuit, une grande ville, apparemment pas la moindre inscription n'indique notre position. A perte de vue, ce n'est qu'une accumulation de ruines où les pans de murs émergent à peine. (Nous apprendrons, plus tard, que nous étions à Arnhem, en Hollande). Le train ne se décide pas à repartir. La nuit est froide. Pour se réchauffer, on fait feu de tous les débris de portes et châssis de fenêtres qui jonchent le sol. Seuls, quelques courageux parviennent à trouver le sommeil dans les wagons. C'est vers midi seulement que, le lendemain, le convoi s'ébranle. Nous traversons le Rhin à la lenteur de l'escargot, sur un pont provisoire très étroit et dont la hauteur ne manque pas de nous impressionner craintivement ; aux deux côtés des wagons, on n'aperçoit rien, que le vide et le lit du fleuve. Nous nous apercevons aisément que nous sommes en territoire hollandais, par ces paysans qui, au travail dans les champs longeant la Waal, lèvent la main à notre passage, tenant l'index et le majeur écartés en signe de V. Dans la petite ville de Bokst où nous stationnons assez longtemps, une nombreuse marmaille en sabots escalade les grilles le long des voies et vient nous ravitailler en eau potable. Depuis 32 heures, nous étions sans boisson. Au moment de repartir et si près du but, la déveine s'en mêle une dernière fois ; notre locomotive est tamponnée par une autre machine s'amenant en notre direction sur une voie de croisement et est projetée hors des rails. Malgré les efforts conjugués d'hommes d'équipes et des prisonniers, il faut se résoudre à changer de machine. Enfin, une locomotive poussive entraîne le convoi à sa suite, à l'allure du train de permissionnaires. Nous traversons Eindhoven au ralenti ; puis, nous nous élançons – si on peut dire – en direction de la frontière belge. Dans ce pays plat, la campagne offre peu de charme aux regards et quand bien même en aurait-elle que nous ne les remarquerions pas, occupés que nous sommes à dénombrer les bornes kilométriques qui nous séparent de la frontière. Celle-ci est délimitée par un passage à niveau, suivant le renseignement que nous avons repéré sur une carte d'état-major étalée sur le plancher du wagon. Encore quatre bornes... plus que trois deux... une. Le passage à niveau ! Hourrah ! Une chaleureuse ovation monte du 6ème wagon ; on s’étreint... on s'embrasse. On pleure aussi. Ici, dans cette petite localité frontière de Achel, où d'aimables jeunes filles nous offrent des fleurs, prend fin notre captivité. Nous sommes CHEZ NOUS ! Ce 28 mai 1945 ! 
Carte de retour des P.G. vers la Belgique FIN.
|
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©