 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Jamais ne Désespère...[1] Fischbeck 1944-1945 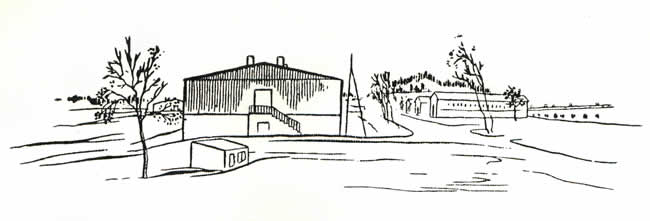
Voulez-vous du sidol pour
vous laver les dents ? J’avais,
pendant ma captivité à Fischbeck, un rare privilège : j’habitais une
petite chambre que je partageais avec le Commandant Petrus, ancien officier de la
Force Publique du Congo. Mon
compagnon était un homme bon, simple et droit et, sauf les petites disputes
inhérentes à la vie en commun, nous faisions bon ménage. Petrus
était fils de fermiers du pays de Dinant. Il avait passé de la ferme au service
militaire et était encore sous les armes lorsqu’éclata la guerre de 1914. Son
comportement au combat lui avait valu un avancement rapide : à la fin de
1914, il était sous-lieutenant. Dès la stabilisation de l’armée belge derrière
l’Yser, il avait demandé à être affecté aux troupes d’Afrique. Parti pour le
Congo au début de 1916, il y resta la guerre finie et fit carrière à la Force
Publique, ne revenant en congé en Europe que pour quelques mois tous les trois
ans. En 1935, il put faire valoir ses droits à la retraite ; il se maria
et s’établit à proximité de son village natal. C’est
circonstances expliquent qu’il était assez porté à mépriser les petits besoins
inutiles dont nous encombrons notre existence de bourgeois ; il les
considérait comme étant des manifestations efféminées ou décadentes. * * * Notre
chambre était petite, très petite, et il n’était vraiment pas possible que nous
y fassions ensemble notre toilette. J’étais le
plus jeune et je me levais le premier, j’allumais le poêle, je mettais chauffer
l’eau pour le déjeuner, je me lavais et je m’habillais. Lorsque ma toilette
était terminée, mon camarade se levait à son tour, faisait sa toilette, et nous
déjeunions ensemble avant de nous rendre à l’appel. Le
dimanche, pourtant, les rôles étaient renversés. Petrus se levait le
premier ; moi-même je me tournais généralement vers le mur et j’essayais
de somnoler jusqu’à ce que je puisse, à mon tour, disposer de l’espace et du
bassin. Un dimanche
matin de printemps, le soleil étant éclatant et le temps doux, tandis que mon
camarade se levait, je n’avais nulle envie de continuer à dormir et,
contrairement à mon habitude, je le regardais se laver. Lorsqu’il arriva au
moment de se laver les dents, je le vis, avec horreur, saisir son morceau de
savon de Marseille et s’apprêter à y frotter sa brosse à dents. Comme j’avais
un tube de dentifrice de réserve, je lui dis : -
Petrus, si vous voulez du dentifrice, je puis vous en donner
un tube. -
Non merci, me répondit-il, je me sers toujours de savon
ordinaire, le dentifrice est trop abrasif et abîme les dents. Je n’insistai pas, j’oubliai
l’incident et bientôt, à mon tour, je me levai, me lavai et nous déjeunâmes
ensemble. Le
dimanche, l’appel était retardé d’une demi-heure et nous en profitions pour
accorder quelques soins à nos vêtements, nettoyer nos souliers, astiquer nos
cuirs et nos cuivres : ceinturons et boutons. Après avoir
ciré ses souliers, Petrus s’installa en face de moi pour « faire »
son ceinturon ; je savais qu’il n’avait pas de sidol, tandis que j’en
possédais un flacon plein, que je lui tendis : -
En voulez-vous ? dis-je. -
Non, me répondit-il, je fais toujours mes cuivres avec du
dentifrice. 
Colis pour la Belgique Dès le
début 1944, les services administratifs des camps reçurent pour consigne de
prendre des mesures en vue de réduire les bagages des prisonniers : il
fallait se préparer à des déménagements pour le cas d’invasion de l’Europe par
les armées alliées. Au camp de
Fischbeck, les prisonniers furent informés qu’ils pourraient renvoyer chez eux
les vêtements et autres objets non strictement indispensables. Par un
agréable retour des choses d’ici-bas, les prisonniers se mirent donc à faire
des colis pour les familles ! Lorsque
tous les colis furent prêts, que leur contenu eut été fouillé par les censeurs,
ils furent rassemblés dans un local spécial, vidé pour la circonstance, et qui
se trouvait au milieu du camp. Il était
prévu que trois wagons seraient mis à la disposition du camp pour le transport
de ces colis vers la Belgique. On savait
que le chargement serait effectué sous la surveillance d’Allemands, par un
sous-officier et des soldats belges, tous prisonniers. Le
lieutenant de Teli était un curieux personnage : il était à la fois
nonchalant et résolu, fantaisiste et persévérant, impulsif et philosophe. Il
était jeune, bien portant et décidé à s’évader. Il avait fait plusieurs
tentatives malheureuses qui ne l’avaient pas découragé. Il s’était
abouché avec le sous-officier belge qui devait diriger l’équipe de chargement
et il était entendu que, si une occasion favorable se présentait, de Teli en
serait prévenu. Lorsque les
wagons arrivèrent à la gare de Fischbeck, on organisa avec le camion du camp un
va-et-vient entre le dépôt des colis et la gare ; on compta qu’il faudrait
environ quinze à vingt voyages pour transporter tous les colis. Au cours
des premiers chargements, les Allemands furent particulièrement attentifs et il
devint évident que, s’ils continuaient ainsi, il n’y aurait aucune chance pour de
Teli d’échapper à leur vigilance. de Teli lui-même en était à ce point
convaincu qu’il n’avait pas poursuivi ses préparatifs. Aussi lorsque le
sous-officier belge lui fit dire, un après-midi vers trois heures, à l’occasion
de l’un des derniers voyages du camion, qu’il pouvait courir sa chance, de Teli
n’était vraiment pas prêt ; il emprunta la tunique et le manteau d’un
soldat belge, de façon à pouvoir passer pour l’un de ceux chargés du chargement
des wagons ; un ami lui remit un paquet contenant une vingtaine de pommes,
et au moment où le camion quittait le dépôt, il parvint à sauter dedans sans se
faire voir des Allemands. A la gare, dans l’un des wagons, les colis avaient
été disposés de manière à laisser une espèce de petite cellule à laquelle on
accédait par un couloir en chicane ; de Teli s’y faufila et on mura le
couloir avec le restant des colis. 
L’important, maintenant, était d’éviter que l’absence de de Teli dans le
camp fût constatée avant que les wagons n’aient eu le temps normal d’arriver en
Belgique. Le Commandant Bayard prit la direction des opérations. En principe,
il fallait aux wagons trois jours pour le trajet Fischbeck-Bruxelles ; par
prudence, on décida d’essayer de camoufler le départ du fugitif pendant au
moins cinq jours. L’essentiel
était que l’effectif présent aux appels concordât apparemment avec l’effectif à
justifier. Il y avait
deux appels par jour : l’un le matin, l’autre le soir. L’appel du
matin avait lieu sur un terrain nu réservé à cet usage dans l’enceinte du
camp ; les prisonniers se groupaient par compagnie ; une compagnie
étant composée de tous les habitants d’une baraque. L’effectif
de chaque compagnie s’alignait sur cinq rangs ; les différentes compagnies
étaient disposées de façon à former trois des côtés d’un vaste quadrilatère. Au
centre de ce quadrilatère, se tenait le « Lagerälteste » et
l’officier allemand auquel l’appel devait être rendu ; devant chaque
compagnie se tenait le chef de baraque. Un officier allemand passait lentement
devant les prisonniers en comptant le nombre de files et en s’assurant que dans
chacune d’elles il y avait bien cinq prisonniers. Parallèlement, un
sous-officier passait derrière les rangs et effectuait, de son côté, le même
contrôle. Chaque fois que l’effectif d’une compagnie avait ainsi été vérifié,
l’officier et le sous-officier allemands confrontaient leurs chiffres ;
s’ils étaient d’accord entre eux et si l’effectif dénombré correspondait au
chiffre à justifier, ils passaient à la compagnie suivante et ainsi de suite. Pour
l’appel du soir, les choses se passaient différemment : les prisonniers se
rassemblaient près de la porte de leurs baraques respectives ; ils se
plaçaient également par rangs de cinq ; les contrôleurs allemands
passaient successivement de baraque en baraque ; dès que l’effectif d’une
compagnie avait été contrôlé, les prisonniers devaient rentrer dans leur
baraque. Les Allemands en fermaient la porte à clef, puis passaient au contrôle
de la baraque suivante et ainsi de suite. Or donc, de
Teli s’était évadé et il fallait s’arranger pour qu’il n’y ait pas de manquant
à l’appel du soir ; il était déjà tard dans la journée, il fallut
improviser. L’ordre de
succession dans lequel s’effectuait, chaque soir, le contrôle des baraques
était immuable. On faisait notamment l’appel de la baraque 6 avant celui de la
baraque 10 et celui-ci avant celui de la baraque 11. Les
baraques étaient accolées deux à deux par l’un de leurs petits côtés ; mais
elles ne communiquaient pas entre elles, étant séparées par un solide mur de
briques ; leurs portes d’entrée respectives étaient situées dans les deux
autres petits côtés : ces portes occupaient donc les extrémités opposées
de chaque bloc de deux. 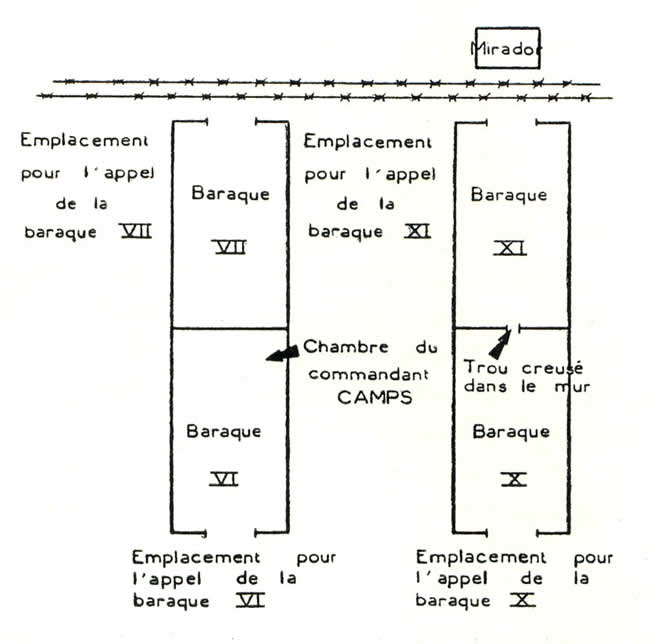
Les
baraques 6 et 7 formaient un bloc ; les baraques 10 et 11 formaient le
bloc voisin ; entre ces deux blocs, il y avait un espace libre. de Teli
figurait à l’effectif de la baraque 10 ; un camarade de la baraque 6 prit
provisoirement sa place à la baraque 10 et lors de l’appel de la baraque 6, fut
remplacé par un autre camarade, le Lieutenant Bec venu de la baraque 11. Le
Commandant Camps occupait dans la baraque 6 la chambre donnant vers les
baraques 10 et 11, la plus éloignée de la porte d’entrée ; la pente du
terrain faisait que l’appui de la fenêtre de cette chambre était peu élevé par
rapport au sol extérieur ; cette fenêtre n’était pas trop éloignée de
l’endroit où se faisait l’appel de la baraque 11. Avant l’appel, le Commandant
Camps vint mettre ses couvertures à aérer sur l’appui de la fenêtre de sa
chambre ; puis, dès l’appel de sa baraque terminé, tandis que les
Allemands fermaient la porte, il vint secouer ses couvertures par la fenêtre avant
de les rentrer. Le Lieutenant Bec profita de ce geste pour sortir par la
fenêtre, dissimulé par les couvertures que l’on secouait ; il rejoignit
les rangs de la baraque 11 avant que les Allemands n’y arrivent eux-mêmes faire
l’appel. Ce manège
était assez imprudent car il se déroulait dans l’avant plan du champ visuel
d’une sentinelle placée dans un mirador tout proche. Aussi, dès
le lendemain matin, se mit-on à percer le mur qui séparait la baraque 10 de la
baraque 11. Avec les instruments de fortune disponible et compte tenu des
précautions à prendre pour ne pas être surpris, ce travail devait durer deux
jours ; le trou, qui n’était pas très grand, (à peine suffisant pour y
faire passer un homme particulièrement mince) fut très habilement dissimulé. Le
troisième soir, Bec fut libéré de son obligation d’ubiquité, qui fut reprise
par le Commandant Pagi. Il se faisait compter d’abord à la baraque 10, puis des
camarades l’aidaient à passer par le trou de la muraille et il prenait place
dans les rangs de la baraque 11. Un soir, avec les trois camarades qui
l’avaient tiré hors du trou, il arriva alors que les Allemands avaient déjà
commencé l’appel ; les quatre complices se justifièrent en prétextant
qu’ils avaient achevé un coup de bridge particulièrement passionnant. L’excuse
fut acceptée sans difficulté. Pour
l’appel du matin, les choses s’organisèrent d’une manière à la fois plus
spectaculaire pour les initiés et plus difficile pour l’exécutant. C’était
toujours au moment de l’appel que les petites demandes, les petites
réclamations individuelles étaient introduites auprès de
« Lagerälteste » qui jugeait s’il convenait ou non de les transmettre
à l’officier allemand qui recevait l’appel. Celui qui
avait une demande à formuler pouvait demander à son commandant de compagnie de
quitter les rangs pour aller exposer son cas au Lagerälteste ; cette
autorisation lui était donnée dès que les Allemands avaient achevé le contrôle
de la compagnie. Le
Lieutenant Obert se chargea de se faire compter deux fois ; il se plaçait,
pour la première fois, dans l’une des compagnies par laquelle le contrôle de
l’appel commençait. Dès que les Allemands avaient passé, il faisait semblant
d’avoir une requête à faire et allait se présenter au Lagerälteste ; après
un moment d’entretien, il allait rejoindre sa place, avant que les Allemands
n’y arrivent, dans l’une des compagnies par lesquelles le contrôle se
terminait. 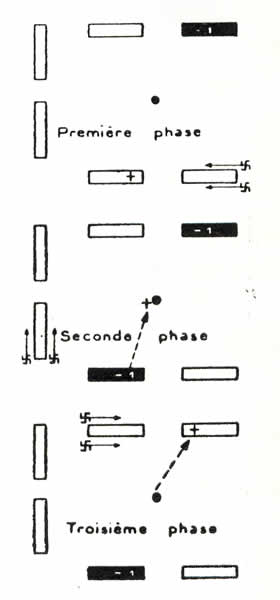
Pour
réaliser cette mise en scène et la renouveler jour après jour, sous le nez des
Allemands, il fallait à celui qui l’exécutait un grand calme et beaucoup
d’assurance ; Obert y réussit pleinement. Teli était
maintenant parti depuis cinq jours ; il était très vraisemblablement déjà
en Belgique ; nous apprîmes d’ailleurs plus tard que cette supposition
était exacte. Un beau
matin, le service de la censure fit savoir que le Lieutenant de Teli avait à se
présenter à la Kommandantur pour y fournir une explication. Chacun y mit du
sien pour faire semblant que l’on venait de le voir. Le jeu s’étendit même par
contagion à plusieurs Allemands qui, de bonne foi, prétendirent qu’ils
l’avaient vu le jour même. Après plusieurs heures de recherches infructueuses,
les Allemands décidèrent de faire un appel spécial ; on ne chercha plus à
dissimuler l’absence de l’évadé.
Immédiatement, les services de police sur les routes et dans les chemins
de fer furent alertés, mais évidemment sans succès ; jamais les Allemands
ne comprirent quand et comment de Teli leur avait faussé compagnie. En avril
1945, il était l’un des officiers de la colonne automobile, détachée par
l’escadron blindé de la brigade Piron, qui vint nous chercher près de Brême et
qui nous ramena à Bruxelles. Le tien et le mien Les services auxiliaires des camps d’officiers
prisonniers étaient assurés par des prisonniers de rang subalterne. On ne
pourra jamais assez dire combien, au cours des cinq années de captivités, ces
« ordonnances », comme on les appelait, nous ont aidés non seulement
par les travaux qu’ils exécutaient, mais aussi par les témoignages d’affectueux
dévouement qu’ils nous ont continuellement prodigués. Ces
circonstances avaient provoqué chez beaucoup d’entre nous le désir de
manifester d’une façon tangible la gratitude que nous éprouvions pour ces
compagnons d’infortune. Mais il
fallait éviter, d’une part, de froisser des susceptibilités souvent très
sensibles et, d’autre part, de ne toucher que ceux qui, étant le plus
directement en contact avec nous, recueillaient déjà des petits avantages
quotidiens. Un comité
s’était formé pour offrir, à l’occasion de la Noël, aux sous-officiers et
soldats prisonniers à notre Oflag, un spectacle et une collation. Les
orchestres et les troupes théâtrales du camp avaient promis leur concours, mais
il fallait obtenir des officiers, individuellement qu’ils prélèvent sur les
colis qu’ils recevaient de leur famille les provisions nécessaires à la
préparation de la collation. Le doyen de
notre camp fit circuler l’avis que ceux d’entre nous qui voulaient contribuer à
cette manifestation devaient remettre ce qu’ils avaient à offrir au Lieutenant
d’Aultrerive, chargé de réunir les dons. J’étais
moi-même un prisonnier privilégié par le nombre de colis que ma famille et les
amis qui résidaient à l’étranger parvenaient à m’adresser ; ce privilège
était d’autant plus sensible que, mon état de santé étant déficient, je ne
pouvais pas beaucoup manger et que, de nature, j’ai heureusement un très petit
appétit. C’est ainsi que je pus me charger de la fourniture de ce qu’il fallait
pour la boisson : du café, du chocolat et du lait en poudre. Tout allait
à merveille, les répétitions annonçaient un spectacle brillant, le volume des
provisions réunies dépassait les espérances. Il me faut
rappeler ici : - tout d’abord, que tout spectacle devait être autorisé par
les services d’ « Abwehr » du camp – ensuite, qu’un censeur
allemand, généralement un officier, assistait aux répétitions et au spectacle
proprement dit – enfin, que le personnel militaire allemand du camp était assez
jaloux des provisions que nous recevions et qui contenaient souvent des vivres
dont il était lui-même privé : café, viande, beurre, cigarettes, etc... Certains de
nos gardiens – et non des moins élevés en grade – n’hésitaient pas à participer
à un commerce clandestin qui nous permettait, en échange de quelques vivres,
d’obtenir certaines faveurs (charbon, bois, formules de lettres ou étiquettes
pour les colis) et même des objets prohibés (pièces pour nos appareils
clandestins de T.S.F., etc...) Ceci pour montrer que, pour certains de geôliers,
toutes les occasions étaient bonnes pour obtenir de nous un peu de ces bonnes
choses qu’ils trouvaient déjà scandaleux que nous ayons et tout à fait
inadmissible que nous donnions à nos soldats. L’un des
censeurs de notre camp, le « Sonderführer »[2]
Schmidt, était de ceux-là ; le spectacle devait être pour lui l’occasion
de bénéficier de la collation. D’autre part, notre doyen, le Colonel Bac, était
un partisan convaincu de la politique du moindre mal. * * * Ainsi donc,
le 24 décembre 1944, à 15 heures 30, dans la grande salle du réfectoire
transformée en café-music-hall, tous nous soldats étaient réunis autour de
petites tables ; devant la scène, autour d’une plus grande table, avaient
pris place les organisateurs, le Colonel Bac et les plus anciens des
sous-officiers prisonniers. Des camarades officiers faisaient le service tandis
que d’autres, sur la scène, tâchaient de faire rire les spectateurs. Schmidt
restait debout, à deux pas de la table d’honneur ; faisant brusquement
mine de le découvrir, le Colonel Bac lui fit signe de s’asseoir à côté de lui
et, Schmidt se rendant à cette invitation, il lui serra la main. L’officier
de service ayant demandé au Colonel s’il fallait aussi servir Schmidt, Bac
répondit oui d’un signe de tête. 
J’étais
moi-même trop impotent pour assister au spectacle ; mais, dès que celui-ci
prit fin, plusieurs amis vinrent vite à ma chambre me raconter ce qui s’était
passé. -
Tu sais, Bac a fait donner du café, de ton café, à
Schmidt ! Le
lendemain, je demandai le rapport du Colonel et, lorsqu’il me reçut, je lui dis
ce qu’on m’avait rapporté. Le Colonel
Bac n’était pas gêné pour si peu : -
Mais, mon cher, cela n’avait vraiment aucune
importance ; d’ailleurs ce Schmidt n’est pas un mauvais type, il laisse
passer beaucoup de choses et il est très correct : je lui ai même serré la
main. Et moi de
répondre : -
Oui, mon Colonel, ça c’est votre affaire, c’était votre main,
mais le café était mon café. Le Colonel
Bac appréciait l’humour à froid ; pourtant la conversation en resta là. 
[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951 [2] Sonderführer : grade temporaire conféré, dans l’armée allemande, à des militaires de rang subalterne pour leur permettre de remplir des fonctions d’officier. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©