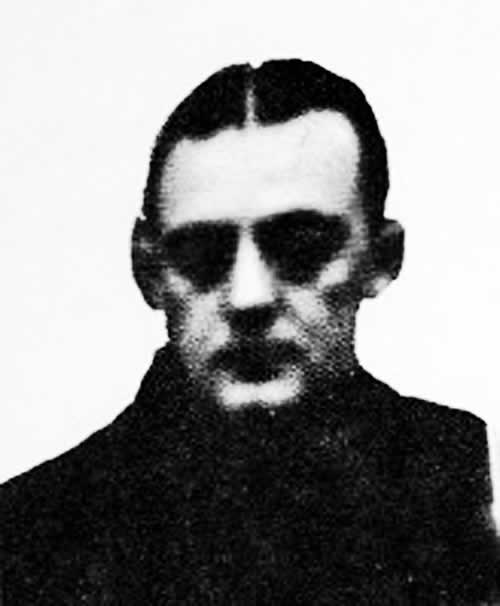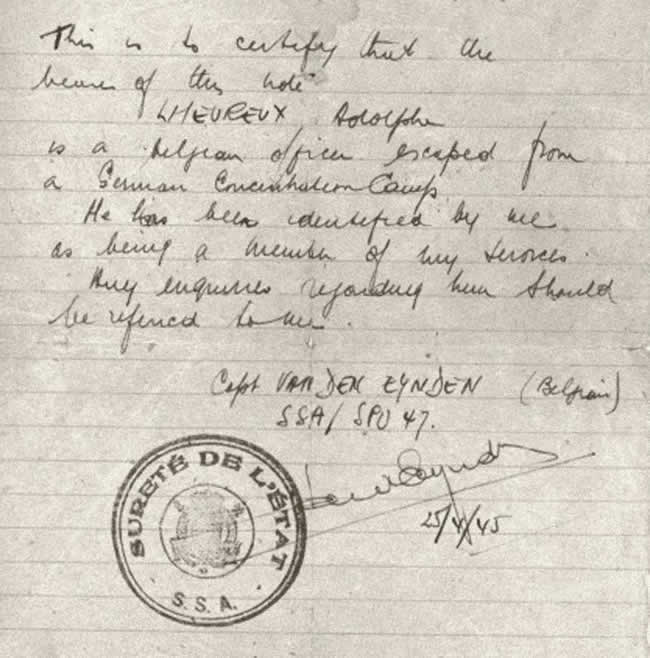Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Classe 38. Souvenirs d'un Chasseur Ardennais Adolphe
Lheureux 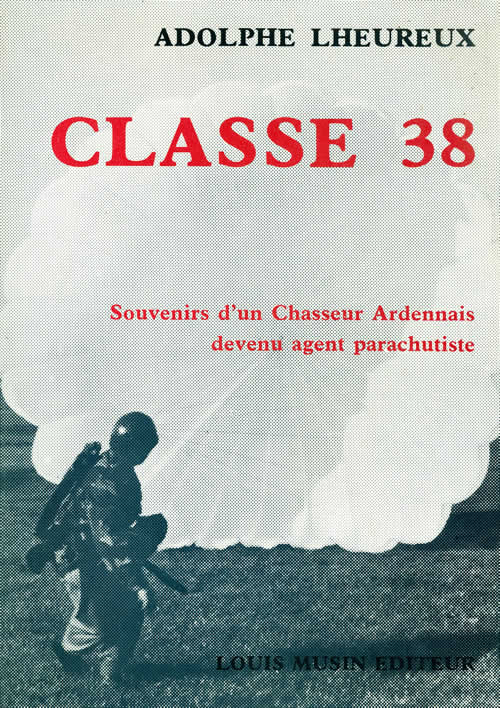
Préface Nous sommes heureux de pouvoir présenter
les souvenirs d'un de nos plus valeureux agents opérationnels de la seconde
guerre mondiale, Adolphe Lheureux. Pour le lecteur non averti, il est bon de
rappeler ce qu'étaient les agents opérationnels, c'est-à-dire les
intermédiaires indispensables entre le haut commandement allié en
Grande-Bretagne et la Résistance des pays occupés. La plupart d'entre ces
agents furent parachutés d'Angleterre sur le continent, certains débarquaient
sur les côtes par petits bateaux ou étaient transportés en avion Lysander. Ils
constituaient souvent une paire: l'organisateur et l’opérateur radio, la
cellule à deux âmes. Ils étaient tous volontaires, agréés de commun accord par
les services britanniques et ceux de leur propre pays repliés en Angleterre.
Les uns étaient destinés aux services de renseignement, d'autres au sabotage,
aux chaînes d'évasion, à l'action psychologique ou aux armées secrètes. Environ
7.000 agents appartenant à 19 nations différentes furent envoyés en territoire
occupé ou ennemi : Britanniques, Canadiens, Américains, citoyens de tous nos
pays alliés, même des Juifs allemands et autrichiens[1].
Leurs pertes furent lourdes. A titre d'exemple, sur les 300 agents clandestins
belges envoyés sur le continent, le tiers n'est pas revenu : l'avion des
parachutistes ou le Lysander abattu, la radiogoniométrie ennemie, la torture,
l'exécution ou le camp d'extermination. Avant qu'ils ne soient définitivement
agréés, après une sélection sévère, l'entraînement des agents s'effectuait
pendant plusieurs mois dans des régions isolées de Grande-Bretagne ou d'Overseas et portait sur : l'étude de la
radio, des codes, des armes, des explosifs ; la connaissance de l'ennemi, de
ses moyens, de ses procédés de police ; le rigoureux dressage physique
indispensable aux exercices de saut en parachute ; l'étude détaillée de la
mission particulière qu'ils avaient à accomplir, des moyens les plus efficaces
pour se soustraire à l'ennemi, de la cover
story qu'ils débiteraient à leurs interrogateurs allemands s'ils étaient
arrêtés. Certes, un abîme sépare les théories d'école des dures réalités du
pays occupé. L'entraînement n'en était pas moins indispensable et, avec les
leçons de l'expérience, devint de plus en plus sévère entre 1941 et 1944. La carrière combattante d'Adolphe
Lheureux est vraiment marquée du signe de l'unité : sergent de réserve au 3e
régiment de chasseurs ardennais, il fait honneur, durant les premiers jours de
la campagne, à ce beau régiment, refuse le plus simplement du monde la
capitulation, s'embarque avec quelques amis vers l'Angleterre, se présente pour
les missions spéciales, en subit le rude entraînement, est parachuté non loin
de Dinant le 3 septembre 1941, fournit durant une année un travail considérable,
évite plus d'une fois la capture en des circonstances dramatiques, tombe
finalement grièvement blessé aux mains de l'ennemi, puis connaît les interrogatoires,
les tortures, les prisons, les camps maudits du Reich hitlérien. Et tout cela
nous est raconté de façon simple, claire, émouvante, charnelle. L'histoire des agents opérationnels n'a
jamais été écrite. Il serait du reste, impossible de composer pareil travail.
Trop d'entre eux sont morts, durant ou après la guerre. Si tous avaient pu
relater leurs souvenirs comme Adolphe Lheureux, la tâche de l'historien eût été
bien facile. Si tous les survivants en faisaient autant, nous aurions, tout de
même, de cette merveilleuse épopée, une plus large vision partielle. Après
avoir si bien servi la Belgique et la Cause, merci, cher Adolphe, pour la
contribution que tu viens d'apporter à l'Histoire.
HENRI BERNARD
Président d'Honneur du Comité d'Action
des Forces belges de Grande-Bretagne La campagne de 40 Le neuf mai de l'an 1940, la 3e
Compagnie du 1er Bataillon du 3e Chasseurs Ardennais
était cantonnée à Chabrehez. Chabrehez est un petit hameau de la
commune des Tailles ; une jolie petite bourgade ardennaise située à huit
kilomètres au sud-est de la Baraque Fraiture et sur la droite de la route
allant de Manhay vers Houffalize. Ce jour-là, le moral des soldats était
comme le temps, au beau fixe. Les permissions avaient été rétablies le matin
même. Alors ! J'étais sergent de réserve, classe 1938. J'avais dû passer neuf
mois à la fameuse compagnie-école de la division des Chasseurs Ardennais. Je
n'avais absolument rien d'un foudre de guerre. Je n'étais d'ailleurs pas un
modèle de discipline, et du reste je ne me prenais pas très au sérieux. Etant
un paysan de Hesbaye j'avais les deux pieds sur terre, assez en tout cas, pour
savoir qu'une fois démobilisé, j'oublierais rapidement tout ce qu'on m'avait
inculqué au point de vue militaire. C'était du moins ce que je pensais à
cette époque. Le lendemain – quelle fête ! – je
retournais en permission. Huit semaines que je n'avais plus revu les miens. Ce
soir du neuf mai j'avais bu plus que de coutume. Les quelques « Bergenbier »
que j'avais ingurgitées me faisaient chavirer. Aussi je m'abattis tout habillé
sur mon lit. Je n'avais aucune raison de ne pas m'endormir profondément. Ce que
je fis sans arrière pensée. Ne devais-je pas prendre le camion des
permissionnaires demain matin à six heures ! Secoué comme un prunier je fus réveillé
en sursaut. Il faisait nuit. Pas une lumière. Le caporal Courard me cria à tue
tête : Sergent, lève-toi ; c'est la guerre. Encore une « connerie » à dormir
debout ! Je me retournai furieux. Sergent, sergent, je t'assure, c'est la
guerre. Je compris bel et bien que c'était la réalité. Je bondis hors du lit et
fus chez l'adjudant C.S.L.R. Monneau très rapidement. « Rassemble les hommes en
vitesse, distribue les munitions et file sur les positions le plus vite possible
» dit-il. Une demi-heure à peine, les soldats harnachés mirent les vélos
paquetés en parcage. Je distribuai les munitions, balles de guerre cette fois,
grenades D.B.T.[2] pistolets et chargeurs
G.P. Nous allâmes occuper les positions, en
l'occurrence de petits éléments de tranchée flanquant la colline droite de la
vallée du Chabrehez. L'aube perçait à peine. Un brouillard très léger cachait
le ru serpentant dans le fond annonçait un très beau temps. Des détonations
sourdes éclataient du côté de la frontière. C'étaient nos destructions qui
sautaient successivement. Très haut dans le ciel, nous entendions pour la
première fois ce long ronronnement malsain des moteurs deux temps des bombardiers
ennemis qui allaient semer la panique, la ruine et la misère dans notre
malheureux pays. Vers les six heures le ravitaillement s'amena : une boule de
pain, du sirop et du café brûlant qui fut le bienvenu pour moi, soit dit en
passant. Ce petit déjeuner allait être notre viatique pour bien des heures et
pour certains d'entre nous, hélas, c'était le repas du condamné : le dernier. Le soleil se levait radieux tel le
soleil d'Austerlitz, hélas pas pour nous les Chasseurs Ardennais !!! Après notre frugal repas, le silence se
rompit. Les hommes se hélaient des trous de fusiliers, discutant ferme. L'adjudant Monneau qui avait pris
position avec le reste du second peloton au bois St-Jean, vint m'annoncer vers
les onze heures que notre lieutenant commandant la 3e Compagnie
avait reculé son P.C. jusqu'à la grand 'route Baraque Fraiture-La Roche, à deux
kilomètres environ. Il me prit à part pour dire ce qu'il en
pensait et bien sûr, moi, petit sergent de réserve, je n'émis aucun
commentaire. Resté seul, je trouvais cependant
bizarre ce transfert du P.C. à la dernière minute. L'adjudant revint à nouveau.
Je devais mettre au courant de cette situation le sous-lieutenant Kremer, officier
de garde à Gouvy, qui allait venir d'un instant à l'autre prendre le
commandement du second peloton. Vers treize heures, le lieutenant Kremer
arriva fourbu, fatigué à l'extrême limite. Il avait fait exploser le pont de
Gouvy au nez et à la barbe des Allemands. Revenu à moto à travers la forêt
ardennaise, contournant les nombreuses chicanes, il avait dû faire
littéralement du moto-cross ; heureusement sa moto Saroléa avait tenu bon. Il
n'avait rien avalé depuis la veille et je n'avais rien à lui offrir, mes
biscuits de réserve se trouvaient dans une de mes besaces attachées à mon vélo,
qui se trouvait à cinq cents mètres d'où nous étions. Je lui fis un petit topo de la
situation. Il s'assit dans un trou vacant et ne tarda pas à s'endormir d'un
sommeil paisible et réparateur. Il était vraiment vanné à l'extrême. Les soldats et moi contemplions, les
larmes aux yeux, la rage au cœur, les paysans hébétés qui fuyaient avec leur
bétail. Ils tiraient les objets les plus hétéroclites accusant déjà la fatigue
et nous saluant dignement. Qui avait donné cet ordre imbécile de
tout quitter ? Pourquoi ne pas rester au logis, Grand Dieu ? Où allaient-ils ainsi désespérément ?
Que comptaient-ils trouver plus loin ? C'était donc cela la panique ! Progressivement le silence se fit. Un
silence étrange. Même les oiseaux en ce beau jour de printemps ne chantaient
plus dans les sous-bois. Au loin, dans la forêt vers les Tailles, des
vrombissements de moteur allaient grandissant. Ils se rapprochèrent, et nous
n'entendîmes plus que cela. Soudain, comme nous l'attendions depuis longtemps,
le premier coup de feu retentit. Qui le tira le premier ? Eux ? Nous ??? Des motos descendaient la route dans une
pétarade folle qui se mariait avec les rafales rageuses de nos fusils
mitrailleurs. Le petit pont de la rivière sauta, cachant momentanément
l'ennemi. Sur le flanc de la vallée opposée, un char
seul, s'avançait dans un chemin de terre caché par les buissons touffus puis
ressurgissait soudain. Mis en batterie et tirant rageusement, les grenades de
nos D.B.T. l'encadrèrent. Nous ouvrions la bouche à chaque départ. Nous nous
encouragions en hurlant sans le savoir. Miaulement vicieux, la mitrailleuse du
char nous encadra, nous obligeant à cesser le feu momentanément. Nous nous
tenions, qui dans la tranchée, qui à l'abri bien factice d'un sapin. Quelle
trouille Bon Dieu !!! Effectivement, j'appelai le Dieu que je
connaissais de tout mon être. Je crois qu'Il me rendit un peu de ce courage
dont j'avais bien besoin. Je me hasardai à jeter un coup d'œil. Incroyable
! un officier allemand en képi, comme si rien n'était nous observait de ses
jumelles debout sur la tourelle du char. Nos D.B.T. y allèrent de plus belle.
L'officier ennemi descendit calmement, lentement du blindé, je n'en revenais
pas. Quant à moi, en toute modestie, j'avais
retrouvé un peu de mon calme. Au début de l'action, j'avais éprouvé une peur
intense, immense, je l'avoue toute honte bue. Mais actuellement, je n'avais
plus peur, vraiment plus peur. J'étais d'un calme absolu. Le temps passait à la
fois vite et lentement. Je me rappellerai toujours ce soldat allemand étendu
près de la rivière, grièvement blessé sans doute et qui appela pendant des
heures : « Mutti, Mutti ». Il appelait vainement sa mère ; ceci non plus, je ne
l'ai pas oublié. Le soleil se couchait et brusquement, ce
fut l'attaque à revers, sur la gauche du premier peloton de fusiliers. Le
lieutenant Kremer nous donna l'ordre d'aller aux vélos. J'armai mon G.P., les
soldats mirent la baïonnette au canon et ce fut la course éperdue ; le cœur qui
bat à tout rompre, une lucidité et une vision extraordinaire du lieu, des
gestes des camarades, du lieutenant qui nous précédait. Où était passée la
section D.B.T. ? Des hautes flammes rouges et orange embrasaient nos baraquements.
Des lueurs rapides et brèves jaillissaient vers nous. Le lieutenant Kremer
tomba. Bastin et un autre boulèrent tels des lapins blessés à la traque. D'un seul bond, d'un seul, j'avais sauté
la haie d'aubépines longeant le pré. Une lune sanglante et ironique qui me
découvrait, me montrait admirablement aux yeux de l'ennemi. Je constatai que j'avais vidé le
chargeur de mon pistolet instinctivement sur qui, sur quoi ? Je réarmai mon
G.P. tel un automate. J'entendis les Allemands qui hurlaient
leur victoire. Je m'orientais, non, je n'étais pas perdu. Je sus tout de suite
où je me trouvais. Je revoyais ce qui s'était passé... Je m'orientais. J'allai
sud-ouest délibérément. Il fallait que je retrouve les miens : les Chasseurs
Ardennais. Je ne voulais pas être leur prisonnier. Oui, je devais retrouver mon
bataillon, mon régiment. Je marchai, je courus. Un béret vert dans
une clairière. Il conduisait son vélo à la main, je le hélai, c'était le
caporal Schmidt. Je l'avais connu dix-huit mois auparavant, à la compagnie-école,
un bon Ardennais. Nous atteignîmes la route Baraque
Fraiture-La Roche. Je me juchai sur son porte-bagages. La route descendante
nous permit de joindre assez rapidement l'arrière-garde de la Compagnie Motos
commandée par le commandant Dupont. J'allai vers celui-ci et lui contai
brièvement ce qui s'était passé. A plusieurs reprises le commandant me demanda
de baisser le ton. Les D.B.T. m'avaient assourdi complètement. L'épisode de
Chabrehez était terminé, mais un autre homme était né en moi. J'avais appris à
haïr. Je haïssais cet ennemi... … Pas mal de choses ont été dites et
écrites sur le combat de Chabrehez. Loin de moi d'en connaître la primeur, mais
ce que je dis et écris formellement, c'est que la vérité en a été un peu
tordue. Parfois, par certains à l'affût d'une croix de guerre qui ferait bien
sur leur veston. Par d'autres, pour la jactance. La conclusion pour moi est celle-ci :
nous avons résisté à un contre quatre. Ils avaient des chars, nous n'avions
même pas un canon antichar 4/7, le nôtre était parti comme par hasard, en
révision quelques jours auparavant. Ils mirent des heures pour passer. Leur
chef était le générai Rommel en personne. Cela dit tout. Pour un baptême du feu
contre des troupes aguerries, ce n'était pas si mal. Les anciens de la magnifique
8e Armée Britannique ne me démentiront pas. Je redescendis vers Barvaux avec une
estafette motocycliste se rendant au P.C. régimentaire. Pendant cette randonnée
sans aucune exaltation, je revécus comme je revivrais encore souvent : le
combat de Chabrehez. Je revoyais les soldats ennemis, manches retroussées, cols
de veste largement ouverts, poussant des « HURRAH », fanatisés, et forçant
malgré tout mon admiration. Je les haïssais cependant de toutes mes forces. J'arrivai sous bonne escorte à
Barvaux-sur-Ourthe. Le conducteur du side-car me conduisit chez ses parents. On
me fit une véritable fête. On me fit laver, je changeai de linge et de
chaussettes que je gardai, soit disant en passant, presque tout au long de la
campagne. Je me rappelle toutefois encore avoir dévoré une de ces vraies
fricassées ardennaises. Je bus jusqu'à plus soif, deux grands bols de café,
faits pour réveiller un mort. Braves gens, je les remerciai du mieux que je
pus. Ils trouvaient cela normal d'aider un des leurs. Après la guerre je
recherchai en vain ces personnes. Sans doute avaient-ils quitté la région ? ...
Tout cela m'avait remis du cœur au
ventre. Je marchai une bonne partie de la nuit. La gaine de mon pistolet
battant ma cuisse droite se rappelant ainsi à mon bon souvenir. Rien n'était
fini, et, tout commençait. Je rencontrai des Chasseurs du 2e
Bataillon. Ils m'apprirent que ma compagnie se trouvait du côté d'Ouffet. Je
rejoignis effectivement ce qui restait de ses effectifs vers quatre heures du
matin. En chemin, une voiture civile qui filait vers Huy s'arrêta aimablement.
Elle me véhicula jusqu'à Fraigneux où s'était installé le P.C. du 1er
bataillon. Je
fus appelé chez le major Van Espen (un héros de l'autre guerre) qui était
accompagné du commandant Flébus. Ce dernier avait pris momentanément le
commandement de la 3e Cie. Ils me firent raconter ce que j'avais vu
à Chabrehez. Je leur dis et ne leur cachai même pas l'histoire de changement de
P.C. Ils me questionnèrent à ce sujet. Pourquoi leur aurais-je menti ? Ils
connaissaient, Dieu sait comment, la mort des sous-lieutenants Gourmet et
Kremer. Ils me dirent que j'avais été porté disparu en même temps que le
sergent Flamand, les caporaux Michel et Schmidt et les soldats Léonard et Avalosse.
Tous les cinq réintégrèrent vaillamment
la compagnie peu après. Ce furent tous les hommes qui revinrent du premier et
du second peloton, d'une section de mitrailleurs et de D.B.T. Sept Chasseurs Ardennais étaient morts
au combat, dont deux officiers. J'appris après la guerre que les hommes
de troupe fait prisonniers restèrent sans boisson et sans nourriture jusqu'au
lendemain soir. Pour les Allemands, une façon comme une autre de montrer qu'ils
étaient bien les vainqueurs. Vers sept heures du matin, le 11 mai, je
rejoignis le peloton et demi qui formait encore la 3e compagnie. Je fus heureux de revoir tant de visages
connus qui avaient été gais et joyeux. Ces figures avaient changés. Elles
étaient marquées par la tension et l'inquiétude. Tous ces braves Ardennais
avaient quitté irrémédiablement leurs terres et leurs biens déjà foulés par
l'ennemi. Les gars s'étaient admirablement débrouillés. Les trous de fusiliers
étaient complètement achevés y compris les barbettes et les créneaux
réglementaires. Les emplacements des fusils mitrailleurs avaient été fignolés
comme ils ne le furent jamais lors des plus belles manœuvres. Une seule chose
manquait : la « bouffe ». Notre cuisine roulante avait encaissé un des premiers
obus tirés par les tanks allemands. Il fallait donc se débrouiller autrement.
Des hommes furent envoyé à Ouffet avec pour mission de trouver des vivres, ce
qu'ils firent avec dévouement et sagacité. La population d'Ouffet leur
facilitant la besogne en se montrant accueillante et généreuse. Je reçus finalement une nouvelle
bicyclette, mais je dus me passer de sac et de capote. Je ne pus jamais
retrouver mon sergent fourrier. La journée du 11 mai se passa à l'ombre des
arbres bordant le Néblon ; une des plus belles rivières de notre pays, soit
dit-en passant. Je dormis sagement, assez pour récupérer mes forces. Vers vingt heures, le commandant Flébus
me désigna pour aller en patrouille avec deux hommes de mon choix. Ce choix;
fut vite établi: Fernand Léonard et Pol Avalosse se présentèrent volontairement
et sans mot dire nous partîmes. Munis de nos armes respectives nous
prîmes chacun trois grenades Mills et après avoir marché cinq cents mètres
environ, gagnâmes un endroit en surplomb. Cachés par les taillis et surveillant le
carrefour de Fraigneux admirablement, nous attendîmes le char « annoncé »
puisque char il y avait. Ce blindé vint en effet assez rapidement. Surgissant
de la route d'Ocquier il avançait à belle allure. Un soldat laissant apparaître
la tête et les épaules hors de la tourelle ouverte, observait la route. Son
casque était du même gabarit que ceux de nos chasseurs des 4/7. C'était
un Renault français. Et la vigie, un Parisien sans conteste. Léonard et
Avalosse échangèrent des cigarettes. Le blindé repartit immédiatement vers
l'ennemi. Le « titi » nous avait promis sans complexe qu'on allait voir ce
qu'on allait voir. Nous le vîmes en effet plus tard. Nous constatâmes amèrement
au cours de la retraite que les fantassins français étaient de loin moins bien
équipés que nous les Chasseurs Ardennais. Nous qui avions vu les Allemands d'assez
près pouvions juger à bon escient. Il existait incontestablement une différence
sensible entre l'équipement des Panzers allemands et des blindés français. Je
n'avais jamais été défaitiste, au contraire. Et, que l'on ne me cite surtout
pas les statistiques des Armées faites en ce temps-là par « Paris-Match ».
C'est trop simple et trop facile. Les faits furent établis en ces jours de
mai 40. Je n'ai jamais cru aux statistiques. Elles sont faites dans les
ministères afin que certains grands « esprits » aient bonne conscience. Durant
la nuit du 11 au 12 mai, le premier bataillon du 3e Régiment de
Chasseurs Ardennais fut rassemblé au Château de Fraigneux et après nous être
endormis d'un sommeil de plomb, nous fûmes réveillés sans ménagement. Vingt
minutes plus tard, nous filions tous phares éteints : direction Engis. Nous devions prendre position le long de
la rive gauche de la Meuse. Ma compagnie était maintenant commandée par le
lieutenant Stevelinkx. Elle ne s'attarda guère dans la bonne cité engissoise.
Nous apprîmes que le canal Albert qui devait tenir, avait été pris sans coup
férir, par l'armée allemande. Il ne nous restait plus qu'à nous regrouper
au-delà de Namur. Ce que nous fîmes sur l'heure. Et c'est ainsi qu'à la pointe
de l'aube nous filions vers Huy. La masse des réfugiés nous ralentissait
sensiblement. Je regardais de tous mes yeux si je n'apercevais aucune de mes
connaissances. Je passai ainsi à quelque trois kilomètres de ma maison natale
où habitaient toujours mes parents. J'étais sûr que ma mère ne quitterait pas
la maison. Seul mon père encore mobilisable aux chemins de fer pouvait partir.
Une envie folle de rejoindre les miens s'empara de moi. En un quart d'heure, je
pouvais être chez eux, les embrasser. Je restai avec ma compagnie. A la minute même où je décidai de
rester, je devins insensible à tout. J'étais devenu mauvais. Ma haine s'était
encore durcie. Une haine implacable pour l'Allemand. Cette haine, j'allais la
garder de nombreuses années encore. Sous l'impulsion du lieutenant Stevelinkx,
ma compagnie roula plus vite encore, comme à l'exercice presque. Nous traversâmes
Burdinne et nous fûmes rapidement sur la grand’ route Hannut-Namur. Pourquoi
allions-nous si rapidement ? Nous avions le sentiment de nous enfuir. Les
ordres étaient les ordres. Nous les petits n'avions pas à discuter. Depuis Fraineux,
j'étais personnellement sous la férule de l'adjudant Monneau. Il avait remplacé
mon chef, le sous-lieutenant Kremer. Sachant que j'étais du pays l'adjudant
Monneau me confia la charge de sergent retardataire. J'avais le devoir de
ramener les chasseurs accidentés ou à la traîne. Au carrefour de la route
d'Eghezée, alors que j'étais accompagné de deux hommes ayant subi une
crevaison, nous vîmes un bombardier vert de gris marqué d'une grande croix
noire. Il volait très bas presque en rase motte. Prenant la route en enfilade,
il commença à nous mitrailler. Le temps de jeter nos vélos, de nous balancer
dans le fossé longeant la chaussée, il était loin. Pas pour longtemps, il
faisait demi-tour nous cherchant délibérément. Un des hommes détachant son F.M.
le mit rapidement en batterie. Au nouveau passage du bombardier le tireur lui
envoya tout son chargeur, une giclée bien arrosée nous sembla-t-il. Nous
rejoignîmes éperdument les murs d'un café sur le bord de la route nous abritant
tant bien que mal, contournant la maison au gré de là fantaisie du pilote
revenant sans cesse nous arroser de son feu meurtrier. Lassé sans doute, il
nous abandonna à notre sort. Dignes de nos grands coureurs cyclistes de
l'époque, nous sautions sur nos bécanes intactes et à toutes pompes nous sprintions
en direction de Namur. J'appris bien plus tard que deux avions étaient revenus
et comme pour se jouer avaient bombardé ce paisible immeuble tuant et blessant
de nombreux civils qui en avaient fait leur havre. Aurions-nous mieux fait de
ne pas riposter ? Etait-ce notre faute ? C'était-ça la guerre. Ma compagnie avait enfin fait halte aux
abords de Gelbressée... L'adjudant Monneau me dit que la 1ère
Division de C.H.A. se rassemblait à Temploux ... Les premier, deuxième et
troisième régiments de Chasseurs Ardennais étaient sans conteste, la meilleure
division de toute l'armée belge de 1940. C'étaient les bérets verts de la
frontière de l'Est. L'adjudant Monneau m'adjoignit de ne le quitter sous aucun
prétexte. Ce que je fis. Nous traversions bientôt Namur, en butte aux premiers
bombardements. Montant vers Belgrade, une escadrille de Stukas piqua vers nous.
Une cave nous abrita un instant. Le major Deneef commandant le IIe
Bataillon y vint également. Délaissant cet abri trop précaire à nos yeux, nous
rejoignîmes bientôt la plaine de Temploux. Quelques instants après notre
départ, une bombe éclatait, tuant le colonnel du 1er Chasseurs Ardennais
et notre bon major Deneef. Nous tombions de Charybde en Scylla. Je ne sais quel
fut le général insensé qui fit se réunir l'élite de notre armée sur cette
plaine sans défense. Nos mitrailleuses étaient restées en arrière. Nous
restions encaqués, sans aucun défilé pour nous abriter, sans aucune protection
contre les bombardiers. Une fois le bombardement du fort de Suarlée accompli,
ces avions venaient comme à plaisir nous mitrailler à merci, sûrs qu'ils
étaient de leur impunité. Une compagnie du second bataillon crut
bon de s'abriter dans un des rares petits vergers de l'endroit. Mal lui en
prit. Elle subit des pertes énormes. Nos mitrailleuses, des Maxims de 14-18
étaient dans des camions qui ne pouvaient pas nous joindre dans cet enfer de
feu. Que pouvions-nous faire avec nos armes d'infanterie ? Nous n'avions rien
d'autre à leur opposer. Ce fut réellement un jeu pour l'aviation allemande de
nous massacrer. Nous n'étions plus à l'époque de la chevalerie, ils en
profitèrent. Et le général incapable et coupable de nous avoir réunis en cet
endroit, ne fut sans doute jamais inquiété. Temploux[3]
signifia pour nous bien des choses. Oui nous étions à Temploux et il y
pleuvait dru. Que de bons et excellents soldats, que
de vies auraient pu être épargnés, que de morts et de blessés inutiles. Un ordre imbécile : des conséquences
tragiques firent de ce rassemblement une sanglante mêlée. Et cependant dans ce désordre inouï, que
d'actes courageux. Je revois toujours un lieutenant-médecin prodiguant ses
soins aux blessés comme si rien ne s'était passé autour de lui, comme si le
bombardement n'avait pas eu lieu. « Si mes souvenirs sont exacts, ce docteur
était Jean Petit, ancien joueur international du Standard, le frère de l'actuel
secrétaire de notre cher club wallon. » Cela valait bien en classe, l'épisode de
l'officier allemand des Panzers à Chabrehez. Cela méritait d'être dit
également... Si nous nous étions attardés un peu plus
longtemps dans cette plaine néfaste, notre division eût été décimée
radicalement. Nous comprîmes tous, du simple soldat aux officiers qu'il valait
mieux s'égailler. Mon peloton suivit l'adjudant Monneau jusque dans les
faubourgs de Charleroi. A la nuit tomée, le gîte nous fut offert dans une école
de l'endroit. Nous couchâmes sur la dure. Il n'y avait pas que nous. Le lendemain matin nous nous dirigions
vers la cité de « Djan Djan », Mal nous en prit. A peine arrivés, nous fûmes
bombardés une fois de plus et nous dûmes mordre la poussière des fonds de
rigole de Nivelles. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, cette belle
et noble cité fut en partie détruite et son joyau, la collégiale brisée à
jamais. Ainsi un pur chef-d'œuvre de chez nous acquis depuis des siècles fut
anéanti en un instant. Nos vélos étaient inutilisables,
complètement hors d'usage. Nous mîmes le cap sur Bruxelles pédestrement, nous
étions devenus des fantassins. Nous dépassâmes notre capitale bien triste. Où
était le bon temps de l'expo de 1935 ? Péniblement, nous rejoignîmes
Grimberghen, toujours « pedibus » bien sûr. Un centre de regroupement y
était installé. Nous fûmes nourris et désaltérés et en bonne infanterie disciplinée
nous rejoignîmes Alost, tiraillant tant bien que mal en compagnie de soldats britanniques
sur des avions ennemis évoluant à trop haute altitude. Puis, la chance évoluant,
le chauffeur d'un camion du 3e CH.A., perdu comme nous, eut la bonne
obligeance de nous charger jusque Gand. Et, là, à force d'investigations et de
roublardise, nous retrouvions des vélos « Van Hauwaert » et de quoi nous
sustenter largement. L'adjudant Monneau disparut un moment. Il nous revint avec
des nouvelles fraîches. Nous devions nous rendre à Bruges et aller aux ordres
chez le commandant de la place. Avant de partir pour la Venise du nord,
nous dormîmes confortablement dans une villa de Melle et le lendemain, nanti
d'une barbe impressionnante de saleté, nous arrivions dans la jolie cité des
canaux. L'adjudant Monneau alla donc aux ordres comme prévu. Il nous apprit
qu'il était fait sous-lieutenant ; ce qui ne changeait rien pour nous,
accoutumés que nous étions à la discipline. Nous devions, situation étrange,
nous rendre en France pour nous reformer. Les choses étant ce qu'elles étaient
ou du moins ce qu'elles paraissaient être ; nous gagnâmes la France, avec tout
le peloton. En quelques étapes, nous atteignîmes Amiens, Abbeville, Conches,
puis enfin un village dont je n'ai plus de souvenance. Nous avions pu faire un
brin de toilette et nous nous étions restaurés suffisamment, quand l'ordre vint
de nous embarquer vers une destination lointaine. Un train (hommes quarante,
chevaux en long huit) nous conduisit à Pont-Sr-Esprit en plein Sud de la France
où paraît-il étaient reformées des compagnies d'instruction prêtes à monter au
front. Dans ce wagon misérable, j'eus la très grande joie de retrouver deux de
mes bonnes vieilles connaissances : le caporal Emile Tromme de la 2e
Cie, mon ancienne compagnie du temps de paix et le soldat mécanicien Armand
Leblicq, un bruxellois. De copains, que nous étions, nous devînmes des amis
inséparables. Pendant ce voyage qui nous éloignait toujours plus du front et de
la bataille, nous apprîmes la capitulation de notre armée. Les Français ne se
firent pas faute de nous l'apprendre dans des termes sans équivoques. Tromme,
Leblicq et moi ne mirent jamais un instant en doute la bonne foi de notre chef,
le Roi des Belges. Jamais, au grand jamais aucun des trois n'eut le moindre
doute sur l'issue de la guerre. Nous devions continuer la guerre malgré et
contre tout, quoiqu'il advint. Notre même idéal, nos mêmes idées, notre même
foi aussi firent que nous formions un trio que rien ne pouvait séparer. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, rien
ne nous a séparés. L'arrivée à Pont-St-Esprit : plutôt mal
que bien ! Des divisions au sujet du Roi s'étaient
créées dans notre peloton. Même parmi nos chefs. Tromme, Leblicq et moi assistions à la
messe un dimanche à Pont-St-Esprit. Nous y revoyions notre ancien adjudant de
compagnie du temps de paix ; l'adjudant-chef Meunier. C'était un « crack » et
un meneur d'hommes superbe. Il vint nous chercher un soir de désœuvrement, et
nous dinâmes à son mess comme nous l'aurions fait en Belgique. Steack, pommes
frites, salade le tout arrosé d'une bonne bière belge qu'il avait pu récupérer
Dieu sait où. On jura de se retrouver coûte que coûte.
(Je le retrouvai effectivement au camp des « Nacht und Nebel » d'Esterwegen. Il
devait mourir à Dachau). Nous portâmes un toast au Roi et à notre
régiment. Puis, nous le quittâmes avec regret. Un nouvel épisode commençait. Nous
allions remonter vers la Bretagne, au camp de Malestroit, où avait été créée
précédemment une nouvelle division polonaise. Nous devions recomposer avec des
éléments des deux divisions de CH.A. un nouveau régiment structuré et armé
selon de nouvelles méthodes françaises. C'est du moins ce que nous dit le
sous-lieutenant Monneau. La plupart des hommes durent remettre les fusils et
les F.M. qu'ils avaient trimballés jusque là. Précisément Tromme, Leblicq et moi
avions gardé nos fameux G.P. 9 mm ainsi que nos chargeurs Il n'était pas
question de les rendre. L'adjudant Meunier avait fait parvenir à chacun de nous
trois, quatre autres chargeurs supplémentaires, quand il avait connu notre
destination. L'armement pour les soldats et les sous-officiers consistait dans
la possession du vieux fusil Mauser de 1889, sans munitions. Et c'est ainsi que
nous réintégrâmes notre nouveau wagon « homme quarante, chevaux en long huit ».
J’eus la satisfaction d'y retrouver les sergents Gillet et Reisdorff, des
copains de la compagnie école de Namur. Ivan Reisdorff était le fils du
lieutenant Reisdorff du 10e de ligne tué à l'ennemi en 1914. Il
était docteur en droit. Gillet était ingénieur agronome. Il y a un mois encore
tous deux étudiaient à l'Institut Colonial d'Anvers où ils préparaient des
cours les destinant à se rendre utiles au Congo Belge. C'étaient deux chies
types. Après les présentations d'usage, ils firent partie de notre équipe
instantanément. Ivan Reisdorff avait lu les journaux
français et avait en outre entendu les nouvelles à la radio. D'après lui elles
n'étaient pas fameuses. Nous résolûmes de ne plus nous quitter et de tout faire
pour éviter notre emprisonnement. Ayant roulé toute la journée et toute la nuit
sans arrêt, nous arrivions à Saint-Nazaire et pouvions enfin mettre pied à
terre. Nous fîmes la connaissance de volontaires britanniques qui venaient
d'arriver également sur une voie proche de la nôtre. Le peu de rudiments
d'anglais encore connus depuis l'école nous revinrent à la mémoire. Notre
jargon suffit cependant largement pour que nous ayons droit à des boîtes de
conserve et des paquets de cigarettes « Players ». Ce ravitaillement impromptu
garnit nos musettes immédiatement et nous vint à point dans les jours qui
suivirent. Je crois bien que ce furent ces mêmes Britanniques ou du moins une
partie d'entre eux qui furent coulés au large de cette ville. Deux mille
environ furent coincés sous la coque de leur navire bombardé qui se retourna
dessus-dessous. Peu d'entre nous acceptèrent le thé qu'ils nous offraient si
généreusement, préférant le cidre et le vin que l'on nous distribuait dans une
cantine de la gare. Leblicq m'avait confié ainsi qu'à Tromme
qu'il était en possession de cinq mille francs belges ; une petite fortune pour
l'époque. Il entendait bien la partager entre nous trois. Il résolut d'aller
faire le change. Nous le consacrâmes de bon cœur « trésorier » ; d'autant plus
que l'argent lui appartenait. Ce fut lui qui nous empêcha d'avoir faim, et
grâce à son argent et avec les vivres qu'il nous apporta, il nous tint en bonne
condition physique... ... Nous étions à Saint-Guyomard,
exactement dans un grand château ; tenu avant nous par des Polonais. C'était à
cet endroit en effet que le gouvernement polonais en exil avait rassemblé
toutes les forces polonaises venues du monde entier. J'ai su par la suite que la plupart
d'entre eux furent prisonniers pour le restant de la guerre. Dix pour cent
seulement parvinrent à s'échapper et à reprendre les armes. Notre équipe était parvenue à entrer en
possession d'une tente en dehors du château. Nous évitions ainsi la vermine qui
y pullulait. Nous en fîmes notre havre. Nous cuisinions à l'air libre. Une
vieille marmite et une louche nous servaient à la préparation de notre maigre «
frichti ». Notre ami Leblicq élu fourrier à
l'unanimité nous procurait du pain et du chocolat achetés au village voisin. Serrés les uns contre les autres nous
nous endormions en commentant les nouvelles de la guerre. Nous discutions des
heures entières avec nos voisins. Il nous était bien facile de deviner déjà les
défaitistes et pire encore. Tôt le matin, Tromme et moi, pêcheurs
invétérés, allions tirer quelque menu fretin de la rivière proche. Ces petits
poissons amélioraient notre ordinaire. Tromme avait repéré à cinq kilomètres du
château, une grosse ferme où nous parvînmes à négocier des vieux singlets et
des caleçons datant sûrement des « Chouans ». Je me procurai notamment une
vieille culotte de cheval qui remplaça la mienne usée jusqu'à la corde.
Subitement, un soir nous apprenions que la France allait capituler elle aussi.
Le jour suivant des camions vinrent nous prendre et nous conduisirent à La
Roche-sur- Yon en Vendée. Nous apprîmes également qu'on voulait
nous emmener dans un camp de prisonniers situé à proximité de la Vilaine. Il
n'en était pas question. Le sous-lieutenant Monneau, Reisdorff, Gillet, Tromme,
Leblicq, Lodomez, José Moyse, Maus, trois autres chasseurs ardennais et moi-même
tinrent conseil et décidâmes d'avertir les commandants Van de Casteele et
Cambier. Ces officiers avaient paru être des hommes de confiance. Eux
aussi voulaient continuer la guerre à tout prix. Nous avions décidé de nous
rendre en Grande-Bretagne envers et contre tout. Nous les mîmes au courant de
notre projet. Ils acceptèrent immédiatement. La chance sourit aux audacieux,
dit-on ; c'est vrai. Elle nous exauça particulièrement. Nous apprîmes
fortuitement qu'un vieux Vendéen avait réussi à cacher un camion Bedford
provenant de l'Armée britannique. C'était un ancien poilu de Verdun. Il nous le
confia gentiment en nous souhaitant « Bon voyage ». Lodomez nous conduisit jusque sur le
quai du petit port de pêche de la Turballe. Sans hésiter nous mîmes le feu au
camion. Encore un qu'ils n'auraient pas. Devant nous l'Océan Atlantique, libre
comme nous. A quelques encablures un destroyer battant pavillon britannique. La
mer ne m'avait jamais paru aussi belle. Le patron d'une barque de pêche nous
invita à bord et nous mettions le cap sur ce bateau du Royaume-Uni. Il
représentait pour nous tout ce qui nous restait de liberté. Il pouvait nous
conduire, là, où nous voulions combattre, tous autant que nous étions. On aurait cru qu'il n'attendait plus que
nous pour partir vers son port d'attache. Et bientôt nous laissions la France
vaincue sur laquelle nous avions tant comptée. Notre patrie déjà courbée sous
le joug ennemi. Notre Roi était prisonnier. Nos camarades, les Chasseurs
Ardennais, étaient depuis un mois en Allemagne. Oui, nous avions la chance infinie de
pouvoir partir sans nous rendre. Nous accostâmes enfin. En un clin d'œil nous
fûmes à bord du « His Majesty's Ship Imogen ». Le pavillon de la Royal Navy
flottait fièrement au vent du large. (Je signale en passant, que le H.M.S.
Imogen se perdit corps et biens un mois environ après notre escapade). Les « cups of tea » étaient déjà là que
nous ne pouvions décemment refuser. Elles nous étaient servies en même temps
que de nombreux sandwiches au jambon et au chester. Puis les marins nous
offrirent les inévitables chocolats « Cadbury » et les « Players » bienvenus.
Le destroyer avait mis le cap vers le plein océan. Dans le lointain nous
apercevions encore vaguement les côtes de France. J'avais les yeux embués de
larmes, je l'avoue sans fausse honte. Aurions-nous le bonheur de revoir cette France
! Reverrions-nous jamais notre petite Belgique !!! Cependant, jamais un instant alors que
tout était contre nous, jamais je n'ai cru au triomphe du nazisme. J'avais la
foi qui soulève les montagnes. Je ne pouvais admettre le triomphe d’Hitler.
Pendant tout le restant de cet après-midi et de cette soirée, nous tînmes
compagnie aux marins servant les « Ackack guns ». Nous fûmes invités à partager
le dîner de l'équipage. Ils nous apprirent le désastre de ces deux mille
soldats Britanniques morts noyés devant Saint-Nazaire. Nous
nous étendîmes à même le pont du navire pour sombrer rapidement dans un sommeil
réparateur. Leblicq déjà levé, rasé de frais
m'éveilla. J'enlevai, décapai plutôt ma barbe, vieille d'une semaine au moins,
remis de l'ordre dans ma tenue nettement défraîchie, cirai mes bottines et mes
guêtres. Je voulais être présentable aux yeux de nos futurs hôtes. Et, c'est
coiffé du vert béret garni de la hure symbolique que nous descendîmes fièrement
entre deux haies de curieux au son d'une marche militaire exécutée par un «
band » des « Royal Marines ». En
Grande-Bretagne Jamais de toute ma vie, je n'oublierai
cet accueil que nous réserva Plymouth !, et l'Angleterre ! Où était cette
réserve britannique ? Où était cette froideur anglo-saxonne ?
Nous étions conduits dans une école, mangions et buvions à satiété. Chacun
d'entre nous prit une douche merveilleuse, reçut un rasoir, un savon, une
brosse à dents et un essuie. Dans une salle de l'école un lit de camp garni de
couvertures nous attendait. Nous n'avions plus vu cela depuis longtemps. Un sergent payeur nous délivra une «
pound » à valoir, sans doute, sur une prochaine solde. Au crépuscule de cette
fameuse journée nous admirions les barrages de ballons captifs protégeant
d'innombrables navires de guerre dans ce port s'étendant à perte de vue. Nous fûmes reçus dans les « pubs » de
cette ville accueillante et nous bûmes à l'œil « whiskies » et bières de toutes
sortes. Je ne sais plus comment je parvins à réintégrer ma salle d'école. Le
lendemain nous étions en pleine forme et c'est lesté d'un bon breakfeast que
nous prîmes le train qui nous conduisit à Tenby via Bristol. Le bruit avait
couru à Tenby qu'une dizaine de Chasseurs Ardennais arrivaient. Une des
premières personnes que nous aperçûmes dans la foule fut le vicomte Arthur de
Jonghe. Sa mère avait habité, avant guerre, un château à Vielsam. Elle avait
offert également un des fameux cors de chasse composant la clique de mon
régiment. Après des présentations sommaires et
après avoir parlé plus longuement de nos aventures, nous fûmes logés dans ce
qui avait été un de ces hôtels bourgeois de cette perle du Pays de Galles. Tenby était le centre de regroupement
des soldats belges arrivés en Grande-Bretagne. Elle était aussi le
rassemblement de types de tous poils. Il y avait même les quelques inévitables
extrémistes flamingants prédisant la victoire totale de l'axe. Ils ne la
prédirent pas longtemps. Un matin très discrètement on les embarqua. Jamais
plus on n'entendit parler d'eux. Ils ne pesaient pas lourd dans la balance. Bon
débarras. C'était très bien ainsi. En ces temps-là, les Britanniques ne
badinaient pas et pour cause. De jour en jour, le vicomte de Jonghe, Leblicq,
Tromme et moi devinrent de plus en plus liés. La veille du 21 juillet, notre fête
nationale, le vicomte nous fixa rendez-vous dans un vieux « pub » de l'endroit.
Entre-temps, Leblicq, Tromme et moi
avions fait notre demande pour passer comme mitrailleur arrière dans les bombardiers
de la Royal Air Force. Aucune réponse ne nous parvint jamais. Nous avions mis
le vicomte de Jonghe au courant de nos projets, bien sûr. Il ne nous avait
nullement désapprouvé. Nous avions reçu de splendides « battle-dress
» qui remplacèrent avantageusement nos uniformes malmenés et raides de crasse.
Nous avions cependant refusé le calot. Nous portions ostensiblement nos bérets
verts. Nous ne tenions, bien sûr, aucun compte des ordres donnés concernant le
port obligatoire de notre nouveau couvre-chef, le « cap » britannique. C'est donc le crâne toujours garni du
béret vert que nous abordâmes la vieille auberge galloise où nous attendait le
vicomte. D'emblée Arthur de Jonghe nous posa la
question à brûle pourpoint. Voulions-nous être volontaire pour des missions
spéciales sur le continent occupé ??? Vous avez, nous dit-il, une chance sur
trois de vous en tirer. Il avait vu juste puisque Tromme et Leblicq n'en
revinrent pas. Il nous pria de garder bouche cousue envers quiconque. Il nous
demanda de réfléchir longuement avant de lui donner réponse. Le lendemain 21
juillet à midi très exactement on nous fit défiler dans les rues de Tenby.
Défilé lamentable, s'il en fut. L'après-midi un concours d'athlétisme avait
été organisé. J'eus la chance de gagner le 100 mètres plat et le relais 4 fois
100 mètres en compagnie d'Ivan Reisdorff, de Lodomez et de José Moyse. Les
Chasseurs Ardennais y furent donc à l'honneur. Le 25 juillet le vicomte de Jonghe nous
fixa derechef rendez-vous. Tromme, Leblicq et moi, sans nous être concertés
d'aucune manière, étions volontaires. Nous nous déclarâmes être prêts à partir
pour le meilleur et pour le pire, comme dans les manages. Par après le vicomte nous avoua sincèrement
qu'il n'avait jamais douté de notre disponibilité. Aucun d'entre nous n'avait prononcé de
grandes phrases ; mais nous savions que nous pouvions compter l'un sur l'autre
en toutes circonstances. De toute façon nous étions embarqués sur
la même galère. Et nous étions contents, heureux de pouvoir servir... Le huit août 1940 nous quittions Tenby,
le cœur à l'aise. Nous partions tous trois, Leblicq, Tromme et moi. Direction
Victoria Station à Londres où le vicomte nous attendait, sur le quai de la
gare. Nous étions enfin débarrassés de cet
infect esprit de Tenby 1940. Je m'y sentis souvent, je l'avoue sans honte, très
peu fier d'être Belge. Certains jours passés dans cette jolie ville balnéaire
furent bien tristes pour ceux qui voulaient encore combattre et ne pas se
planquer. Nous étions donc à Londres et nous
logions dans une chambre du rez-de-chaussée de la conciergerie à l'ambassade
belge d'Eton Square. Après avoir déjeuné au « Lyori's » de Leicester Square,
nous allions saluer le baron Cartier et le major B.E.M. Cumont, attaché
militaire à Londres. (Le major Cumont était un vrai chef, un des rares de
l'armée belge se trouvant en Grande-Bretagne à cette époque). Nous fûmes très
bien reçus. Un home de l'Y.M.C.A. était à deux pas
de là, nous y passions pour ainsi dire toutes nos journées à essayer de lire
les journaux britanniques, à écouter Radio-Paris qui mentait déjà à cette
époque. Nous devenions également des joueurs valables au billard anglais. Un
jour que nous étions complètement démunis d'argent, nous l'avouâmes en toute
simplicité au major Cumont qui nous donna très flegmatiquement cinq livres à
chacun. Ces « pounds » nous vinrent bien à
point. Jointes à notre maigre solde, nous parvînmes à nouer les deux bouts
jusqu'à notre départ vers l'inconnu. Nous fûmes accompagnés longtemps par
deux autres Belges qui se désistèrent « brillamment » un certain jour. Ils
furent renvoyés à Tenby. Nous quittâmes Londres le 3 septembre 1940. Ce fut un
grand manoir entouré d'un immense parc qui nous accueillit. Un canal d'eau
traversait une grande pelouse de part en part. Ce canal fut souvent le théâtre
d'exploits « homériques » qui consistaient à jeter l'un de nos compagnons tout
habillé dans son eau pas très limpide. La victime de ces bains forcés était la
plupart du temps un copain qui avait enfreint certaine loi que nous avions
établie entre nous. Des Britanniques, des Norvégiens, les
plus nombreux, des Français et des Belges avaient été réunis dans cette station
du Special Operation Executive : le S.O.E. Pendant les deux premières semaines,
tous les matins, nous y apprîmes les rudiments d'anglais nécessaires à notre
instruction et nous piquant au jeu nous fîmes des progrès énormes en très peu
de temps dans la langue de Shakeaspeare. L'après-midi était réservée à la
construction d'abris antiaériens. Là, les petits Belges se firent connaître en
tant que maçons. Je jouai pour ma part au porteur de briques et de ciment. Ce
n'était vraiment pas une sinécure. Nous élaborions également nos propres
tranchées garnies de sacs de sable. Grâce à Dieu nous n'eûmes jamais à les
employer. C'est pendant ce fameux mois de
septembre que nous assistâmes à ces spectacles émouvants des passages
d'escadrilles de chasseurs Spitfire et Hurricane allant au combat et souvent au
sacrifice. Nous étions de tout cœur avec ces gars
splendides qui allaient vers leur destin mais qui se battaient pour le même
idéal que le nôtre. Je savais par les journaux britanniques
que notre petite Belgique y était vaillamment et dignement représentée par
Vicky Ortmans que je connaissais et par les autres : Le Roy du Vivier, Philippart,
de Hemptinne, de Grunne, Offenberg et j'en passe. Vingt-six Belges participèrent à la
bataille d'Angleterre et sept y furent tués. Plusieurs d'entre eux, les vingt-six
moururent en opérations dans la suite de la guerre. Aujourd'hui il en reste quatre en vie :
« Le Boy » Roy du Vivier, Malengrau, Prévot et Dieu. Vicky Ortmans se tua malencontreusement
après guerre. Ce fut lui qui eut le plus de victoires à son actif. Après la guerre, le vicomte de Jonghe
qui me connaissait bien ne cessa jamais de m'aider à tous points de vue. Il
s'enquit toujours des besoins de Madame Leblicq et de la maman d'Emile Tromme.
Il le fit très discrètement à la manière d'un vrai gentilhomme qu'il était. Il fut le parrain de mon second fils et
il ne fut pas peu fier de me voir lui remettre son béret vert de para-commando
à la caserne de Flawinnes. Ses yeux s'embuèrent quand André nous
eut rejoint au mess du régiment. Nous bûmes un whisky ensemble. C'était la
dernière fois que je lui parlai. Le vicomte Arthur de Jonghe fut le seul Belge
à avoir pris part au raid de Saint-Nazaire avec les commandos britanniques. Ce fut
un combat sans pitié de part et d'autre. Il ne reçut même pas la croix de
guerre belge qui fut très galvaudée. Je ne connais qu'une phrase pour qualifier
cet oubli. Je ne la dirai pas ... Quant à nous et bien pour nous le régime
s'était fait très dur et très sévère. A six heures lever sans fanfare; nous
nous habillions d'un short et d'une vareuse, pantoufles au pied. Nous faisions une heure de gym: du P.T.
comme disait notre instructeur britannique. Après cet exercice « sommaire»,
nous devions abattre et sans tricher nos douze kilomètres environ de
cross-country. Je l'avoue sans modestie, j'étais très souvent le premier à
franchir ce parcours et forcément le premier à prendre une douche chaude et
froide. Celle-ci me ragaillardissait avant l'épreuve du « breakfast» anglais
que je passais tous les matins avec distinction. Nous avalions porridge et «
eggs and bacon» sans faiblir. Nous ne tardâmes pas à acquérir bientôt
une forme splendide et parfaite. J'admirais de plus en plus Arthur de Jonghe et
Leblicq qui malgré leur âge; trente-huit et trente-cinq ans, terminaient chaque
jour cet entraînement sans tripoter et sans tricher. Et moi qui venais de fêter mon vingt et
unième anniversaire, je devins bien modeste à côté d'eux. Une fois le petit déjeuner terminé,
venaient les «lectures» basées essentiellement : 1) Sur le
cours des opérations de guerre, en ce temps-là, elles avaient lieu en Afrique
et sur toutes les mers du monde. ... Bientôt le tir à la « Sub Thompson
Machine Gun », au F.M., le maniement de toutes les armes allemandes que nous
possédions, le lancement de la grenade, le tir au pistolet surtout. Bientôt
tout cela n'eut plus de secret pour nous. Le « P.T. », la course, les «
lectures» se faisaient dans la matinée. Le temps du lunch arrivait très vite.
Nous dévorions littéralement ce repas frugal. A 13 heures venait la lecture des cartes
avec TOUJOURS de la pratique et de la marche en campagne. Puis retour au gîte : changement de
tenue, nous revêtions à nouveau short et vareuse, et, c'étaient encore deux
heures de boxe, de lutte, et de close-combat. Nous commencions à être presque
des artistes en ce genre. Nous étions devenus en quelques mois des combattants
dans toute l'acception du terme. La victoire dans la bataille aérienne
d'Angleterre, la « torgnole » qu'avaient ramassée les Italiens en Afrique.
L'espoir d'entrer bientôt en action. La confiance, la foi qui régnaient parmi
nous : Britanniques, Norvégiens, Français et Belges nous donnaient un moral de
fer. Les randonnées à travers les bois et les
champs anglais, les exercices de nuit où nous nous jouions de la « Home Cuard »
nous durcissaient terriblement. C'est vers la fin du mois de novembre 40
que nous eûmes la visite de ceux que je reconnus vingt-cinq ans plus tard dans
un article du journal « La Meuse » comme étant les trop fameux Burgess et
Maclean. L'une de ces « vedettes » écrivit d'ailleurs un livre. Il parlait avec
dédain du vicomte de Jonghe. Bien sûr, ce dernier ne fut jamais de leur bord. Pour moi, que ce soit Burgess ou Maclean,
un traitre reste un traitre. Et tout qui renie son pays, qu'il soit rouge ou
blanc, ne mérite qu'un seul nom. Ces deux messieurs nous prirent de très haut.
Sans doute n'étions-nous pour eux que des « Bloody Foreigners ». Et en plus
parmi nous aucun n'était communiste. Noël vint et avec cette
grande fête notre première permission. Nos chefs avaient choisi pour le
Norvégiens, les Français et les Belges des logis nettement éloignés les uns des
autres. Nous quittions définitivement
la base S.O.E de Herdford à 14 heures. Inutile de vous dire qu'à 20 heures nous
étions tous réunis dans un club de Soho. J'y pris une cuite
mémorable. Plus jamais dans toute mon existence, je ne fus ivre à ce point.
Comment retrouvai-je ma chambre, mon lit dans la pension qui nous était louée ?
Le lendemain de Noël,
j'eus assez de courage pour aller entendre la messe à la Cathédrale des Saints
Pierre et Paul. Tromme et Leblicq m'y accompagnèrent. L'ivresse ne nous avait
point coupé l'appétit. Nous déjeunâmes chez Rose, une Ostendaise tenant un
petit restaurant. Les « beefsteacks » frites, salade y étaient à l'honneur. On
y rencontrait la plupart du temps des compatriotes et des Britanniques.
Heureusement ces derniers ignoraient qu'en tant que « beefsteacks » Rose
servait des steacks de cheval. De toute façon nous appréciâmes ce bon repas
bien de chez nous, arrosé de bière au tonneau. Il faisait encore bon vivre à
cette époque et nous en profitions sans remords. La semaine de permission
dura jusqu'à l'an nouveau. Nous fîmes la connaissance de jolies filles qui
contribuèrent largement à nous faire progresser dans l'emploi de la langue anglaise.
Rien de tel que de puiser
aux sources, nous en étions persuadés. Le 2 janvier 1941 nous nous retrouvions
avec tout notre barda devant les grilles d'un hôtel des environs du quartier de
Victoria Station. Un autocar de l'armée vint nous y quérir vers dix heures du
matin. Les Belges uniquement furent débarqués dans un « cottage» de la campagne
anglaise. Nous refîmes du P.T. et des marches harassantes afin de nous remettre
en forme. Deux semaines suffirent. Le 16 janvier, une
station wagon conduite par une dame de la N.A.A.F.I. passa nous prendre. Nous
essayâmes en vain de lui faire avouer le but de notre voyage. Nous arrivâmes le
soir à Altrincham dans la banlieue de Manchester. Nous nous installions pour
une quinzaine à 1'« Unicorn Hotel ». Le lendemain nous
faisions connaissance avec un « Warrant Officer » de la R.A.F. Ses moustaches
en forme de guidon de bicyclette lui donnaient un air impressionnant et
vraiment martial. Et nous partîmes :
Direction RINGW AY. Ringway était un champ
d'aviation de la Royal Air Force. Là nous apprîmes qu'il nous faudrait apprendre
à sauter en parachute. Aucun des trois ne cilla. Personnellement à cet instant,
je me demandais bien franchement si je pourrais tenir le coup, si je
parviendrais réellement à sauter. Je n'eus d'ailleurs pas
trop de temps d'y penser. Nous nous mîmes en tenue de P.T. et un
entrainement de forcenés commença. Roulés, boulés, flexions, balancements,
sauts sur place, nous fûmes soumis à ces exercices pendant toute une longue
semaine. Nous rentrions le soir à
1'« Unicorn Hotel » crevés, fourbus ayant mal partout. Trois envies subsistaient
: manger, se relaxer, dormir. Il n'y eut ni week-end,
ni repos. Nous étions en guerre, pas vrai. Le seul changement consista à
refaire tous ces exercices en uniforme avec godasses et guêtrons. Un casque en
caoutchouc en guise de serre-tête nous fut fourni. Nous dûmes sauter d'un
fuselage d'avion situé à une hauteur de quatre mètres environ. Un trou dans ce
fuselage où nous prenions place assis en face l'un de l'autre et harnachés d'un
sac simulant un parachute. Et au « GO » hurlé plus que crié nous devions sauter
successivement. Comment aucun de nous ne fut accidenté, comment personne ne se
cassa proprement la figure, cela demeurera toujours un mystère. Puis vint le grand jour.
On nous l'annonça la veille. C'était la moindre des choses. Nous devions bel et
bien sauter réellement d'un avion avec un seul et unique parachute. Aucun de
nous ne parvint vraiment à bien dormir cette nuit-là. C'était un dimanche. Sachant que nous
étions des « Roman Catholics » nous pûmes entendre la messe, nous confesser et
communier. Après le service religieux le curé de la
paroisse, ancien vicaire d'une église parisienne, nous invita à prendre le
petit déjeuner à sa table. Il parlait un français impeccable. Ce brave homme
nous remit à chacun deux paquets de « Gold Flake » puis un bâton de chocolat «
Cadbury ». Je suis persuadé qu'il s'agissait de sa ration de plusieurs
semaines. Ne sachant pas où nous allions, il nous
souhaita bonne chance sans sourire. J'estimai que j'en avais le plus grand
besoin. A neuf heures nous étions sur le terrain
de Ringway. On nous distribua un parachute. Un vrai celui-là. Il me semblait
que ceux de mes amis étaient mieux parés que le mien. A quoi pouvaient bien
penser mes camarades ? Longue et interminable attente jusqu'à
midi. Je déjeunai du bout des lèvres. Je n'avais plus très faim. J'aurais voulu
que ce temps d'arrêt durât des heures, qu'il y eut une tempête, un contretemps,
quoi. Mais le ciel se dégagea tout à coup, le vent cessa, la météo était
parait-il excellente. Nous partîmes vers notre destin. L'avion qui nous emporta
était un vieux Whithey. Il n'était véritablement plus de toute première
jeunesse. Pour nous les Belges, c'était notre baptême de l'air. Aucun d'entre
nous n'avait jamais mis les pieds dans un avion. Enfin voyons, début 1941 qui
pouvait se vanter d'avoir voyagé par voie aérienne ? Un « dispatcher » nous
accompagnait. Il prit place en face de moi. J'étais le premier à sauter.
Personne ne soufflait mot. D'ailleurs à quoi bon. Les moteurs hurlaient. Mes
pensées allaient vers les êtres qui m'étaient chers : ma fiancée, mes parents.
J'avais peur. J'étais certainement vert de peur. Je n'ai aucune honte à
l'avouer. Etais-je le seul ? J'aurais tant voulu le savoir. L'avion avait
décollé depuis longtemps, me semblait-il. Le « dispatcher » me prévint. La
lampe rouge s'alluma. Je remis mon âme entre les mains de Dieu. C'était la
seule chose qui me restait à faire. Puis subitement le feu tourna au vert. Le «
dispatcher » leva le pouce. Sans rémission je sautai et sans l'aide de
personne. Ce saut qui n'en finissait plus. Ce fut le blocage des bretelles, le
grand claquement du pépin, le grand silence impressionnant après le chahut des
moteurs. Une joie immense m'envahit, j'étais transporté. Rappel à l'ordre. Le
warrant officer aux moustaches énormes hurlait dans son porte-voix : « Feet
together, feet together ». Le sol vint à moi particulièrement vite, je ne
l'attendais plus celui-là. Je fis mon roulé instinctivement. Je me redressai.
Je n'avais rien de cassé. Je décrochai mon harnais et roulai le parachute. Un
gars de la R.A.F. m'offrit une cigarette et me l'alluma, aurais-je seulement pu
craquer une allumette. Mes amis sautèrent l'un après l'autre. L'avion fit
encore deux passages. Nous rejoignîmes l'autocar. En bons Belges que nous étions, nous
nous promîmes une bonne pinte au bar. Hélas, il fallut déchanter. A peine
rentrés au hangar, on nous délivra un autre parachute. Derechef, il fallut remettre
ça. Nous devions sauter en « stick » cette fois. L'avion ferait une seule passe
au-dessus de la « dropping zone ». Nous étions déçus, certes, mais aucun ne se
dégonfla. J'allais sauter en troisième position. L'objectif fut rapidement atteint. Notre
saut fut parfait et pour la seconde fois nous rejoignîmes la base. Le warrant
officer moustachu nous paya cette bière tant attendue. Le soir nous sortîmes sans complexe et
sans reproches. Personnellement, j'avais vaincu une immense frousse. Avions-nous vraiment fait preuve de
courage ? De toute façon nous étions devenus très
modestes, et, chose remarquable, à partir de cet instant nous nous serrâmes
encore plus les coudes. Le lendemain un troisième et un quatrième sauts nous
donnèrent plus d'assurance. Deux jours après nous fîmes un saut de nuit qui,
paraît-il, fut réussi. Un de nos camarades étrangers refusa de
sauter et fut réintégré immédiatement dans son unité. C'est en pleine euphorie que nous mîmes
le cap sur l'Ecosse. A cette époque aucun d'entre nous ne sut
réellement où nous allions. Ce n'est qu'après guerre que j'appris qu'il
s'agissait de Fort William. Quel pays merveilleux que l'Ecosse à cette époque
de l'année !!!. Tout ce qui nous entourait était recouvert d'une épaisse couche
de neige. Nous habitions une grande maison paysanne. Il y régnait un froid de
canard. Pendant quinze longs jours et quinze longues nuits nous allions y jouer
au scout. Nous naviguions (c'est bien le mot) par monts et par vaux, les
godasses et les guêtres britanniques ne nous protégeaient guère. Il n'y eut pas
d'enrhumés cependant. Nous « pétions » de santé. Nous avions retrouvé le vicomte de
Jonghe. Ce dernier avait sauté avec deux Français. Nos amis Jean Pilet et
Guiomard. Notre « staff » avait jugé que tout
était bien. Il nous envoya à Beaulieu. Nous nous séparâmes définitivement des
Français et du vicomte de Jonghe. Beaulieu était situé en face de l'île de
Wight. Nous avions nos pénates dans une imposante villa. De notre chambre à
l'étage, nous découvrions les ruines de l'ancienne abbaye qui avait dû être
magnifique au temps de sa splendeur, sept cents ans auparavant. La mer et l'île
de Wight formaient une toile de fond unique. Nous étions trois petits Belges qui
allions apprendre entre autre à devenir radiotélégraphistes. Après trois mois de labeur intense, nous
assimilions le morse à longueur de journée. Malgré toute ma bonne volonté je ne pus
jamais dépasser le cap des seize mots de cinq chiffres à la minute, Des essais
faits après guerre me convainquirent définitivement que ces seize mots était
mon maximum. D'autres que moi paraît-il se trouvèrent dans le même cas. Ces séances de morse étaient pour moi
une véritable torture, du moins le croyais-je à cette époque. Vint le mois de mai. Tromme et Leblicq, meilleurs radios que
moi étaient disparus de la circulation. Néanmoins avant leur départ, nous nous
étions fixés rendez-vous en Belgique occupée. Quittes à outrepasser tous les
ordres, nous savions tous trois que les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Deux autres Belges : Fonck et Verhaegen vinrent
les y remplacer. Etant en retard dans mon instruction radio je remis ça. Le matin du 22 juin la B.B.C. nous
apprit que l'armée allemande avait pénétré en Russie. Du coup nous prîmes radio
Paris et Berlin. Des rodomontades, des flons flons, des marches militaires. Pour nous l'URSS était un allié de plus.
C'était grand la Russie. Le morceau était de taille. Et puis pour Hitler
c'était la guerre sur deux fronts. Il avait mal assimilé Clausewitz. Le « Grand » Napoléon s'y était cassé le
nez. Personnellement je n'avais pas oublié le
coup de Jarnac de 1939 : « Le pacte de non-agression germano-russe ». Je finis bel et bien par passer mes
examens de morsiste. Mon examinateur avait certainement mis beaucoup d'eau dans
son vin. Je lui fis cependant remarquer que je ne parvenais pas à franchir le
mur des seize mots minute. Il me dit que ma bonne volonté aidant, tout irait
bien. Je le crus, mais une fois sur le terrain ce n'était plus vrai. Là, il ne
s'agissait plus de bonne volonté. Je fus, bien sûr, très content de moi.
C'était une grave erreur. Fonck et Verhaegen allèrent suivre des cours de
sécurité que j'avais étudiés au préalable. Je restai seul à Beaulieu. Un vieil
officier de l'Armée des Indes, qui était également un officier de chasse du roi
Georges VI, m'apprit comment me débrouiller en forêt. Faire du feu avec un
rien. Cuire du gibier dans une enveloppe d'argile. Bref après une semaine je
retrouvai Fonck, Verhaegen et ce bon « vieux » Freddy Wampach de Vielsalm. Henri Verhaegen allait devenir mon
inestimable ami en Belgique occupée. Il fut un agent hors pair. Tous les quatre, nous partîmes à
Aylesbury. J'y étais à peine d'une semaine qu'au
cours d'un exercice, j'eus un grave accident de voiture. Je me retrouvai au « Royal
Buck's Hospital ». J'étais resté dans le coma pendant trois jours. Mes amis me
le confirmèrent lors d'une visite. On avait cru que j'avais la colonne
vertébrale fracturée. Il n'en fut rien, heureusement. Mais je dus néanmoins
réapprendre à marcher et je le fis réellement bien que fin juillet. J'appris
alors que j'aurais dû être parachuté en Belgique fin juin en solitaire. En août
j'allai suivre un cours de codage à Londres. Je logeais à ce moment-là à
Henley-on-Thames. Chaque jour je faisais la navette Henley- Londres et retour. J’éprouvais encore des difficultés à
marcher, mais je refusai la canne qui m'était offerte. Il fallait rester digne
devant les Britanniques. Je m'en voudrais de passer ceci sous silence, un
certain soir début juillet, Armand Leblicq était venu me rendre une dernière visite
à Henley. Il me présenta un monsieur en civil, que je ne devais revoir qu'une
fois la guerre finie. Ce Monsieur m'apprit en 1945, qu'il
était l'abbé Robert Jourdain, père Jésuite, et professeur à l'Institut Gramme
de Liège. Armand resta un moment seul dans ma
chambre et nous renouvelâmes nos promesses de rencontre dans notre pays. Il me confia qu'il partait sous peu en
Belgique, en compagnie de cet abbé Jourdain. Je ne devais jamais le revoir. Le vieux comme je l'appelais, était le
type même du vrai, du bon Bruxellois. Combien de fois ne m'avait-il pas parlé
de sa femme qu'il adorait. C'est un des hommes les plus droits qu'il m'ait été
donné de connaître. Avec lui il n'y avait jamais de détours ni de demi-mesures.
J'ai appris beaucoup à son contact. Il était mon ainé de treize ans au moins.
Il était la droiture même et quand j'y réfléchis, j'estime que je ne lui
arrivais pas au talon. Il fut parachuté « façon de parler » en Belgique occupée
le 21 juillet 1941. Je laisse à l'abbé Jourdain le
soin de faire le récit de sa mort, que je n'appris d'ailleurs qu'en rentrant de
captivité. Nous avions décidé de
nous associer après la guerre et d'aller au Congo Belge. Nous n'avions jamais
envisagé d'autre solution que la Victoire. J'ai perdu un véritable
ami qui connaissait cependant tous mes nombreux défauts et malgré cela il ne
cessa jamais d'être MON AMI. Voici le récit du Père Robert Jourdain,
ex-aumônier des Paras S.A.S., récit qu'il écrivit en 1947 dans le journal
namurois « Vers l'Avenir ». J'en ai recopié la principale partie: * * * « Dans une famille amie de Londres; d'ecclésiastique,
je suis redevenu civil. J'ai dû les mettre au courant
secrètement et leur dire que je me préparais à partir en Ethiopie pour une
mission de liaison. Mes autres compatriotes me croyaient déjà parti vers cette
Ethiopie, mais trois Belges seulement savent que je devais être parachuté en
Belgique en mission spéciale en même temps que le Sergent Leblicq qui portera
en opération le nom de Delpierre. J'ai choisi d'être parachuté dans la
région de Harsin, près de Marche où j'ai des amis qui pourront m'aider. ... Un dernier « Good luck » du major
anglais nous accompagnant et bientôt, nous montons vers le ciel. Mon compagnon Leblicq s'approche de moi
sur le paillasson qu'on a étendu pour nous sur le plancher de la carlingue. Il
m'a demandé si je pouvais le confesser. « Que le Seigneur soit dans ton cœur et
sur tes lèvres, pour que tu fasses une juste confession de tes péchés ». Tandis
que j'écoute ce pénitent parachutiste qui va affronter la mort, je voudrais
entrevoir l'avenir. Quel souvenir que cette confession dans
l'avion d'un parachutiste à un autre parachutiste, peu avant la mort du
pénitent. Souvenir unique peut-être dans ce genre d'opération. «
Deinde ego te absolvo ». Je t'absous... Et quand je devrai dire à ta Veuve et à
tes proches ce que furent tes derniers moments ; je pourrai leur assurer que tu
les avais employés en chrétien à te préparer à bien mourir. Un crépitement de mitrailleuses ? Qu'y
a-t-il ? le dispatcher anglais nous rassure. C'est le mitrailleur arrière qui
s'assure du bon fonctionnement de ses armes. Mais voici que l'avion descend,
mes oreilles bourdonnent. Le dispatcher est en communication téléphonique avec
le pilote. Il reste assis dans un coin de la carlingue. L'avion vire, va et
revient. Il rôde ainsi pendant une demi-heure et voilà que tout à coup il
reprend de la hauteur. Le dispatcher vient nous expliquer que nous retournons
en Angleterre. Il y a du brouillard sur la Belgique et le pilote ne voyant pas,
ne veut pas risquer de nous parachuter. Nous retournons en Angleterre. A la sortie de l'avion le major anglais
averti par radio nous attend sur la plaine. Il est quatre heures du matin. Nous
rentrons à Londres. Le soir tout sera à recommencer. Nous arrivons de nouveau sur la Belgique
vers une heure et demie du matin. La visibilité est excellente. Quand la trappe
du vieux Whitley est ouverte je distingue parfaitement les prairies, les haies
et les maisons. Le signal rouge s'allume indiquant que
je dois me mettre en position de saut jusqu'au signal vert qui 3 minutes plus
tard sera l'ordre de sauter. Ces trois minutes me paraissent très longues. L'avion volait à 150, 200 mètres
d'altitude, se rapprochait encore puis pris dans un trou d'air remontait. Signal vert. Des deux mains je me pousse
en avant et glisse par la trappe. Choc d'air habituel qui vous abasourdit. La pleine lune éclaire magnifiquement la
plaine d'atterrissage. Je me vois descendre. Je vois se profiler l'ombre de mon
parachute. Je suis dans un champ à 400, 500 mètres d'un groupe de maisons. Rien
ne bouge. Je regarde l'heure : deux heures et quart. L'avion revient au-dessus
de moi. J'agite mon casque en dernier adieu. Il disparaît mais quelques
instants plus tard, j'entends le bruit d'un moteur dans la direction du village
et je distingue un appareil qui n'est pas un bombardier comme le nôtre. La
chasse est alertée par notre avion, qui hier et cette nuit a évolué plus d'une
demi-heure au-dessus du pays. Je dépose mon parachute en bordure du
champ dans un bosquet en attendant de l'enterrer. Je suis dans une région peu éloignée
d'un endroit où pendant quelques années j'ai campé en vacances. Mais avant
tout, il faut retrouver mon compagnon qui ne se montre pas spontanément comme
j'aurais pu l'espérer. Je repère la direction qu'aurait dû avoir l'avion,
traverse un champ, cherche à apercevoir le parachute qui s'est peut-être
accroché à un arbre. Rien. Je reviens sur mes pas. Un quart d'heure, une demi-heure
serait-il blessé ? Je reste immobile retenant ma respiration et j'écoute, rien,
rien. Je suis seul. Après trois quarts d'heure
de recherches infructueuses, je décide de me cacher dans un petit bois que
j'aperçois à quelque cinq cents mètres. Peut-être mon compagnon est-il caché
là-bas ? Sinon, comme convenu nous nous retrouverons dans les trois jours à
Marche. Je
me charge de nouveau de mon parachute. Mon compagnon ayant la pelle, je ne puis
creuser pour enterrer ce parachute lourd et encombrant. Il me faut passer des
haies, traverser des champs et des prairies. Je transpire à grosses gouttes. Me
voilà près du petit bois, il me faut traverser la route et la ligne du vicinal.
Il me semble entendre quelque chose. Je me cache parmi les bosquets ayant perdu
un peu de la complète assurance que j'avais eu jusqu'ici. Mon compagnon Leblicq
était armé, moi pas. Rien
ne bouge. Je me décide à passer la route. Je le fais d'abord sans mon parachute
car il me semble qu'il y a un ravin de l'autre côté de la route en face de moi.
De fait il faut appuyer sur la gauche où il y a un sentier. Je reprends le parachute, retraverse la
route et gagne le bois. J'y pénètre assez profondément en grimpant la colline
escarpée. M'écartant du sentier, je me cache dans les taillis et m'étends sur
mon parachute en attendant le lever du soleil. Il eut été imprudent de me déplacer
la nuit puisqu'il était interdit aux Belges de sortir après le couvre-feu. Qu'était devenu mon compagnon ? Je pensais encore le retrouver le
lendemain et le surlendemain dans la ville.... ... En réalité, le malheureux mourait d'une
mort horrible due à un accident rare même à cette période des premiers parachutages,
et quasi inexistant à l'heure actuelle. (Je parle de 1941). Il sauta immédiatement après moi, mais
par suite d'un défaut technique, à la vitesse de 250 km/heure, il alla se
fracasser contre la queue de l'avion. Son parachute s'accrocha à la queue et il
resta pendu tandis que l'avion regagnait l'Angleterre. Malgré les efforts du personnel de
l'avion on ne parvint pas à ramener le corps. Entraîné avec le parachute par la
violence du vent, au-dessus de la Manche, mon pauvre compagnon tomba déchiqueté
en mer... Lettre – Testament
d'Armand Leblicq à sa femme. «
Londres le huit mai 1941 Tu m'as dit entre tes larmes : « Fais
ton devoir ». Je crois que la seule façon de faire ce devoir était d'agir comme
je l'ai fait. Je l'ai librement choisi, seulement, c'est un travail extrêmement
périlleux auquel j'ai offert ma vie. Maintenant, ma femme chérie, je te dis
au revoir ou peut-être adieu, c'est le sort de la bataille qui en décidera. Si le malheur veut que j'y laisse ma
vie, au moins console-toi en pensant que j'ai fait tout mon devoir. J'ai foi en Dieu ma chérie, je sais que
tu es une fervente chrétienne. Nous acceptons le sort que Dieu nous réserve...
» J'ai tenu à reprendre certains passages
de cet article écrit par le père Jourdain... ... Je remercie chaleureusement le
journal « Vers l'Avenir » de son amabilité. Je tiens à signaler que l'abbé
Jourdain revint en Angleterre sa mission terminée et s'engagea comme aumônier
dans la compagnie S.A.S. (compagnie d'élite constituée par le major Blondeel en
Grande-Bretagne). Cette unité composée de 125 hommes, tous volontaires, se
tailla une solide réputation au sein des armées alliées. Ils furent de toutes
les batailles. En dehors de certaines missions dont
cette histoire donne un petit aperçu, des parachutistes S.A.S. furent
parachutés en France à l'époque du débarquement puis plus tard dans les
Ardennes, en Campine et même en Hollande. Au moment de la dernière offensive
allemande en Ardenne à la fin de 1944, les paras furent envoyés par route à la
rencontre des pointes avancées allemandes. Dotés d'une formidable puissance de
feu et surtout animés d'un moral à toute épreuve, ces soldats accomplirent des
prodiges de valeur. Aujourd'hui, tous ces parachutistes ont
conservé un impérissable souvenir des exploits accomplis naguère ». * * * Le mois de
juillet s'effaça. Chaque jour nous écoutions les
communiqués de l'Armée rouge et de la Wehrmacht. Les Russes reculaient sans
cesse, mais non sans combattre. Eux seuls pouvaient le faire. Leur pays était
si grand. Malgré tout cela, l'optimisme était de rigueur. Petit à petit j'avais repris
l'entraînement. Je faisais mon P.T. seul mais en toute conscience. La forme
revint malgré encore quelques petites difficultés à courir en pleine foulée. Enfin, le jour vint où je fus appelé à
Londres afin d'y rencontrer Octave. Je devais sauter avec lui en Belgique
occupée. Je devais travailler sous sa houlette mais il fut bien entendu que si
mes compagnons Tromme ou Leblicq se trouvaient en difficulté, ces derniers
passeraient avant n'importe qui en tout premier lieu. Rien n'aurait pu me faire changer
d'avis. A la fin du mois d'août, après une
sérieuse visite médicale, je fus déclaré: Bon pour le service. Le 2 septembre 1941, une station-wagon
vint nous prendre, Freddy Wampach, Octave et moi. Elle nous conduisit dans un
hôtel tenu par quelqu'un du service. J'y rencontrai Jean Pillet, un Normand
avec qui je m'étais lié d'amitié à Herdford. Comme nous étions sensiblement de taille
égale, il me conseilla vivement, lui qui revenait, sans doute, de France occupée,
de disposer de ses vêtements venant tout droit de France. Un knickerbocker bleu marine, un blouson,
de la même couleur, la chemise, la cravate, les bas et les souliers étaient
rigoureusement français. Seul mon vieil imper était d'origine britannique. Octave et moi restions consignés dans
une chambre de l'hôtel. Nous repassions mentalement notre « cover-story ». Tiendrait-elle
à l'usage ? Ma « cover-story », autrement dit ce que je raconterais aux
Allemands si j'étais pris la première semaine ; consisterait à leur faire
avaler ceci : J'étais resté à Saint-Jean de Luz, que
je connaissais bien, de juillet 1940 à août 1941. Une jeune fille basque avait
contribué à me retenir et à me faire passer le temps. Revenu à de meilleurs sentiments, ayant
la nostalgie du pays j'étais parvenu à rentrer à vélo. Je m'étais fait chiper
ma bicyclette aux environs de Givet. J'avais passé la frontière comme une
fleur. J'avais pris le train jusque Namur. Avec d'autres menus détails, cette
histoire pouvait tenir. Le soir du deux septembre nous
partions. Je me séparai de Freddy
Wampach qui allait sauter en France non occupée. C'était son dernier au revoir.
A trente cinq ans, père
de famille, il n'avait pas hésité un seul instant à se porter volontaire pour
les Missions Spéciales. Il savait lui aussi ce qu'il risquait. Il avait décidé. Capturé par la Gestapo en
zone non-occupée, il s'évada du camp où il était retenu prisonnier. Il
rejoignit Bruxelles et se fit avoir par le trop fameux De Zitter. Il marcha
vers le peloton d'exécution comme un homme qu'il était. C'était un fils de
l'Ardenne. …….. Octave et moi arrivâmes à un aérodrome
situé près de Londres. Notre « big chief » nous fit admirer une escadrille de
nouveaux quadrimoteurs. C'étaient les premiers que nous apercevions. Malgré
tous les revers alliés de cette époque de la guerre, nous sentions qu'avec tout
ce matériel tôt ou tard quelque chose changerait et que ce serait bien sûr à
notre avantage. Nous attendions dans une espèce de
cahute. Pour la Xième fois nous vidions nos poches, regardions les
cartes de la région où nous allions être parachutés. Cette région se situait entre Dinant et
Spontin, exactement à Purnode. Je connaissais parfaitement cet endroit. Je
gardai ma carte d'identité, la vraie, celle dont je ne m'étais jamais séparée
depuis 1938. Elle valait ce qu'elle valait. Le tout pour moi était de me faire
admettre dans 1'« Ordre nouveau ». Vers 22 heures nous prîmes une collation. On
nous servit le fameux « eggs and bacon » britannique. .Le colonel qui nous
accompagnait nous fit cadeau de ce qui allait devenir une tradition chez ceux
des missions spéciales : la petite gourde en métal inoxydable remplie de thé et
de rhum. Nous en aurions bien besoin dans l'avion. L'heure du grand départ arriva. C'est du vieux whitley filant tant bien
que mal à 250 km heure, que nous allions sauter. Le whitley atteignait un plafond de 3000
mètres, dans son fuselage un trou d'environ 1 m 50 de diamètre était découpé.
Les sauts n'allaient pas toujours sans aléas en 1941. Nous nous harnachions, ajustions nos
impers, serrions nos casques en caoutchouc, prenions nos couteaux de chasse et
nos colts 7,65 mm. Nous nous hissions péniblement dans le vieil appareil. Le Colonel, le pilote et l'équipage
tinrent à nous serrer la main. Puis Octave et moi, chacun de notre côté
regardions défiler la piste. La pleine lune ajoutait sa clarté au décor, assez
pour pouvoir distinguer que la côte anglaise s'enfuyait irrémédiablement. Nous prenions de l'altitude et
commencions à sentir le froid. Le dispatcher habillé de sa grosse veste fourrée
nous invita à boire un coup de rhum. Ce que nous fîmes vaillamment sans nous
faire prier. Nous passions la côte française. Les coups de canon de la Flak se
suivaient sans interruption. Le bruit cependant énorme des moteurs ne nous
empêchaient pas d'entendre. Nous essayions de là-haut de repérer une ville, un
clocher, mais allez donc reconnaître une partie de la France, au clair de lune,
que vous n'avez jamais vue du ciel auparavant. Mission secrète en Belgique Le dispatcher nous hurla que nous
étions vraisemblablement au-dessus de notre pays. Mon cœur battait à grands
coups. J’écarquillai les yeux de plus en plus. Je tâchais de voir, de
reconnaître. Nous apercevions en effet que la Belgique était moins bien
occultée que la France. Quelques lueurs de-ci de-là trahissaient une vie
nocturne. Je vis dans ces faibles lumières les signes de l'indiscipline belge.
Brusquement je reconnus Namur. Je voyais la citadelle et les méandres de la
Meuse que nous remontions. Et tout à coup Dinant
nous apparut avec le clocher bulbeux de sa collégiale, et sa citadelle qui en
avait vu d'autres. Le feu rouge d'« action station » nous
dressa brusquement et nous nous assîmes au bord du trou du fuselage. Le sol se rapprochait.
L'émotion nous tenaillait. Pendant cet instant
exaltant, je n'avais pas peur. Aucun doute là-dessus.
Octave et moi étions survoltés. Feu vert : le « GO » du
dispatcher. Je sautai le premier. La chute, l'air vif du
dehors qui vous surprend ; le « clac » des bretelles, je me balançais au-dessus
de Purnode. Pas pour longtemps, je
fis un roulé boulé parfait. La soie blanche de mon
parachute s'abattit. Un petit colis bien ficelé attaché aux cordes tomba à mes
côtés. C'était mon poste de radio émetteur récepteur, format 40 cm sur 30 cm. Le petit cylindre en
carton percé de trous que j'avais inséré tant bien que mal dans le devant de ma
gabardine était sain et sauf. Il contenait le pigeon que je devais libérer au
petit matin. L'oiseau roucoulait comme en plein jour. Tout allait bien pour lui
comme pour moi. Je me couchai sur le sol, hululai telle une chouette. Octave me
répondit. Nous roulions notre pépin. A cinq cents mètres de là, nous
distinguions parfaitement une grande ferme. Un chien aboyait à perdre haleine.
La route de Dinant-Spontin était à peine à trois cents mètres. Le pilote était
un as. Il nous avait « droppé » impeccablement. La lune se faisait notre
complice. Sa pâle lueur nous faisait distinguer l'orée d'un bois à un kilomètre
environ. Cela nous donnait du cœur
au ventre. Nous marchâmes et atteignîmes rapidement la lisière de cet abri
accueillant. Je détachai ma petite bêche et après avoir essayé de creuser vainement,
le schiste y affleurant, nous résolûmes d'entrer profondément dans la futaie et
de nous y reposer. La soie de notre parachute nous tiendrait bien au chaud. Avant de quitter
l'Angleterre, nous avions trempés nos souliers dans de l'extrait d'ail. Ainsi
nous étions sûrs et certains que des chiens lancés à nos trousses y perdraient
leur « latin ». Ce n'est quand même pas
sans arrière-pensée que nous nous installions dans le taillis. Octave prit la
garde jusqu'à quatre heures. Mon tour vint de quatre heures jusqu'à l'aube. Un train passa. Je le
situai à moins d'un Km. Je reconnus instantanément le bruit particulier que
font les wagons minéraliers de Cockerill, chargés du minerai de fer venant de
Lorraine. Je les avais si souvent vus et entendus passer sur la ligne du Nord
Belge avant la guerre. Nous étions donc à
proximité de la ligne Dinant-Namur, donc près de la Meuse. J'adressai un
remerciement et une pensée émus aux aviateurs de la R.A.F. qui nous avaient si
magnifiquement placés. J'attendis qu'il soit sept heures avant de réveiller mon
compagnon. Nous roulions nos parachutes, les enfouissions au plus profond d'un
fourré, cachions nos révolvers et nos couteaux dans des endroits différents. Je
pris un soin tout particulier pour camoufler mon poste de radio. Après avoir repéré
l'endroit d'une manière parfaite, nous effaçâmes toutes nos traces, comme on
nous l'avait appris. Nous mîmes de l'ordre dans nos vêtements. Je tins à cirer
les godasses d'Octave et les miennes avec du cirage que j'avais gardé en
réserve. Nous étions présentables. Nous pouvions marcher au grand jour. Je lâchai mon brave
compagnon ailé en lui souhaitant de tout cœur bon voyage et bonne traversée. Je descendis sur la
route, et reconnus les environs immédiatement. Nous étions près de Dinant.
Octave me rejoignit et nous marchâmes allègrement vers la cité des
« Copères ». Nous rencontrâmes nos
premiers compatriotes. Une chose nous frappa singulièrement: la tristesse
qu'ils affichaient. Nous avions quitté des
Britanniques en guerre, mais libres. Nous abordions des gens
conquis et dont la plupart avait des fils, des maris, des amis dans les « Stalags
». Nous franchissions le
pont reconstruit par le génie allemand. Nous étions immédiatement à la gare. Je
commis ma première gaffe. J'achetai le « Soir » volé. Je donnai royalement 25
centimes, le prix d'avant le 10 mai. La marchande de journaux me réclama
évidemment le supplément. Je lui donnai une pièce d'un franc et tout fut dit.
Elle me prit sans doute pour un distrait. Mon compagnon et moi allions prendre
un café. Nous bûmes ce breuvage infect sans dire un mot. Flegmatiquement,
Octave prit note des horaires des trains jusqu'à Namur. Le prochain omnibus
partait à 9h30. Nous étions dans cette ville de Namur vers les onze heures.
Quelque chose avait changé dans cette jolie cité, qui n'avait pas été épargnée
par les bombardements de 1940. Mais, bien sûr, il y avait les soldats allemands
déambulant en parfaits conquérants qu'ils étaient. Nous bûmes un verre de
bière à la terrasse d'un café et nous jouions à qui reconnaîtrait un fantassin
d'un cavalier ou d'un type de la Luftwaffe. Octave prit sa
correspondance vers Bruxelles. Je devais attendre jusque
14h30 un train vers Liège-Guillemins. Octave et moi avions mis au point notre
future rencontre. Nous devions nous revoir dans quatorze jours exactement au
café Britannique, place de la République Française à Liège à 15 heures pile. Comme il me restait deux
heures à attendre, j'allai me promener rue de Fer et passai devant la caserne
de la Cie Ecole des Chasseurs Ardennais où j'avais fait mes
premières armes. Naturellement nos
protecteurs nous avaient remplacés. Je revis mes instructeurs, les copains,
notre belle compagnie fringante et admirablement disciplinée. Je fis demi-tour.
J'entrai dans une petite friture qui m'avait si souvent accueilli en 1938. Rien
n'y était changé. Le patron me reconnut malgré mes habits bourgeois. J'obtins
de suite une double portion de frites et deux œufs sur le plat. L'émotion m'avait
creusé. Je demandai des cigarettes. Le patron m'apporta un paquet de V.F.
J'appréhendais le paiement, les timbres à donner. J'en étais complètement
dépourvu. Passez muscade, je payai un peu plus cher et voilà tout. De ce pas je m'en allai
vers le parc Marie-Henriette. Le soleil de septembre tapait dur. J'étais absolument
sans complexe. J'allai m'asseoir sur un banc public. Je commençai à réfléchir.
J'avais chargé Emile Tromme de prévenir ma fiancée et ma famille de mon retour
probable en juin. Depuis mai j'étais sans nouvelles de lui. J'avais eu cet
accident déplorable ; trois mois étaient passés, trois mois interminables
d'attente pour le brave Emile. Etait-il vivant ? S'était-il fait choper ? De
toute façon je devais revoir ma fiancée. Je savais que je pouvais compter sur
elle, sur ses parents. Son père était un ancien de 14-18. Il avait eu une
brillante conduite sur l'Yser en 1914. Je devais partir. Mon train était à
l'heure. Je choisis délibérément un compartiment non-fumeurs. Je restai seul
jusqu'à Liège. Je passai à Statte et à
Huy. Je me fis très petit dans mon compartiment. Je ne désirais pas être vu
d'une quelconque connaissance. Je revoyais la Meuse, ses ponts sautés et à
moitié reconstruits, les « blockhaus » qui n'avaient servi à rien. A Flémalle-Haute, j'eus
l'occasion de voir un train militaire ennemi transportant des chars. Leurs
équipages étaient habillés de noir. Ils étaient eux aussi sans complexe. Tout
cela respirait une discipline et un ordre impeccables. Les journaux belges et
français avaient tant écrit sur l'infériorité de l'armée allemande. Ils
étaient, disaient-ils, incapables de s'attaquer à l'armée belge et française.
Moi qui les avais vus à Steinbruck en 39-40, je savais qu'on les sous-estimait.
Ils l'avaient prouvé
depuis lors et de maîtresse façon. Au contraire, tous les Allemands en 1940 et
bien au-delà eurent un idéal et une conception de la guerre que nous n'avions
malheureusement pas et qui nous fit cruellement défaut en temps opportun. Leur discipline, leur
fanatisme aveugle : tout était là. J'étais persuadé, et les
Anglais ne nous l'avaient jamais caché, que la noix serait dure à croquer. J'étais sûr que la guerre
était loin d'être finie. Tant pis j'étais dans le
bain jusqu'au cou. Il ne s'agissait surtout pas de faire demi-tour. J'arrivais dans la cité
ardente, ma ville de prédilection. La vieille gare des
Guillemins était toujours là aussi sale et aussi grise. Un tas de soldats «
feldgrau » y circulaient comme chez eux. A la sortie, deux gendarmes « à
collier » visitaient les sacs et les valises. Je n'avais rien. Je passai comme
une lettre à la poste. Je ne m'attardai guère, pris le tram 4 et passai devant
l'usine Englebert qu'un colonel anglais m'avait conseillé de saboter. Je n'en
fis rien. J'appris par mon futur beau-père que le docteur Orban et sa femme
Jeannot Englebert étaient des patriotes à toute épreuve. En effet, deux mois plus
tard le docteur Orban « brûlé » comme on disait alors, s'évada en Angleterre.
Il était temps pour lui. Sa femme fut admirable durant toute la guerre. Le
colonel anglais m'avait mal conseillé... J'arrivai donc au numéro
17 de l'avenue Ferrer où résidait ma fiancée et ses parents. Je sonnai à
l'entrée et elle vint m'ouvrir. J'eus juste le temps de la rattraper. Elle reprit
vite ses esprits et avec le calme qui la caractérisait, elle me dit simplement :
« Te voilà enfin, mon grand ». La mère de ma femme m'accueillit on ne peut
mieux. Finalement ma fiancée donna congé à ses trois cousettes et je pus enfin
lui raconter et lui expliquer certaines phases de mon aventure. Mon ami Emile
Tromme leur avait rendu visite dès la mi-mai. Il les avait mis au courant de
ses activités et des miennes. Et à toutes les pleines lunes depuis mai, on
m'attendait. Rien que ça. Ma future belle-mère s'en
fut vers l'usine où le père de ma fiancée était employé. Peu après ils
revinrent et je dus me raconter une seconde fois. Mon futur beau-père partit le
soir même dans mon petit village hesbignon. Il alla prévenir les miens de mon
arrivée. J'y arrivai le lendemain dans l'après-midi. Inutile de vous dire que
j'y fus reçu les bras ouverts. Un de mes bons amis d'enfance qui avait été
prévenu de mon retour vint me saluer. Comme je le reconduisais sur le pas de la
porte, il me dit doucement dans le savoureux wallon de Hesbaye « Twès valet,
comme d'jit'kinoche, t'as d'vou passé l'èwe pos rivni chaâl ». J'eus beau nier
énergiquement n'être jamais allé en Grande Bretagne. Il ne me crut pas. Son
regard ironique me fit comprendre qu'il n'était pas dupe. Quinze jours après, quand
je fus certain de ses sentiments vis-à-vis de l'ennemi, je le mis dans la
confidence. Jamais, j'en suis sûr, il n'en toucha mot à personne, même pas aux
siens. Après le dîner familial nous discutions
père et moi. Maman ne cachait pas ses appréhensions quant à mon futur travail. Mon père prit les rênes
en mains et d'un ton péremptoire : « Il est là, il sait ce qu'il veut, il doit
faire ce qu'on attend de lui »; C'était définitif... Mon père, un simple ouvrier
des chemins de fer ne paniqua jamais et tint toujours la tête haute. Malgré son
chagrin, lors de mon arrestation et pendant ma captivité, il ne douta jamais un
seul instant de la victoire... ... J'avais fixé mes
quartiers à Liège dans un appartement sis au début de la rue Grétry à deux pas
du pont de Longdoz. Comme il se devait et d'après les règles de la sécurité :
ma chambre donnait sur une plate-forme. Trois mètres de chute, c'était la
deuxième sortie, la retraite parfaite. Quatre jours après ma
rentrée, Emile Tromme se pointa chez ma fiancée. Elle l'envoya rue Grétry. Il
devait, lui avait-elle expliqué, s'aidant de la sonnerie électrique qui m'était
personnelle, faire le signal « W » (. --) en morse. Ce qu'il fit. Je le reconnus
à travers la porte vitrée. Je voyais sans qu'on me voie. J'ouvris. Nous
montâmes dans ma chambre. Après force tapes dans le dos et un immense plaisir
de nous revoir, Emile déboucha une « plate de pèket » et nous fîmes santé,
santé. Une petite goutte, nos retrouvailles valaient bien ça. Il m'apprit qu'il avait
sauté le 10 mai 1941. (Jour anniversaire de notre entrée en guerre) dans la
région de Saint-Vith. Son poste de radio s'était écrasé à l'atterrissage.
Parlant admirablement l'allemand, il avait traversé la frontière à Poteau auprès
d'un de nos anciens corps de garde. Il avait rejoint Grand-Halleux la nuit
tombée par les sentiers forestiers qu'il connaissait très bien. Après avoir pris le vent
mais privé de son poste de radio il alla former un groupe de résistants actifs :
un des premiers, dans les environs de Verviers. Il avait attendu le retour de
Leblicq désespérément. Il avait espéré mon arrivée avec impatience. Notre ami Armand Leblicq
n'était pas revenu, et, pour cause. Emile ne le sut jamais. J'espère qu'à
l'heure actuelle ils se sont retrouvés au paradis des parachutistes. Ils
doivent y faire bonne contenance. Finalement nous décidâmes
d'aller récupérer mon poste dès le lendemain. En Angleterre Tromme, Leblicq et
moi-même avions promis de nous aider coûte que coûte une fois sur le terrain.
Nous nous connaissions vraiment et avions foi les uns dans les autres. On
m'avait délibérément forcé la main en me donnant Octave comme compagnon. Je ne
le connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Pour moi, Tromme, Leblicq
et le vicomte de Jonghe passaient avant n'importe qui. Pour ceux qui étaient à
Londres en 1941, il était très facile de donner des ordres. Agir sur le terrain
et exécuter ces ordres en Belgique occupée en septembre 1941 : c'était tout
différent. Honni soit qui mal y pense, le sort en était jeté. Je décidai donc de
travailler aussi en collaboration avec Emile. Au diable toutes les combines à
la noix. Pouvais-je faire autrement ? Nous étions liés plus que des frères. Il
avait exactement le même idéal que le mien. Je devais agir en toute conscience.
Je le fis sans hésiter. Le lendemain nous récupérions mon poste émetteur
récepteur, les deux révolvers 7/65 et les deux couteaux, dans la cachette où je
les avais placés le 3 septembre au matin. Je revis Octave à Liège,
lui expliquai gentiment mon point de vue. Il n'aimait pas beaucoup ma décision.
Il aurait voulu que je cesse l'aide fournie à Emile. Je refusai
catégoriquement. Je lui rappelai volontiers que notre nouveau chef britannique
m'avait forcé la main en me demandant d'être parachuté avec lui. Je pouvais
revenir seul. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Je ne tins absolument aucun
compte de ses avis ni de ses récriminations. A l'heure actuelle et dans les mêmes
conditions j'agirais exactement de la même façon. Emile, lui, n'avait rien
perdu de son dynamisme. Il me fit comprendre que la plupart des Belges
n'acceptaient pas les Allemands, mais que très, très rares étaient ceux qui
osaient se risquer à les contrecarrer réellement. Je suis persuadé qu'il
n'y avait pas plus de trois mille véritables résistants en Belgique en 1941. C'était l'éternelle
histoire du Rodilard de La Fontaine « … Ne faut-il que délibérer La cour en conseillers
foisonne ; Trois mille ; la masse
n'était pas bien grande. Le fait était là cependant. Bien sûr en août 1944, le
flot allait grossir puissamment. Il allait même éclater après la libération du
territoire. C'est d'ailleurs cela qui fit tant de mal à la Vraie Résistance. Emile avait pu obtenir la
liaison avec Londres. Il me dit qu'il allait recevoir un parachutage à
Solwaster, à quelques kilomètres du barrage de la Gileppe. Début Octobre. Le
parachutage vint à point donné. Londres avait admis ma façon de faire et de
voir les choses. Cela aussi Emile me le dit. J'étais donc paré. J'en fus très
heureux et très rasséréné. Ce parachutage d'armes et
d'explosifs, un des premiers qui eut lieu en Belgique occupée à ma connaissance
fut parfait. Aidés par Louis Baikry, Dechêne, Dartois, Hurard et les très fidèles
Raymond Fisher et Edmond Maréchal, Emile reçut la manne céleste. Un nouveau poste de radio
émetteur-récepteur, des mitraillettes « Sub-Thompson », du « plastic » et
bien sûr du chocolat Cadbury et des cigarettes Players. Emile émettait des
environs de Verviers pendant une heure environ, une heure et demie parfois, en
dépit de mes avertissements. Et ce qui devait arriver, arriva. Le dimanche huit
octobre vers 13 heures j'avais rendez-vous chez lui à Verviers. J'attendais
depuis une vingtaine de minutes quand tout à coup un homme hors d'haleine
entre. Il parvint à me dire qu'Emile avait été arrêté par la « Geheim Feld
Polizei ». Je le prévins et lui dit « il ne vous reste plus qu'une chose à
faire, filez d'ici le plus vite possible et ne remettez plus les pieds chez
vous ». « Monsieur » me dit-il « je
ne suis pas un lâche » ; Je partis sans discuter. Il fut arrêté dans la
demi-heure qui suivit. Il ne revint jamais des camps de concentration ... Emile avait donné ses
instructions à une jeune Verviétoise. En cas de pépin, elle connaissait mon
adresse, savait où me trouver et devait m'apporter le poste de réserve arrivé
récemment lors du parachutage et qui avait été caché chez Monsieur Tiquet
Mangomboux. Ce qu'elle fit. En effet, elle vint
accompagnée de Raymond Fisher, un ancien maréchal des logis du fort de Battice.
Ils vinrent donc, faisant fi de toutes les règles de sécurité qu'ils
ignoraient, les braves gens, et que les Britanniques nous avaient tant
ressassées avec juste raison. Je savais pertinemment qu'un réseau atteint doit
être mis en veilleuse mais pouvais-je faire autrement devant cette magnifique
bonne volonté ? D'ailleurs, je voulais collaborer avec Fisher et Maréchal dont
j'avais pu voir et sentir tout le courage et la volonté de lutter contre
l'ennemi. Je ne devais pas le regretter. Quelques mots concernant
Fisher : Durant les dix-huit jours
de guerre à la forteresse de Battice, Raymond Fisher avait effectué
volontairement plusieurs sorties périlleuses (c'est le moins qu'on puisse
dire). Il fut cité à l'ordre du jour de son régiment. A l'époque c'était un
garçon très mince, tout blond et bouclé. Il avait des yeux très bleus dans
lesquels pétillaient la malice, l'humour et la détermination. Raymond Fisher me
présenta à Edmond Maréchal qui était aussi noir que l'autre était blond. Edmond
était un ancien carabinier cycliste. Bref c'étaient deux gars
sympathiques et décidés sur lesquels on pouvait compter à n'importe quelle
occasion. Je leur fis entière confiance. Je ne le regrette pas. De toute façon
les recrues d'Emile étaient des types excellents en leur genre. D'ailleurs le
choix en était très limité en cet automne de 1941. A partir de cet instant
Raymond et Edmond m'accompagnèrent souvent à Liège et à Bruxelles. Ils eurent
souvent l'occasion également de se rendre un peu partout en Belgique. Et même
pour voyager à Arlon ou à Namur, aucun de ces deux-là ne me réclamèrent jamais
un sou. Vraiment des hommes de ce gabarit il y en avait peu, beaucoup trop peu.
Le nouveau poste émetteur
fut inauguré chez mes parents. Une imprudence en plus. Je n'avais pu trouver un
autre endroit où émettre parmi mes connaissances. Je fis une émission d'une
demi-heure. Dieu seul et mon instructeur anglais Georges Priee savaient que je
ne faisais pas le poids en morse. Je m'en tirai très difficilement, faisant
répéter mon partenaire à maintes reprises. Je reçus quand même son message à
peu près bien. Mon père fit le guet pendant toute l'émission. Heureusement la
maison était à l'écart, on pouvait voir arriver. Je jugeai sereinement
qu'émettre de cette façon, c'était courir à ma perte d'ici très peu de temps.
Il fallait tout changer. Octave me mit donc en
rapport avec Messieurs Hoffmann père et fils. Ceux que nous appellerions
désormais les Jardiniers. Le père Hoffmann était
ingénieur des mines : grandes moustaches blanches à la gauloise. Il avait le
regard franc, sûr de lui. Son fils était un des plus jeunes professeurs de
l'U.L.B. L'Université libre de
Bruxelles venait d'être fermée par l'occupant. La radio, l'électricité
n'avaient aucun secret pour Jean Hoffmann. Une conversation que j'eus avec lui
m'apprit qu'aucune émission ne pouvait en aucun cas dépasser quinze minutes...
Et, c'était un maximum. Il m'expliqua simplement mais
d'une façon limpide le système de repérage par la radiogoniométrie. Vraiment il m'ouvrait des
horizons auxquels je n'avais pas pensé et dont on ne m'avait jamais parlé. Mes instructeurs de Grande-Bretagne
avaient-ils connaissance de ces problèmes ? Je me suis souvent posé la question
après coup. Entre temps j'avais eu l'occasion de me rendre chez les parents de
Vicky et de Christian Ortmans deux célèbres chasseurs de la section belge de la
R.A.F. en Grande Bretagne. J'avais rencontré Christian de l'autre côté du « Channel
». Je lui avais confié certaines choses. J'allai voir ses parents. Comment
expliquer cet accueil que me firent Monsieur et Madame Ortmans en pleine guerre
? Je ne pus m'empêcher d'admirer la dignité, la fierté, le patriotisme du père
et de la mère de Vicky et de Christian. Je compris alors l'idéal
que de tels parents avaient pu insuffler à ces deux héros de notre aviation
belge. Hélas, je ne revis plus
jamais Christian assassiné par des pilotes japonais alors qu'il sautait en parachute
de son avion en perdition... Le sept décembre 1941 :
coup de théâtre. Les Etats-Unis d'Amérique entraient en guerre contre le Japon,
l'Allemagne et l'Italie. Pearl Harbor avait hâté ce qui devait arriver inéluctablement,
fatalement. Les leçons de politique
internationale qui nous étaient données à Herdford me revenaient toutes
fraîches à la mémoire. Comment Hitler, Mussolini et les Jaunes allaient-ils
lutter contre ce colosse ? Momentanément, bien sûr, ils étaient les plus forts.
Le potentiel économique, le chauvinisme et l'acharnement des Américains
allaient faire pencher la balance tôt ou tard. De cela, j'étais
absolument sûr. Je ne me fis pas prier
pour prêcher et commenter cette bonne nouvelle à mes copains Fisher et
Maréchal. Et cela nous remit du cœur au ventre. Octave et moi passâmes un
« gentleman's agreement ». Je m'occuperais du réseau d'Emile Tromme quitte à
collaborer au maximum avec Octave pour certaines affaires spéciales. Je pense
l'avoir fait sans détours. La guerre est finie depuis longtemps. Nous avons eu
la chance inouïe d'en revenir tous deux, non sans mal. Tout est donc bien
ainsi. Jean Hoffmann avait pu par l'entremise de Philippe le Grand, mettre la
main sur un ancien officier radio de la marine marchande. Je tairai son nom. Ce
type était vraiment l'oiseau rare. Il tapait ses trente mots minute comme pour
se jouer. Avec toutes les précautions minutieuses que Jean Hoffmann prenait,
les télégrammes s'accumulèrent rapidement. Petit incident à narrer :
Une émission avait lieu
chez la sœur de Jean Hoffmann : Madame Bettig. J'y allai porter mon télégramme.
Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées que Jean Hoffmann vint m'annoncer
flegmatiquement que la camionnette de repérage était à proximité. Effectivement
il me la montra. Elle était muée en camion automobile commercial pour la bonne
cause. J'eus la trouille et m'apprêtai à repartir quand tranquillement Jean me
prit la main, me fit asseoir, et m'apprit à jouer au « Puzzle ». J'avoue avoir
eu ce jour-là une frousse intense. Tel était Jean Hoffmann. Il fut à mon avis
un des plus grands et des plus modestes Résistant de notre pays. Cet après-midi également
je fis la connaissance du « Miche » Jansen. Il était venu apporter des
documents à transmettre et en même temps surveillait les environs. Miche fut
celui qui aida considérablement Divoi et Donnet à réaliser l'exploit qui les
conduisit en Grande-Bretagne. Il fut également l'un des
rares à s'être évadé de St-Cilles après avoir été condamné à mort. Miche
rejoignit la Grande-Bretagne, « tricha » sur son âge et accomplit plus de
trente raids de bombardement en qualité de mitrailleur. Un homme, un vrai. Il y
gagna une D.F.C., largement méritée. La R.A.F. ne fut plus
aussi spontanée. Le temps était effroyablement mauvais en cet hiver 41-42. Et déjà, aussi il faut
bien l'avouer, les services belges se disputaient à Londres. Mais que de fois
pendant ce rude hiver très enneigé, ne sommes-nous pas allés attendre à
Solwaster: un parachutage qui ne venait jamais. Deux fois de suite après avoir
allumé les feux et balisé le terrain, nous entendîmes l'appareil nous survoler.
Le brouillard épais dans cette partie des Ardennes se levait tout à coup pour
revenir ensuite plus dense encore. Cependant le réseau
verviétois commençait à saboter. Il fut certainement l'un des premiers à le
faire. Les voies de Liège-Huy, Liège-Visé, Liège-Verviers sautèrent à maintes
reprises. Des pylônes soutenant des lignes à haute tension se brisèrent. Le
réseau Maurice Christelbach composé entre autres de Mathéi, Brose, Tonglet,
Jacques Snyders et Albert Vilette commençait lui aussi à se remuer. De l'acide rongea le
tissu feldgrau fabriqué dans une usine verviétoise. L'inter-vapeur fut touchée
également. Une locomotive sabotée en Belgique sauta en Allemagne. Ce n'était
pas parfait mais il faut un commencement à tout. Un jour d'hiver
particulièrement froid, je fus appelé à Verviers. Le « Pilot-officer » de la
R.A.F. James Mac Cairns s'était évadé d'un OFLAG. John Struckmeyer l'avait
recueilli près de Spa. Il l'avait amené jusqu'à Verviers. J'allai le
réceptionner dans cette ville et accompagné de Raymond et d'Edmond nous
l'amenions à Bruxelles. Il fut caché chez l'Abbé Froidure en attendant son
départ vers la France et l'Espagne. C'était un gars de Vancouver (Canada). J'ai
lu dans un livre écrit par un auteur anglais, ayant trait aux évasions durant
la guerre 39-45, qu'il fut un des premiers officiers aviateurs britanniques à
avoir réussi l'exploit de s'évader ... d'un OFLAG. J'avoue que même après
trente ans de distance, cette nouvelle m'a procuré un immense plaisir. Sachant
que j'étais parachutiste des missions spéciales, il m'avait invité chez lui, au
Canada après la guerre. Je suis certain qu'il n'a rien oublié. Il a peut-être
connu le démantèlement de notre réseau et sachant le sort qui était
habituellement réservé à des gens de notre espèce, il aura cru à notre
disparition parmi les « Nacht und Nebel ». Fin janvier 42, nous
repartîmes une fois de plus vers Solwaster. L'équipe de Verviers était appuyée
par René Watteau et son ami Edward. Nous fûmes interrompus dans notre attente
du parachutage par le bruit d'une voiture qui arrivait tous phares allumés dans
l'épais brouillard, véritable purée de pois. Malgré la neige très abondante,
nous prîmes place dans les fossés longeant la route, mitraillettes au poing.
Ils s'arrêtèrent à dix mètres de nous. Ils s'exprimaient en wallon du pays.
C'étaient probablement des fraudeurs bien organisés. Cette nuit-là leur vie ne
tint qu'à un fil. Je suppose qu'ils ne
l'ont jamais su. Vint le huit février,
nous apprîmes qu'Emile Tromme avait été condamné à mort, par l'ennemi. Par l'entreprise de Flora
et d'Ernest Ramaeckers qui m'aidèrent d'une façon prodigieuse, je fus mis en
relation avec deux types de la GFP. Nous achetâmes ces deux hommes sans scrupules.
Ils se firent fort de nous obtenir le transfert d'Emile de St Léonard à la
forteresse de Huy. Nous pouvions arrêter le convoi en cours de route et libérer
mon compagnon d'armes. Le complot fut découvert. Les deux sbires de
la G.F.P. mis en « couveuse ». Emile fut fusillé le lendemain. Avions-nous fait le
maximum ? En toute conscience, oui… Qu'aurions nous pu faire d'autre à cette
époque ? Je partageais la colère
et l'amertume du groupe verviétois ; mais je ne laissai rien paraître de mon
chagrin. Quand je fus seul dans ma
chambre, je pleurai tel un gosse. J'avais perdu un ami véritable, un frère. Son corps avait été
transporté à Bourg-Léopold le jour-même du drame, sans autre forme de procès.
En 46 il revint à Grand-Halleux, son village natal. Le Pays et sa vieille
Ardenne perdait un de ses meilleurs fils. Ce coup dur, je l'avoue démoralisa
notre groupe. D'aucuns étaient atteints d'espionnite aigüe. Un agent double
s'était glissé parmi nous. Il n'en était rien. Il aurait fallu jouer
beaucoup plus serré avec la G.F.P. Ces gens-là et leurs services comptaient
d'authentiques professionnels. Nous étions jeunes dans la mêlée et nous
dépassions tous les jours les règles de la sécurité. La plupart d'entre nous
avaient un peu plus de vingt ans... ... Un certain jour de
l'an de « Grâce 1968 » il me fut reproché par un industriel carolorégien d'être
revenu beaucoup trop tôt en Belgique occupée. Je lui demandai, le sachant fort
bien, ce qu'il avait fait pendant la guerre. Ce monsieur était resté sagement à
l'Université à continuer ses chères études jusqu'en 1945. Inutile de vous dire
qu'il avait un très gros « job ». Il se croyait très important et était devenu
forcément politicien. Je quittai la compagnie dans laquelle il était mon
directeur. Il puait littéralement. Bien sûr, une fois de plus je faisais figure
d'instable... je m'en félicite d'ailleurs... - ... Oui il y avait
beaucoup de jeunes parmi nous. Emile avait terminé sa vie à 25 ans. Octave en
avait 21. Edmond et Raymond aussi. J'en avais à peine 22. Malgré les nombreux cours
suivis en Angleterre, nous fîmes des gaffes sensationnelles. Mais qu'auraient
fait d'autres à notre place. Ceux-là, il fallait d'abord les trouver. Et,
croyez-moi, il n'y en avait pas des masses. Même les généraux Bastin,
Lentz, les colonels Ouwerx et Bernard, notre Pat O' Leary ..., notre cher
Pierre Vandermies, Pierre Bourrier, Frans Hentjens, Albert Régibeau et d'autres
encore, ceux du service Zéro et de Comète n'étaient que des amateurs au sens le
plus strict du mot en 1941. D'aucuns apprirent plus vite, d'autres eurent plus
de chance. La plupart de ceux qui participèrent à la résistance en 1944
attendaient. Oui, ils attendaient que la roue tourne, il faut bien l'avouer. En
1944, quand même ils répondirent à l'appel : c'est humain. Ils eurent également
leurs héros et leurs morts. Peut-être mes amis et mes
chefs des premières missions : Les Vandermies, Hingot, Tromme, Leblicq,
Jourdain, Octave, Fabri, Fonck, Maus, Cassart, Sterckmans, Verhaegen, Wendelen,
Brion, Delmeire, Passelecq, Catherine, Stinglamber, les Pat O' Leary, Pierre
Bourrier, furent-ils des cobayes eux aussi ? Je suis persuadé qu'aucun
d'entre eux n'auraient rien regretté, ne regrettent rien. Ce fut vraiment le
temps des camarades. Tout le reste c'est du vent. On m'a souvent demandé:
pourquoi avez-vous fait cela ? Peut-on répondre pour
ceux qui sont morts ?... Mais encore, je suis sûr
qu'ils le firent tous sans exception pour une certaine idée qu'ils avaient de
la vie ; pour sortir des sentiers battus, par sport également. Et, malgré tout, chacun
d'entre eux avait son idéal propre. Eh, oui ça peut paraître bizarre ou baroque
de nos jours. Mais cela a vraiment existé. Tous ces compagnons qui y ont laissé
leur peau ; peut-être ont-ils contribué eux aussi, un peu, à la libération de
leur pays ? qui sait ?... Puis vint le commencement
de la fin pour notre groupe. Octave s'était fait arrêter chez lui. Les
Allemands avaient également appréhendé le père d'Octave et un agent féminin. Vers cette époque, et,
grâce à Flora et à Ernest Ramaeckers, j'avais fait la connaissance de Monsieur
et Madame Georges Laport. Ils habitaient Rue des Anges, 17, à Liège. Outre
cette maison de maître, Monsieur et Madame Laport possédaient un domaine splendide
à Fraiture près de Chanxhe. Ils mirent ce domaine à
mon entière disposition pour un futur parachutage. Je reconnus les environs
avec Maurice Christelbach et Félix Mathéi. Impeccable, parfait... Je devais donc faire passer
un message demandant un parachutage à Chanxhe-Fraiture. ... Un certain jour très ensoleillé de mars
1942, je me trouvais Avenue Albert à Bruxelles. Je me rendais chez le
jardinier. J'avais emporté un message codé inséré parmi les pages d'un bouquin.
Dans une serviette se trouvaient parmi quelques feuilles de timbres de
ravitaillement, une douzaine de paquets de cigarettes. Je déambulais, mon
chapeau en bataille. J'avais glissé mon colt 38 dans la poche de mon imper. Mon
pistolet était armé d'une balle dans le canon. Prémonition sans doute. Je fus donc devant la
maison de Jean Hoffman. Il était environ 11 heures. La matinée était splendide.
Le soleil déjà chaud. Les rideaux de la cuisine-cave étaient tirés. J'avais
donc le feu vert. J'émis les lettres WE en morse, comme convenus, au moyen de
la sonnerie électrique de l'Office. Un inconnu en habits
bourgeois arborant au revers du veston une rosette aux couleurs belges vint
m'ouvrir. En un éclair, j'avais pu voir un militaire feldgrau dans la
cuisine-cave. Profonde erreur chez eux également. J'avertis mon interlocuteur
de ce que je m'étais trompé d'adresse et refermai violemment la porte. Je
traversai l'Avenue Albert en courant. Je perdis mon chapeau « Eden ». Je
l'avais acheté un numéro trop petit expressément. Je me retournai et vis quatre
hommes lancés à ma poursuite. Connaissant mes vieilles possibilités de coureur
à pied, je pris une foulée longue et soutenue. Me retournant encore, je vis un
type qui piquait un véritable sprint, il devançait mes autres poursuivants d'au
moins cinquante mètres. Le sentant sur mes talons arrivé juste à la hauteur de
l'église du chat, je m'arrêtai pile, sortis mon colt et comme je l'avais
exécuté des dizaines de fois à l'exercice, le coude collé à la hanche, la jambe
gauche en avant, je lui logeai une balle en pleine poitrine. Il pirouetta. Ses
copains l'entourèrent. L'un fit mine de me suivre. Tout en courant j'agitai mon
pistolet, cela les refroidit, sans jeu de mots. Ce fut finalement un policier de
Forest qui m'escorta à vélo et m'enjoignit de me rendre. « Monsieur, lui
dis-je, je suis poursuivi par la G.F.P., je suis un patriote.» (Peut-être
ignorait-il le sens de ce mot ?) J'ajoutai vertement « Si
vous insistez, je ne vous rate pas, vous non plus ». Il était à deux mètres de
moi. Je braquai mon arme dans sa direction. Il s'enfuit. J'allais tirer sans
hésitation. Une grande sablière
s'ouvrait devant moi. Je la dévalai en moins de deux. Je courus encore pendant
dix minutes à peu près. Un ancien combattant de 14-18 reconnaissable à ses
multiples diminutifs de décorations qu'il osait porter à la boutonnière prenait
le frais sur le pas de la porte. J'eus confiance de suite.
Je risquai le coup. J'entrai chez lui et lui
contai brièvement mon histoire. Je lui laissai mon imper, ma cravate et je me
recoiffai. Je lui laissai ma serviette en lui demandant de la brûler
immédiatement. Je voulus lui offrir un billet de 1000 francs. Il refusa
énergiquement, vint sur le seuil de sa porte pour me raccompagner. Il me fit
signe que tout était clair. Il me dit en guise d'adieu avec ce bon accent «
brusseleer » « ça est de la part d'un ancien du 9e de ligne ». Lui avait compris sans nulle autre
explication. Un tram passa. J'allai vers
la place de Namur, je descendis, pris le 16 qui, à cette époque allait jusqu'à
Laeken. Je me rendis chez un cousin, boulevard de Smet de Naeyer. Après ma captivité,
j'entrepris de retrouver cet agent de police et ce brave ancien. Je ne pus joindre
ni l'un ni l'autre. * * * Je me dois de revenir un peu en arrière
de ce récit. En février 1939, lors de mon
assimilation au grade de sergent de réserve au 3e Chasseurs
Ardennais, j'eus pour parrain le sous-officier d'élite Louis Philippe, un « Pays
». Je ne l'avais plus revu depuis septembre 1939. Un jour de janvier 1942 j'eus
de ses nouvelles. Louis Philippe accompagné de Peigneux, un autre du 3e
Ch.A. se trouvait dans le salon des Ramaeckers. Ils étaient complètement « hors
course ». Ils devaient partir vers l'Espagne le plus rapidement possible. (Le
brave Louis Philippe fut un des premiers à être recruté par le colonel
Bernard, au service de Luc, en octobre 1940). Louis me prit à part et
me fit le récit suivant : A plusieurs anciens du
régiment, ils avaient formé un groupe à Vielsalm. Ils avaient aidé le capitaine
Cassart qui avait été parachuté de Grande-Bretagne à Manhay en compagnie
d’Henri Verhaegen, mon ami. La propriété du notaire Jacob leur avait servi de
point de chute. Le capitaine Cassart avait décidé de retourner en Angleterre au
moyen d'un avion Lysander qui devait atterrir près de Neufchâteau. Seulement,
il y avait eu un os de dimension. Le terrain de Neufchâteau était entouré par
la Wehrmacht. Le capitaine Cassart avait été fait prisonnier. Henri Verhaegen
plein de réflexes au dernier moment avait détourné l'arme de l'officier
allemand qui l'arrêtait ; l'avait « shooté » selon la méthode apprise, puis
l'avait abattu. Henri était venu se cacher à Grand-Halleux chez le 1er
chef Debroe que j'avais connu, moi aussi, à Vielsalm. La maison de Debroe avait
été cernée par une compagnie d'infanterie alpine allemande en garnison dans
notre caserne. Debroe et Verhaegen avaient abattu quatre soldats allemands,
s'étaient fait une brèche à la grenade Mills et avaient pu s'échapper dans la
forêt ardennaise. Le fils de Debroe avait été blessé dans cette affaire.
Verhaegen et Dubroe s'en étaient tirés, Dieu seul sait comment. Louis Philippe s'était
mis à leur recherche. Il les retrouva dans une cache du bois de Wanne. Il les
ramena à Liège chez le brave notaire Jacob. Finalement Henri Verhaegen ne
voulant pas compromettre d'autres activités s'était réfugié chez les parents de
Jean Adam, un universitaire liégeois. Tel fut le récit de
Louis, un chic type... * * * La famille de Jean Adam ne pouvait pas
garder trop long temps Henri Verhaegen. Henri devait absolument se faire oublier
pendant un bon bout de temps, sa tête était mise à prix. Avant que Fisher et
Maréchal ne me quittent définitivement j'allai les quérir. Ils vinrent comme
d'habitude sans rechigner. Nous étions munis de trois mitraillettes Thompson,
Henri avait son pistolet. Nous étions décidés à vendre chèrement notre peau. Nous amenâmes Henri dans mon petit
village hesbignon. Maman condamna littéralement une pièce, ce fut le refuge de
Henri durant un bon mois. Les familiers de la maison : mes tantes, oncles et
cousines ne se doutèrent jamais qu'un agent parachutiste dont la tête était
mise à prix avait séjourné pendant une trentaine de jours dans notre demeure.
Deux jours après le départ de Henri vers la Grande-Bretagne le fameux De Zitter
et sa maîtresse vinrent rendre visite chez moi. Les Anglais déjà, Henri
Verhaegen également m'avaient mis en garde contre cette sinistre crapule. La
première phalange de son auriculaire gauche était coupée, une mèche argentée
détonait parmi ses cheveux noirs. Il parlait l'anglais parfaitement et se
faisait invariablement passer pour un aviateur britannique abattu et cherchant
assistance. Henri et moi avions débattu de son cas devant mes parents... Quand il arriva ; pour une fois, avec ma
mère il avait changé son scenario. Il interpella ma mère et lui dit qu'il était
un agent britannique. Il proposait de m'aider et il offrit 100.000 francs en
billets de banque pour payer mes frais de retour... via l'Espagne. Ma mère en
bonne paysanne qu'elle était ne fut pas dupe et lui joua parfaitement la
comédie. Son fils, moi en l'occurrence, n'était pas des plus sérieux et elle le
déplorait. N'était-il pas resté en France jusqu'en 1941 en compagnie d'une
femme dont le mari était prisonnier de guerre. D'ailleurs je ne rentrais plus
chez moi, je menais une vie dissolue. Elle ne savait pas jusqu'où j'étais enfoncé
dans le marché noir. Nullement convaincu ce salaud plaça derechef son argent
sur la table. Maman le lui rejeta entre les mains et les pria vertement lui et
sa maitresse de vider les lieux. Ce qu'ils firent. Si De Zitter était arrivé deux jours
plus tôt, Henri et moi aurions réglé de façon radicale cette affaire. Il n'y
aurait pas eu de pardon de notre part et bien des victimes de ce couple
diabolique eussent été épargnées. Henri Verhaegen, cet Anversois, mon ami
parvint à rejoindre l'Angleterre, fut parachuté une seconde fois, s'évada une
fois de plus. A son troisième retour au pays, son avion fut abattu par un
chasseur de nuit allemand. Seul un de ses équipiers s'en sortit. Henri
Verhaegen fut un pur entre les purs. C'était un Flamand comme je les aime,
modeste, taiseux mais agissant. Sa famille d'Oude God paya un large tribut à la
Résistance, la vraie. Entretemps, Raymond Fisher et Edmond
Maréchal brûlés jusqu'aux os avaient dû, par la force des choses, se dissiper
dans la nature. Ils étaient partis vers l'Espagne. Le second allait être
parachuté et capturé : 24 mois de camp de concentration. Son moral élevé le fit
revenir de cet enfer (qui paraît-il, selon certains, n'a jamais existé). Fisher
lui fut arrêté une fois la frontière espagnole franchie. Il séjourna à Miranda,
les « délices » des prisons espagnoles. Il fut envoyé au Congo Belge, se porta
immédiatement volontaire pour le corps expéditionnaire belge de Birmanie. Lui
aussi possédait un caractère peu commun auquel s'alliait un esprit combattif et
sans faille. Toutes ces arrestations, toutes ces vicissitudes, tous ces copains
évadés ou arrêtés ; cette histoire de l'avenue Albert à Bruxelles, cette visite
de De Zitter chez moi indiquait que moi aussi j'étais brûlé jusqu'à la « gauche
» Une nuit je revins dans mon village et
par l'entremise du curé Auguste Marbaise, je pus obtenir un sérieux viatique.
La baronne du Fontbaré et Monsieur Henri Limbort n'hésitèrent pas un
seul instant à me prêter de quoi me débrouiller pendant longtemps. Je me cachai
à nouveau chez Monsieur et Madame Laport dans leur château de Fraiture. Je
devais me faire oublier pendant un certain temps, c'était de règle. En plus de
cela Monsieur et Madame Laport avaient trouvé le moyen de me faire partir par
une voie très directe et très discrète à la fois. Ils m'expliquèrent le « topo
» de ma future escapade vers la France et l'Espagne. Un de leurs amis, Monsieur
Lepage, directeur de l'Azote à Ougrée me fournirait une voiture qui me
véhiculerait jusqu'à Paris. « Ausweis » et permis de circuler tout avait été
mis au point complètement. J'aurais un contact dans la capitale française et
là, vogue la galère. C'est ainsi que le 14
avril 1942 dans la matinée, je me rendis à Liège par chemin de fer. Je
descendis à Angleur et pris toutes les mesures de sécurité afin de ne pas être
suivi. Je fis prévenir discrètement ma fiancée qui vint me faire ses adieux
chez des amis sûrs. Je lui expliquai et lui recommandai ce qu'il fallait dire
et faire en cas d'arrestation. Je pris un trolleybus,
entrai au Cinéac, on y donnait un film de Danielle Darieux. Dix minutes après,
je quittai ce cinéma par une sortie de secours sans demander l'avis de
personne. Je me défilai dans une petite rue, rejoignis le boulevard. Je
m'arrêtais nonchalamment admirant les vitrines, regardant surtout si je n'étais
pas suivi. A 11 heures j'étais au domicile de Monsieur et Madame Laport, 17 rue
des Anges. Monsieur Lepage en personne, comme promis, viendrait me prendre vers
17 heures. Le temps de mettre certaines choses au point avec mes hôtes nous
passâmes à table. Diner de guerre bien sûr, mais bonne chère avant longtemps
assurément. Monsieur Georges Laport
avait été membre d'une mission diplomatique belge en Roumanie. C'était un
gentilhomme dans toute l'acception du mot. Jusqu'à sa mort, Madame
Laport fut une des grandes dames de la ville de Liège. Pour eux le verbe «
servir » avait encore un sens. Leur grandeur d'âme était exceptionnelle. Madame Laport me
conseilla d'aller me reposer. Je m'endormis immédiatement. Je devais aller très
loin et je récupérais à l'avance des fatigues futures. Vers 14 heures je fus
réveillé en sursaut. Madame Laport était dans ma chambre un peu affolée. - «
André, me dit-elle ; les Allemands cernent la maison. Sauvez-vous par les
toits, je vous le demande, c'est votre seule chance ». C'était aussi à mon avis
la seule solution pour moi. Au travers des rideaux,
dans le jardin, je vis une trentaine de soldats feldgrau. Je plongeai sur le
devant. Là, ils pullulaient. Madame Laport était redescendue. Je montai au
grenier, j'essayai de me faire le plus petit possible. Je sortis par la
tabatière du toit et me planquai derrière une cheminée. Les
balles sifflaient, d'autres écaillaient la cheminée. J'entendais vociférer des
ordres. Puis brusquement un coup de marteau dans la cuisse droite, le sang
dégoulinait ; je sentis que ma jambe était percée de part en part. Je me levai
sur ma jambe valide et sautai sur le toit voisin deux mètres plus bas. Un autre
choc dans la cuisse gauche. Je tombai m'accrochant à une lucarne, cassai la
vitre avec mon pistolet et y pénétrai la tête la première. Je tombai dessus,
c'est le cas de la dire. Je vis trente six étoiles. Je sombrais dans le noir. «
Knock out ». Je repris mes esprits et
j'étais, paraît-il, chez le professeur Leplat de l'Université de Liège au
numéro 15 de la rue des Anges. Des feldgendarmes,
reconnaissables à leurs plaques, me tabassaient à coup de pieds. J'étais là
gisant sur le carreau, la tête et les jambes pleines de sang. Un domestique se
tenait debout, essayant malgré les Allemands de me donner un verre d'eau. A
cette époque en Belgique occupée nous étions peut-être huit agents
parachutistes sur le terrain. Fallait-il ce coup de malchance ?... Le domestique n'était
autre que Jean Brion, le radio d'André Wendelen. Ils avaient été parachutés en
janvier 1942. Mon ami se démenait afin d'attirer mon attention. Bien sûr, je
l'avais reconnu. J'aurais voulu lui dire que je ne parlerais pas, lui crier de
toutes mes forces que je ne dirais rien. J'eus enfin l'occasion de lui tirer un
fameux clin d'œil. Je vis qu'il avait compris. Il se retira enfin, une peine
immense dans les yeux. Un hasard étrange avait
voulu que deux agents parachutistes fussent dans deux immeubles voisins l'un de
l'autre, sans le savoir. Voici ce qui s'était passé : Jean Brion était en train
d'émettre. Sa liaison avec Londres avait dépassé largement les quinze minutes.
Sans s'en apercevoir, il continuait de « pomper » afin de faire passer tous ses
messages. La radiogoniométrie allemande l'avait intercepté. La G.F.P. avait
entouré la maison au 15 de la rue des Anges. J'étais au 17. Je n'étais pas
averti de la présence de mon camarade chez Monsieur Leplat. J'avais voulu bien
faire. J'étais pris en lieu et place de mon ami Jean. A quoi bon proclamer mon
innocence ? J'avais été pris le pistolet à la main. Heureusement pour moi,
j'avais changé celui-ci contre l'arme qui avait abattu l'homme de la G.F.P. à
Bruxelles le 21 mars. Le docteur Leplat et son
fils étaient parvenus à me coucher sur le divan du vestibule ignorant
totalement les éclaboussures de mon sang. Ils voulurent me soigner, mal leur en
prit ... C'était gagné ... En captivité J'allais quitter le monde civilisé pour
un bon bout de temps. Je fus chargé brutalement dans une ambulance militaire
qui me transporta à l'hôpital St-Laurent. Deux soldats me conduisirent, les
jambes trainant sur le pavé, dans une chambre cellule. J'avais pu repérer,
connaissant le quartier, que j'étais situé près de la rue Wazon. Un infirmier
Gefreiter assez correct m'enleva mes vêtements poissés de sang, lava mes
blessures. Mon sang s'était arrêté de couler. Je fus affublé d'une longue
chemise grise et je fus placé dans un lit propre. Un capitaine et un major vinrent alors
et me questionnèrent jusqu'à minuit. Ils étaient accompagnés d'un Obergefreiter
sténographe. Ma montre m'avait été enlevée, mais celle du Herr Hauptmann
m'indiquait l'heure. La carte d'identité que je portais lors
de mon-arrestation m'avait fait citoyen d'Ivoz-Ramet. Je m'appelais Robert
Begon. J'étais orphelin. Jusqu'alors tout s'était bien passé. Ils se levèrent
pour me quitter. L'Obergefreiter dans un français fleurant le parisien me dit
alors : « Ne te fais aucune illusion mon « petit pote », tu seras fusillé d'ici
peu ». J'étais resté très calme durant tout
l'interrogatoire. Je recommandai mon âme à Dieu. Que pouvais-je faire d'autre,
moi, qui suis croyant. Je lui demandai très sincèrement, (serais-je encore
jamais aussi sincère) je lui demandai d'avoir la force et le courage de ne pas
parler... et, je m'endormis. Le lendemain deux infirmiers me
transportèrent dans la chambre voisine. Cette chambre était occupée par un
garçon amputé d'un bras. Il me dit s'appeler René Renson, ex-soldat au 1er
lanciers. Il avait fait du sabotage en compagnie d'un de ses amis. Ayant fait
brûler un entrepôt où l'on fabriquait des parachutes destinés à l'armée
allemande, son ami, leur coup fait, avait remis en poche une bombe non
employée. Le copain avait probablement appuyé sur le « fuse-time » sans s'en
apercevoir. La bombe avait explosé le réduisant en son et lumière. Elle avait
arraché du même coup le bras de René. Je le crus. Je ne pouvais m'assurer de ce
qu'aucun écouteur n'était dans cette chambre. Je lui racontai que j'étais un
mitrailleur arrière de la R.A.F. abattu en Normandie, Belge, j'étais revenu
chez mes parents d'où j'essayais de repasser en Grande-Bretagne. J'avais trompé
Monsieur et Madame Laport sur ma véritable identité. (Ceux qui m'avaient
écouté, et je savais pertinemment qu'ils étaient à l'écoute savaient donc à
quoi s'en tenir) J'allais maintenir cette histoire durant plusieurs jours.
C'était du temps gagné de toute façon. L'histoire de « René
Begon » était fichue. Un simple contrôle à la commune d'Ivoz-Ramet allait le
prouver. Elle n'aurait pu tenir qu'en France non occupée et encore. Le lendemain, je fus
retransféré dans la chambre qui m'avait abrité lors de mon arrivée. Tout cela
afin de subir un nouvel interrogatoire. Et, je me mis à table : c'est-à-dire
que je reconnus après « maintes tergiversations » être un mitrailleur belge
passé à la R.A.F. A brûle-pourpoint, le major me parla dans un anglais
impeccable. Je lui répondis du tac au tac. A cette époque, je
parlais cette langue très « potablement ». Je lui donnai mon numéro
d'escadrille fictive, mes grades et mon matricule. Je lui rappelai surtout la
convention de Genève ayant trait aux prisonniers de guerre. J'ajoutai que
forcément j'avais dû m'habiller en habits bourgeois. Mon pistolet 7,65 je
l'avais eu en Angleterre. J'avais refusé le « Smith and Wesson» trop
encombrant. Pendant cinq jours je fus
questionné et pendant cinq jours je maintins mon alibi. La nuit un Gefreiter
infirmier, originaire de Hambourg, veillait à notre chevet, car je partageais
maintenant la chambre de René Renson. Chaque jour il apportait sa bouteille
thermos. Vers deux heures du matin il commençait à somnoler. Mine de rien, chaque
nuit je l'avais surveillé... Pendant la journée, quand
je n'étais pas questionné, quand tous les gardiens mangeaient à l'heure de
midi, je me plaçais devant l'espion et j'esquissais quelques assouplissements.
Je m'aperçus que je pouvais agiter les jambes. Je ne saignais plus, mes
blessures étaient presque cicatrisées. J'étais donc en état de m'évader. Parlant à voix basse
auprès du lit de René, je lui fis part de mes projets. La nuit prochaine je
refroidirais le Grefreiter pendant qu'il sommeillait. Je lui chiperais son
revolver et nous nous esquiverions par la rue Wazon. Nous entrerions n'importe
où avec ou sans menace. Et là nous trouverions bien à nous habiller. Pour le reste
j'en faisais mon affaire. René me supplia de mettre
mon projet à exécution le surlendemain. Pourquoi le surlendemain ??? J'acceptai
à contrecœur. Le lendemain matin à 8
heures, René dût revêtir ses habits civils et me quitter. Une heure après, ce fut
mon tour. Je m'habillai. Mes vêtements étaient poissés et raides de sang séché.
Je fus embarqué à la citadelle de Liège et jeté, c'est le mot, dans un cachot
infect et puant. On eut soin également de m'attacher les menottes aux poings.
(Je devais les garder jusqu'au mois de septembre jour et nuit). Ma villégiature
aux frais de l'état nazi était commencée. Je reçus un bol de soupe très fluide
pour dîner, ce fut tout. Petit à petit, je
m'enhardis à héler certains captifs, que je sentais disséminés dans le couloir.
Je compris que des
personnes du groupe de Verviers étaient également emprisonnées. Vers 13 heures, un
nouveau prisonnier fut introduit juste à côté de ma cellule. Le nouveau
pensionnaire était René Renson. C'est avec des larmes dans la voix qu'il
m'apprit qu'il était passé devant le Tribunal allemand, qu'il avait été
condamné à mort et qu'il serait fusillé demain à l'aube. Il me dit toute sa
déception de n'avoir pas essayé l'évasion projetée la nuit précédente. Il me
fit ses dernières recommandations. Je devais aller voir sa femme et son fils
après la guerre. Il était sûr que je m'en tirerais. Dans mon for intérieur, je
ne partageais absolument pas sa certitude. Le soir, le bon abbé
Voncken, un saint homme, vint l'assister et demeura toute la nuit avec lui. Le
mur d'une brique qui nous séparait ne parvenait pas à couvrir leurs voix. Je me
bouchais les oreilles pour ne point entendre. Je comprenais quand même malgré
moi ce qu'ils racontaient. C'est une des pires nuits que j'ai passées en
prison. A l'aube, René demanda au geôlier que l'on me passât des cigarettes et
du chocolat que l'abbé Voncken lui avait offerts. J'eus une cigarette. Je la
fumai et parvins à reprendre mon calme, jusqu'au moment où l'on vint le
chercher. Il quitta dignement sa cellule et me cria ces paroles que je
n'oublierai jamais : « Au revoir André, au revoir ». Des larmes me vinrent aux
yeux. Je cassai un carreau de la petite fenêtre grillagée du talon de mon
soulier que j'assénai avec violence sur la vitre. Au diable les coups et
les hurlements que j'allais engendrer. Je suivis des yeux mon ami René. Je le
hélai. René me fit signe de la tête. Il cria encore une fois « Au revoir. Vive
la Belgique ». Il continua à marcher calmement, fièrement, la tête haute. Puis
il disparut, quelques minutes plus tard une forte détonation et après une plus
faible. Il faut avoir vu et
entendu cela pour comprendre réellement tout le sens de ce mot : « c'était un
homme ». Bien sûr la guerre est
une chose horrible. Fou est celui qui l'aime. Mais les malheurs, les jours
tristes, les misères qu'elle engendre créent chez ceux qui doivent la faire
vraiment, une camaraderie à nulle autre pareille... J'entends déjà les
ricanements de ceux qui ne « voudront » jamais la faire, les faiseurs de paix à
tout prix, les embusqués de tout poil. Pour moi cette engeance qui se paie de
mots, n'est qu'une kyrielle de « couillons » gonflés de vent et d'illusions
infantiles ou intéressées. Ceux-là sont prêts à se « déculotter » et à recevoir
des coups de pieds au « cul » de tous nos futurs « protecteurs » en puissance...
Vers la fin de ce mois de
mai 1942 je fus confronté avec un des hommes du groupe de Liège. On l'amena
dans mon cachot. Il avait subi un terrible « passage à tabac ». Il avait le nez
boursouflé qui saignait encore. Ses yeux n'étaient plus que des fentes
noirâtres. Des traces violettes teignaient toute sa figure attestant que mon
pauvre camarade avait été plus que rudement malmené. En pleurant, il reconnut
que nous étions allés attendre un parachutage et que j'étais son chef revenu
d'Angleterre. Je le revis au camp d'Esterwegen. J'eus l'occasion de lui parler
d'homme à homme. Je lui pardonnai tout sur le champ et lui fis comprendre qu'à
sa place, j'en aurais fait sans doute autant. Je dus réellement me fâcher pour
qu'il admette mon point de vue. Nous ne revînmes jamais plus sur ce sujet. Il
tenta de s'évader de ce camp maudit d'Esterwegen, fut repris et se perdit dans
le long et ténébreux chemin des « Nacht und Nebel ». C'était un très chic type.
Jamais je ne l'ai jugé, ne fut-ce qu'un instant. Un autre eût-il pu tenir aussi
longtemps que lui ! Il est si facile d'affirmer qu'on ne se « mettrait pas à
table » alors qu'on est assis dans un bon fauteuil et qu'on à rien à dire... Depuis longtemps ;
c'était certain : la Geheim Feld Polizei était au courant de tout. Un homme de
notre groupe avait eu la maladresse et le mauvais goût d'élaborer son journal
de guerre ; et qui plus est de tenir « à jour » et en clair une liste de nos
gens. Tout cela bien sûr en dépit d'avertissements répétés maintes et maintes
fois. Cette liste contenait des
personnes qui n'avaient jamais pu servir d'ailleurs, qui furent arrêtées et
moururent dans les camps de concentration. L'adresse de ma mère et celle de ma
fiancée y figuraient notamment. Malgré et contre tout je m'obstinai à nier la
part de leurs activités. Elles furent relâchées toutes deux après 5 mois de
captivité. Elles furent surveillées sévèrement, bien sûr, jusqu'à août 44. La
G.F.P. continua son travail de sape. Ils connaissaient mon vrai nom depuis longtemps.
Lors d'un interrogatoire particulièrement violent, traumatisé par un « Dolmetscher
» qui se vanta d'être un ancien Chasseur Ardennais, j'admis que mon vrai prénom
était le même que celui du « Führer » mais que le mien s'écrivait avec PH. A
ces mots, mon fameux compatriote l'ex-Chasseur Ardennais, me laboura de coups
de pieds et de poings. J'eus néanmoins la grande satisfaction de voir que le
Herr Major et le Herr Hauptmann le considéraient avec un réel mépris. Après la
guerre, j'appris qu'il avait été passé par les armes, les nôtres. Depuis mon entrée à la
citadelle, donc, j'avais le triste privilège d'avoir les menottes jour et nuit.
Cependant les interrogatoires se firent de moins en moins nombreux. Ils vinrent
plusieurs fois me questionner durant la nuit. Une fois, rien qu'une fois ils me
demandèrent de transmettre vers Londres. Je refusai
catégoriquement, moi qui n'aimais déjà pas d'émettre pour nos amis. Un jour d'août 1942, le
gardien-chef de la citadelle de Liège, un gestapiste celui-là, vint m'apporter
le « Soir volé » relatant le fameux raid commando de Dieppe. Je le lus
entièrement, épluchant même les petites annonces. Quand le bonhomme revint le
lendemain, je lui avouai sans détours : qu'étant dépourvu de papiers de
toilette, j'avais réservé le journal à des fins extrêmes. Il ne rit nullement, ni lui, ni le docteur
SS qui l'accompagnait. Ce dernier était venu se rendre compte de l'état de mes
blessures qui recommençaient à suppurer. Ce SS me dit brutalement que je
n'avais aucun besoin de soin, « tu seras bientôt crevé » m'apprit-il en bon
français. Je lui répondis
froidement qu'il le serait sans doute avant moi. Je crânais bien sûr. J'ai actuellement 59 ans,
mes blessures se sont cicatrisées depuis longtemps. Quant à lui ? Les premiers jours de
septembre arrivèrent. De temps en temps nous parvenions à avoir des nouvelles
des fronts russe et africain. Elles n'étaient guère satisfaisantes. En Russie
comme en Afrique nos alliés prenaient des « tatouilles » de dimension. Cela ne
nous empêchait guère de garder un moral excellent, inusable. Par un après-midi très
ensoleillé, il y eut un rassemblement de tous les prisonniers appartenant à
notre affaire. Pour la première fois je voyais tous ceux appartenant à notre
groupe. Nous prîmes le chemin de Sr-Léonard. Nous fûmes mis à quatre
dans une petite cellule destinée à une personne en d'autres temps. Je choisis un coin et me
mis à ronfler comme un sonneur au dire de mes compagnons d'infortune. Les
punaises ne m'attaquèrent jamais durant ma captivité: question de sang, peut-être
? Par contre celles de St-Léonard ne laissèrent aucun répit à mes camarades
cette nuit-là. Le lendemain 19 septembre 1942 : grand branle-bas. A grand coup de gueule,
nos geôliers nous firent monter dans des camions bâchés et gardés par de
nombreux soldats armés. Nous fûmes conduits à la
gare de Bressoux et encaqués dans des wagons à marchandises. Une mince couche
de minium adhérait encore toute fraîche aux planchers. En guise de bienvenue. Le machiniste du convoi, Albert Fossoul,
était un gars de mon village. J'avais tant et tant joué avec lui Sous-Chaumont.
M'ayant reconnu malgré ma maigreur il me fit envoyer ses tartines et celles de
son chauffeur que je partageai illico avec mes nombreux compagnons. J'avais
réussi à garder, malgré toutes les perquisitions, une mine de crayon dans le
revers de mon veston. Un truc appris en Angleterre. Je réussis à jeter un bout
de papier à l'adresse de ma fiancée. Je lui adressai ce petit message : « Parti
en Allemagne. Bons baisers. Ton Grand ». Un employé de la gare originaire de
Vaux et Borset le fit parvenir à destination. Il est toujours en ma possession.
Le train se mit en marche et bientôt par la lucarne grillagée nous aperçûmes
Visé. Nous passâmes la frontière. Nous étions en Bochie. Eussé-je pu m'évader,
je n'aurais pu aller bien loin tant j'étais affaibli. Je ne pesais plus
quarante kilos alors que je mesurais 1,81 mètre, j'avais perdu 38 Kg en 6 mois
de captivité. J'étais complètement vidé physiquement. Je m'étais mis en tête
d'apercevoir le dôme de Cologne. Aussi étais-je à l'affût. Superstition bien
sûr : « si je vois le dôme, je reviendrai » Voilà quelles pouvaient être les
pensées d'un prisonnier politique. Je l'aperçus dans toute sa splendeur. Les
derniers rayons du soleil couchant l'atteignaient encore. Riez donc. Chaque fois
que je dois passer à Cologne, j'essaye de « zieuter » le double clocher de
cette magnifique cathédrale et je repense alors à ce long et terrible périple
que je fis il y a trente cinq ans. Assis entre le notaire
Jacob et John Struckmeyer, malgré la peinture encore fraîche, je parvins à
dormir jusqu'aux premières lueurs matinales. Le train s'arrêta
définitivement. Nous étions arrivés à destination : à Bochum, et dirigés « natùrlich
» vers la prison. Rassemblés, la moitié de
notre groupe, une vingtaine environ furent parqués dans une salle de 8m x 7m
environ. Pendant quatre mois, nous allions y vivre encaqués, affamés et malgré
tout, pour la plupart, optimistes. Vers la fin décembre 1942
jusqu'à la mi-janvier 1943 ; nous voyions à la mine déconfite de nos gardiens,
à la hargne de l'inénarrable « Charlot » que quelque chose ne tournait pas
rond. Aucune nouvelle
d'Afrique. Mais il y avait Stalingrad. Nous apprîmes également vers cette
époque que les prisonniers de droit commun allemand devaient quitter la prison
de Bochum pour être engagés sur le front de l'Est. Je suis persuadé que
beaucoup d'entre eux, de véritables « criminels » furent enrôlés dans des
bataillons « d'où l'on ne revenaient pas ». Petit à petit, d'autres
bonnes nouvelles commencèrent à filtrer. Les forces italo-allemandes d'Afrique
se faisaient dure ment malmener par nos alliés. Les Anglo-américains avaient
réussi leur débarquement en Afrique du Nord. Pour nous, tout cela
valait des trésors. Un matin, comme je
rentrais d'une « promenade » de dix minutes dans la cour de la prison,
j'annonçais le « communiqué » au vieux commandant Margraff. Je n'avais pas vu «
Charlot » caché dans la pénombre du porche. Le soleil d'avril m'avait aveuglé
en rentrant dans la demi-obscurité de notre « hôtel ». Le coup de pied me frappa
dans les testicules. Puis, il paraît que je fus roué de coups. Charlot avait
sans doute entendu le nom de « Montgomery ». Je me retrouvai dans la
cellule en compagnie de Léon Denis de Verviers et de Florent Broze de Bressoux.
Ils me soignèrent de leur mieux; mais je ne pus marcher convenablement pendant
une quinzaine de jours. Et ce fut un raid de la R.A.F. qui déclencha un autre
grand départ. En effet, une aile de la prison fut atteinte. Des camarades et
beaucoup d'Allemands aussi brûlèrent pendant des heures. Et là, mes compagnons
et moi eûmes réellement peur d'être brûlés vifs. Les geôliers étaient affolés.
Ils auraient certainement préféré nous voir rôtir plutôt que de risquer leur
vie à nous ouvrir les portes. Heureusement pour nous, l'on parvint à éteindre
l'incendie. Deux jours plus tard,
branle-bas et rassemblement. Des camions militaires
nous transportèrent vers la gare de Bochum et nous embarquions vers une
destination inconnue. Dieu seul savait dans quel antre nous allions tomber !!! Les commentaires allaient
bon train. Les plus optimistes voyaient déjà la guerre finie. Pour les plus
pessimistes, nous serions liquidés en deux temps trois mouvements. En réalité
pour beaucoup d'entre nous, c'était vers la mort lente que nous nous dirigions.
Nous passions Münster en
Westphalie. Puis l'arrêt brutal du train en pleine nuit. Une gare déserte et
sans nom. Nous embarquions dans de
grands camions avec remorques. De sinistres gardiens
veillaient avec détermination. Et, nous arrivons au
misérable camp d'Esterwegen. Qui connaît encore ce nom
à l'heure actuelle, à part ceux qui en sont revenus. Et pourtant il ne devait
rien à Dachau, ni à Buchenwald ni à tous les autres endroits de captivité (qui
paraît-il n'ont pas pu exister). L'Abbé Froidure a écrit
et décrit ce camp des « Nacht und Nebel », Nuit et brouillard, les effacés de
la vie selon le grand Reich. Tous ceux qui y furent n'oublieront jamais cet
enfer. Ce camp était installé
sur des tourbières. Il était entouré de quatre rangées de fils de fer barbelés
et électrisés. Ses miradors étaient survolés été comme hiver par de sinistres
corbeaux. Et malgré tout, pour beaucoup de copains, c'était une espèce de retour
à la vie. Nous nous retrouvions plusieurs agents parachutistes des missions spéciales,
et, en dépit de l'éloignement de nos baraques et de la défense de circuler,
nous nous rassemblions chaque jour. Il y avait Valère
Passelecq, Bob Wauters, Guy Stinglamber, André Flotte, Pierre Danloy et
Alphonse Delmeire « le joyeux luron ». Tous les sept, nous tînmes le coup
admirablement, nous aidant sans compter au propre comme au figuré... ... La dysenterie ne nous
épargna pas. Tout le monde en eut son compte. La tuberculose fit des
ravages énormes et faucha par dizaines. Notre moral, notre esprit nous mirent
au-dessus de cette mêlée. Une affaire extraordinaire nous tint en haleine
pendant des mois. Lemaire, Valère Passelecq, Pierre Meeuwis, Auguste Déan le
Français du Nord avaient pu récupérer parmi les détritus d'une usine
hollandaise d'électricité bombardée, de quoi fabriquer un petit poste
récepteur. Cette radio nous mettait pour ainsi dire à la portée du monde libre.
Valère, Pierre et Auguste écoutaient les communiqués de Londres et de Berlin.
Robert Begon, un Namurois, ami de Valère et moi étions chargés de faire passer
ces communiqués dans les différentes baraques. Le chef de la baraque VI,
Monsieur Van den Einde de Renaix, avait laissé installer le poste à la VI. Il
simula pendant longtemps une parfaite discipline vis-à-vis de notre gardien
chef « Cognac » Il évita ainsi bien des ennuis et des fouilles intempestives. Sur du papier de toilette
volé aux « Frisés » nous écrivions nos fameux communiqués qui étaient lus dans
chaque baraque avant ou après l'appel du soir. A la V, la mienne, Maître
Tytgat et Edmond Struyf se chargeaient journellement de nous lire les
commentaires en français et en flamand rédigés par P. Meeuwis et Valère
Passelecq. Ils commençaient bien sûr
par annoncer les opérations alliées et finissaient par les « Deutsche
Nachrichten » : Ce fut la retraite de
Russie, la bataille de Koursk, l'abandon de Sébastopol, les débarquements de
Sicile et de Salerne. Toutes ces bonnes
nouvelles nous permettaient de vivre, dans le vrai sens du mot. Elles
constituaient réellement notre pain quotidien. * * * Un dimanche de février 1944, il avait
neigé abondamment. Il nous fut interdit de voyager. Je n'en fis rien. Je devais
porter un message à la IV. Je fus surpris par Charlot qui me vit franchir
l'allée allant vers la V. Je rentrai par derrière, jetai mon billet dans un « Kübel
». Quand, je pénétrai dans la place où nous séjournions, le garde-chiourme était
là. Il annonça triomphalement que le coupable devait se dénoncer sous peine de
rationnement des vivres. Il connaissait le coupable et il cita mon nom. Je me présentai uniquement à lui parce
que je savais que mes compagnons ne toucheraient par leur dîner. Je reçus une
volée de bois vert. Puis il me fit enlever ma veste et rester en plein air. Le
repas avait enfin eu lieu. « Millimètre » un autre « Wachtrneister » vint
prendre la relève de Charlot, attendit que son collègue ait disparu
définitivement. Puis, me fit signe de rentrer. Je le remerciai d'un coup de
tête, remis ma veste et rejoignis mes copains. Ceux-ci m'avaient gardé deux
gamelles de soupe. Je n'eus même pas un rhume et pour une
fois je m'endormis le ventre plein... Il faut absolument que je vous conte
également l'histoire du tunnel de la V. Des gens nous étaient arrivés de
Belgique depuis peu. La plupart d'entre eux appartenait à l'Armée des Partisans
de Liège. Des gens bien. Après deux, trois mois du régime d'Esterwegen, voyant
ce qu'il en était, les plus costauds d'entre eux résolurent de creuser un
tunnel qui sortirait à quelques mètres derrière les barbelés. Quelques-uns
avaient été mineurs ; ils « boisèrent » cette galerie de planches subtilisées
aux caisses de « cartouches » qui s'accumulaient près de la « Revier ». Ils en
barbotèrent aux bat-flanc qui nous servaient de lits. Toutes les nuits, ils
déversaient le sable prélevé en dessous de la baraque. Le tunnel long d'une
trentaine de mètres était presque terminé. Le camion citerne servant à vider les
latrines passa au-dessus du tunnel et creva la galerie, s'enfonçant dans le
sable. La baraque fut rassemblée. Bien peu échappèrent à la vindicte de nos
protecteurs. Trois d'entre les partisans se dénoncèrent pour empêcher un
malheur. Un Herstalien, ancien de la Légion, un Polonais et un Bessarabien, anciens
des brigades internationales. Ils furent punis très sévèrement et réintégrés
dans des prisons spéciales. Ils échouèrent finalement à Dachau, je crois ; d'où
ils revinrent. C'étaient trois partisans, mais aussi trois braves, de foi et
d'idéal communiste. Je revoyais encore parfois Lucien « le Bessarabien » Il
habitait Liège et y possédait un commerce très florissant. J'ai conservé un
profond respect pour ces gens-là. La découverte du tunnel fut pour nous le
commencement d'un grand chambardement (rien à voir avec la chanson). Les prisonniers politiques furent
conduits au camp de Burgermoor. Nous fûmes soumis à un régime moins sévère. Pendant
trois semaines la nourriture nous sustenta nettement mieux. Le moral redevint
fameux. Mais brusquement nous retournions à Esterwegen où là rien n'était
changé. Les « boullimistes » refirent leurs recettes culinaires. Mordus,
tenaillés par la faim, ils éprouvaient une étrange satisfaction à parler
cuisine. Pleins d'œdème, toute volonté annihilée, les pauvres s'enfonçaient un
peu plus chaque jour vers l'inanition et la mort. Durant les 3 semaines de notre séjour à
Burgermoor, les Allemands avaient fouillé systématiquement toutes les baraques
d'Esterwegen de fond en comble. Il nous fut donc impossible de reprendre le
service d'écoute radio, et, ce d'autant plus que Valère Passelecq, Robert
Begon, Alphonse Delmeire et tous les autres agents de ce réseau étaient appelés
au « Volksgericht ». Pour eux cela signifiait la mort. Ils eurent la tête tranchée
sur le billot. Le bourreau « fonctionnait » habillé en
grande tenue et chapeau claque. Delmeire nous avait juré que les Allemands ne
le tueraient pas. Le jour de son exécution, il sauta du 3e étage et
s'écrasa 25 mètres plus bas, la tête fracassée. Il avait tenu parole. Valère Passelecq, Robert Begon et toi
mon vieux Alphonse Delmeire, quels chics garçons vous étiez !!! Evidemment, sans radio, sans vraies
nouvelles, les canards ne tardèrent pas à voler bas. Un personnage très connu
d'Esterwegen m'assura, comme il assura à tout le monde, que le débarquement
avait eu lieu en Belgique (nous étions fin avril 1944). Au tout dernier bobard,
les Alliés étaient à Gand. D'aucuns mordirent à l'hameçon et l'avalèrent tout
entier. Ils devaient déchanter quelques jours plus tard. Lorsque l'on parvint à
voler un journal allemand, on ne parlait bien sûr que des opérations en cours
sur le front de l'Est et sur le front italien. Beaucoup de prisonniers perdirent le
moral tout à fait, et, quand l'esprit vacillait, c'était la fin de tout. J'en ai voulu très longtemps à cet
homme. Il l'avait certainement fait dans un but très louable. Il y avait cru
lui-même. Il avait causé sans s'en rendre compte un tort énorme aux copains. Et
cependant lui aussi était un très chic type. Je lui ai pardonné depuis
longtemps car au fond je le répète, il était bien, très bien. Un soir de mai 1944 « Cognac » vint nous
annoncer que nous allions quitter Esterwegen. J'avais
pour ami un Amaytois : Lambert Tomballe. C'était un ancien des brigades internationales.
C'était aussi un pur idéaliste et un grand bonhomme à tous points de vue. Nous
convenions de tenter l'évasion ensemble durant le futur trajet. Désigné pour
une autre destination que celle de Lambert, je parvins à m'arranger et à partir
dans le même convoi que lui. Nous roulions depuis une dizaine
d'heures, le train courait à toute vapeur. Nous étions parvenus à desceller
deux lattes du plancher du wagon. L'un de ceux qui nous accompagnait promit
d'appeler les gardiens SS si nous mettions notre projet à exécution. Ce
salopard avait quelques types pour le soutenir. Le train s'arrêta. Il nous
menaça à nouveau et nous ne partîmes point. Le salaud avait certainement ses
raisons pour empêcher notre fuite. Je les connus après la guerre. C'était une
sombre histoire. Cela ne me regardait plus... Le train stoppa finalement. Les « raus »
et les « Mensch » reprirent. C'était sacré chez eux. Une petite gare fleurie de
Thuringe. Nous étions à Ichtershausen, petit patelin situé dans la région de
Bayreuth à une trentaine de kilomètres d'Erfurt. Nous étions une centaine de
pauvres types squelettiques sales et dégoutants. Nous fûmes encadrés par une
vingtaine de gardiens, pistolets mitrailleurs en mains. La prison était droit,
devant. C'était une forteresse entourée de murs
énormes. Au donjon, le drapeau à croix gammée nous narguait. Nous entrâmes dans
la cour. Des gardiens aux uniformes encore rutilants nous attendaient sur le
perron. L' « Oberwachtrneister », un type gargantuesque (le seul à ne point
porter de croix gammée), nous tînt un discours en allemand. Nous perçûmes à
différentes reprises le mot « beefsteack ». Du coup pour nous il devint « Bifteck
». Si j'avais eu à le juger après la
guerre, je l'eusse acquitté séance tenante. Il était sévère mais bon à la fois,
j'en suis persuadé. Jamais il ne leva la main sur aucun d'entre nous… Jamais
il ne porta atteinte à notre dignité. Et à l'encontre de ses subordonnés, il
resta digne, lui. Rien que pour ça, je l'estimais. Nous fûmes remis seuls en
cellule. D'un côté Maurice Pire, un liégeois. De l'autre Lambert Tomballe.
Pendant de longs mois il allait en être ainsi. Ma « taule » avait trois mètres
de long sur deux de large, un « kübel » y puait à longueur de journée. Une
lucarne grillagée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur éclairait à peine
mon antre. Nous étions véritablement choyés. Nous avions droit à deux promenades par
semaine. Pire, Tomballe et moi refusions le
travail qu'on voulait nous imposer. Nous n'avions pour nous occuper qu'à
regarder par la très petite fenêtre d'une petite cellule située au 3e
étage du donjon. Un train poussif passait trois fois par jour. Nous pouvions
voir également la ferme-état juste à côté de la prison où des prisonniers de
guerre français et yougoslaves étaient occupés. Que n'aurais-je pas donné pour être à
leur place... Je crois sincèrement que j'aurais fait
la « belle » très rapidement. Début juin 44, une hirondelle, malgré
mes doubles barreaux, alors que j'avais aéré, entra dans ma cellule.
Epouvantée, ne sachant plus sortir; affolée visiblement elle s'assomma contre
un des murs. Je la pris précautionneusement, la caressai longuement et
gentiment ; puis quand elle fut bien réveillée, je la lâchai et lui souhaitai «
bonne chance ». Si j'avais pu être cette hirondelle ; je serais parti d'un seul
coup d'aile vers mon pays. Ce jour-là j'eus vraiment le cafard. Le lendemain, un jeunet, Mimile un gars
de « Ch'riord » qui se trouvait juste au-dessous de moi se mit à hurler. Il
appelait désespérément sa mère. Il cria pendant des heures, ameutant nos
gardiens qui s'occupèrent de lui à leur façon. Il mourut deux jours plus tard... A la fin je m'étais bouché les oreilles
pour ne plus l'entendre. Le petit « ch'timi » à la mine éveillée avait perdu
les pédales. Il avait baissé les bras, cela ne pardonnait pas... Tout fini par se savoir, même dans les
prisons des dictatures, les pires. Les prisonniers de guerre Français et
Yougoslaves surent que des Belges et des Français, prisonniers politiques,
étaient enfermés dans cette forteresse-prison. Nous les hélions à l'occasion,
quand nous étions sûrs que nos gardes n'étaient pas dans les couloirs du dernier
étage. Malgré toutes les précautions que nos protecteurs prenaient, nous les
entendions arriver. Une gamelle que l'on faisait tomber violemment, cela
suffisait pour que tout le monde se tienne coi. ... Enfin Le Grand Jour arriva, le jour
J évidemment. Le 10 juin 1944 exactement, un
prisonnier français nous cria la nouvelle, la formidable, l'inoubliable
nouvelle. Ils étaient débarqués... en Normandie. Je
voudrais te connaître ami français. Quel baume tu as mis dans nos cœurs. Quel
espoir fou tu suscitas en nous. Nous te crûmes TOI, instantanément. Nous ne
mîmes jamais ta parole en doute. Et à partir de cet instant, je sus
réellement que les Alliés avaient gagné la guerre. Je peux le jurer. Notre vieux geôlier « grincheux » nous
confirma le débarquement, il était sans nouvelles de son 3e fils
engagé sur le front de France. Deux autres étaient déjà disparus sur celui de
l'Est. A partir de ce jour, il devint plus décrépit et plus grincheux. Il
annonçait que la Manche était littéralement couverte de navires alliés. Bref,
il était devenu complètement pessimiste. Les nouvelles allaient bon train. Nous
communiquions entre nous. Nous avions établi un genre de morse que nous
utilisions le plus souvent possible. Un coup pour A, deux coups pour B. Toutes
les lettres de l'alphabet y passaient bien sûr. Nous les frappions sur les murs
ou sur les tuyaux d'écoulement. Malgré tout, le temps passait trop lentement.
L'horloge sonnait tous les quarts d'heure au dessus de notre tête. Elle nous
allongeait les journées. Que de fois je l'ai souhaitée loin, très loin.
(Maintenant en 1979 elle ne sonne plus). Un obus américain l'a pulvérisé en 45.
Elle n'est toujours pas réparée à l'heure actuelle. La prison, est toujours la
prison. Elle se trouve en Allemagne de l’Est. ... Les Alliés piétinaient, semblait-il,
cela ne tournait pas rond, pas assez pour nous. Seul pendant des heures et des
heures, je m'étais établi un horaire. Après la croûte du matin, je repliais ce
qui me servait de grabat, rabattais ma table, et je parvenais à me rendormir
tous les jours jusque 10 heures environ ; les deux coudes appuyés, la tête
entre les mains. De 10 heures à 12 heures, communication des nouvelles. A 12 heures, la soupe. Après ce qui me
servait de dîner, à force de volonté; je repiquais une sieste toujours dans la
même position assise. Vers 14 heures je marchais dans ma cellule, les pieds
entourés seulement de mes chaussettes russes. Deux tours à gauche, deux tours à
droite. J'accomplissais ainsi quatre à cinq kilomètres par heure. C'était en
même temps une excellente gymnastique, si l'on peut dire, qui m'entretenait.
Vers 17 heures, j'observais par la lucarne jusqu'au souper. Le croûton du soir
et le thé avalés ; je communiquais via le mur à l'un ou l'autre de mes voisins.
Vers 20 heures ; je me recueillais et priais sans fausse honte ; comme je
l'avais toujours fait. C'était en fait le meilleur moment de la journée. Je
marchais à nouveau pendant une heure... Puis lassé, je m'enroulais dans mon
unique couverture et je m'endormais pile jusqu'au lever. Le 25 août arriva. Nous connûmes la
délivrance de Paris par le général Leclerc de Hautecloque... et, l'entrée du
général de Gaulle dans « SA » capitale. Les communistes français parlaient très
peu de tout cela. Chose curieuse, ce qui les intéressait le plus, c'était l'avance
de l'armée rouge. Nous en discutions parfois à « gueule » déployée par nos
lucarnes. Début septembre nous apprîmes que la Belgique était libérée
progressivement. Et le 9 septembre, jour de mes 25 ans, j'appris la délivrance
de Liège, ma chère ville... Aurais-je pu avoir à cette époque un plus bel
anniversaire ? Nous chantâmes la Brabançonne, le
valeureux Liégeois, le Tipperary et la Marseillaise dans nos cellules. Cette
forteresse n'en avait certes jamais entendu autant. Fin septembre alors que les communiqués
se faisaient de plus en plus laconiques ; il y eut un rassemblement général dans
la cour de la prison. Nous eûmes l'occasion de voir partir ce fameux groupe de
partisans belges, vers Dachau (je connus leur destination une fois la guerre
finie). Heureusement j'avais pour principe de ne
pas trop m'attacher à l'un ou l'autre compagnon. Je savais par expérience qu'il
s'en irait un jour soit vers le « Volksgericht », soit vers un nouvel Eden
Nazi. Mais malgré tout le départ de Maurice Pire et de Lambert Tomballe me
toucha très durement. Je me repliai encore un peu plus sur moi-même. Nous
avions des opinions différentes. Ils étaient communistes, moi pas. Mais
c'étaient deux bons et chics types bien plus près de l'esprit du Christ que
beaucoup de croyants. Ils sont revenus eux aussi, leur force de caractère, de
volonté, leur esprit l'a emporté sur tout ce sui était mauvais... Tous les P.P. furent hébergés ou presque
tous dans une grande salle. Cette chambre était, bien sûr, beaucoup trop petite.
Nous nous entassions les uns sur les autres. Nous restions un ramassis de pauvres
diables qui persistaient à survivre et à vivre entre eux avec tous leurs
défauts et leurs qualités. Parmi nous se trouvaient le Docteur Degueldre, Paul
Van Herck, Marcel Darimont, François Devaux, le père Brissac, Merland, Charles
Defrecheux, le baron del Marmol, .Jacques van den Eynde, un Lierrois énergique,
notre Tchantchès l'unijambiste d'Outre-Meuse, gouailleur sympathique en diable
et généreux à l'extrême, Albert Maex, Eugène Gillissen et j'en passe... La source de nos nouvelles ayant été
coupée du fait de notre transfert dans cette chambrée, elles ne nous
parvenaient presque plus. Nous savions par un gardien bavarois grand blessé du
front russe que les Alliés avaient pénétré en Hollande... et en Allemagne, que
le Grand-Duché de Luxembourg était à moitié délivré. Les jours passaient interminablement
longs. Les pessimistes s'en donnaient à cœur
joie. Le temps de Noël arriva, qui combla
presque nos broyeurs de noir. Nos gardiens survoltés vinrent nous refaire la
nique. Personnellement, je ne perdis jamais
confiance ni espoir et je crus simplement comme beaucoup de camarades que
l'offensive des Ardennes était une légère contre-attaque. Nos protecteurs nous apprirent que Liège
était retombé entre leurs mains et que la Belgique entière allait être
réoccupée. Un peu plus tard ils durent déchanter. ... Fin décembre je fus remis en cellule
avec Raphaël Baert de Zweveghem, et Milleke un bon Flamand des environs de
Courtrai. Il avait servi en 14-18 sous les ordres de notre glorieux général
baron Bastin. Milleke fut mon compagnon de travail
forcé. Nous polissions à longueur de nuit des pièces destinées à des grenades à
mains ; du moins c'est ce que nous croyions. Ce travail se faisait dans une
cave nauséabonde et hurlante de crasse. Les murs dégoulinaient d'humidité. A
trois mètres derrière nous se trouvaient les « kübel », latrines où venaient se
« délester » les camarades occupés à l'atelier voisin. Ils y venaient plutôt
deux fois qu'une. Il s'agissait de perdre du temps et de couper la cadence du
travail. Evidemment, il arrivait très souvent que l'on cassât une pièce
essentielle ; ce qui procurait pour tout le monde un repos supplémentaire. Pendant
deux mois nous polîmes ces pièces, Emile et moi, la nuit uniquement. Nous
rentrions, mangions notre misérable pitance, dormions à poings fermés. Nous
étions noirs des pieds à la tête et aucun savon pour nous débarbouiller. Avec
le froid humide de nos cellules et l'humidité glaciale de cette cave-atelier,
comment ne sommes-nous pas « crevés » ? Vers fin mars tout travail cessa
brusquement. Nous savions que les Alliés avaient traversés le Rhin et couraient
à travers ce Reich grand pour mille ans. Du front de l'est nous arrivaient
d'autres nouvelles. Les Russes approchaient de Berlin. J'étais enfin parvenu à chiper un savon
à un « Wachtmeister » ; Je parvins à me délivrer presqu'entièrement de cette
horrible crasse qui me collait au corps depuis des jours et jours. Je me
sentais infiniment mieux. Mon moral était au zénith. A part que je pesais toujours royalement
un peu moins de quarante kg. Etions-nous le 20 ou le 21 mars 1945 ? Nouveau grand rassemblement. Nous
allâmes au « greffe » où l'on nous remit nos habits bourgeois avec lesquels
nous avions été capturés. J'avais aux pieds les souliers qui m'avaient reçu
lors de mon parachutage en Belgique occupée. Comparés à mes vieux sabots, ils
étaient légers, légers. Mon costume à part les taches de sang et les
effilochures faites par les balles était encore potable. A même la peau je portais un grand sac
en papier qui avait contenu du ciment. Cette espèce de chasuble me tenait plus
chaud que n'importe quel pardessus. Je l'avais barboté au nez et à la barbe de
nos anges gardiens. J'en étais particulièrement fier et j'y tenais énormément .
... En l'espace d'un instant nous nous
étions passés de bouche à oreille que nous partions vers Wolfenbüttel, via
Erfurt. Wolfenbüttel était l'endroit le plus
malsain qui pouvait exister pour la plupart d'entre nous. C'était là que le
bourreau sévissait. Malsain, oui très malsain... vraiment. Vaille que vaille nous mîmes le cap sur
Erfurt. Chacun d'entre nous avait reçu un pain entier. Ce pain devait être
notre viatique pour tout le voyage. Défense d'y toucher bien entendu. Nous fîmes les trente kilomètre à pied
d'Ichtershausen à Erfurt. Nous arrivâmes à la gare d'Erfurt, juste à temps pour
y subir un terrible bombardement. La vieille ville qui n'avait jamais subi
d'attaque aérienne fut complètement nettoyée, soufflée. J'étais dans un passage souterrain de la
gare en compagnie de Gillissen, Maex et Defrecheux. Un fantassin allemand rentrant de
permission et allant rejoindre le front nous jaugea immédiatement et partagea
avec nous son pain et ses cigarettes. Puis le bombardement terminé, il nous
serra la main, nous dit adieu et marcha lui aussi, vers son destin. Nos « Wachtmeister » nous avaient
aimablement prévenus de ce que toute évasion équivaudrait à la mort certaine
des deux plus âgés de nos camarades. Le baron Albert del Marmol nous annonça
que pendant le bombardement, un Allemand qui le côtoyait lui avait affirmé que
les alliés étaient proches et que de toutes façons l'Allemagne était « kaput ».
Une fois de plus on nous rassembla. Il ne manquait personne. Ni un
prisonnier, ni un gardien. Nous refîmes le chemin en sens inverse.
Nous n'allions plus à Wolfenbüttel. C'était toujours ça de pris. Quel
soulagement. Je respirais plus librement. Je mangeai tout mon pain. Beaucoup
l'avaient gardé à peu près intact. Cela aurait pu être pour eux un repas
pantagruélique. Ils ratèrent là une occasion unique. Nous étions de nouveau à Ichtershausen.
On refit l'appel. On reprit les pains non consommés. Une gifle ou deux pour les
gourmands. Et hop dans les cellules. Je dormis du sommeil du Juste. A l'aube « ré-appel » dans la cour. «
Bifteck » nous rendit un pain à chacun, et, nous voilà repartis. Vers où
allions-nous cette fois ? Personne n'était au courant de rien. Au dixième
kilomètre environ, nos « Wachtmeister » s'éclipsèrent pour de bon. « Salut en
de kost »… Ils furent remplacés par de vrais
SS Gestapo. Ceux-ci accompagnaient d'autres prisonniers parmi lesquels des
Polonais, des Russes et des Français. Pendant des heures et des heures nous
marchions péniblement vers Rudolfstadt. Nous traversâmes cette ville au
crépuscule. Nous fûmes enfermés dans l'immense garage d'une caserne de blindés.
Plongeant sur un tas de vieux journaux, les partageant avec mes copains je les
adaptai au mieux sur le ciment, me couchai dessus et j'eus ainsi l'occasion de
dormir relativement bien. Suffisamment en tout cas pour être reposé. Je m'étais choisi comme compagnon
d'infortune et de marche : Eugène Gillissen, un jeune Sérésien de dix-huit ans
environ... Eugène était communiste, il l'est toujours d'ailleurs. Je ne l'étais
pas et ne le suis pas devenu. Il savait que j'étais un anglophile acharné. Cela
ne nous empêchait pas d'être de bons amis. Rien n'a changé d'ailleurs à ce
jour. C'était un garçon courageux à l'extrême. Il était cependant très mal en
point, crachant du sang continuellement... A peine rentré en
Belgique il dut quitter son pays pendant trois nouvelles années afin de se
faire soigner en Suisse... En toute modestie je me sentais encore assez costaud
que pour lui venir en aide tout en ne le lui montrant pas trop. Le bon air des sapins
rencontrés dans la forêt que nous traversions nous ravigotait. La gueule
penaude des SS me donnait un fol espoir. Je reçus un coup de cravache d'un
gradé SS pour une vétille que j'avais commise. Je jurai en wallon. Il vint par
la suite me dire qu'il m'avait cru Français, qu'il était des environs de
Malmédy et qu'il avait très bien compris là où je l'avais souhaité d'aller. Il
nous déclara qu'il haïssait tout ce qui était français. Nos camarades
d'Outre-Quiévrain le lui rendaient bien. Dès leur libération, ils le
cherchèrent, le trouvèrent caché et le pendirent sans autre forme de procès. Tant bien que mal, plutôt
mal que bien, nous arrivions à Possneck. Nous pûmes jouir du ravitaillement que
la ville offrait aux soldats en retraite et aux civils victimes des bombardements.
Je mangeai au moins cinq
rations de potage. Très rapidement nos
gardiens nous remirent au travail. Il s'agissait de déterrer des bombes alliées
non explosées. Tout un quartier avait été évacué par les habitants. Eugène se
reposa. Nous rejoignîmes les caves des maisons inoccupées et profitâmes ainsi
des nombreuses réserve et conserves de toutes sortes qui s'y trouvaient. Honni
soit qui mal y pense. Pommes et conserves de
fruits surtout furent appréciées. Je mangeais à ma faim depuis trois ans. Nous logions dans le foin
des granges chez l'habitant, fermées et gardées bien sûr. Cela me rappelait les
débuts de la mobilisation. Je profitai d'être seul
avec Eugène pour lui parler franchement. Parmi nos amis, le docteur Degueldre
et bien d'autres voulaient s'échapper. Ils le firent d'ailleurs. Eugène et moi
résolûmes de quitter une fois notre convoi engagé dans la forêt. Car le convoi
continuait sa route. Le soleil était bas à l'horizon lorsque nous quittâmes
Possneck. La longue chaussée en surplomb traversait un bois très fourni.
Brusquement des « Mosquitos » se pointèrent. Ils plongèrent sur la colonne.
Nous comprîmes tous les deux que c'était l'instant propice. Nous roulions déjà
dans le fossé qui nous déposa assez brutalement dans la forêt. Pénétrant dans les
taillis nous restions cois, laissant partir nos malheureux compagnons le plus
loin possible... et, sans nous. Nous attendîmes encore un bon quart d'heure
environ. Puis entre chien et loup nous rejoignîmes Possneck. Nous atteignions un camp
de travailleurs obligatoires que j'avais repéré la veille. Nous y entrions sans
complexe. Aucun gardien de quoi que ce soit. Nous nous installions sur des
matelas inoccupés et nous dormions tout notre saoul. Le lendemain au réveil,
nous aperçûmes que le baron del Marmol et Prosper Charlier, un Hervien, avaient
fait la « belle » eux aussi. Ils avaient également passé la nuit dans le camp.
Il ne nous restait plus qu'à assurer notre ravitaillement. Un Français de Lille
rentra, c'était un travailleur forcé. Il partagea avec nous ce que son amie lui
donnait chaque jour pour son petit déjeuner. Je me rappelle parfaitement son nom.
Il était d'origine hongroise et s'appelait Jean SZY. Le pain était sec, mais
depuis trois ans je mangeais du pain sec, alors. Pendant qu'Eugène se reposait,
Prosper et moi allions tranquillement vers une usine brûlée la veille par les
bombes incendiaires. Nous passâmes au crible ce qu'il en restait. Nous y
trouvions ce qui nous intéressait par dessus-tout : des victuailles en l'occurrence
; des pommes de terre « pètées ». Mais oui des centaines de patates, la réserve
de l'usine sans doute était restée dans l'incendie. Elles étaient parfaitement
cuites sous la cendre. Nous attachions nos bas
de pantalons au moyen de fils électriques trainant à gauche et à droite, et par
la braguette nous enfournions nos vivres jusqu'à ras bord. Nous en fîmes nos
délices. Nous avions ainsi de quoi nous sustenter pendant un bon bout de temps.
Nous prolongions notre sieste jusqu'à la nuit tombée. Nous avions remarqué,
rien ne nous échappait pendant notre séjour inopiné à Posneck, une remarquable
boulangerie où travaillaient des prisonniers de guerre italiens. Au moment des
nombreuses alertes aériennes qui avaient lieu aussi bien de jour que de nuit,
nous supputions que les Italiens, ne leur en déplaise, n'étaient pas hommes à
rester coûte que coûte au travail. Nous résolûmes donc avec Prosper de nous y
rendre à la prochaine alerte nocturne. Vers 21 heures : « Fliegalarrn » nous
bondissions tout habillé de nos bat-flanc et en cinq minutes : objectif
atteint. Personne en vue. De bons pains frais et croustillants comme nous n'en
avions plus vu depuis très, très longtemps attendaient notre passage. Muni d'un sac pris au
camp, nous empilâmes huit de ces merveilles. Sorti de la boulangerie, nous
fûmes pris alors dans un barrage d'artillerie intense. Les Américains
bombardaient la ville avec du gros calibre. Les soldats allemands retraitaient
en pagaille. Juste retour des choses. Nous nous blottissions l'encoignure d'un
mur providentiel et nous laissions passer cet orage meurtrier qui ne nous était
certes pas destiné. Tous ceux qui ont été pris dans un feu roulant d'artillerie
comprendront certainement que nous serrions les fesses. Eugène nous accueillit
avec un large sourire. Comme nous il y avait longtemps qu'il n'avait plus été à
pareille fête. Nous satisfîmes une faim presque insatiable. Pendant deux longs jours
encore, nous attendîmes notre libération. Elle vint enfin, le 14 avril 1945.
Jour anniversaire de ma capture. J'avais dû attendre 6 mois exactement. Enfin nos libérateurs
arrivaient... J'aperçus les premiers éclaireurs, l'extrême pointe,
l'avant-garde, les fameux tanks Sherman que suivaient des jeeps infatigables.
C'était l'armée du général Patton. Le fameux général qui bouleversait toutes
les tactiques établies. Nous étions fous de joie acclamant frénétiquement nos
sauveurs. Eugène était resté au camp bien mal en point. Accompagné de Prosper
j'assistai à ce qui était pour nous un défilé victorieux. Je vis que mon
compagnon avait des larmes plein les yeux. Il était temps de rentrer au camp,
la grande nouvelle était cependant connue de tous. La liberté J'eus vite fait de découvrir le « Provost
Marshall » ; il fit rassembler tous ceux qui avaient quitté le trop fameux
convoi. Il nous fit loger à l'hôpital de l'ancienne Wehrmacht. Tout le monde y
compris le personnel médical avait évacué les lieux, sauf de gros lapins trop
bien nourris et des serviettes hygiéniques usagées et semées intentionnellement
dans la plupart des chambres. Il fallait bien plus que cela pour nous dégoûter.
Nous en avions vu bien d'autres. Ça ne nous dérangeait absolument
pas. Un bon coup de balai, le temps de tuer et de cuire 3 lapins. La
débrouillardise des Belges fait merveille dans des cas semblables. Je crois que
nous sommes les champions toute catégories du système « D ». Je fis comme mes
compagnons. Je fus trop gourmand. Je mangeai trop de lapin. La nuit, d'atroces
coliques nous tinrent éveillés, nous formions déjà des projets de retour au
pays, interrompus sans cesse par des plongeons vers les toilettes. Le 15 avril,
dans la matinée, je revis le « Provost Marshall » qui avait le temps maintenant
d'écouter mes problèmes et mes doléances. Je lui exposai que j'avais fait
partie des « Spécial Forces », les « Spécial Opération Executive », autrement
dit le S.O.E. en Grande Bretagne et en Belgique occupée. Bientôt il me fit prendre congé de mes
compagnons. Je me rendis en jeep à Weimar. Dans cette ville, je ne fus pas peu
surpris d'y rencontrer un officier Belge appartenant à mon service. Le capitaine Van Den Eynde (Van pour les
copains), un Malinois de pure souche était l'adjoint du major Ides Floor (D.S.O.)
commandant le groupe de sûreté et d'action et qui dépendait lui-même
directement du général britannique Gubbins D.S.O. le grand chef de la S.O.E. Il
me serra dans ses bras et je ne pus retenir mes larmes. Je logeais à l'Elephant
Haus, hôtel où descendait le Führer du temps de sa splendeur. Les Américains y étaient installés comme
chez eux, et ils avaient entièrement raison d'ailleurs. Je
me relevai plusieurs fois la nuit pour aller déguster une sorte de « pape »
merveilleuse que préparaient de jolies Ukrainiennes employées à la cuisine. Dès
la rentrée du capitaine Van, le lendemain j'eus droit à un paquet de
Chesterfield et à une barre de chocolat (Côte d'or). Quel délice que ce Côte
d'or ? Je le savourai en toute quiétude. Peu après, le capitaine Van den Eynde me
présenta à un groupe d'agents parachutistes en mission de recherches de prisonniers
politiques. Je connus donc là Elaine, une femme agent, Michel Blaes, Albert Penninckx.
Ils portaient fièrement notre fameux badge au dessus de la poche gauche du
battle-dress. Le capitaine Van m'apprit que tous mes
compagnons qui avaient fui le convoi seraient regroupés au champ d'aviation de
Dora. Effectivement, quelques jours plus tard, j'y retrouvai Eugène Gillissen,
Prosper Charlier, le docteur Degueldre, Henri Merland, Defrecheux, Maex, Paul
van Herck, Arthur Hambursin, François Devaux et j'en oublie. Nous étions réunis
entre autres avec des dizaines de gars revenant de Buchenwald. Je m'enquis chez
certains d'entre eux de mes autres compagnons, de Monsieur Laport, des frères
Jacob, de John Struckmeyer, de Léon Hennen, de Joseph Heenen, du commandant
Libert, de Victor Zauwen, des Charron père et fils, des Henneumont, des Duray,
de Louis Baikry, de Christelback, de Snyders et de bien d'autres. Nul ne put me
donner de leurs nouvelles… Par contre les G I'S eux nous apprirent
la mort de leur président Roosevelt. Leur chagrin était immense et vraiment
sincère. Nous nous étions établis dans un bloc de
l'aérodrome. Nous étions amplement ravitaillés en vivres et en cigarettes. Le capitaine Seems de l'Intelligence
Corps Britannique était à la recherche lui aussi d'agents parachutés et de
certains prisonniers politiques. Les Anglais ne laissaient pas tomber leurs
gens. Je m'en aperçus. Il se présenta et me demanda de rechercher avec lui
André Fonck qui, paraît-il, devait se trouver parmi nous. Après une heure de
recherches, je reconnus André réduit à l'état de cadavre pour ainsi dire. Le capitaine
Seems le remit aux Américains qui l'envoyèrent dans un de leurs hôpitaux de
campagne. Ils lui firent une transfusion de sang, ce qui lui sauva certainement
la vie. Deux mois après je revis André Fonck.
L'air et, le lait des Ardennes l'avaient presqu'entièrement retapé. ... Le trois mai 1945, un C47 de la
Royal Canadian Air Force me ramenait à Evere. Il avait neigé la veille en Belgique. Mais ce jour-là, le soleil de mal était
au rendez-vous. Il avalait la parure hivernale à grands coups. Tout respirait le printemps, le
renouveau. Oui pour mes compagnons et moi, c'était
le nouveau printemps de la vie. J'étais à Bruxelles, je foulais de nouveau le
sol de mon pays. Cette fois la Belgique était entièrement libre. Je fus conduit au cirque royal où avait
lieu le rassemblement final. Je remis mon nom afin que les ondes, de la radio
nationale, le propulsent vers mes parents et ma future femme. Afin qu'ils
connaissent mon retour au bercail. Je passai le même jour des examens médicaux
à la clinique Depage où je fus traité comme un roi, Je fus déclaré « FIT AND WELL », même
mes poumons avaient tenu le coup. Mon corps de paysan de Hesbaye avait résisté
à toutes les avanies. Je fus ramené au mess des « Missions Spéciales » de la
rue Belliard ! Quel accueil je dus subir de la part de mes frères d'armes !
Claire Fauconnier qui avait été formidable sur le terrain joua pour moi le rôle
de fourrier. Je fus rhabillé de pied en cap d'effets militaires et elle
s'appliqua à coudre mon badge sur ma veste. Souliers règlementaires, chemise,
cravate et battle-dress impeccables. Le lendemain, j'écoutai la messe en
compagnie de tous mes copains croyants et incroyants et une voiture de service
me ramena dans mon petit village hesbignon. Ma mère, ma fiancée, mon père, mes
parents, mes amis, mon village, tout le monde était là. Les drapeaux claquaient au vent sur les
maisons. J'avais des fleurs, pleins les bras :
cadeaux naïfs mais sincères. Quel souvenir !!! Après six mois de récupération, je me
fis démobiliser et rentrai dans la vie civile. * * * J'avais acquis une certaine philosophie
dans mes prisons, dans mes cellules. Par exemple, pour moi l'argent n'avait
plus aucune valeur. C'est peut-être fou... Evidemment ma solitude pendant des
mois avait contribué à cette douce folie. Mais je devais absolument bâtir ma
future vie sur ce principe. Je n'ai absolument pas changé d'opinion.
J'en suis heureux... Mais j'avais cru, moi, pauvre imbécile, que la guerre
aurait changé nos politiciens et leurs combines. Je fus sollicité très vite après mon
retour afin de me présenter aux élections proches sur la liste d'un parti «
bien propre et bien honnête ». Qu'auraient dit Leblicq, Tromme,
Verhaegen et tous mes vrais compagnons ? Ils se seraient bien marrés et ils
auraient eu mille fois raison. Je fis ce qu'ils auraient fait et je dis ce
qu'ils auraient dit... Sur le terrain, au camp d'Esterwegen, dans mes geôles,
j'avais appris à connaître les hommes, les vrais. J'avais vu les plus belles et les plus
basses choses qu'un homme peut faire. J'avais vu tout cela. Seul en cellule
pendant des jours et des jours, j'avais appris à avoir mauvais caractère. Car
il fallait avoir mauvais caractère pour rester seul sans flancher et sans
lécher leurs bottes. Mais
j'avais appris du bon également ; j'avais appris à apprécier deux grandes
qualités ; deux grandes vertus chez l'homme : LA FOI ET LA TOLERANCE. * * * Et si c'était
à refaire. [1]
Les services secrets britanniques avaient une section en Angleterre pour les
agents destinés à l'Europe occidentale et centrale, une autre au Caire pour les
Balkans et le Moyen-Orient, une autre en Inde pour les pays sous contrôle
japonais; ils en établiront une à Alger fin 1942 et une en Italie en 1943. [2]
Remarque : D.B.T. -
lance grenade sur trépieds, engin très
précis employé et fabriqué par l'armée belge, pour tirer dans les angles morts.
D.B.T. sont les initiales des inventeurs belges à savoir : Denis, Bertrand et
Troisfontaines. [3]
Temploux, jeu de mots wallon qui signifie également : a tant plu ... |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©