 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Sauvetage de familles juives à Jauche 
TEMOIGNAGES 
Maison Decoux (Collection Farid Hosni) AVANT-PROPOS 10 mai 1940 : Pour la seconde fois en un
quart de siècle, la Belgique est envahie par l'Allemagne. Une période noire de
l'histoire de notre pays commence. Elle durera cinq ans. Au lendemain de l'invasion, alors que
nos concitoyens croupissent sous la botte nazie, l'existence des Juifs de
Belgique tourne rapidement au cauchemar, suite aux nombreuses vexations et aux
persécutions auxquelles l'occupant les soumet. Début 1942, leur destin bascule.
Ils sont en effet, en exécution de la politique d'extermination de la race
juive, pourchassés, traqués, arrêtés, emprisonnés et déportés en Allemagne dans
des camps de concentration où la grande majorité d'entre eux s'évanouira dans
la fumée des fours crématoires. Mais la résistance s'organisa et, avec
l'aide de leurs voisins, de leurs amis, d'hommes et de femmes courageux et
désintéressés, certains de ces Juifs tentèrent de se soustraire à la déportation
en se cachant le plus souvent à la campagne et bon nombre d'entre eux auront la
chance de renaître à la vie lors de la libération du pays. C'est ainsi que, de fin juillet 1942 à
début septembre 1944, deux familles juives et quelques-uns de leurs amis, en
tout une vingtaine de personnes, seront à l'initiative de la famille Paquay et avec l'aide des Decoux, des Tiriard,
des Courtoy et finalement de toute la population Jauchoise, cachées, aidées, protégées et, n'ayons pas peur
des mots, sauvées à Jauche de la mort atroce à laquelle la folie d'Hitler les
destinait. Toute l'opération fut menée dans la plus
grande discrétion car le risque était évident d'être arrêté et déporté pour
tous ceux qui courageusement accomplissaient cette action de résistance
passive, ce geste généreux de solidarité. Au lendemain du conflit, il semble que
la consigne de discrétion, qui avait été si bien appliquée pendant plus de deux
ans, n'ait pas été levée. Si bien que beaucoup de nos concitoyens ignorent aujourd'hui
que des Israélites furent cachés à Jauche, il y a plus de soixante ans. Il était donc temps, avant que le
souvenir ne s'en perde, de raconter ce que fut cette aventure commune des Jauchois et des Juifs. C'est l'ambition de cette plaquette
qui en présente le récit, par le biais de trois témoignages rédigés par trois Jauchois. Ceux-ci ont en commun d'une part, de ne plus
habiter Jauche et, d'autre part, d'être restés profondément attachés à leur
village. Le premier d'entre eux, Joseph Boly,
prêtre et religieux croisier, homme de qualité, grand
érudit et pédagogue remarquable, est Jauchois de
naissance. Il a vécu les faits qu'il nous raconte et a connu les réfugiés. Le deuxième, Monsieur Jean-Jacques Sarton, est Jauchois d'adoption
car il est arrivé à Jauche, adolescent, à la mi-1940. Historien du village, il
nous livre le fruit de ses recherches. Le troisième, Monsieur Gabriel Kierszencweig, est un des membres, encore en vie, d'une des
familles juives cachées à Jauche. Il avait 12 ans à son arrivée au village. Il est,
lui, Jauchois de cœur, car comme il le dit avec
beaucoup de reconnaissance dans la voix: « C'est à Jauche que je suis né pour
la seconde fois. » Puisse notre jeunesse prendre, avec
fierté, connaissance de cette magnifique page d'histoire écrite par ses parents
dans des circonstances difficiles. Puissent aussi tous les Jauchois voir dans cette brochure l'expression sincère de l'hommage
auquel ils ont droit. J.
PIRSOUL
Bourgmestre d'Orp-Jauche
Le 1er juillet 2006. 
Le Père J. Boly AU REVOIR LES ENFANTS Contribution
à l'histoire des Juifs, à Jauche, pendant la guerre. (Extrait
des Cahiers du « Cercle Historique et Archéologique de la Région de
Hannut» ASBL
- Année 1988) «
Il y a crime contre l'humanité lorsque l'on tue quelqu'un sous prétexte qu'il
est né. »
André
FROSSARD 
En haut, de gauche à droite: Gabriel Michel, Eugène Motte, Robert Michel et Joseph Boly, En bas, de gauche à droite: Charles Paquay, Raymond* et Jean Jamart - 13/08/1944 (Collection de l'auteur) La photo date du 13 août 1944, veille de
mon départ pour le couvent. Je l'ai toujours conservée. Bien qu'elle ne soit
imprimée qu'à moitié, on distingue nettement au premier rang de ce groupe de jeunes,
assis sur le banc de chez Paquay, la figure du petit
Raymond. C'est un des vingt-deux juifs qui ont vécu à Jauche durant la guerre, les
uns pour une période de trois ans, les autres pour quelques mois. Il s'agissait principalement de deux familles
: d'une part, Charles Kierszencweig (44 ans), son
épouse Dora (42 ans), leurs deux fils, Léon, dit Kiki, (19 ans) et Gaby (12 ans),
et leur fille, Lisa (20 ans) ; d'autre part, Samuel Wyschnia
(46 ans), son épouse, Anna (44 ans), leurs deux fils, Léon (21 ans), qui
épousera Lisa Kierszencweig, et David (13 ans), et
leur fille, Hilda (19 ans). Ils avaient quitté la Pologne, en 1923,
et s'étaient installés à Charleroi, dans la Ville-Haute où vivaient de nombreux
petits commerçants juifs. Une bouchère du quartier, Louisa Paquay,
avait servi d'intermédiaire pour les amener à Jauche, dans la maison de ses
cousins, Jules et Marie Paquay qui tenaient un
commerce de fruits et légumes. C'est devant cette maison, quartier
général de nos jeux et de nos rencontres, pendant la guerre, que la photo a été
prise. Charles Paquay, un des fils, qui se trouve sur
la photo est resté en contact avec ces familles juives, aujourd'hui partagées
entre la Belgique et Israël. On lui doit ces précieux souvenirs que Jean-Jacques
Sarton, historien de Jauche, s'est chargé de
recueillir. 
Eugène Motte (Collection Monique Motte) 
Jean Jamart (Collection Léon Tricot) Les premiers fugitifs étaient arrivés à
Jauche, le 30 juillet 1942, après avoir enlevé l'étoile jaune et quitté
Charleroi, au moment où s'annonçaient les arrestations nazies. Ils passèrent
leur première nuit chez Paquay, mais l'endroit était
trop dangereux. Grâce à Auguste Paquay (27 ans),
l'autre fils de la maison, ils furent acheminés, dès le 31 juillet au soir, par
le sentier du petit bois du parc de Hemptinne, à la
villa de Fernand Decoux, à l'angle des routes qui vont vers Hannut et vers les campagnes
du petit bois, presque en face de la gendarmerie. La villa a disparu aujourd'hui
au profit d'un sinistre silo à grains. 
Villa de Fernand Decoux (Collection René Marchal) C'est dans cette villa et plus
précisément sous les combles du grenier que la vie juive s'organisa à Jauche.
Le matin, la porte était verrouillée pour permettre aux réfugiés de descendre
et de prendre l'air dans la propriété. L'après-midi, ils vivaient à l'étage, à
l'insu des visiteurs. Bientôt, de nombreux Jauchois
furent mis dans le coup. Le docteur Mottoulle vint
soigner Samuel W. qui souffrait d'un ulcère à l'estomac. L'instituteur Tiriard accepta de faire la classe aux enfants. Georges Decoux
fournit à Léon K. du travail dans son atelier. Les bouchers de Jauche, Emile Mélery, Fernand Motte, Camille Doyen, débitaient leurs
bêtes, en cachette, dans le garage de Fernand Decoux, avec l'aide de Charles Courtoy. Louise Paquay, la bouchère
de Charleroi, procurait la farine que Dora K. transformait en pâte et que Madame
Tiriard cuisait au four, sans négliger le pain sans
levain pour célébrer la Pâque. Quant à la petite tribu juive, très
industrieuse, elle n'était jamais inactive. Le jardin de Monsieur Decoux était
devenu un véritable paradis de légumes. Lisa K. tricotait à façon pour la
famille Michotte. Hilda W. faisait le ménage chez le
baron Osterath (actuellement villa du docteur Mottoulle) qui offrait en échange le lait et le fromage de
son petit élevage. Bientôt, tout le village de Jauche sut
qu'il y avait des Juifs chez Decoux. Jamais ils ne furent dénoncés. Cependant,
les alertes ne manquèrent pas. Le petit K., qui courait partout dans les rues
et dont les cheveux noirs et frisés pouvaient susciter des soupçons, ne dut son
salut, à maintes reprises, qu'à la connivence des Jauchois.
Un jour, les allemands firent même irruption à la villa Decoux et y
découvrirent le boucher Mélery en train de dépecer
une bête. On leur fit croire n'importe quoi et on leur présenta des biftecks,
tandis que Charles K. et son fils se sauvaient dans le petit bois. Un seul,
Léon K., dit Kiki, fut arrêté (avec Charles Courtoy),
lors d'une rafle, le 19 avril 1944. Heureusement, l'examen sanitaire lui fut
épargné. Il fut embarqué comme travailleur obligatoire pour Oberhausen où il
séjourna jusqu'au 25 avril 1945. Il est actuellement directeur d'un supermarché
en Israël. Son frère, Gaby K. participa à la première guerre d'Israël, puis il
revint accomplir son service militaire, en Belgique, où j'eus le bonheur de le
retrouver, à Bruxelles, à l'hôpital militaire de l'avenue de la Couronne. Il
fait maintenant les marchés dans les environs de Bruxelles. Léon W., son épouse
Lisa K. et Hilda W. quittèrent Jauche pour le maquis avant la fin de la guerre
et furent décorés de la « Médaille belge de la Résistance ». Léon et Lisa, de
même que Léon K., dit Kiki, et Hilda W. habitent aujourd'hui en Israël. Le
petit David W. fut tué au cours de la guerre du Sinaï. Il avait vingt-cinq ans
et repose sur le Mont Herzl, dernière demeure de Théodore Herzl, le plus haut point
à l'ouest de Jérusalem, qui abrite les restes de ceux qui sont morts pour l'indépendance
d'Israël, ainsi que le mémorial Yad Vashem, élevé en souvenir des six millions de morts de
l'holocauste. Quant au petit Raymond, orphelin qui avait accompagné les
familles en exil, on ignore ce qu'il est devenu. 
De gauche à droite : Georges Decoux (père de Pierre et de Bernard), Pierre Decoux (à genoux), Bernard Decoux, Eliane Fievez, Arlette Fievez (à genoux), Fernand Decoux (frère de Georges) et Anne-Marie Decerf. (Collection Famille Decoux) Au revoir les enfants ! Cette odyssée des réfugiés juifs, à
Jauche, n'a pas tourné à la tragédie. Toute une population les a protégés et
sauvés, le plus naturellement du monde et souvent au péril de sa vie. C'est
ainsi qu'en Belgique, 34.019 juifs échappèrent à la déportation, 32.632 furent
arrêtés et presque tous massacrés, puisque, dans les camps de la mort, il n'y
eut que 1.520 survivants. Les images de ces deux petits
Israélites, Gaby et Raymond, avec lesquels j'ai joué pendant ces années
d'occupation me revenaient à la mémoire, tandis que défilaient, sur l'écran du
cinéma « Le Parc », à Liège, les figures extraordinairement sobres du film de
Louis Malle : « Au revoir les enfants ». Louis Malle rapporte, dans son film, un
souvenir vécu, en janvier 1944, au Collège des Carmes d'Avon où il a été
pensionnaire à l'âge de douze ans. Quatre enfants juifs vivaient parmi les
autres qui n'étaient pas dans le secret. Un domestique a parlé. La gestapo est
venue. Le Collège a été fermé. Les élèves ont été rassemblés une dernière fois
dans la cour de récréation. Le père Jacques, directeur, et les quatre garçons
ont été emmenés par les nazis. Les enfants ont applaudi. Le père Jacques s'est
retourné et a crié : « Au revoir les enfants ! » On ne l'a plus jamais
revu : il est mort à Mauthausen, tandis que les quatre petits Juifs
disparaissaient dans l'anonymat des camps de la mort. La réussite de ce film tient au regard.
Regard fidèle sur l'enfance, telle qu'elle est, avec ses ferveurs et ses
cruautés. Regard angoissé sur une époque, telle que nous l'avons vécue, à la
fois banale et tragique. Regard douloureux sur le destin qui, pour les Juifs,
fut l'holocauste. En recevant les sept César, récompense exceptionnelle pour un
film exceptionnel, Louis Malle, qui revenait d'un long séjour aux Etats-Unis, s'est
adressé aux cinéastes français pour leur demander de rester fidèles à eux-mêmes,
à leur identité française, et de ne pas se laisser séduire par l'appât commercial
d'une prostitution étrangère où ils risquent de perdre leur âme et leur créativité.
Joseph BOLY ODYSSÉE DES JUIFS RÉFUGIÉS À JAUCHE (Extrait
de « Jauche 1940-1945 » - Les Cahiers Jauchois – 2e fascicule) 
J.-J. Sarton Dans un de nos précédents chapitres,
nous avons signalé que des Juifs, traqués par les Allemands, avaient eu la vie
sauve en se cachant dans la villa de Mr Fernand Decoux de Jauche (villa
actuellement démolie et qui se situait en face de la gendarmerie). Grâce à Mr Charles Paquay,
nous avons été mis en rapport avec quelques-uns de ces Juifs qui s'étaient réfugiés
à Jauche. Une réunion, organisée le 18 août 1983, nous a permis de rassembler
de nombreux renseignements que nous avons le plaisir de vous livrer aujourd'hui. 
Feu Charles Paquay (Collection Famille Paquay) Les diverses péripéties de ces
malheureuses victimes du rêve fou d'Hitler, qui voulait exterminer tous les
Juifs vivant dans les territoires occupés par les Allemands, ont déjà fait
l'objet de nombreux ouvrages. Nous nous contenterons, pour commencer, d'évoquer
brièvement ce que fut l'extermination du peuple juif en Belgique. Lors de l'occupation allemande de mai
1940, Hitler n'avait pas encore fixé clairement ses intentions envers les Juifs
de notre pays ; toutefois, depuis son accession au pouvoir en 1934, ceux-ci
sont traqués dans toute l'Allemagne et envoyés aux camps de Dachau et de
Buchenwald, ouverts pour y accueillir les adversaires du parti nazi. Contraints
à un travail inhumain dans des usines d'armement, où les détentions sont aggravées
par un manque de nourriture, ces malheureux sont gardés par des kapos, criminels
de droit commun, et certains détenus serviront même de cobayes pour les expériences
des médecins fous du IIIe Reich. Enfin,
lorsque le rendement de ces détenus est insuffisant, ils sont livrés aux
chambres à gaz et leurs corps incinérés dans les fours crématoires. Le sort des Juifs allemands était ignoré
de leurs coreligionnaires en raison du fait que nulle information ne filtrait
des camps. Craignant le pire, de nombreux Juifs allemands parvinrent toutefois
à quitter le pays. Dès leur arrivée en Belgique, les
responsables des troupes allemandes décidèrent provisoirement que les Juifs
feraient l'objet de mesures de ségrégation et de discrimination non-violentes.
Pour débuter, ils décrétèrent que les Juifs porteraient désormais, cousue sur
leurs vêtements, une étoile jaune ornée d'un « J » ; les intéressés se
soumirent, croyant que leur docilité les sauverait. Le 28 octobre 1940, une ordonnance
allemande décida l'élimination des Juifs de la vie économique et, le 31-5-1941,
les Allemands firent un pas de plus dans la persécution en procédant au
recensement de tous les biens des intéressés. Le 15 janvier 1942, un envoyé spécial de
la gestapo, le sturmbannfürer Eichmann s'installe à
Bruxelles et met en place un détachement spécial, chargé d'organiser la déportation
des Juifs de Belgique et du nord de la France. Dans le courant de 1942, le non-respect
de l'obligation de porter l'étoile jaune est sanctionné de la peine de mort ;
de plus il est interdit aux Juifs d'exercer une profession médicale ou
pharmaceutique et, pour eux, le couvre-feu est fixé à 20 h.(voire
à 16 h. dans certaines communes). Le 15 juillet 1942, tous les Juifs sont
astreints à mettre, à la devanture de leur magasin et de leur habitation, une
pancarte signalant qu'il s'agit d'une maison juive. Une habile et insidieuse
propagande, menée par l'occupant, décrit en même temps les Juifs comme des gens
cupides et voleurs, responsables de la crise économique que le monde vient de
subir. C'est évidemment le moyen trouvé par les nazis pour ruiner le commerce
pratiqué par de nombreux Juifs. Le 22 juin 1942, Eichmann avait avisé le
Ministère belge des Affaires Etrangères que 10.000 Juifs, aptes au travail,
allaient être déportés vers Auschwitz. A cet effet, un immense camp avait été
préparé pour recevoir 150.000 travailleurs qui devaient être gardés par 3.000
S.S. Bon nombre de Juifs belges convoqués
répondent à l'appel des Allemands et sont rassemblés à la Caserne Dossin de Mechelen (Malines). Du 4 au 15 août, 3.000 Juifs ont
répondu à l'appel. Il en manque 7.000 pour faire le compte. Eichmann change alors
de méthode et charge la police allemande de traquer les réfractaires. Du 4 au
31 août, 16.000 Juifs seront rassemblés et dix-sept convois partiront de
Mechelen pour Auswichtz. Cette fois, les Juifs réagissent. Ils
quittent leur domicile légal, enlèvent leur étoile, abandonnent les villes et
se procurent de vrais faux papiers d'identité, avec lesquels ils vont se cacher
à la campagne. Certaines femmes échapperont par un mariage blanc avec un non
Juif ; d'autres utiliseront des chaînes d'évasion vers l'Espagne ou la Suisse ;
d'autres enfin bénéficieront de faux extraits de baptêmes chrétiens. Au total, 32.632 Juifs seront déportés;
31.112 d'entre eux seront massacrés. 34.019 parviendront à échapper à la
déportation, pour la plupart grâce à la générosité de Belges, qui les ont
cachés au risque de leur vie. Qui sont ces Juifs ? D'où viennent-ils ?
Certains sont belges de très ancienne date. Beaucoup ont combattu durant la
guerre 1914-1918. D'autres ont quitté l'Allemagne hitlérienne. Beaucoup sont
originaires de Pologne, d'où ils ont fui pour échapper aux pogroms de 1934. Ces
émigrants sont, pour la plupart, des artisans ou de petits commerçants, qui
étaient loin d'être riches. Arrivés en Belgique, ils trouvèrent de modestes
occupations dans la brocante, la friperie, la serrurerie, les réparations diverses. C'est l'odyssée de plusieurs d'entre
eux, cachés à Jauche durant la période 1942-1944, que nous voudrions vous
conter. Les premiers Juifs arrivés à Jauche font
partie des familles Kierszencweig et Wyschnia. Ils ont quitté la Pologne en 1923 pour
s'installer Grand' rue à Charleroi. Il faut signaler que la Ville-haute de la
cité carolorégienne comprenait de nombreux petits commerçants juifs, qui
s'entraidaient volontiers. 
Retrouvailles à Jauche, le 18 août 1983, des Juifs cachés à Jauche durant la guerre 1940-1945. De gauche à droite : Gaby Kierszencweig*, Auguste Paquay, Lisa Kierszencweig veuve Wyschnia Léon*, Charles Courtoy, Charles Paquay, Nelly Sarton, Denise Courtoy, Pierre Courtoy, Myriam Zesler*, Léon Kierszencweig, dit Kiki *, et Broclim Frydman, épouse Gaby Kierszencweig. (Collection de l'auteur) En 1940, ils croient bon d'obéir à
l'ordonnance allemande qui leur enjoignait de coudre sur leurs vêtements
l'étoile jaune ornée d'un « J ». « Vous feriez mieux de vous cacher »
leur disaient leurs amis belges, qui avaient connu les horreurs de la guerre
1914-1918, mais les Israélites hésitaient. Devaient-ils poursuivre leur destin de
Juifs errants ou devaient-ils tenter d'échapper ? Durant plus d'un an, ils patientèrent.
Beaucoup de bruits leur parvenaient au sujet des Juifs séjournant en Allemagne
et dont on était sans nouvelles. Mais ces bruits étaient-ils exacts ? Sur le point
d'obéir aux ordres de rassemblement, la famille Kierzencweig
reçoit un message ainsi libellé : « Ne vous rendez pas au mariage de Tante Olga
». Dans la famille, on sait que la Tante Olga est morte depuis longtemps. On en
conclut que cela signifie qu'il ne faut pas se rendre à la convocation allemande. A ce moment, une belge de leurs
connaissances intervient ; il s'agit de Mme Louisa Paquay,
bouchère à Charleroi-Nord. Elle vit au milieu de ce quartier où résident de nombreux
Juifs et devine la menace qui pèse sur eux. Plusieurs d'entre eux ont déjà été
déportés, soi-disant pour travailler aux fortifications du Mur de l'Atlantique (fortifications
allemandes en cours d'édification pour défendre la côte normande contre une
invasion des Alliés). Mme Louisa Paquay, cousine de
Jules et de Marie Paquay (commerce de fruits et
légumes, à l'époque Mme Moulin Sophie), prend contact avec ses cousins jauchois et leur demande d'aider ses voisins juifs, ce
qu'ils acceptent volontiers. 
Jules Paquay (Collection Famille Paquay) 
Marie Paquay (Collection Famille Paquay) La maison Paquay
de Jauche se révélant trop petite pour loger toutes les personnes annoncées,
Marie Paquay prend contact avec une famille très
patriote de Jauche, qui accepte de loger une partie des Israélites. Le 30 juillet 1942, ayant enlevé leur
étoile jaune, arrivent à Jauche, par le vicinal de Mellet-Perwez-Jodoigne,
six fugitifs : Charles Kierszencweig (44 ans), son
épouse Dora (42 ans) et leur fils Gaby (12 ans), Samuel Wyschnia
(46 ans), son épouse Anna (44 ans) et leur fils David (13 ans). Vu l'heure
tardive de leur arrivée à Jauche, tout le monde est logé pour un mieux à
l'étage chez Paquay. Le lendemain, la dame qui avait accepté
de loger des Juifs se présente chez Paquay et demande
tout de go si les Juifs sont arrivés, car, dit-elle, « il faut absolument les signaler
aux Allemands ». Vous devinez quelle fut la surprise de
Marie Paquay en entendant cette déclaration et surtout
quelle fut la déconvenue des Juifs qui, étant à l'étage, entendaient tout ce
qui se disait au rez-de-chaussée. On se doit, à la vérité, de signaler que
la dénonciatrice en puissance, influencée par la propagande allemande de
l'époque, laquelle rendait les Juifs responsables de tous nos maux, eut, par la
suite, une conduite patriotique irréprochable et rendit à ses compatriotes, et
particulièrement aux résistants, d'immenses services. Malgré son trouble, Marie Paquay eut la présence d'esprit de déclarer à son
interlocutrice que les Israélites ne venaient pas mais, dès lors, se posa pour les
Paquay la question de savoir où loger, dans des conditions
non dangereuses, ces six malheureux. Auguste Paquay,
fils des précédents, âgé à l'époque de 27 ans, et qui était un ami de Mr
Fernand Decoux proposa de contacter ce dernier. Fernand Decoux occupait, seul,
une vaste villa qui se situait en face de la gendarmerie. 
Auguste Paquay, dit « Gus » (Collection Famille Paquay) Sa grande propriété, entourée de hauts
murs, était propice à cacher et à héberger les fugitifs. Fernand Decoux
accepta, au risque de sa vie, de loger nos Carolorégiens en fuite, et le 31
juillet au soir, ceux-ci furent conduits à destination en empruntant le sentier
du petit-bois (longeant le Parc de Hemptinne). A la villa, Fernand Decoux installa son
petit monde sous les combles et l'on étudia ensemble les dispositions à
prendre. La vie des logés, comme du logeur, ne tenait en effet qu'à un fil,
toute dénonciation pouvant les envoyer au poteau d'exécution ou, pour le moins,
dans un de ces camps allemands dont « jamais personne n'était revenu ! » La vie s'organisa tant bien que mal. Mr
Decoux condamnait sa porte le matin, pour permettre à ses hôtes de descendre et
de se dérouiller les jambes dans la propriété. Après le dîner, les camouflés
remontaient à l'étage, ce qui permettait au propriétaire d'ouvrir sa porte à
ses amis et visiteurs, lesquels restaient dans l'ignorance de la présence des
nouveaux occupants de l'immeuble. Pour plus de sécurité, les initiés frappaient
à la porte avec un signal convenu, tandis qu'avant d'introduire un visiteur, on
baissait la tonalité du poste de radio, modification portée à la connaissance
des occupants du second étage par un haut parleur supplémentaire. Quelques semaines après l'arrivée des
premiers Juifs, vinrent également chez Decoux : Léon Wyschnia
(21 ans) et son épouse Lisa Kierszencweig (20 ans),
récemment mariés, Léon Kierszncweig(19 ans), dit Kiki, et Hilda Wyschnia
(19 ans). La consigne du silence était bien gardée
puisque, pendant plusieurs semaines, Jauche ignora la présence de ses nouveaux
citoyens. La première personne à pénétrer le secret fut Mme A. Courtoy-Lacroix qui avait l'habitude de faire paître sa
chèvre, l'après-midi, dans les prés de Mr Decoux. Quelle ne fut pas sa surprise
quand, étant venue un jour la faire paître le matin, elle se trouva nez à nez
avec un inconnu ; et c'est ainsi que les parents Courtoy
furent mis au courant de la situation. Les Courtoy
n'ébruitèrent pas la chose mais une nouvelle alerte eut lieu quelques semaines
plus tard, lorsque Samuel Wyschnia frôla la mort avec
un ulcère à l'estomac. Que faire alors que son état requérait un médecin
d'urgence ? Que faire si l'intéressé venait à décéder ? Fallait-il l'enterrer
dans le jardin, pour garder l'anonymat ? Le docteur Mottoule,
mis au courant de la situation, accepta de soigner gratuitement le malade
jusqu'à son complet rétablissement, tout en gardant la consigne du silence. Seuls semblaient apprécier la situation
les enfants des Israélites qui, par la force des choses, ne pouvaient pas aller
à l'école. Cette situation ne pouvant perdurer, Fernand Decoux en parla à Mr Tiriard qui était son camarade de bridge et qui accepta de
venir donner des leçons de français et de calcul aux enfants. Nul ne vit d'amour et d'eau fraîche, pas
plus les Juifs que d'autres. La petite tribu dut donc s'organiser car le petit
pécule que les parents avaient recueilli, en liquidant leur commerce, fut vite
épuisé ; dès lors, chacun s'affaira à trouver du travail Léon Kierszencweig fut occupé aux Ateliers Georges Decoux, ce
qui fournissait de l'argent. Les trois familles s'affairaient au jardin qui ne
fut jamais aussi bien cultivé et produisit des légumes en abondance. Quant à la
viande, elle était fournie par les bouchers Emile Mélery
et Fernand Motte, qui, tous deux, débitaient leurs bêtes en cachette dans le
garage de Fernand Decoux, aidés dans leur tâche, de même que dans celle de la
confection de la charcuterie, par Charles, Léon et Gaby Kierszencweig,
ainsi que par Charles Courtoy. Louisa Paquay, la cousine bouchère de Charleroi, fournissait de la
farine achetée en échange de viande, ainsi que de fausses cartes d'identité et
de ravitaillement. Cette farine, Dora Kierszencweig
en faisait de la pâte que Mme Tiriard cuisait au four
pour avoir le pain nécessaire aux trois familles. Sacrifiant à la coutume
juive, Dora préparait également pour la Pâque le pain sans levain. Lisa Kierszencweig
tricotait à façon, par l'intermédiaire de la famille Michotte.
Quant à la famille du baron Osterath, qui à l'époque
habitait l'actuelle maison du docteur Mottoule, elle
fournissait aux réfugiés lait et fromage en provenance du bétail qu'elle
élevait, ceci se faisant en échange de travaux ménagers effectués par Juliette Patachevitch, dite Juju. Cette
grande famille devint si industrieuse que l'on fabriqua même du savon avec les
dépouilles provenant des abattages. Avec le temps, de nombreux Juifs et
apatrides passèrent des périodes plus ou moins longues à Jauche, cherchant, ici
et là, l'abri le plus sûr contre la soldatesque allemande. C'est ainsi que
séjournèrent David Schiewicz, Gaby, son fils, et Fella, sa fille, Maurice Trygier,
Juliette Patachevitch, Bernard Toporeck,
dont le frère était champion de boxe amateur poids léger, et Max Burger. Une des plus chaudes alertes survenue à
la villa Decoux fut causée, bien involontairement, par Pierre Courtoy. Celui-ci, réfractaire au travail obligatoire, travaillait
chez Mr Suys, marchand de grains à Marilles. Il dormait chez Fernand Decoux lorsque ce dernier
était en visite chez sa mère et sa sœur, qui résidaient en France. Un jour de
1944, un voleur pénétra dans la chambre de Mr Suys et
lui vola son portefeuille. La fille de Mr Suys, par
la chambre de qui le voleur était passé, avait cru apercevoir une cicatrice sur
la figure du voleur. Comme Pierre Courtoy portait
également une cicatrice, le rapprochement fut fait. Pierre Courtoy
avait comme témoins irréfutables de sa présence à Jauche durant les voiles
Juifs de la villa Decoux, avec qui il avait passé la soirée et la nuit.
Pouvait-il invoquer leurs témoignages, sans les faire repérer par la police
allemande ? Finalement, l'affaire fut expliquée au gendarme Noël qui, ayant
interrogé les Juifs, fut convaincu de l'innocence de Pierre Courtoy
et transmit au Parquet un dossier dans ce sens. Après son interrogatoire par le
Parquet, Pierre Courtoy fut définitivement blanchi
sans que l'affaire fût transmise à la police allemande. Pierre Courtoy, comme les Juifs, retrouvèrent, dès lors, leur
quiétude. Ainsi que vous avez pu le constater, au
fur et à mesure des mois, de plus en plus de Jauchois
étaient au courant de la présence des Juifs chez Decoux. II est, en effet, très
difficile de garder indéfiniment enfermés des enfants et des jeunes gens. Mais
les Jauchois sont patriotes et pour tous ceux qui
étaient recherchés par les Allemands : résistants, Juifs et réfractaires, la
consigne du silence jouait. Deux exemples typiques nous montrent la complicité
des Jauchois vis-à-vis de leurs hôtes Israélites.
Tous deux eurent pour acteur le petit Gaby Kierszencweig,
qui avait 14 ans en 1944 et se baladait volontiers dans les rues de notre cité.
Le premier cas se passe lors d'une descente des Allemands, provoquée par un vol
de tabac chez le grossiste G. Lacroix. Reconnaissant le garçon qui, en toute
innocence, regardait les Allemands, un Jauchois
l'attrapa par le gilet et le renvoya chez lui, évitant ainsi tout contact avec
les occupants qui, au vu des cheveux noirs et frisés du garçon, auraient pu
avoir des doutes quant à sa race. Dans le second cas, Gaby eut passablement la
frousse lorsqu'il fut arrêté par une voiture allemande, dont les occupants lui
demandèrent de le conduire chez Charles Van Hecke. Le
garçon était relativement perdu, lorsque Huguette Bumick, connaissant la situation, s'interposa en disant aux
Allemands que le garçon était trop jeune pour connaître le village et en
s'offrant de les conduire à destination. Les Teutons ne voulurent rien entendre
et emmenèrent Gaby. Il va sans dire qu’arriver chez Van Hecke,
le garçon s'empressa de déguerpir, les Allemands le laissant heureusement faire. C'est avec la fin de la guerre, en cette
période trouble où les Allemands subissaient le débarquement allié, tandis que
les résistants devenaient de plus en plus audacieux, que les alertes furent les
plus sérieuses parmi les réfugiés juifs. Jusqu'en avril 1944, la colonie juive
avait échappé à la déportation. Mais le 19 avril, la consternation atteignit
les réfugiés et leurs amis belges. Léon Kierszencweig,
dit Kiki, venait d'être arrêté par les Allemands ; il avait alors 21 ans mais était
porteur d'une fausse carte d'identité belge lui donnant 19 ans. La rafle
s'était passée très rapidement. Des Belges, travaillant pour les Allemands,
étaient venus à Jauche pour arrêter Marcel Ghenne, ancien militaire de
carrière, ainsi qu'Arthur Gougnard et Joseph Corbet, réfractaires. Marcel Ghenne, arrêté mais muni de
papiers en règle, fut relâché. Les sbires s'étant rendus chez les deux autres Jauchois ne les trouvèrent pas, malgré une fouille en règle
de leur habitation. Furieux de leur déconvenue, les deux pro-allemands
s'emparèrent de Charles Courtoy et de Léon Kirszencweig (Kiki.), qui passaient par hasard en face de
chez Gougnard. Les jeunes gens protestèrent, mais les
émules d'Hitler les embarquèrent, en disant qu'ils étaient munis de faux papiers.
Charles Courtoy, furieux d'être arrêté, protesta avec
violence de la valeur de sa carte d'identité et fut si convainquant que les
pro-allemands acceptèrent d'arrêter leur camionnette devant chez le notaire Scheys, bourgmestre à l'époque. Le notaire déclara qu'il
connaissait très bien Charles Courtoy, que ses
papiers étaient authentiques et qu'il était le fils d'Edmond Courtoy présent à ce moment à l'étude. Tous deux furent si
convaincants que Charles fut relâché. Le malheureux Kiki, habillé avec une
chemise sans col de Mr Decoux et vêtu d'un pantalon de la même provenance mais
deux fois trop large pour lui, fut embarqué. Il partit les pieds chaussés de
pantoufles dont les semelles étaient des morceaux de pneus d'auto cousues à des
empeignes de tissu. Il passa successivement par Wavre, Leuven
(Louvain) et Liège, avant d'être embarqué comme travailleur obligatoire pour Oberhausen.
Heureusement pour Léon, la visite sanitaire qu'il dut subir fut assez sommaire
et les Allemands croyant avoir affaire à un réfractaire au travail obligatoire ne
surent jamais qu'ils avaient en face d'eux un authentique Juif. Il va sans dire
que le départ de Kiki fut douloureusement ressenti par ses parents. Les Jauchois au courant de la situation songèrent avec effroi
au sort qui pouvait lui être réservé et ne manquèrent pas de lui adresser,
suivant leurs maigres possibilités, colis de vivres et de vêtements. Une des dernières péripéties du séjour
des Juifs à Jauche eut pour acteur Emile Mélery. Un
jour, deux Allemands, pour une raison que l'on ignore, montent sur le perron de
la porte d'entrée de la villa Decoux et actionnent la sonnette. Alerte !!! Charles
Kierszencweig et son fils se sauvent dans le
petit-bois, ce qu'aperçoivent les Allemands qui, ne pouvant entrer dans la
maison par la porte d'entrée, pénètrent dans le garage. Qu'y trouvent-ils ?
Emile Mélery en train de dépecer une bête. Les gros nigauds
croient comprendre que les deux personnes se sont sauvées parce qu'elles étaient
surprises à pratiquer un abattage clandestin, et se mettent à rire à pleine
gorge. Il en est un qui ne rit pas, c'est Emile Mélery
; et les habitants de la villa sont sur le qui-vive. Les Allemands, croyant
vraiment avoir trouvé un abatteur clandestin, demandent à notre boucher de leur
préparer à chacun quatre steaks qu'ils reviendront chercher plus tard, puis
s'en vont. Dès leur départ toute la colonie juive quitte la maison Decoux et
cherche refuge chez des amis. Calme complet quelques heures plus tard, quand
les Allemands reviennent. Cette fois, ils demandent encore deux steaks de plus
pour les copains. Emile Mélery, sachant que les Juifs
ne sont plus en danger et que les Allemands n'en veulent qu'à ses biftecks, se
fâche cette fois et ne veut rien entendre. Surprise des Allemands qui, ne
sachant que faire, embarquèrent notre boucher qu'ils relâchèrent quelques
heures plus tard. L'alerte avait été chaude. 6 septembre 1944. Jauche est libéré par
les Américains. La colonie israélite est enfin libre et peut circuler,
librement et sans crainte, dans le village. Pour la première fois, les Jauchois découvrent des hommes et des femmes qui ont vécu
deux ans dans leur village et dont ils ne connaissent pas les figures. Il va
sans dire qu'il n'en était pas de même de Léon Kierszencweig
et surtout de Gaby que tout le monde connaissait et nous avons été étonnés de
constater, le 18 août 1983, lorsque nous avons revu Léon Kierszencweig
avec son épouse, Gaby Kiersencweig avec son épouse et
Lisa Wyschnia, combien nos anciens hôtes
connaissaient encore beaucoup de Jauchois. Une grande page est aujourd'hui tournée.
Après cinquante ans, que sont devenus nos Juifs de l'an 40 ? Gaby Kierszencweig,
après l'armistice, est parti en Israël où il fit la guerre de la libération du pays. Rentré en
Belgique après la proclamation de l'indépendance d'Israël, il fit de nouveau un
service militaire en Belgique. Lancé dans le commerce, Gaby Kierzencweig
tient les magasins de tissus « Gaby », à Charleroi et à Bruxelles. Léon Kierszencweig,
dit Kiki, après avoir passé un an dans le camp de travail allemand d'Oberhaussen, est rentré en Belgique le 25 avril 1945. Il
est actuellement directeur d'un supermarché en Israël. Léon Wyschnia
a épousé Lisa Kierszencweig. Ils sont également en
Israël où Léon est responsable de l'enseignement de la gymnastique dans son
pays. Lisa Kierszencweig,
dite Lili, séjourna à Jauche en 1942-1943. Elle quitta notre village pour
gagner le maquis de la région namuroise (Front de l'Indépendance), sous le
prénom de Marie-Louise. Une fois par semaine, elle se rendait notamment à Chimay
pour y prendre le courrier. Léon Wyschnia et Lisa Kierszencweig furent tous deux décorés de la Médaille de la
Résistance. Juliette Patachevitz,
dite Juju, entra dans le groupe de Résistance « Front
de l'Indépendance », à Couillet. Arrêtée à Namur, en avril 1944, elle fut
transférée à Mechelen et fit partie, trois semaines avant la libération, du
dernier convoi (n°26) qui quitta effectivement Mechelen pour Auschwitz. Après
trois mois passés dans ce dernier camp, elle fut transférée à Dachau où elle
recouvra la liberté, en mai 1945. Après la guerre, le Ministère de la Défense
Nationale accorda à Juliette Patachevitz la Médaille
de Prisonnière Politique et la Médaille de la Résistance. Bernard Toporeck
se cacha à Jauche, de 1943 à septembre 1944. Il fit partie du Mouvement
National Belge (M.N.B.). Il collabora avec Léon Peeters, transportant notamment
du T.N.T. (explosif), de Namur à Jauche. Il fut décoré de la Médaille de la
Résistance. Hilda Wyschnia,
dite Catherine, entra dans la Résistance à Chimay, dès novembre 1943, sous le
prénom de Jeanne. Elle fut décorée de la Médaille de la Résistance. 
Retrouvailles à Jauche, le 18 août 1983, des Juifs cachés à Jauche durant la guerre 1940 --1945. De gauche à droite : Broc1im Trydman, épouse de Gaby Kierszencweig, Auguste Paquay, Lisa Kierszencweig*, veuve de Léon Wyschnia, Nelly Uyttebroeck, épouse de J.-J. Sarton, Léon Kierszencweig*, dit Kiki, Myriam Zesler, Gaby Kierszencweig* et Charles Paquay. (Collection de l'auteur) Pour terminer cet article, nous
rapporterons ces quelques lignes, que Lisa Wyschnia nous
écrivit d'Israël lorsque nous l'avons contactée : «
J'ai fait la connaissance de beaucoup de Jauchois et
je n'ai jamais été déçue. Ils se sont montrés très gentils et très affectueux.
Ils ont toujours fait leur possible pour nous aider. Une chose relie tous les Jauchois, c'est leur grand cœur, leur volonté d'aider, même
s'il y a des risques. Petit à
petit, la majorité des Jauchois étaient au courant de
notre présence chez Decoux. Non seulement personne ne nous a dénoncés, mais, au
contraire, chacun a fait son possible pour nous aider. Malgré notre situation
précaire et pénible, nous avons passé de très bons moments à Jauche. Je ne
crois pas que l'on puisse trouver beaucoup de « Jauche » sur notre planète et
cela a été notre chance de tomber dans un tel oasis. » Nous ne pouvions terminer sur des mots
plus chaleureux. J.-J.
SARTON
Jauche, le 28 janvier 1991. EXODE DE JUIFS DE CHARLEROI A JAUCHE DE
JUILLET 1942 A LA LIBERATION EN 1944 
Gabriel Kierszencweig ************************************************** Sauvetage
d'Israélites avec la collaboration d'un village ************************************************** En hommage à
la famille Paquay de Charleroi et PROLOGUE MARIAGE ET DEPART DE CHARLEROI Présentation
des principaux personnages : - La famille Paquay : Jules, le chef de famille, son épouse Marie,
l'aîné des fils, Auguste, dit Gus, et Charles. Elle exploite l'épicerie
familiale au cœur du village de Jauche. - Les familles Kierszencweig et Wyschnia, dont
la composition est la suivante : 1) Charles (Chaïm) Kierszencweig,
le papa, la maman Dora, la fille Lisa, Léon, dit Kiki, l'aîné des fils, et
Gaby, l'auteur du présent texte. 
Charles (Chaïrn) et Dora Kierszencweig. Parents de l'auteur (Collection de l’auteur) 
Lisa Wyschnia, née Kierszencweig. Pendant la guerre (Collection de l’auteur) 2) Schmerel Wyschnia, le papa, Hanschè, la
mère, Léon, le fils aîné, Hilda, la fille et David, le
plus jeune. Au fil des événements sont venus aussi à Jauche: Maurice Trygier, dit Raymond, Juliette, alias Juju,
Bernard Toporek, cousin de Léon Wyschnia,
dit Dov, la famille Sciewicsz
et d'autres, par intermittence et dans certaines circonstances qui seront décrites,
dont Madame Korn d'Anvers et ses deux enfants. - Fernand Decoux: qui fut
avec les Paquay notre second sauveur. Célibataire, fonctionnaire
au Congo, rentré en Belgique pour ses vacances, il avait, à cause de la guerre,
été empêché de rejoindre son poste en Afrique. Le lien entre ces deux groupes : Louisa Paquay et Prosper, son époux, cousins de Jules Paquay, bouchers de leur état et voisins de la famille Kierszencweig à la Grand' Rue à Charleroi. La raison de la rencontre entre ces deux
familles juives : d'une part, Louisa, les Paquay et
Fernand Decoux, d'autre part. En 1942, les Allemands, occupant
l'Europe, décident de rassembler tous les Juifs de Belgique, afin de,
soi-disant, les envoyer dans des camps de travail !!! En Allemagne, mais, en
réalité, de les exterminer, comme tous les Juifs d'Europe, pour rendre plus pure
la race aryenne (voir Mein Kampf d'Adolphe Hitler). Ces
Juifs devaient se munir de linge et de nourriture pour les quelques jours de voyage
et se présenter à la caserne Dossin, à Malines, sous
peine de graves sanctions en cas de refus. Nous savions, par des lettres venues de
Pologne où résidaient les familles de nos parents et où cela avait débuté plus
tôt que chez nous, que c'était pour aller à la mort !!! Mais que faire ? Où
aller ? Comment échapper à cette condamnation collective ? C'est au cours d'une conversation entre
la cousine Louisa et mon père, qui expliquait notre détresse, que Louisa émit
l'idée d'en parler à ses cousins du village de Jauche, (dont nous ne savions
rien, ni même où il pouvait bien se trouver). Louisa nous proposa d'attendre
leur réponse avant de prendre notre décision. A son retour, elle nous expliqua
que ses cousins, la famille Paquay, avaient trouvé une
personne qui acceptait de nous louer un appartement au village, et ainsi de
nous aider à échapper à la horde nazie. Aussitôt, nous préparons nos maigres
bagages, car nous ne pouvions emporter que peu de choses, papa entreposant les
marchandises restantes (bas et chaussettes) de son commerce chez Louisa et
d'autres objets de famille chez un autre voisin. 
Lisa Kierszencweig et Léon Wyschnia (Collection famille Courtoy) t-align: Le 30 juillet 1942, jour de notre
départ, Lisa Kierszencweig et Léon Wyschnia s'unirent pour le meilleur et pour le pire, en
espérant que ce ne soit pas le pire, en cette période noire, qui prenne le
dessus !!! Ce fut un mariage à la sauvette, sans tralala, juste un verre à la
maison, pour ne pas en être séparés, et les jeunes mariés, accompagnés d'Hilda,
la sœur de Léon Wyschnia, et de mon frère Kiki, partirent
vers un endroit pour s'y cacher. Nous : les parents, David et moi, qui
arborions l'étoile jaune de David, portée obligatoirement par tous les
Israélites sur le revers des vestons, pulls ou blouses, nous enlevâmes cet
emblème de nos vêtements, avant de monter dans le tram qui devait nous conduire
à Fleurus, où nous devions prendre un tram vicinal pour les environs de Jauche.
Ces étoiles avaient été décousues et puis faufilées à grands points pour pouvoir
être enlevées rapidement pendant notre voyage vers Jauche. Finie pour nous la
peur d'être plus facilement repérables. Nous pouvions respirer, avec un peu
moins d'angoisse, mais n'étions pas sauvés pour autant. 
Léon Kierszencweig, dit « Kiki », avec Monsieur Fernand Decoux (Collection de l'auteur) CHAPITRE I ARRIVEE A JAUCHE ET INSTALLATION Arrivés au village avec notre accompagnatrice,
l'inoubliable Louisa, nous faisons enfin la connaissance de la famille Paquay au complet : Jules, Marie, Gus et Charles, mon
compagnon de jeux et mon ami pour la vie. Après cette prise de contact, au cours
de laquelle nous avons savouré le merveilleux accent de Marie Paquay, fait d'un tiers de français, d'un tiers de wallon
et du dernier tiers de flamand, qui donnait, une fois mélangé et compris, un
langage très coloré et depuis lors inoubliable pour nous, après avoir bu et
dégusté un repas savoureux, nous nous sommes installés pour attendre la venue
de notre future logeuse qui tardait. Ne la voyant pas venir nous chercher,
nous avons dormi au premier étage, les uns sur un divan, les autres à la bonne
franquette, en attendant la suite des événements. Au matin, nous fûmes réveillés par des
cris. C'était notre logeuse, dont nous tairons le nom. Elle venait exhorter les
Paquay à nous confisquer nos bagages, à les partager avec
elle et à dénoncer « CES JUIFS » aux Allemands etc, etc ... Marie Paquay ne perdit
pas son sang froid et lui répondit que, comme elle n'était pas venue la veille
nous chercher, nous étions repartis, désespérés, sans doute à Charleroi !!! C'est par ce premier contact, pourtant
difficile, avec cette triste réalité de la méchanceté de certaines gens, et
avec la prise de position des Paquay, que nous avons compris
que nous étions tombés chez des personnes formidables. Nous ne pensions plus
que cela pouvait exister, après ce que nous avions déjà entendu !!! On tint un conseil de famille. C'est
alors que Gus émit une idée : il proposa de contacter Monsieur Fernand Decoux,
un célibataire âgé de 42 ans (le même âge que ma mère), qu'il savait gaulliste
et anti-nazi convaincu, espérant obtenir de lui qu'il
nous héberge en attendant de trouver une solution... Nous y sommes restés plus
de deux ans, jusqu'à la libération. Le soir, en passant par l'arrière du
village, par le lieu-dit « le petit bois » qui menait discrètement à l'immense
propriété de F. Decoux, nous arrivâmes à notre futur lieu de séjour. 
Villa de Fernand Decoux (Collection René Marchal) Des chambres pour tous, des cuisines à
profusion, salle de bain, nous ne connaissions pas un tel luxe, un parc
immense, un potager, un verger avec une centaine d'arbres fruitiers, et,
derrière ce verger, un terrain de foot, qui servait à l'équipe locale, dont Gus
faisait partie. Ce terrain, avec son entrée sur la grand' route de Hannut,
jouera son rôle dans la suite de l'histoire. A ce bien-être, il y avait, bien sûr,
des restrictions : Il nous fallait rester tous groupés au grenier pendant la
journée, car, pour ne pas alerter les nombreux visiteurs de F. Decoux, qui
avaient table et maison ouvertes aux jeunes du village qui entraient et sortaient
de ce lieu à longueur de journée, nous devions rester tapis dans la mansarde, jusqu'à
ce que la cloche de la porte d'entrée sonne trois fois. C'était pour nous le signal
convenu pour descendre nous relaxer et pour permettre aux mères de préparer les
repas pour le lendemain. Cette cloche servait aussi de mot de passe pour les Paquay, et principalement pour Gus, qui venait, chaque
jour, nous apporter ce qu'il pouvait nous trouver, grâce aux timbres de
ravitaillement que nous procurait Louisa, aidée par la résistance
carolorégienne. Et,
quand Gus venait nous voir, il faisait retentir cette cloche trois fois. F.
Decoux allait alors ouvrir en criant : « C'est toi, Gus ? » !!! Et ainsi, le temps passait. Nous jouions
aux cartes, à la belote, et ce, toute la journée, et nous lisions beaucoup car
F. Decoux avait une belle bibliothèque qui vint bien à point. Et le soir, quand
nous pouvions enfin descendre, F. Decoux et Gus nous apprenaient le whist ; ce
furent des parties inoubliables. Et la vie suivit son cours jusqu'au jour
du premier incident. Un soir, alors que nous étions tous au
rez-de-chaussée, que nous lisions ou jouions aux cartes, tout en écoutant la
radio, et que les femmes préparaient la tambouille du lendemain, on sonne « DRELIN
DRELIN DRELIN ». Monsieur
Decoux alla ouvrir en criant comme toujours : « C'est toi Gus ? ». Surprise !
Ce n'était pas lui, mais les instituteurs du village, Madame et Monsieur Tiriard !!! Et celui-ci s'écria : « Tiens, il n'y a que Gus
qui peut venir et sonner trois fois ? », tout en continuant sa marche vers l'intérieur
du bâtiment. Ils furent, tous deux, étonnés en nous voyant tous réunis autour
de la table au salon. Il fallut bien les mettre au courant de
la situation, tout en les conjurant de garder le silence sur notre existence
dans cette maison au sein du village, ce dont ils se doutaient bien car
certains indices de notre présence étaient évidents. Après ces révélations, et les premiers
moments de surprise de tous, le réflexe naturel des instituteurs fut de s'écrier
: « Mais alors ces gosses ne vont pas à l'école et ne suivent aucune
instruction scolaire ? » !!! Il est vrai que, suite à l'occupation
allemande, nous étions astreints à des règles très strictes : pas d'école pour
les enfants, couvre feu à 23 H, (et malheur à celui qui se faisait prendre
après l'heure indiquée), port de l'étoile jaune, interdiction de ceci, interdiction
de cela. Avec l'accord des parents, les Tiriard décidèrent donc de venir, chaque jour, nous donner
des cours particuliers, afin que nous ne prenions pas un trop grand retard dans
nos études. Histoire, géographie, calcul, et, bien sûr, le français, rien ne
fut laissé au hasard. L'avantage pour nous, c'est que, quand nous faisions des
fautes, il était impossible de nous mettre en retenue ou de nous punir; nous
l'étions déjà de par notre enfermement. La vie reprit son train-train quotidien.
Dans l'ordre : lever, toilette, déjeuner, lecture, devoirs pour les jeunes,
cartes pour les autres et aussi les travaux de jardinage, car, grâce aux
conseils éclairés de Jules Paquay, jardinier émérite,
qui nous enseigna les rudiments et petits trucs pour faire pousser fruits et
légumes, nous eûmes, sans doute, les plus beaux potager et verger des environs.
Il n'y avait pas une mauvaise herbe car nous, les gosses, étions réquisitionnés
pour les arracher. Il est vrai que nous en avions le temps. Nous nous occupions de notre élevage de
lapins, de poules ; nous avions une chèvre, « bèbètte
», un mouton. Nous avions donc des œufs ; de temps à autre, un bon plat de
lapin venait consolider le menu du dimanche et, avec le produit du potager, nous
n'étions pas trop à plaindre question nourriture. C'était un retour à la terre.
L'expérience ne fut pas négative. Quand un lapin mourait prématurément,
nous, les gosses, le mettions dans une boîte, et l'enterrions dans un coin du
jardin, avec une croix et une inscription ; « Ici gît Jeannot », où un autre
nom, au point que cela faillit nous causer des ennuis. Lors d'une visite des
Allemands, expliquée plus loin, ceux-ci, qui se demandaient de qui étaient ces
tombes, exigèrent des explications. Celles qu'ils reçurent les contentèrent et
les firent même sourire. CHAPITRE II LES AVATARS ET NOS RECREATIONS Pour nous distraire pendant la journée,
on avait installé un haut parleur qui nous transmettait la musique et les
nouvelles écoutées en bas par F. Decoux et/ou les gens qui étaient dans le
salon. Quand quelqu'un voulait couper la radio,
il lui était répondu par le maître de céans qui remettait le son : « Tu n'es
pas le seul à écouter !!! » à la grande incompréhension de l'interpellé. Le signal pour pouvoir descendre avait
été changé, après l'incident de la cloche. Pour nous donner le feu vert, F.
Decoux tournait les boutons des ondes plusieurs fois. Cela provoquait un
brouhaha pendant quelques secondes et nous savions que nous pouvions nous
pointer en bas. Jusqu'au jour où quelqu'un, ne trouvant
pas un programme à sa convenance, se mit à chercher et chercher encore autre
chose, ce qui provoqua le même effet que le signal : « Vous pouvez descendre ».
Mais comme cela avait été fait plus tôt que d'habitude, un seul de nous
descendit sur ses chaussettes, afin de vérifier si la voie était vraiment libre,
et, après avoir compris le quiproquo, on changea encore une fois de système. Ce
fut, dès lors, Pierre Courtoy qui eut la tâche de
venir nous libérer de notre claustration nécessaire à notre sécurité. Entre-temps, Lisa, Léon, son époux,
Hilda, la sœur de ce dernier, et mon frère Kiki étaient venus nous rejoindre,
car là où ils étaient cachés, le responsable avait été arrêté sur dénonciation
et l'endroit n'était plus sécurisé. Nous étions donc dix. Hilda Wyschnia et ma sœur Lisa avaient rejoint la résistance avec
Léon Wyschnia dès que nous fûmes dans la
clandestinité à Jauche. Ils firent partie du Front de l'Indépendance et furent
tous décorés de la Médaille de la Résistance. Qui était Pierre Courtoy
? 
Pierre Courtoy (Collection famille Courtoy) Monsieur Fernand Decoux étant
célibataire et sans enfant, chose plus ou moins normale à cette époque, avait
accueilli chez lui Pierre Courtoy, l'aîné d'une
famille nombreuse de cinq enfants du village, et se chargeait de ses études. En
même temps, cela rompait sa solitude. La mère de Pierre, qui possédait deux
chèvres, venait les mettre en pâture dans le verger de F. Decoux, chaque matin
assez tôt. Un jour qu'elle était venue à une heure inhabituelle, elle tomba nez
à nez avec papa, qui se fit passer pour un ouvrier. Mais elle ne fut pas dupe.
Elle en parla à son fils, et c'est ainsi qu'une personne de plus fut mise dans
le secret !!! D'autres personnes du village durent se
demander aussi par quel phénomène, quand F. Decoux était en France où
résidaient sa mère et sa sœur, il y avait de la fumée qui s'échappait des
cheminées, car nous n'avions pas de cuisinière, ni à gaz ni électrique, et il
fallait bien faire du feu pour cuisiner et se chauffer en hiver. Cela était
visible de la grande rue du village et posait problème mais, vu la discrétion
des gens, cela ne prêta pas à conséquence. Même la gendarmerie, qui se trouvait
juste de l'autre côté de la rue, fut discrète et ferma les yeux sur ce qui
pouvait se passer chez nous. Au point qu'un jour Pierre Courtoy, qui travaillait comme aide-comptable dans le commerce
de grains de Monsieur Suys à Marilles,
fut accusé par celui-ci d'un vol commis avec un complice. Après confrontation à
notre domicile, le plaignant crut reconnaître le complice en la personne de
Léon, dit Kiki, et, comme celui-ci dormait avec Pierre Courtoy,
aucun des deux ne pouvait servir d'alibi à l'autre, les deux étant accusés. Le
Commandant de la Brigade de Gendarmerie faisant fonction, Monsieur Mathut, fit traîner les choses pour ne pas nous inquiéter
et c'est seulement après la libération que l'affaire fut éclaircie et que les
vrais coupables furent pris. Quelles auraient pu être les conséquences d'une
arrestation de Kiki si la gendarmerie avait été collaboratrice des nazis ? Avec le temps, sortant quand même au
village pour certains achats, et papa et Kiki travaillant chez Georges Decoux,
le frère de Fernand, qui possédait un grand atelier de constructions
métalliques, fil de fer, etc, et nous, les gosses,
jouant avec d'autres enfants du village, notre présence fut remarquée par
beaucoup d'autochtones. Tout le village sut que des étrangers, sans doute des
Juifs, avaient établi leur résidence à Jauche. Mais le secret continuait à être
bien gardé. La résistance locale aussi, bien sûr,
était au courant et cette unité de patriotes ne resta pas inactive. Un Jauchois, partisan des Allemands et portant uniforme SS,
fut retrouvé pendu dans un bois. Un autre sympathisant des teutons fut prévenu
de se tenir tranquille s'il ne voulait pas subir le même sort, ce qu'il fit.
Même notre logeuse ne se manifesta plus. Vu le calme qui régnait, on avait
presque oublié que c'était la guerre et que nous vivions dans la clandestinité. Le temps passait ainsi, plus ou moins
agréablement, malgré les vicissitudes de la guerre, les parents travaillant,
les enfants jouant et étudiant, et tout le village collaborait au bien-être des
gens cachés chez F. Decoux, « Les petits Juifs de chez Decoux », comme ils
disaient gentiment. Il y avait aussi les soirées
récréatives, où tous les soirs nous jouions aux cartes, c'est ainsi que l'on
apprit à jouer au whist et, une fois par quinzaine, des jeux collectifs, des prestations
plus ou moins humoristiques des uns et des autres, des sketches, etc ... et même des radio-crochets. Celui qui n'a pas vu et
entendu Hanschè Wyschnia
chanter en français ou vu et entendu Marie Paquay
chanter « Viva borna patates met saucisses » n'a
jamais rien vu de plus comique et savoureux à la fois, car cela se faisait,
juché sur une table au milieu du salon, entouré de tous les participants qui tapaient
dans les mains. Des jeux de devinettes, etc, ...
clôturaient ces soirées récréatives. Nous pouvions de cette manière mettre un
peu de baume sur notre cœur et sur nos plaies morales, car nous nous doutions
de ce qui se passait pour les autres Israélites du monde entier, qui, eux,
n'avaient pas notre chance d'être tombés dans un paradis comme Jauche. CHAPITRE III LE GANG DES GANTS NOIRS Comme indiqué ci-avant, il y avait les
soirées whist, et les joueurs avaient leurs boîtes de monnaies, car on jouait
pour de l'argent, des petites mises, mais cela nécessitait de la menue monnaie.
Chacun gardait son argent dans une boîte, et les boîtes étaient entreposées en
différents endroits. Un jour, le gang des gants noirs eut l'idée folle de
cacher une de ces boîtes, et ce fut fait. Une boîte, prise au hasard, fut cachée
et, à la place de son trésor, le propriétaire trouva un gant noir. Il faut
savoir que la sœur et la mère de F. Decoux, qui avaient habité la maison avant
de s'installer en France, avaient laissé des vêtements et accessoires à la
villa Decoux et, comme nous avions trouvé ces choses, nous avions pris le gant
noir comme symbole de notre gang. Quel ne fut pas notre plaisir, le lendemain,
en voyant la personne spoliée chercher son avoir !!! Tout le monde cherchait,
mais personne ne s'était imaginé que nous étions les membres du gang !!! Devant ce succès, nous décidâmes de
continuer et, en plus des boîtes de monnaies, d'autres choses disparurent. A
chaque fois, un gant noir fut laissé sur les lieux du méfait. Nous faisions les
innocents et nous participions aux recherches, en riant sous cape. Et comme il
fallait cacher certaines choses ailleurs que chez Decoux, notre complice,
Charles Paquay, qui n'était pas le dernier pour
trouver des objets à dérober et pour imaginer la manière de le faire, était la
personne toute trouvée pour faire sortir notre trésor de guerre. Hélas, tout à une fin. Un jour, en
mettant de l'ordre dans la remise où nous entreposions notre butin, on
découvrit le pot aux roses. Nous fûmes priés de rendre le produit de ces
larcins et nous écopâmes d'une bonne admonestation collective, bien corsée et
bien nette, qui nous enleva l'envie de recommencer… Pour passer le temps, vu la fin du gang
des gants noirs, nous trouvâmes un nouveau jeu. Avec les diverses panoplies
d'armes africaines, ramenées du Congo par F. Decoux : flèches, arcs,
coupe-coupe, etc ... nous avions pris possession de
l'immense grenier de la maison. Celui-ci avait été divisé en deux zones, deux
territoires, et nous nous battions avec ces armes très dangereuses, certaines
flèches pouvant encore être empoisonnées, sans penser au danger que nous
courions. Ce fut, à la longue, le bruit que nous faisions en poussant nos cris
de guerre qui donna l'alerte. Et les adultes nous imposèrent de faire la paix.
Cela se passait en période hivernale car, aux beaux jours, nous avions le parc,
les pelouses et le terrain de foot pour nos ébats pleins de vigueur juvénile.
Et c'est ainsi que le temps passait. En outre, comme de plus en plus de
personnes connaissaient notre présence au village, nous les gosses, nous y
allions beaucoup plus souvent, et par après, régulièrement, pour y jouer avec
d'autres jeunes de Jauche. C'est ainsi que nous fîmes la connaissance de celui
qui allait devenir le R.P. Boly, de Jean Jamart et de
sa sœur Anne-Marie, pour qui j'avais une affection particulière. Elle devint
mon premier amour secret, puis partagé, mais très platonique, notre jeunesse
n'étant pas celle d'aujourd'hui Quand nos regards se croisaient, cela nous
transportait très pudiquement au paradis. J'étais très ami avec son frère Jean,
qui, avec Charles Paquay, était aussi mon grand
complice, et ses parents me recevaient toujours avec plaisir quand c'était chez
eux que j'allais prendre mon quatre heures. 
Jean Jamart (Collection Famille Tricot-Jamart) 
Anne-Marie Jamart, dite Mimie (Collection Famille Tricot-Jamart) David Wyschnia,
lui, c'était Madeleine Mathut sa dulcinée secrète, la
sœur de Denise, l'amie de Pierre Courtoy. Ah
l'innocence de cette époque !!! Mais quels agréables souvenirs. 
Denise Mathut. Veuve de l'ancien Bourgmestre Willy Ghenne (Collection Denise Mathut) 
Madeleine Mathut (Collection Denise Mathut) Il y eut d'autres jeunes, bien sûr,
comme les autres Courtoy, Francis et Jacques, Charles
étant plus âgé allait plutôt vers mon frère Kiki, et les trois enfants de
Georges Decoux, Bernard, Annie et Pierrot ou encore Eugène Motte, au gabarit
très impressionnant, appelé par ses parents « Noss
petit Eugène », quel euphémisme, le fils du magasin Delhaize, etc... et nous faisions une belle
bande de joyeux lurons. Nous, les jeunes de la maison Decoux,
regardions, le dimanche, les matchs de football joués par l'équipe locale, dans
laquelle évoluaient notre ami Gus, le fils Lacroix, Pierre Courtoy,
les Renard, Drossart et compagnie, bref toute la jeunesse qui fréquentait la
maison Decoux. Nous regardions leurs efforts par les lucarnes du grenier, d'où
l'on pouvait voir des extraits de la rencontre, en se tordant le cou. Plus tard,
nous devînmes plus hardis et nous nous rendions alors au verger jouxtant notre parc,
là où il y avait une grotte artificielle couverte d'arbustes qui nous
protégeaient des regards indiscrets. Par après, nous allâmes carrément au
terrain qui se trouvait juste derrière le verger. Nous passions par une petite
porte, non utilisée d'habitude, qui se trouvait dans la clôture de la propriété
Decoux. Nous-mêmes jouions au foot, d'abord dans
le verger et, ensuite, sur le terrain même, lorsque les autres Jauchois surent qui nous étions et comprirent que la
population de leur village avait augmenté. Comme il n'y avait pas de vestiaires,
les équipes se changeaient chez Léon Drossart, marchand de vélos dans la Grand'
Rue non loin de chez nous, et qui avait participé comme coureur au tour de
France. Il s'occupait de l'équipe et surtout des ballons. Ceux-ci étaient
équipés d'une chambre à air et, quand ils crevaient, il fallait y mettre des « rustines
», comme nous disions alors, comme pour les pneus de vélos. De chez lui, donc
des vestiaires, l'équipe et les supporters, c'est à dire presque tout le
village, se rendaient au terrain tout proche à pied, comme en procession.
C'était la fête au village et la détente en ces moments troubles, et cela
procurait un peu de distraction, qui faisait oublier les contraintes de
l'époque. L'équipe locale jouait surtout contre
des adversaires des environs. Cela nous permit d'apprendre la géographie locale
en nous référant aux noms des villages des visiteurs. CHAPITRE IV LES GENS DU VILLAGE Les voitures ayant été réquisitionnées,
Monsieur Decoux, en échange d'un peu de viande, louait aux bouchers du village,
Messieurs Mélery, Motte et Doyen, ses anciens
garages, pour que ceux-ci puissent y exercer leur métier et y abattre des vaches
ou des porcs. Ces derniers grognaient et criaient énormément, ce qui provoquait
les hurlements et rires du Commandant de la Brigade de Gendarmerie, l'Adjudant -
Chef Mathut. La gendarmerie était installée juste de
l'autre côté de la rue et les cris du porc y parvenaient facilement, le trafic
routier étant très faible à cette époque. 
Emile Mélery. Bourgmestre de Jauche de 1953 à 1964 (Collection Famille Mélery) 
Fernand Motte (Collection Monique Motte) Le Commandant criait : « Encore raté !!!
», ce qui mettait de l'ambiance dans la propriété Decoux. Pour nous permettre d'améliorer l'ordinaire,
mon père, mon frère et moi aidions, dans la mesure de nos moyens et de nos
capacités, les bouchers dans leurs œuvres, c'est à dire que, le soir et le
matin avant l'abattage des vaches, nous faisions la traite car il fallait que
ces animaux ne soient pas pleins de lait. Cette traite nous procurait du lait avec
lequel nous faisions des fromages et même du beurre avec la crème selon un procédé
mis au point par papa lorsque nous avions évacué dans le sud de la France en 1940.
Nous remplissions de lait des bouteilles à large goulot et nous nous servions
de sièges rembourrés contre lesquels nous frappions ces bouteilles ; cela nous
servait de baratte et nous obtenions du très bon beurre. De plus, nous
recevions, pour notre travail, des abats : poumons, rates, pieds et autres
morceaux, avec lesquels maman faisait des pâtés, des terrines et autres mets
très succulents. Comme papa et Kiki travaillaient chez
Georges Decoux, nous avions un peu d'argent avec lequel nous pouvions payer les
marchandises, apportées par Gus Paquay le soir, grâce
aux timbres de ravitaillement que la cousine Louisa nous faisait parvenir via
la résistance de Charleroi. Celle-ci nous avait, par ailleurs, procuré de faux
papiers et, ainsi, nous recevions aussi ces fameux timbres indispensables pour
obtenir de la nourriture. Papa, étant de son métier d'origine
tapissier, réparait de vieux fauteuils, matelas et autres sièges pour des gens
du village et était payé en nature avec du blé que nous transformions en farine
car, dans les sous-sols de la maison, il y avait un petit moulin à grain et,
comble du bonheur, un grand four à pain... Nous devînmes donc boulangers !!! Et
cela nous permettait, pendant la période de la Pâque juive, de faire du pain
azyme (sans levure ni levain) et d'envoyer, par l'intermédiaire de la cousine Louisa,
à quelques personnes très pieuses, ce pain spécial pour cette fête primordiale dans
le Judaïsme. Grâce à nos parents, nous apprîmes à ne pas être égoïstes, et
c'est en respectant cette doctrine que nous recueillîmes d'autres personnes qui
devaient se cacher : Maurice Trygier dont les parents
et deux frères avaient été déportés, et qui se retrouvait seul. Il fut sauvé
par la cousine Louisa qui, lorsqu'elle narra à mon père ce sauvetage, lui
répondit « Qu'il vienne. S'il y en a pour dix, il y en aura bien pour onze ». Par après, la fille d'une amie de la
famille, Juliette Patachevitch, copine de mon frère et
de ma sœur, membre du même mouvement de Jeunesse Sioniste de Belgique « Le DROR
», signifiant « LIBERTÉ », et dont les parents furent également pris par les Allemands,
échoua, elle aussi, chez nous, toujours via Louisa et la Résistance dont Juliette
faisait partie comme courrier avec ma sœur et Hilda, mais cela je ne l'appris que
plus tard. Nous étions ainsi douze à la villa Decoux. Entrée, elle aussi, dans
la résistance au Front de l'Indépendance, Juliette fut arrêtée à Couillet et
déportée à Auschwitz, trois semaines avant notre libération, et de là à Dachau.
Elle retrouva la liberté en mai 1945 et reçut les médailles de Prisonnière
Politique et de la Résistance. Plus tard, arriva Bernard Toporek, cousin de Léon Wyscnia,
dont la mère était la sœur du père Toporek. Il était,
lui aussi, membre de la résistance. Il faisait partie du Mouvement National
Belge (M.N.B.) et collabora avec Léon Peeters à transporter des explosifs de
Namur à Jauche. Il disparaissait, certains jours ou nuits, prétextant diverses
occupations hors du village. Seul papa était au courant de ses escapades dangereuses,
mais utiles pour le pays. Il avait dû être opéré de l'appendicite et, suite à de
graves complications, devait être soigné très vigoureusement et il ne pouvait
l'être là où il se trouvait. Il fut soigné avec efficacité par le docteur Mottoulle et vint ainsi augmenter le nombre des gens cachés
chez Decoux. Nous passions à treize. Il fut, lui aussi, décoré de la médaille
de la Résistance. Vinrent encore grossir nos effectifs :
David Schiewitch, qui avait perdu son épouse avant
ces évènements, sa fille Fela et son fils Gaby, eux
aussi grâce à Louisa. Ils habitaient, comme nous, à la Grand' Rue à Charleroi
et étaient voisins de notre bouchère. Nous étions alors seize à Jauche. Fut encore reçue chez nous une dame
d'Anvers, Madame Kom, avec sa fille et son fils. Ils
restèrent un certain temps, qui dura quand même quelques mois, jusqu'à ce qu'on
trouve pour eux un endroit sûr. Nous étions donc dix-neuf. Stop ! Il n'en vint plus,
sauf pour des visites de quelques jours. Nous servions de transit pour certains
qui devaient rejoindre d'autres lieux, comme Max Burger, réfugié Autrichien, merveilleux
pianiste, qui agrémenta notre séjour de quelques beaux concerts, mais fut malheureusement
déporté. Il y eut aussi Max Ber, notre voisin de la Grand' Rue à Charleroi, qui
travaillait avec David Schiewitch, et dont l'épouse
venait d'être arrêtée et déportée par les Allemands. Plus tard, Lisa, Léon et Hilda
quittèrent le village pour se rapprocher des lieux où leurs activités de
résistants les appelaient. Ils gagnèrent Wépion, dans les environs de Namur. Entre-temps, Lisa, reine du tricot,
faisait des pulls pour des personnes des environs, par l'intermédiaire de la
famille Michotte. Hilda et ensuite Juliette
travaillèrent comme aide-ménagères chez le Baron Osterath
qui avait de nombreux enfants. Ces revenus supplémentaires aidaient à améliorer
l'ordinaire. Comme écrit plus avant dans ce récit, avec les dépouilles des
animaux abattus, nous faisions aussi une sorte de savon noir, qui, mélangé à
des produits de droguerie, fournissait même du savon de toilette : à la guerre
comme à la guerre. Il y avait aussi la famille de
Tirlemont, cousins des Paquay, poissonniers de leur
état, qui nous procuraient des harengs et divers autres poissons et, en revanche,
nous nous occupions de trier et de coller les timbres de ravitaillement qu'ils
recevaient de leurs clients : échange de bons procédés, mais qui nous aidait à
vivre encore un peu mieux en ce qui concerne la diversité dans la nourriture. Il ne faut pas oublier la générosité
d'autres personnes, les propriétaires du cinéma du village, la famille Burnick, qui faisait entrer gratuitement les enfants
cachés, et, en plus, offraient une crème glacée à l'entracte. Leurs voisins,
marchands de chaussures, qui voyant passer les gosses, appelaient papa en
disant : « Les pieds de ces enfants grandissent, voici d'autres souliers pour
eux » et cela, toujours gratuitement. Il y avait le merveilleux docteur Mottoulle, qui venait soigner les malades, et surtout maman,
sujette à de nombreux ennuis de santé en cette difficile période. Quand on lui
demandait combien on devait pour la consultation, il répondait : « Vous paierez
après la guerre », Avec les ordonnances, il fallait aller chercher les médicaments ; nous allions à
la pharmacie Mathot, et là, même refrain au moment de
régler la note : « Après la guerre ». Mais oui, des gens pareils ont
existés et beaucoup d'autres ; je les ai connus ; c'était à JAUCHE. Il y eut aussi l'épisode de la fancy-fair, dans la propriété du
Bourgmestre, le notaire Scheys, où nous, les enfants,
pouvions entrer gratuitement et profiter, sans payer, des jeux et autres objets
de divertissements. Sans oublier les délicieuses crèmes glacées de Marie Paquay, que nous pouvions aussi savourer à longueur de mois
d'été, car elle n'était pas avare de ces merveilles avec nous. Ce sont les
meilleures crèmes que j'ai pu manger tout au long de ma vie, non pas parce que
c'était en cette période difficile, mais simplement parce qu'elles étaient
vraiment un délice, résultat d'un savoir faire exceptionnel. Puis un jour, le drame survint. Nous
apprîmes, en effet, l'arrestation de notre amie Louisa, dénoncée par une
personne qui, poursuivie et arrêtée par les Allemands et voulant se sauver et
se dédouaner à leurs yeux, trahit la confiance qui avait été placée en elle.
Cette personne fut quand même déportée et ne revint pas. Il y avait une justice. Louisa fut enfermée à la gestapo,
torturée, brûlée avec des cigarettes. Il fallait réagir et sauver ce qui
pouvait l'être, en premier lieu les enfants. Par l'intermédiaire de Lisa et du
réseau de résistance où elle œuvrait, Maurice Trygier,
dit Raymond, et moi fûmes placés dans l'orphelinat St-Jean de Dieu à Salzinnes, et David fut engagé comme commis de salle à «
l'Hôtel - Restaurant de Paris », à Namur, en face de la gare. Nous sommes restés quelque mois en ce
lieu et, grâce aux sœurs et à l'aumônier, nous pûmes attendre des jours plus
rassurants en ce qui concernait notre sécurité. C'est à cette époque que nous
fîmes la connaissance de l'Abbé Joseph André, qui s'occupait de l'orphelinat
et, dans la région de Namur, aidait les personnes dans le besoin, et dans la
clandestinité. Nous lui consacrerons un chapitre, car ce saint homme le mérite bien. Quand l'amie Louisa put rentrer chez
elle, et qu'il n'y eut plus d'inquiétude à avoir, nous revînmes à Jauche,
Raymond et moi. David resta à Namur, car, entre-temps, ses parents avaient
rejoint cette région, pour être plus près de leurs trois enfants et des parents
Toporek, dont Madame Wyscnia
était la sœur et belle-sœur. En ce qui concerne le père Schmerel Wyscnia, une anecdote
mérite d'être contée, qui aurait pu tourner au tragique. Le pauvre souffrait
beaucoup d'un ulcère à l'estomac. Il avait des crises très graves et perdait
parfois du sang, et les moyens pour le soigner n'étaient évidemment pas, à
l'époque, ceux dont on dispose aujourd'hui, à un tel point que nous crûmes, un
jour, qu'il allait mourir. Nous décidâmes donc de creuser, dans le parc, une
tombe rudimentaire pour pouvoir l'enterrer, en cas de besoin. Heureusement, il
n'en fut rien. Soigné, toujours gratuitement, par le docteur Mottoulle, qui lui rendit de nombreuses visites, il se
remit lentement de cette crise... et nous pûmes reboucher ce qui devait servir
de sépulture provisoire. (Petite parenthèse sur notre travail de
terrassier) Ayant pris l’habitude de creuser, lors
de l'exécution de notre travail de fossoyeur –amateur, nous fîmes mieux et sous
la conduite éclairée de Bernard, nous nous mîmes à construire un abri, qui
devait nous servir en cas de bombardement allié. C'était pour nous l'occasion
de jouer, de nous détendre, et de plus, le travail au grand air ne pouvait que
nous faire du bien, dont nous profitions au maximum. Bernard, qui avait fait de
la boxe en Allemagne et par après à Charleroi, nous servait d'entraîneur et nous
faisait faire, tous les matins, de la gymnastique et des tours du parc pour
nous muscler. Nous ne déjeunions qu'après ces exercices. Merci Bernard pour ces
bons moments, et pour nous avoir donné le goût de l'effort. Donc, quand l'affaire Louisa se fut
calmée, nous pûmes rentrer, Maurice et moi, au bercail et la vie reprit un
cours plus ou moins normal. Nous
ne savions pas ce qui nous attendait de tragique par la suite. CHAPITRE V LES AMITIES JUVENILES Il faut aussi que je parle des amitiés
sincères des jeunes de mon âge, qui, ayant compris qui nous étions, nous
entouraient d'attentions particulières. Je ne parle pas de Charles Paquay ; depuis mon arrivée au village, nous étions comme
deux frères et nous le sommes restés jusqu'à sa mort. Celle-ci fut une perte
pénible pour nous tous, car perdre un membre de sa famille est toujours
douloureux, surtout quand c'est un frère de cœur que l'on a choisi et qui vous
a choisi comme tel. Je veux dire ici quelques mots au sujet
des autres amis de mon âge. Chaque jour, vers 16 heures, coutume plus prisée à
la campagne que dans les villes, il y avait le goûter et c'était des disputes
incessantes entre mes amis pour décider où j'irais prendre ce goûter, à savoir
une tartine de saindoux par ci, une autre de beurre et confiture par là avec
une jatte de café ou de lait. Il fallait voir les yeux brillants du vainqueur
et, toujours, j'étais reçu par les parents avec le sourire. Un jour, un jaloux, furieux parce que je
n'allais pas, ce jour-là, goûter chez lui s'écria, fou de rage : « Faites
attention, car c'est un Juif », laissant ahuris ceux qui se trouvaient là !!!
Ce mot n'était jamais employé par aucune personne de notre groupe, alors que
tous savaient qui nous étions et le pourquoi de notre situation forcée au village
en cette période de guerre et de discrimination. On n'en faisait jamais état, non
pas qu'il y ait eu des directives spéciales de la part des adultes, mais parce
que, malgré leur jeune âge, ils avaient compris que cela était tabou. Ce jour
là, je vis une chose inouïe de la part de Charles, à savoir la gifle
retentissante qu'il donna à cet énergumène, qui se le tint pour dit et ne
récidiva plus. Ce jour là, Charles me souffla et je compris encore mieux, qui
il était et comment sa famille l'avait éduqué. C'est ce jour là que je compris encore
mieux, la chance que nous avions d'être reçus par ce
village et ses habitants. Je fis même partie, avec Raymond, des
scouts catholiques de Jauche et, en été 1943, nous partîmes faire un camp dans
un village des environs, à Bomal, accompagnés par un
jeune abbé et son frère. Nous logions dans une ferme. Etant tombé malade, je
fus soigné sur place, et restais encore une semaine seul chez les fermiers, qui
me dorlotèrent pendant ce séjour et me ramenèrent chez moi à Jauche, en
carriole. Ce fut ma première promenade équestre et champêtre et, grâce à elle,
j'ai eu la possibilité de découvrir la campagne environnante. Grâce à ces amitiés, à ces jeux, et à la
manière dont ces amis nous entouraient, nous ne nous sentions pas des parias,
et ne fûmes pas trop traumatisés par les événements de cette période
douloureuse. Et avec le recul, hormis le fait que
c'était en période de guerre, que nos mouvements de liberté étaient restreints,
je crois pouvoir écrire que c'était, pour moi, une des belles périodes de mon
adolescence. CHAPITRE VI L'ARRESTATION DE MON FRERE LEON, DIT
KIKI Un jour, après une visite médicale du
docteur Mottoulle, Kiki quitta le domicile, pour
aller chercher des médicaments à la pharmacie. Il était vêtu d'une simple salopette
et chaussé de mi-pantoufles faites par le père Wyschnia,
cordonnier de son état, avec des morceaux de vieux pneus et de feutre, un moyen
de se chausser que nous avions tous adopté pour travailler, soit en boucherie ou
au jardin, afin d'économiser nos bonnes chaussures. Il était accompagné de son
ami, Charles Courtoy et ils furent tous deux
interpellés par la gestapo. 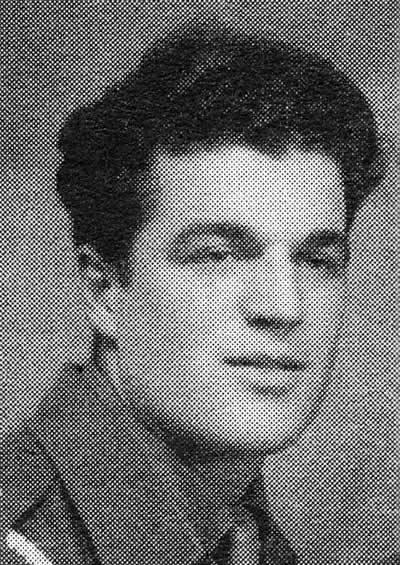
Charles Courtoy (Collection famille Courtoy) Les Allemands étaient venus au village
pour s'emparer d'un résistant. Celui-ci ayant réussi à s'échapper, ils mirent
la main sur les deux premiers jeunes qui passaient par là et tombèrent sur
Charles Courtoy et mon frère. Charles, dont le père
travaillait comme géomètre chez le notaire Scheys,
bourgmestre du village, osa clamer son innocence et déclara fermement qu'il
était du village, qu'il n'était pas un délinquant et que sa famille était
honorablement connue. Les Allemands se rendirent donc chez le notaire Scheys qui se porta garant pour lui. De son côté, le
secrétaire communal, Maurice Bastaits, qui n'était
pas le dernier pour aider et renseigner les gens du village sur les faits et
gestes de l'ennemi et pour les avertir des dangers éventuels, confirma les
dires du bourgmestre. Pour mon frère, hélas, et à juste titre sans doute, ils n'osèrent
pas faire de même, ne sachant pas pour quelles raisons il était entre les mains
de la gestapo. Les Allemands emmenèrent donc Kiki à la kommandantur où ils
commencèrent à l'interroger. En premier lieu, ils lui demandèrent sa date de naissance
et, à la réponse de mon frère, ils répondirent « FAUX !!! » Kiki donna donc une autre date, puis une
autre encore et, à chaque fois, les Allemands répondirent « Encore FAUX !!! ».
Il est vrai que les papiers d'identité de mon frère étaient faux et qu'il avait
un peu perdu les pédales. Ils le jetèrent donc au cachot en lui disant qu'ils
allaient faire une enquête et qu'ils reviendraient, le lendemain matin. Le jour suivant, ils revinrent donc à la
charge mais, ayant repris ses esprits, mon frère s'obstina à confirmer la
première date donnée la veille, en arguant que, vu son jeune âge, il avait
paniqué mais que, si quelqu'un savait quand il était né, c'était bien lui. Cet
argument dut satisfaire les Teutons. Ils répondirent qu'à son âge il aurait dû
se présenter comme travailleur volontaire pour l'Allemagne et qu'il allait y
être envoyé le plus tôt possible. De Wavre, où il se trouvait incarcéré, il fut
transféré à Beauvechain et de là, à Louvain, puis déporté en Allemagne. Pendant son séjour à Louvain, ses « petites
copines » prirent leur vélo et, sous la pluie et les bombardements, lui
apportèrent des vêtements et de la nourriture. Il s'agissait de Mimie Courtoy et Josée Doyen,
pourtant rivales de cœur. Encore merci à ces personnes, même à titre posthume. Emprisonné dans un camp, dit « de
redressement », ne recevant que peu de nourriture, soumis aux coups et autres
gentillesses, il dut, par après, travailler en usine « pour aider »,
disaient-ils, « l'économie allemande ». Il fut libéré par les américains et
revint en Belgique, à pied, à cheval et en voiture, ne voulant pas rester un
jour de plus en Allemagne et espérant retrouver les siens. Un fait anecdotique :
pendant son séjour en usine, non loin de l'endroit où il était né, (il était en
effet venu en Belgique à l'âge de 5 mois et son lieu de détention se trouvait à
peine à quelques kilomètres de son lieu de naissance, près de Oberhausen, aux
environs de Ikern près de
Dortmund), il eut une crise d'appendicite et dut être opéré. Et là, il y eut un
miracle, qui rendit le personnel soignant aveugle, car personne ne s'aperçut
qu'il avait été circoncis, ou alors les Allemands ignoraient qu'une personne
circoncise avait beaucoup de chances d'être juive !!! Toujours est-il que rien
ne fut révélé aux autorités du camp, et il ne fut donc pas inquiété. Revenons à son retour en Belgique. A la
frontière belge, on procéda au contrôle de ses papiers. Il présenta donc le
seul document en sa possession, à savoir : sa fausse carte d'identité. Après
vérification, il fut emmené au poste de police et mis en état d'arrestation, car
son faux nom, Léon Vanzène, était celui d'un rexiste,
collaborateur des Allemands et à ce titre recherché par la police. A ce moment, il s'écria : « Stop ! On ne
joue plus » et il expliqua qui il était vraiment et les raisons de sa fausse
identité, etc, etc ... Mais
encore fallait-il des preuves pour être cru. Il fit comprendre qu'il n'avait
plus de nouvelles de sa famille depuis le débarquement des alliés et qu'avant
celui-ci, il correspondait avec des amis du village ou avec Louisa, qui servaient
d'intermédiaire entre nous et lui. La seule personne qui pouvait certifier son
histoire était Louisa. Les autorités firent donc appel, par téléphone, à notre
amie qui, de cette façon, put reconnaître sa voix et authentifier son histoire.
Il fut aussitôt relâché et reprit sa route pour Charleroi, où nous étions retournés
après la libération. Vers onze heures du soir, Louisa et son mari, Prosper, vinrent
nous prévenir, à la maison, de l'arrivée imminente de Kiki. Je fus chargé d'aller
quérir le reste de la famille, ma sœur et son mari, tante et oncle et ce furent
des retrouvailles quasiment inespérées. Rires, larmes se partagèrent cette nuit
inoubliable. Mais revenons à Jauche. Au moment de
l'arrestation de mon frère, je me trouvais aussi, dans les environs, avec mes
jeunes copains et au bruit de cet événement, je voulus me précipiter vers Kiki.
Des Jauchois m'en empêchèrent en me retenant, et c'est
en pleurant que je rentrai à la maison où mes parents, déjà prévenus, étaient,
eux aussi, en larmes. Ma mère en fut encore plus malade et il fallut retourner
à la pharmacie chercher les médicaments repris sur l'ordonnance que mon frère
avait emportée. A quelque temps de là, suite à un « vol »
commis chez le grossiste en tabac G. Lacroix, ou plutôt une réquisition par la
résistance, les Allemands, étant venus enquêter, se trouvaient dans la rue
principale, là où le délit avait été perpétré, et je devais passer par là pour
rentrer à la maison. M'ayant reconnu, un passant me fit faire demi tour, en me
mettant la main au collet, et me renvoya chez moi par un autre chemin. Ouf ! Je
l'avais peut-être échappé belle, grâce au réflexe de cette personne. Vers la fin de la guerre, à quelques
jours de la libération, rentrant à la maison, je fus interpellé par des
Allemands en voiture qui me demandèrent de les conduire chez un nommé Van Heck. Je me demandais pourquoi ils m'avaient choisi, moi,
alors que d'autres personnes étaient, elles aussi, dans la rue principale. La jeune fille des propriétaires du
cinéma, Huguette Bumick, qui savait qui j'étais, vu que
ses parents nous faisaient entrer gratuitement les dimanches, se présenta pour
me remplacer, arguant du fait que, n'étant pas du village, je ne pouvais les
renseigner !!! Mais ils insistèrent pour que ce soit moi qui les conduise à
cette adresse. Ce que je fis, contraint et forcé. Une fois arrivé à l'endroit demandé, ils
me dirent d'attendre et quittèrent l'auto, sans la fermer à clef. Poussé par je ne sais quoi, je m'enfuis
à toutes jambes, sans demander mon reste et me réfugiai dans le lieu-dit « le
petit bois », proche de la maison, et attendis la soirée. Voyant que tout était calme, je vins
sonner à la porte d'entrée, et pus rentrer, sans encombre, chez nous, à la
grande joie de mes parents qui avaient cru avoir perdu leur deuxième fils.
Encore merci à Huguette pour son geste désintéressé mais non sans danger. CHAPITRE VII LA RETAITE ALLEMANDE Vers la fin de la guerre, la résistance
se montrait de plus en plus active. Un beau matin, le village se réveilla sans
numéro de maisons dans quasiment toutes les rues. Les résistants avaient peint
toute la numérotation en blanc. Le peintre Ch. Linard
fut chargé de réparer les dégâts et, comme il avait besoin d'une petite main
pour l'aider, je fus engagé pour ce petit boulot qui dura, dura, dura... car
nous n'étions pas pressés ! Nous voici enfin arrivés à la fin de
cette maudite guerre, du moins en Belgique. Les Allemands battent en retraite,
et nous, basés au cœur du village, à la villa Decoux, sur la chaussée entre
Jodoigne et Hannut, donc sur la route vers Liège et l'Allemagne, nous
assistions satisfaits à cette retraite, baptisée par les chroniqueurs de
l'époque de retraite élastique sur des bases préparées à l'avance. Et
c'était vraiment le début de la fin. Certains se déplaçaient en camion,
d'autres sur des charrettes, d'autres à pied, traînant leurs bottes devenues
lourdes de par les kilomètres avalés, la langue pendante. Tout cela confortait
notre certitude de leur défaite et nous assurait de la fin prochaine. Un jour, alors que nous jouions au
jardin et dans le parc et que mon père écoutait la B.B.C. : « ICI LONDRES »,
tandis que maman surveillait le devant de la maison, au cas où... !!!, une voiture allemande entra dans la propriété et se
rangea devant le perron. Deux officiers en descendirent et se dirigèrent vers
l'entrée. Ma mère, ayant prévenu papa, celui-ci éteignit la radio, tout en
brouillant les ondes, et sauta par la fenêtre du salon au moment où les
Allemands, entrés par une porte latérale, se trouvèrent devant lui. « Halte ! Où vas-tu ? » demandèrent-ils en allemand. Mon père fit semblant de ne pas
comprendre et l'un des officiers dit à l'autre : « Il doit y avoir quelque
chose de louche pour que cet homme saute par la fenêtre ! » « Nous allons bien
voir » répondit l'autre, et la première porte qu'ils ouvrirent fut celle de
l'abattoir !!! Miracle !!! Mais que serions-nous devenus, si la vache,
fraîchement abattue, n'avait pas été là, pendue, prête à être dépecée ? Quelle
aurait été la réaction des Allemands ??? Merci aux bovins. Quand je mange du
bœuf, je ne puis m'empêcher de penser à cette vache, avec une certaine émotion
et de la tendresse, surtout si la viande est aussi tendre !!! Les Allemands se mirent alors à rire, en
s'écriant : « C'est pour cela que tu t'enfuis ? Nous savons bien que des belges
font du marché noir ; ce n'est pas grave ; trois bons steaks pour nous,
officiers, et on n'en parle plus »! !! Voyant la tournure moins dangereuse que
prenaient les événements, mon père se mit à parler allemand, expliquant qu'il
n'était que le concierge, l'homme à tout faire, que le propriétaire était en
France, et que la viande n'était pas à lui, mais à un boucher du village, qui
devait bientôt venir. Il promit de lui demander les steaks. Sur ces entrefaites,
le boucher Mélery arriva et, quand les Allemands
revinrent un peu plus tard, il rechigna à offrir un steak de plus, pour un
autre officier, arrivé entre-temps. 
Emile Mélery (Collection Famille Mélery) Mais, devant l'insistance de mon père
qui voulait le dédommager, et, réalisant peut-être tous les ennuis qu'il
pourrait avoir, il accepta et les Allemands partirent sans demander autre
chose, ni préciser la raison de leur visite. Au moment où mon père se faisait
appréhender après son saut par la fenêtre, nous étions occupés à fuir par un itinéraire
préparé de longue date : jardin, verger, terrain de football, puis la traversée
de la grand' route pour nous réfugier chez les Lacroix et attendre la suite.
Après quelques heures, je pris mon courage à deux mains et, malgré les
dénégations de ma mère, je décidais d'essayer de me rendre compte de ce qui se
passait à la villa. Je vins donc sonner à la porte d'entrée, et, voyant mon
père qui ouvrait cette porte, je dis assez haut : « Bonjour monsieur, je viens
voir si... » Mon père ne me laissa pas continuer et répondit : « Ca va, ils
sont partis, va chercher les autres », Ouf ! Encore une fois, nous avions eu
chaud. La retraite continuait pour les occupants
et, une belle après-midi, un groupe s'arrêta devant la maison pour y réclamer
de l'eau. Voyant un piano dans le salon, un des officiers demanda si l'on
pouvait lui jouer un air. Devant la réponse négative de mon père, expliquant
que personne ne savait en jouer, sauf le propriétaire, et que celui-ci était
absent, l'officier demanda la permission de faire venir un de ses hommes pour qu'il
puisse se mettre au piano et les distraire un peu. Ce n'était pas le moment de dire
non ! Il fit donc venir un soldat, en lui recommandant de bien faire attention
au piano, de ne rien salir et, ainsi, après avoir pris de l'eau et s'être
distraits un peu, ils repartirent vers leur destin, épuisés et « contents »,
nous dirent-ils, « que cela touchât à sa fin ». Un jour ou deux plus tard, ce fut le
dernier groupe que nous vîmes arriver vers notre maison : petits canons en
batterie, grosses mitrailleuses. Nous comprîmes que, s'il devait y avoir un
combat, nous serions au milieu de celui-ci et nous décidâmes donc de ne pas
passer la nuit à la villa Decoux. Grâce à la résistance et à certains villageois,
nous quittâmes la maison, par petits groupes, pour ne pas éveiller les soupçons.
Mais les Allemands avaient compris car, au passage du troisième groupe, ils
dirent entre eux : « Avant dernier départ des froussards, ils vont loger
ailleurs »! !! Le lendemain matin, nous revînmes,
toujours en petits groupes, et nous pûmes reprendre possession de nos pénates.
Un peu plus tard dans la journée, brouhaha, des cris, branle bas chez les
Allemands, qui ramassèrent leurs armes et quittèrent les lieux précipitamment.
La bataille n'aurait pas lieu devant chez nous. Après avoir déjeuné, j'allais rejoindre
le boucher Fernand Motte qui avait un champ, presque en face de la maison, pour
travailler avec lui. Soudain, des cris s'élevèrent de la rue : « Les
Américains, les Américains », Nous quittâmes le champ pour aller vers l'endroit
du tumulte voir ce qui se passait, et nous apprîmes que les Yankees faisaient leur
entrée dans Jauche. C'était une avant-garde, emmenée par la résistance et conduite
par six résistants, venus en renfort pour les aider à tenir un lieu
stratégique, le gros des troupes étant en arrière. Nous avions donc été libérés
un jour plus tôt que prévu dans les plans des états-majors. Nous étions le 6
septembre 1944, à 18 H. 30. Liesse au village, les drapeaux des
alliés sortent des caches. Rires et larmes se mêlent sur les visages heureux de
la tournure rassurante de la fin proche et de notre libération définitive. Du cinéma Burnick,
on sortit un piano et quelqu'un se mit à jouer des airs patriotiques et de
danse. Une euphorie générale gagna toute la population présente. La seule cloche restée au village, les
autres ayant été prises par les Allemands, se mit à tinter et sonner de plus
belle, voulant, elle aussi, être de la fête. Subitement, des coups de feu, une
contre-attaque allemande et la fuite générale. On abandonna le piano sur place,
au grand désappointement de ses propriétaires, qui criaient : « Rentrez le
piano, rentrez-le » ! !! Peu après, le calme revint au cœur du
village, les Américains ayant repoussé cette attaque aux abords de celui-ci.
Mais le lendemain, un char allié en faction fut repéré par les Allemands, qui firent
feu sur lui, blessant un G.I. qui était posté aux environs. Celui-ci fut
ensuite poignardé lâchement par un des soldats allemands qui, se voyant perdus,
avaient abandonnés, camion, munitions, et s'enfuyaient à pied. Ce G.I. s'appelait
Ralph E. Nimo. Il avait 20 ans et était marié. Il fut
enterré au cimetière de Fosses-la-Ville et rapatrié en 1949 aux Etats-Unis. Une
plaque commémorative a été placée au village, à l'endroit où il fut assassiné. Enfin, nous étions libres. Après
quelques jours de patience, pour se rendre compte de la suite des événements,
et la tournure de la situation, mon père rentra à Charleroi pour examiner ce
qu'il pourrait faire pour que nous puissions revenir dans notre ville. Nous n'avions plus rien, pas une chaise,
pas une table, ni de lits, pas de travail, ni de revenus. Il ne nous restait
que notre bonne volonté pour recommencer notre vie, avec l'espoir que Kiki
était toujours vivant et qu'il nous reviendrait, une fois toute l'Allemagne
libérée du nazisme. Au point de vue papiers d'identité, nous
n'eûmes pas de problème; les autorités communales firent preuve de
compréhension et aidèrent les personnes dans notre cas. Les autorités
nationales firent de même. Papa reçut très rapidement les autorisations pour reprendre
son métier de commerçant ambulant. Il nous restait à trouver les meubles et la
marchandise. Le secours d'hiver et d'autres
organisations d'aide aux victimes nous procurèrent qui, des lits, qui, tables
et chaises, de quoi pouvoir se remettre à vivre dans un nouveau foyer, à la
bonne franquette, mais libres et avec le courage nécessaire pour redémarrer dans
la vie. Papa trouva une petite maison à louer à
Marcinelle. Elle ne payait pas de mine, était sans grande commodité et vétuste
sous certains aspects. Mais nous serions chez nous. En ce qui concerne les marchandises, mon
père se mit à prospecter ses anciens fournisseurs, à Alost, à Saint-Nicolas et
aussi à Bruxelles. Tous étaient heureux de le revoir, et le rassurèrent. Même
sans argent, ils lui donnèrent de la marchandise, en lui faisant confiance,
(ils le connaissaient pour sa grande honnêteté) et en lui disant « Cher
Monsieur Charles, tu paieras après avoir vendu, retapez-vous en famille et, plus
tard, nous réglerons les comptes ». Encore merci à toutes ces braves personnes qui
ont aidé à notre renouveau. Sûr de l'avenir, papa vint nous
rechercher au village et nous pûmes rentrer à Charleroi. Georges Decoux mit à
notre disposition un de ses camions; des gens du village nous firent don de
quelques pièces de vaisselle, de quelques petits meubles. Nous chargeâmes le
camion et partîmes vers ce renouveau. Au revoir Jauche. Mille mercis pour ton
accueil, ta gentillesse à notre égard. Merci de nous avoir sauvés, et redonné
le goût de la vie. Si chacun de nous est né quelque part, c'est à JAUCHE que
nous sommes tous ressuscités. Ce village est donc devenu notre seconde mère
patrie. La vie reprit donc son cours : papa les
marchés et maman le ménage, mais aussi pour mon père la réorganisation, avec
d'autres amis juifs survivants et revenus à Charleroi, des anciens comités
sionistes, pour aider les personnes, rescapées de la SHOAH, qui traversaient et
transitaient par notre pays, soit pour s'y installer, soit dans l'attente de papiers
pour partir en Israël. Certains se marièrent chez nous, y fondèrent des
familles heureuses et s'intégrèrent bien parmi nous. Créer une maison d'accueil, organiser
une soupe populaire, procurer des papiers, (on ne voulait pas de clandestins chez
nous), aider à trouver du travail, et de cette façon donner à chacun la chance
de repartir dans la vie, telle était la mission de mon père et de ses amis,
tous rescapés, et qui voulaient faire renaître une vie normale et communautaire
juive pour les survivants des camps. Moi, je repris le chemin de l'école.
Grâce aux Tiriard, je n'avais pas trop de retard dans
mes études et je finis même l'année scolaire parmi les meilleurs de la classe. Peut-être
un deuxième miracle ? Mais non. C'était dû au labeur de mes instituteurs de
cœur. Soudain, catastrophe, mauvaise nouvelle :
les Allemands reviennent. C'est l'offensive Von Runstedt.
La peur se réinstalle chez tous, et mes parents décident que Maurice, maman et
moi, nous retournons à Jauche. Nous trouvons refuge cette fois chez les Tiriard, Fernand Decoux étant en France et la maison
fermée. Quand la situation se fut décantée, nous
pûmes, le calme revenu, rentrer à Charleroi. Un an plus tard, Maurice, dit Raymond,
nous quitta. Un membre de sa famille, une tante, sœur de sa mère, s'était
souvenue qu'elle avait un neveu, resté seul suite à la capture et l'assassinat
de ses parents par les Allemands, et le réclamait. Souvenirs tardifs, mais le
principal était qu'il fut sain et sauf, peu importe grâce à qui. Lisa revint à Charleroi avec son mari.
Les familles Wyschnia et Toporek
firent de même, ainsi que les Schiewitch. Juliette,
seule de sa famille à être rescapée des camps rentra, elle aussi, et nous nous
retrouvâmes, tous, avec joie. En avril 1945, ma sœur, son mari, et
nous tous eûmes la joie d'accueillir la fille de Lisa et Léon Wyschnia, première enfant juive née à Charleroi après la
guerre, notre Mimie dorlotée, chouchoutée et aimée
par tous, car elle était l'emblème de la renaissance de notre communauté
carolorégienne. CHAPITRE VIII L'ABBE JOSEPH ANDRE UNE VIE DE SAINT DE SON VIVANT Je fis sa connaissance pendant mon
séjour à l'orphelinat de Salzinnes. Il venait rendre visite
aux enfants de cette institution qui étaient dans une situation critique :
enfants de résistants, de juifs, de déportés, seuls, abandonnés par tous ceux
qui fuyaient les nazis. Il venait nous chercher pour aller en
ville à Namur. Goûters, promenades, après-midi théâtrales pour enfants et jeux
dans sa maison d'accueil, place de l'Ange, qui, petit détail, se trouvait être
quasiment mitoyenne des locaux de la gestapo. Quel meilleur endroit pour des
visites de clandestins ! Une plaque commémorative est d'ailleurs placée, sur la
façade de cette maison, relatant son courage et son patriotisme. C'est chez lui que je rencontrais des
jeunes juifs de Charleroi, mais nous devions faire semblant de ne pas nous
connaître, car tous les autres enfants, fréquentant cet endroit, n'étaient pas
au courant de notre clandestinité. L'Abbé André aida à sauver des dizaines
de juifs dans la province et même dans d'autres endroits du pays. Un jour, avec certains de ceux qu'il
avait aidé à se sauver, il fut décidé de lui faire visiter Israël, où un
bosquet portant son nom avait été planté au YAD VASCHEM, haut lieu de
recueillement à Jérusalem en l'honneur des Martyrs Juifs du nazisme. Nous vînmes donc lui présenter ce
projet. Il était, alors, aumônier à la prison de Namur et fut très heureux de
me revoir; Il nous montra les registres de la guerre qu'il avait conservés et
où je figurais, sous mon faux nom bien sûr, à savoir : Pierlot, soi disant neveu
d'un ministre belge réfugié à Londres, d'où ma clandestinité. Il était toujours vêtu d'une vieille
soutane, ne voulant pas dépenser son argent à des bêtises. D'autres, plus
pauvres et plus malheureux que lui, avaient des besoins plus importants. Je le
reconnaissais bien là !!! Son altruisme n'avait pas changé. Il aurait, disait-il,
« son bien-être au ciel, s'il y allait », et d'après nous, il y est et à la
droite ou, en tout cas, pas très loin de son Seigneur. Des visites officielles étaient prévues :
réceptions par des personnalités politiques et religieuses, bref, des honneurs
largement mérités pour l'Abbé André. Il refusa, arguant que le temps lui
manquait, que d'autres avaient besoin de lui, qu'il irait peut-être plus tard !!!
Mais devant nos arguments : visiter les Lieux Saints, le tombeau du Christ,
celui de la Vierge Marie, mettre ses pas dans ceux de Jésus, etc, etc, il finit par craquer,
et l'on put organiser son voyage : L'hôtel et ses réservations, les moyens de
locomotion, la visite des endroits cités ci-avant, une rencontre avec la presse
écrite, avec la télévision, un contact avec des juifs venus de Belgique, bref presque
les honneurs d'un chef d'état. Beaucoup de ceux qu'il avait assistés et
aidés pendant la guerre vinrent le voir et il revint en Belgique, très heureux
d'avoir effectué ce voyage, qu'il refit, suite à d'autres invitations, par deux
fois encore. A chaque fois qu'il revint en Israël, il
fut toujours accueilli avec la même ferveur. Hélas, malgré sa sainteté, il
n'était pas immortel et il nous quitta, au grand regret de tous. Mais, jamais
il ne sera oublié. Sa pensée ne nous quittera pas. Elle sera en nous
éternellement. Adieu, Monsieur l'Abbé André. Nous
sommes certains que, là où vous êtes, vous continuez à veiller sur nous, et à
vous occuper de tous les démunis et de tous les persécutés de la terre. 
Maurice Trygier, dit « Raymond », et l'auteur quand ils étaient à Namur à l'orphelinat St-Jean de Dieu, sous l'égide de l'Abbé André, suite à l'arrestation de Louisa Paquay en 1943 (Collection de l'auteur) EPILOGUE QUE SONT-ILS DEVENUS ? Après ce récit succinct, voici ce que
sont devenus les acteurs de cet épisode de la guerre. Bien sûr, avec l'âge, beaucoup de ces
personnages nous ont, hélas, quittés, beaucoup trop tôt à notre goût. Jules Paquay nous laissa, le premier, orphelins, puis Fernand Decoux,
la famille de son frère, les Tiriard, les Courtoy, les Motte, la cousine Louisa et son mari Prosper,
qui se sont, les premiers, inquiétés de nous et furent le point de départ de
notre odyssée, puis Henriette, l'épouse de Gus, qui à l'époque la courtisait déjà,
et qui, elle aussi, fit beaucoup pour nous, et plus tard, malheureusement,
notre Marie Paquay nationale qui, un jour où nous
étions tous en visite chez elle, alors qu'elle avait déjà passé les nonante
ans, disait en nous voyant : « Et si c'était à refaire, nous le referions,
malgré tous les risques que cela pourrait engendrer ». Elle était toujours
aussi droite et généreuse. Gus la rejoignit, quelques années plus
tard, et, hélas, cette année, au mois de juin, nous perdîmes le dernier
survivant de cette saga jauchoise : Charles Paquay, mon frère de cœur, soixante-trois ans d'une amitié,
d'une fraternité, qui ne s'est jamais démentie, et à qui nous rendions des
visites ainsi qu'à son épouse, Nelly, qui était devenue notre complice dans
cette confraternité, et à leurs enfants qui, toujours, ont témoigné envers nous
d'un indéfectible amour. Ce dernier coup fut, pour ma sœur et moi, les deux
derniers et principaux rescapés de la famille des premiers arrivés à Jauche, un
choc terrible, car hormis sa famille et la reconnaissance à ce village, c'était
le dernier maillon qui venait de nous quitter. De notre côté, Papa nous quitta en 1965,
après une longue maladie, le devoir accompli envers sa famille et ses
semblables, car, pendant la guerre, il contribua, aussi, avant d'aller nous
cacher, à aider des gens, à leur trouver du travail, et à découvrir des caches
pour des réfractaires qui ne voulaient pas aller travailler volontairement en
Allemagne. Il reçut, lui aussi, de l'Etat belge, la médaille de la résistance
et devint citoyen belge car, avant cela, il était considéré comme apatride, ayant
renoncé à sa nationalité polonaise, puisque, dans ce pays, il n'avait pas beaucoup
de droits, vu l'antisémitisme qui y régnait. Les parents Wyschnia
l'avaient précédé dans la mort, ainsi que la famille de Bernard Toporek et le père Schiewitch.
Seuls restaient les jeunes. Le premier d'entre eux à quitter cette
terre fut David Wyschnia. Parti en Israël, en 1949,
avec ses parents, il se maria et, en 1956, lors de la guerre du Sinaï, il fut
tué. Il avait vingt-sept ans. Il tomba glorieusement au champ d'honneur, comme
on dit, le jour même de l'arrêt des hostilités. Il avait servi brillamment la
patrie. Deux semaines plus tard, sa veuve
accouchait d'une petite fille, Davida, qui porte donc son nom et son prénom. Davida
est mariée, mère et grand-mère. Malgré la disparition de son père, le remariage
de sa mère et la naissance d'autres enfants venus après elle, elle fait toujours
partie intégrante de notre famille et nous nous voyons, tous, lors de nos séjours
là-bas. Notre mère nous rendit entièrement
orphelins en 1981, après une maladie qui dura un an. Elle fut enterrée à
quelques pas de notre père, à Haïfa. Hélas, la grande faucheuse intervint
encore, à notre plus grand regret. Léon, mari de ma sœur et bien-aimé de toute
la famille, nous quitta en 1985 après une difficile maladie. Il avait émigré en
Israël en 1949 avec son épouse et deux enfants et, là-bas, un autre nouveau-né
était venu égayer leur vie. Léon était devenu secrétaire national du comité de
gymnastique, et voyageait à travers le monde. Il passait fréquemment chez nous,
en Belgique, et était toujours belge de cœur, malgré sa naissance hors du pays. En 1987, ce fut au tour de la fille de
ma sœur de nous quitter, en laissant trois enfants derrière elle. Elle vivait
en Belgique, où son mari travaillait. Elle est enterrée à Holon, près de son
père. Hilda suivit en 1987. Elle, aussi, s'était installée en Israël dès 1946.
Elle avait épousé chez nous, en Belgique, un rescapé des camps. Elle avait
trois enfants et habitait également Holon. En 2002, Juliette suivit cette triste
filière. Nous avions encore eu le bonheur de la voir, cette année-là, lors d'un
séjour durant lequel nous étions allés chez ma sœur pour fêter ses
quatre-vingts ans. Elle était déjà fort malade, et nous savions tous que sa fin
était proche. Elle avait émigré en 1946, avait épousé un ami de Charleroi et avait
deux enfants. En 1946, Bernard Toporek
était venu lui aussi en Israël. Il s'était marié en Belgique avec une Liégeoise
et revint aussi plusieurs fois au pays, où son épouse avait un frère. Il a
travaillé au port de Haïfa comme docker, puis comme grutier. Il profite d'une retraite
bien méritée. Tous servirent dans l'armée en Israël et contribuèrent, et de
manière brillante, à la création de cet état, en 1948. Et hélas, en 1996, Kiki tira lui aussi
sa révérence, après de grandes souffrances. J'étais allé le voir, aussitôt
après son opération, avec un pied dans le plâtre, que je m'étais cassé trois
jours avant la date de ma visite. Je voulais absolument y aller, et rien, ni
médecins, ni personne ne purent m'en empêcher. Je partis en août, accompagné de
mon épouse qu'il aimait très fort et avec laquelle il avait beaucoup d'apartés. Mais je dus retourner en Israël, en
septembre, pour ses funérailles. Il avait septante trois ans. Il s'était marié
en 1947 avec Myriam, une roumaine, qui avait échappé au nazisme et était en
transit en Belgique comme personne déplacée en attendant de pouvoir partir en
Israël. Ils eurent un fils à Charleroi en 1948, puis ils partirent, en 1949,
avec Lisa et Léon en Israël où un autre fils naquit, cinq ans plus tard, mais à
la même date le 30 avril. Il avait toujours été fort en mathématiques, et avait
donc bien calculé son coup ! (Si on peut dire). A ce moment, je n'avais donc plus que ma
sœur. Elle était la seule survivante de ma famille de naissance. Voilà le tour est bouclé, il ne me reste
plus qu'à faire mon « curriculum vitae » : Après avoir poursuivi quelques études,
mais sans jamais vraiment les rattraper, je décidai d'apprendre un métier et choisis
la fourrure. Je ne me débrouillais pas trop mal. En 1948, avec un autre groupe de jeunes,
nous partîmes clandestinement sans en parler, ni à la famille ni aux amis. Nous
gagnâmes Marseille et, de là, Israël, comme volontaires de guerre. Nous voulions
lutter avec les Israéliens pour la création d'un nouvel état, sur la terre de
nos ancêtres, afin que ceux qui le voulaient aient une patrie, une terre, pour
essayer d'y vivre en paix, en ne devant plus subir la dictature de tyrans qui
prenaient toujours les Juifs comme boucs émissaires pour excuser leurs incuries
et leurs mégalomanies, en rejetant sur « LE JUIF » toutes les erreurs du monde,
mais surtout les leurs. Je servis donc dans les commandos et
participai à la libération de certains quartiers de Jérusalem, de Bersheva, et autres lieux. Mon officier supérieur
s'appelait Ytzakh Rabin. J'ai eu l'honneur de le
connaître et, quand il venait, soit à la base, soit dans les tranchées, à
l'heure de la soupe, il faisait la file comme un simple soldat. C'était la démocratie
dans les troupes de choc qu'il commandait. Il n'y avait pas de galons ; on savait
qui étaient nos officiers, et c'était tout. Un exemple pour tous. Quand, à l'armée, je recevais une
permission, étant sans famille là-bas, j'allais à Kiriat
Motskin, près de Haïfa, où habitaient Bernard Toporek et les siens, Juliette et sa famille, ainsi qu'un
autre couple de Charleroi. C'était le clan des Belges et j'y étais reçu comme
l'enfant de la famille. J'y logeais, j'y mangeais, et on lavait même mon linge,
bref : le paradis pour un garçon seul. D'autres soldats volontaires de mon groupe,
venus aussi de Charleroi, y étaient également hébergés, lors de leurs congés. Et quand je n'allais pas chez Bernard,
j'allais chez Hilda, et l'accueil était pareil. Et quand Kiki et Lisa vinrent
s'installer en Israël avec leur famille et qu'ils eurent un logement (très
petit et sans aucune commodité), j'eus un point de chute très familial. Nous
installâmes l'eau, une douche, des W.C. très rudimentaires, mais des W.C. tout de
même, et une nouvelle vie commença pour nous. Vers la fin des hostilités, en 1949, je
reçus, via mes parents, le dernier avertissement du Ministère de la Défense
Nationale, avec ordre de me présenter à une visite médicale, préalable à mon
incorporation dans l'armée belge. Ne voulant pas créer des ennuis à mes parents
et, surtout, désireux de ne pas perdre ma nationalité belge, je me fis
démobiliser sans difficulté et rentrai au pays. Lors de ladite visite médicale, le major
médecin, sans doute irrité par les rappels qui m'avaient été adressés
précédemment et auxquels je n'avais pas répondu, me déclara bon pour le
service, et cela sans auscultation, en disant haut et fort, « Si il était bon pour
l'armée là bas, il l'est pour ici aussi, point à la ligne. Et pas de
rouspétance nom de .... ». Et en octobre 1950, je rejoignis mon nouveau corps :
les blindés à Bourg-Léopold, au 3ème Régiment de Lanciers. 
L'auteur et son père à Charleroi pendant une permission (Collection de l'auteur) De là, nous partîmes pour l'Allemagne, à
Ludenscheid, former un nouveau régiment de tanks, le
1er bataillon tank. J'étais entré sous les armes pour un an, mais,
vu la guerre de Corée, il y eut prolongation et je fis dix-huit mois. Ce qui changea ma vie, c'est que moi,
petit Juif, voué à l'extermination en tant que race impure, par ces mêmes
Allemands qui nous avaient occupés, je faisais maintenant partie des vainqueurs
et j'étais, cette fois, l'occupant. Quel retour de manivelle, quelle revanche
pour moi et les miens, et ceci, grâce à tous ceux qui nous avaient aidés à nous
sauver de cette barbarie: les Jauchois. Après le service militaire, je repris le
travail à l'atelier chez un patron, à Charleroi, et, en 1952, je rencontrai la
femme de ma vie et épousai Brocline. (Nous avons aujourd'hui
plus de cinquante deux ans de vie commune). En 1960, je décidai de faire comme mon
père et débutai sur les marchés publics comme commerçant ambulant, tout en
continuant la fourrure. J'avais créé un petit atelier à la maison où je
travaillais avec ma femme. Mon épouse, qui, comme Nelly, apprit
tout de notre séjour à Jauche par nos récits, connaît cette histoire presque
aussi bien que nous car, à force d'en parler et d'en reparler, cela lui est
entré dans la mémoire, dans le cœur; il y a bien longtemps qu'elle a adopté les
Paquay et famille, et ce merveilleux village. En 1998, je pris une retraite bien
méritée mais je n'abandonnai pas pour autant le commerce ambulant. J'étais
entré dans un comité, une union professionnelle, comme commissaire, puis comme
secrétaire et, depuis peu, j'en assume la présidence, tout cela comme bénévole,
(toujours comme mon père), dans le but d'aider des jeunes à gagner leur vie, en
organisant des marchés hebdomadaires ou annuels et des braderies et des marchés
de Noël. J'avais été aidé lorsque j'ai débuté et j'estime qu'il faut toujours
renvoyer l'ascenseur. Que ressort-il de ce récit ? En 1940, quand la guerre éclata, les
personnages de ce récit, dans leur grande majorité, n'étaient pas belges. Ils
venaient d'Allemagne, de Pologne, fuyant des régimes totalitaires et
antisémites dirigés par des tyrans ou des despotes. Ils vinrent trouver refuge
dans cette Belgique qu'ils ne connaissaient pas mais dont ils avaient entendu
dire beaucoup de bien et beaucoup d'éloges. Mes parents vinrent en Belgique en 1923.
Lisa avait un an et demi et Kiki cinq semaines. Ils se sont toujours considérés
comme belges, ont pensé en belges, ont râlé comme de bons belges, et Wallons de
surcroît, mangé à la belge. Tous ceux qui sont venus vers cette époque ont fait
de même. Alors, c'est tout naturellement que, lorsque les barbares nous eurent
envahis, ils essayèrent de participer, chacun à leur manière et selon leurs
moyens, à la lutte contre l'envahisseur. Car
un pays qui nous avait accueilli, donné des droits, permis de travailler, de
nous loger dignement selon les moyens du bord, de donner une éducation à nos
enfants, de devenir commerçants ou artisans, méritait d'être aidé. Nous avions
contracté moralement des devoirs envers cette nation accueillante qui nous
servait de refuge contre les barbares qui voulaient enlever à tous les belges
le droit de penser et d'être libres. Nous eûmes la chance de tomber sur des
personnes exceptionnelles comme l'était aussi le village où elles habitaient. Beaucoup n'eurent pas cette chance. Bien
sûr, il y eut d'autres personnes à travers le monde qui sauvèrent des juifs ;
d'autres villages qui les aidèrent à se sauver. Mais, malgré ces bonnes
volontés, six millions de personnes furent exterminées par les nazis et leurs
alliés. Nous, ce fut Jauche qui nous permit de
renaître et c'est grâce au dévouement des Jauchois à
notre cause que, des quelques personnes cachées et vivantes à la fin de la guerre,
une cinquantaine de descendants sont venus sur terre. Les habitants de Jauche ont
ainsi contribué à la résurrection de notre peuple, et de cette manière à la
création d'un état, auquel tous les peuples ont droit. C'est lors des funérailles de Charles Paquay, alors que nous nous rappelions nos souvenirs avec
sa famille, que les enfants et petits-enfants qui m'écoutaient me demandèrent
de rédiger ces souvenirs. Ils connaissaient certains faits mais pas toute
1'histoire de cette époque troublée de 1942 à 1944 dont leurs parents,
grands-parents et arrière-grands-parents furent les principaux protagonistes et
les héros bien involontaires, avec nous comme partenaires. C'est donc à eux que je dédie cette
brochure et à toute la famille. Je la dédie aussi, avec notre
reconnaissance éternelle, à toutes ces personnes qui nous aidèrent et sans qui,
sans doute, je n'aurais pas écrit ces lignes. Je le fais en mon nom, bien sûr,
mais aussi au nom de toutes les personnes vivantes ou décédées, dont je suis le
porte-parole, qui passèrent par Jauche et qui furent sauvées par l'attitude héroïque
des Jauchois, pour leur dire à tous MERCI.
Gabriel KIERSZENCWEIG Mars
2006 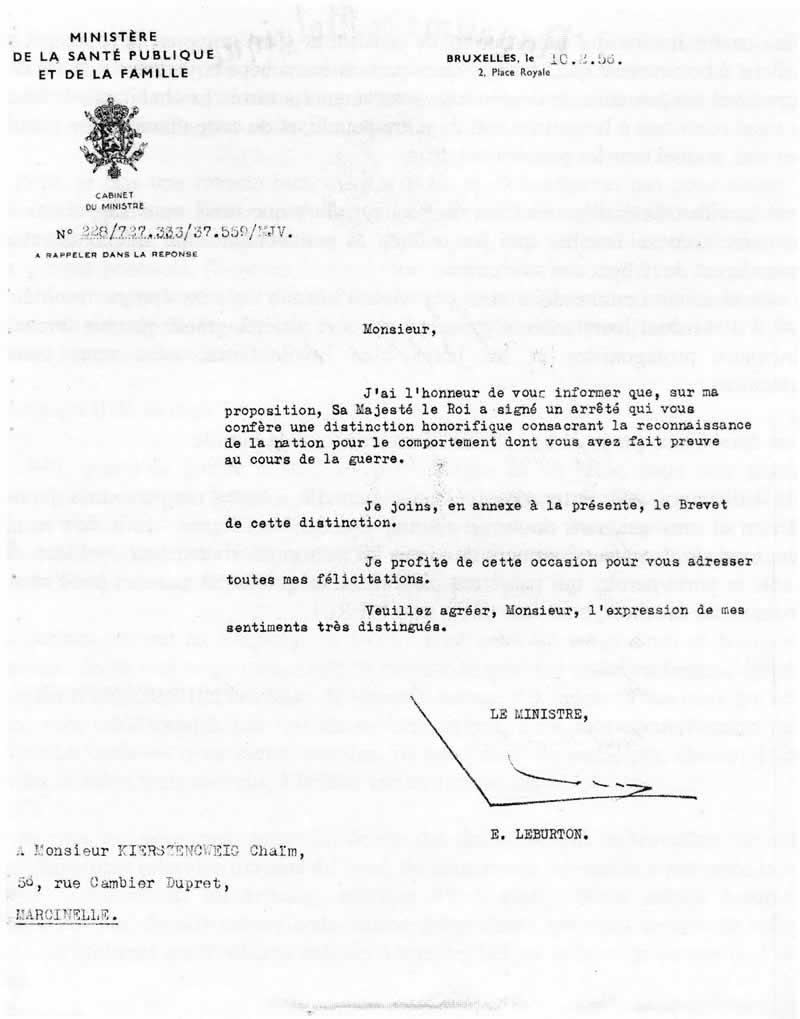
Note ministérielle adressée à Monsieur Kierszencweig Chaïm, père de l'auteur 
Brevet de distinction honorifique de Kierszencweig Chaïm, père de l'auteur 
Brevet de distinction honorifique de Kierszencweig Lisa, soeur de l'auteur 
Brevet de distinction honorifique de Kierszencweig Lisa, soeur de l'auteur 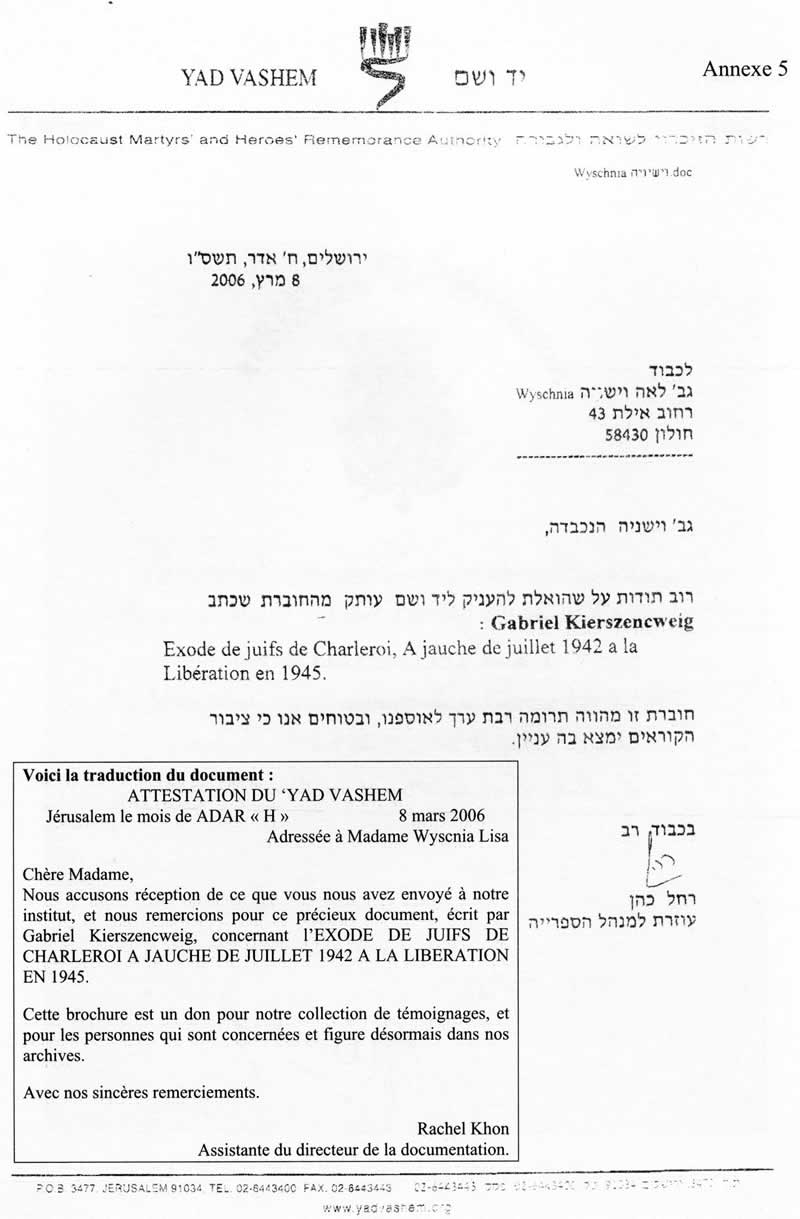
Accusé de réception du "Yad Vashem" adressé à Madame Lisa Wyschnia, soeur de Gabriel Kierszencweig 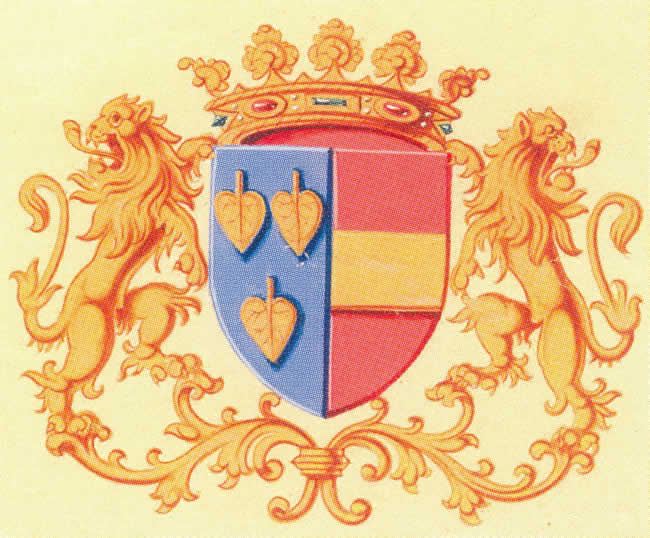
Armoiries de la Commune de Jauche |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©