 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Jamais ne Désespère...[1] Libération Avril 1945 
Les gardiens allemands
rendent leurs armes à leurs prisonniers Dans les
premiers jours d’avril 1945, nous apprîmes que le haut commandement allemand
avait décidé de replier vers le Nord et l’Est de l’Elbe les camps de prisonniers
qui se trouvaient immédiatement au Sud de ce fleuve, dans une région où il
serait tenté d’opposer aux armées anglo-américaines une dernière résistance. Le camp de
Fischbeck était donc de ceux qui devaient être transférés ailleurs. Il était
prévu que le mouvement se ferait à pied. Des rumeurs à caractère officieux
laissaient entendre qu’une première destination serait Lübeck et que le voyage
durerait trois jours. Une
vingtaine de malades, jugés inaptes à faire les étapes, étaient maintenus sur
place, dans l’infirmerie du camp, aux soins du Dr Masson ; une garde plus
nominale qu’effective composée d’un Hauptmann également incapable de supporter
les fatigues du voyage, et de quelques « Schupos »[2]
venus spécialement de Hambourg, devait, au moins dans la forme, maintenir à l’infirmerie
le caractère d’un camp de prisonniers. L’officier
allemand ainsi laissé en arrière-garde avait, de longue date, été surnommé « le
déshydraté » pour sa maigreur impressionnante et son teint décoloré. J’eus la
chance d’être parmi les privilégiés auxquels fut épargné le déménagement. Nous
étions quelques-uns à n’être pas vraiment malades, mais les autorités médicales
allemandes savaient que nous étions exposés, dès la première étape, à ne pas
pouvoir continuer, et l’on préféra éviter les ennuis que ceci ne manquerait pas
de donner à ceux qui avaient la charge d’organiser et de surveiller la colonne
en marche. 
Un matin,
vers le 15 avril, nos dix-sept cents camarades partirent donc chargés de ce qu’ils
avaient de plus précieux : les uns avaient, en hâte, confectionné des sacs
à dos avec des couvertures ; d’autres étaient parvenus à construire de
petits chariots ; enfin, le plus grand nombre portait n’importe comment
des ballots informes. La colonne ressemblait plus à un troupeau qu’à une
troupe, mais on sentait que la libération était dans l’air et chacun trouvait
dans les espoirs du moment un motif de prendre les choses avec bonne humeur. Dans le
cours de la journée, une cinquantaine de camarades nous rejoignirent. C’était,
d’une part, ceux qui étaient parvenus à se cacher au moment du départ de la
colonne et qui, petit à petit, sortaient de leur cachette, et, d’autre part,
ceux qui revenaient de la colonne en marche soit parce qu’ils y étaient
autorisés ne pouvant plus avancer, soit parce qu’ils étaient parvenus à quitter
la colonne subrepticement. Au début,
le « déshydraté » fut tenté de renvoyer ces fugitifs sous escorte à
la colonne, mais bientôt devant leur nombre et sans doute aussi par facilité,
il décida de les incorporer définitivement à l’effectif qui lui était confié. * * * L’infirmerie
du camp faisait partie de ce que l’on appelait le « Vorlager ». Le « Vorlager »
était situé près de la porte d’entrée du camp ; il comprenait, outre l’infirmerie,
un ensemble de baraques destinées aux services généraux. Immédiatement de l’autre
côté de la porte, à l’extérieur des barbelés, se trouvaient des bâtiments de
briques : les uns avaient servi de logement aux officiers de la garde ;
plusieurs y avaient même habité avec leur famille ; les autres avaient
servi de casernement à la garde proprement dite. Au moment
de leur départ, les autorités allemandes du camp avaient décidé que les
familles des officiers resteraient sur place et que la caserne serait
transformée en ambulance pour le cas où il y aurait des combats, ou même
simplement des bombardements dans les environs. L’ambulance
justifiait que l’on hissât partout de grands drapeaux de la Croix-Rouge, et
ceux-ci devaient protéger également les familles que les Allemands laissaient
derrière eux non sans une certaine inquiétude. Pour
diriger l’ambulance, on avait fait venir de Hambourg un major médecin allemand
et quelques infirmiers. Enfin, pour assurer le ravitaillement de ce petit monde
et de ceux qui devaient s’y ajouter, comme je l’expliquerai plus loin, il y
avait un capitaine-intendant assisté de deux militaires de rang subalterne. De notre
côté, à l’infirmerie, nous nous rendîmes rapidement compte qu’il nous fallait
nous organiser pour faire face aux circonstances quelles qu’elles pussent être :
nous savions que les troupes anglo-américaines avaient franchi le Rhin et
progressaient vers nous ; le dispositif de défense allemand de Hambourg
comprenait une tête de pont n’englobant pas notre camp : celui-ci se
trouvait en réalité situé entre la première ligne de défense et les
avant-postes. Notre doyen
d’âge était le brave Major Devue ; c’était un homme de petite taille, âgé
de soixante-trois ans ; il avait une voix fluette et chantante, ses propos
et son comportement toujours amènes faisaient plus penser à un bourgeois
policé, épris de plaisirs calmes et mesurés, qu’à un militaire. Cette apparence
paisible cachait en réalité une nature impétueuse, avide d’activité, une âme où
la plus stricte droiture s’associait au plus ferme courage. Nous
savions que, sous des drapeaux variés, il avait participé à plusieurs guerres
ou campagnes ; qu’il avait acquit un savoir et une expérience rarement en
défaut et que son ardent patriotisme, sa douce obstination à se maintenir dans
la ligne droite, lui avait valu, à lui aussi, de passer aux yeux des Allemands
pour l’un de ces mauvais garçons qui reçurent l’hospitalité du château de
Colditz et du camp de Lübeck. Dans ce dernier camp, sa connaissance approfondie
du russe – il avait longtemps participé à la direction d’une entreprise belge à
Odessa – avait fait de lui l’interprète auquel recouraient ceux d’entre nous
qui voulaient converser avec le capitaine Douchgachvili – le fils de Staline –
qui était notre compagnon de captivité. Devue prit
pour adjudant-major le Commandant Bayard et recruta parmi les plus valides de
nos compagnons un petit état-major. Au titre d’interprète, j’eus le privilège d’en
faire partie. La première
mesure que prit Devue fut d’appeler le « déshydraté » et de lui
signifier que les armes de notre garde étaient incompatibles avec les emblèmes
de la Croix-Rouge qui flottaient au-dessus de la caserne même où logeait cette
garde. Au cours de l’entretien, il apparut nettement que le « déshydraté »
était dépassé par les événements et qu’il ne souhaitait plus qu’une chose :
l’arrivée rapide des Alliés, afin d’être déchargé de toute responsabilité. Le
même sentiment faisait qu’il était prêt à accepter presque n’importe quoi
plutôt que de supprimer les drapeaux de la Croix-Rouge. Aussi le
Major Devue obtint-il, sans trop de difficultés, que la garde fût désarmée et
que les armes fussent déposées dans l’une des caves de la caserne. Deux cadenas
furent ensuite posés à la porte de cette cave ; Devue détenait les clefs
de l’un des cadenas, le « déshydraté » celles de l’autre. 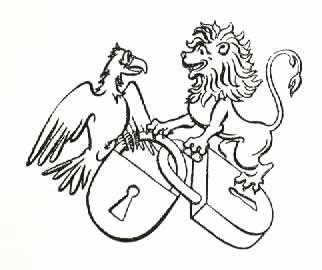
Travailleurs
civils Dans le courant de la même journée, un événement
inattendu devait encore davantage nous donner la direction des opérations :
le gouvernement militaire de Hambourg, soucieux de ne pas avoir dans le dos une
cinquième colonne, décida de refouler vers les casernes et les camps de
prisonniers désaffectés qui se trouvaient au Sud de l’Elbe, les quelques six
mille travailleurs déportés qui se trouvaient à Hambourg où dans les environs
immédiats. Cette
horde, car c’en était une, était composée d’éléments, souvent douteux,
appartenant à toutes les nationalités sur lesquelles avait, à un moment donné,
pesé la domination allemande. Elle fut répartie entre notre camp et deux
casernes voisines ; deux mille de ces malheureux vinrent occuper nos
anciennes baraques. Il y avait là de tout, non seulement des hommes mais aussi
des femmes et même des enfants. Ce monde était absolument anarchique, rebelle à
toute entente intérieure, inquiet et affamé. 
Administrativement, ils étaient confiés à notre « déshydraté »
et celui-ci devait les ravitailler, les maintenir sous surveillance et éviter
qu’ils ne se répandent dans la campagne pour s’y livrer au pillage ; les
maigres ressources disponibles devaient servir, non seulement à leur
subsistance, mais aussi à la nôtre et à celle de la population civile
aborigène. Ceci, bien
entendu, dépassait les capacités du pauvre « déshydraté » ;
accompagné de son capitaine-intendant, il vin exposer le cas au Major Devue et
lui demander son aide. Il fut
entendu que nous nous occuperions nous-mêmes de tout, à la condition que le « déshydraté »
et son intendant nous donnent toutes facilités, tous renseignements utiles et
qu’ils signent toutes réquisitions nécessaires. C’est ainsi
que je reçus la mission d’assurer la discipline des deux mille civils cantonnés
dans notre camp. Je choisis deux collaborateurs de confiance, les Lieutenants
Obert et Bernard. Nous répartîmes nos administrés par nationalité ; dans
chaque groupe, nous fîmes élire un chef responsable et constituer une garde de
police. Les chefs de chaque nationalité constituaient un conseil que je
présidais et la discipline du camp était assurée à tour de rôle par les
différentes gardes de police. Arrivée des
blindés anglais Nous en
étions à ce travail d’organisation lorsqu’un soir, vers cinq heures, une pointe
blindée anglaise arriva au camp ; il s’agissait d’une reconnaissance du 8ème
Hussards, commandée par le Major Gwyn, assisté des Lieutenants Saxby et Turner ;
celui-ci, qui parlait l’allemand comme s’il s’agissait de sa langue maternelle,
était l’« Intelligence Officier » du détachement. Décrire l’enthousiasme,
qui, à ce moment, s’empara de chacun de nous, dépasse mes moyens d’expression.
Il fut impossible de réfréner l’ardeur des travailleurs civils, nouveaux occupants
du camp. Avant que l’on eût pu les en empêcher, ils entourèrent les blindés
anglais et voulurent porter les servants en triomphe ; un geste
malencontreux accrocha la gâchette d’une mitrailleuse, heureusement pointée
vers le sol, et une rafale fut involontairement déclenchée : elle blessa
cinq déportés civils et en tua trois, la plupart polonais. Ce
malheureux accident réfréna automatiquement les débordements de joie : le
calme se rétablit spontanément et, pendant que l’on s’occupait des victimes,
nous pûmes converser avec nos libérateurs. La distance
à laquelle se trouvaient les lignes anglaises ne leur permettait pas de nous
emmener avec eux, ni de rester avec nous. Il fut
convenu que nous demeurerions sur place, mais qu’ils enlèveraient, comme
prisonniers, notre garde. Ma qualité d’interprète me valut de devoir intervenir
pour demander que le « déshydraté » et son intendant nous fussent
maintenus ; nous avions besoin d’eux, ou tout au moins de leur signature,
pour assurer le ravitaillement des déportés civils et le nôtre. 
Après
réflexion, le Major Gwyn céda à mes instances moyennant l’engagement que je
pris de lui livrer les deux officiers lorsqu’il viendrait, quelques jours plus
tard, nous libérer réellement. Par la force des choses, la conversation se
passait entre Gwyn, Turner, le « déshydraté » et moi. Me désignant,
Gwyn leur fit dire en allemand par Turner : « Vous êtes maintenant
les prisonniers du Commandant ». Cette
simple phrase en disait beaucoup, et l’on comprendra les efforts que je dus
faire pour cacher mon émotion joyeuse par un simple et aimable sourire... * * * Pendant ce
temps, le major-médecin allemand, qui avait donné les premiers soins aux
blessés de l’accident qui venait de se passer, estima que le transport urgent
de ces blessés dans un hôpital s’imposait. Comme il n’y avait vraiment pas
moyen de les charger sur les blindés anglais, le médecin-major décida d’essayer
de téléphoner à l’hôpital militaire de Hambourg. A notre
surprise, le téléphone fonctionnait encore avec la rive Nord de l’Elbe :
on n’eut aucune difficulté à obtenir la communication ; l’hôpital offrit d’envoyer
immédiatement une ambulance automobile pour prendre les blessés. -
Attendez une demi-heure, répondit le médecin-major ;
nous avons ici les Anglais, ils vont partir dans un moment, il vaut mieux que
vous ne vous rencontriez pas avec eux ! On demande la
reddition de Hambourg Ce
téléphone qui marchait encore et par lequel on pouvait téléphoner à Hambourg
suscita chez le Lieutenant Turner l’idée d’affoler un peu les autorités
allemandes de la région. 
Prenant à
son tour le téléphone, il demanda, en un allemand parfait et parfaitement
autoritaire, la communication avec le Gauleiter de la ville. L’ayant obtenue,
il lui tint en allemand ce langage : « Je
suis l’interprète du Général Untel (il cita le nom du Général anglais commandant
les troupes qui avançaient vers Hambourg). Le Général me charge de vous
demander la reddition immédiate, pure et simple de la ville, faute de quoi il
ne pourra se considérer être le responsable des pertes de vies et des
destructions que le bombardement qu’il prépare occasionnera ». Le
Gauleiter répondit en bredouillant que cela ne le concernait plus et qu’il
fallait s’adresser à l’autorité militaire. Sur ce, Turner raccrocha. Ohne Gepäck[3] Puis les
Anglais se préparèrent à partir : on enjoignit à la garde allemande de se
former, en rang par cinq, entre deux blindés. L’un des nouveaux prisonniers me
demanda d’intervenir auprès des Anglais, au nom de ses compagnons, pour que
ceux-ci puissent, avant de partir, rentrer un instant au corps de garde pour y
prendre les quelques effets et provisions qu’ils y avaient déposés. 
Le corps de
garde avait deux issues et il eût fallu, pour pouvoir donner sans risque
satisfaction aux Allemands, bloquer au préalable la porte de derrière, faute de
quoi ils se seraient, sans doute, tous échappés. Le temps pressait, le Major
Gwyn n’en avait pas à perdre et d’ailleurs il n’avait pas pour les Allemands
plus de pitié que nous-mêmes. Je fus chargé de refuser la requête ; pour
ce faire, je me plaçai devant la colonne et prononçai haut et clair les mots « Ohne
Gepäck » que les troupes belges qui vécurent la capitulation avaient si fréquemment
entendus le 28 mai 1940 et les quelques jours suivants. Cette
petite scène fut de nouveau pour moi la source d’une certaine émotion, et si
quelque lecteur sensible y trouve une inutile méchanceté, je ne puis encore me
résoudre à lui donner raison. Et les
blindés partirent dans le crépuscule, salués par un chaleureux hourrah ! Enlèvement Notre vie
reprit son cours antérieur. Il n’y eut, pendant les trois jours qui suivirent,
aucun incident marquant. Puis un soir, vers six heures, les blindés revinrent ;
ils étaient cette fois plus nombreux et étaient accompagnés d’une quinzaine de
véhicules sur chenilles aménagés pour le transport des troupes. Nous eûmes une
demi-heure pour nous remettre en état de voyager ; nous donnâmes aux
déportés les instructions qui devaient leur permettre de rejoindre les lignes
anglaises ; nous livrâmes nos deux prisonniers à nos libérateurs et nous
prîmes place dans de lourds camions. 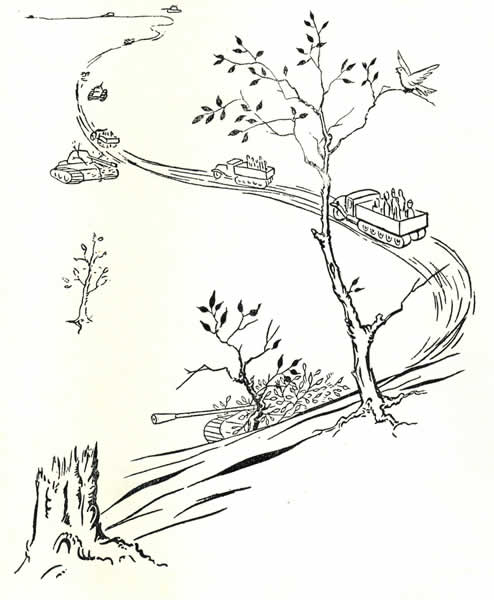
Dans la
demi-obscurité, la colonne partit à toute allure vers la Lüneburger Heide,
empruntant des chemins creux et des défilés boisés. De place en
place, un gros char immobile protégeait l’itinéraire suivi par la colonne. Nous
arrivâmes ainsi dans un petit village où cantonnait le 8ème Hussards ;
nous eûmes à peine le temps de constater que le Dr Masson et six de nos
compagnons, les plus impotents, n’étaient pas avec nous. Mais ceci est une
autre histoire qui se termina bien après avoir failli tourner au tragique. Le
Dr Masson y donna de nouvelles preuves de son sang froid et de son dévouement. Quand à nous, on nous enfourna dans des
ambulances automobiles : une heure après on nous accueillait à l’hôpital
anglais de Bochholz avec du champagne « Pommery et Greno », dont les
étiquettes portaient en allemand la mention : « spécialement mis en bouteilles
pour la Wehrmacht ». Ce fut notre premier moment de détente depuis notre
libération. Nos hôtes nous comblèrent avec une gentillesse et une générosité
touchantes. Ils s’en excusaient presque en nous disant que, s’ils nous accueillaient
si bien, c’était pour remercier nos compatriotes de l’accueil inoubliable qu’ils
avaient reçu en Belgique. On échangea en hâte des bouts de papier où l’on inscrivit
des noms et des adresses, se promettant mutuellement de se revoir. Puis de
nouveau, nous repartîmes en ambulances ; à cinq heures du matin nous
arrivions à Soltau, où nous fûmes confiés, au moins théoriquement, à l’administration
du rapatriement des prisonniers. 
Retour en Belgique Les
circonstances nous furent favorables ; nous partîmes à l’aube pour un camp
d’étape situé au Sud de Brême et nous y logeâmes une nuit. Le lendemain, une
colonne de camions militaires s’arrêta dans le camp et l’officier qui la
commandait, que nous prîmes d’abord pour un Anglais, se révéla être le
capitaine Morane, dont le frère avait été l’un de nos compagnons de captivité. Il s’agissait
de cinq camions envoyés par l’escadron blindé de la Brigade Piron pour nous
chercher. L’un des officiers qui l’accompagnait était notre ancien camarade de
Teli, qui s’était évadé de Fischbeck un an auparavant. Nous eûmes
une seconde fois, l’impression d’être libérés ; et cette fois-ci par des
compatriotes. La rencontre fut émouvante, mais il n’y avait pas de temps à
perdre ; nous étions tous pressé de rentrer en Belgique. Nous nous mîmes
en route ; le lendemain à l’aube, nous étions à Bruxelles, à midi nous
étions dans nos familles. La guerre semblait déjà terminée : quinze jours
plus tard l’Allemagne capitulait. Les joies
du retour avaient effacé les mauvais souvenirs des années écoulées. Aux foyers retrouvés battait
toujours : « Le cœur de
la Patrie ». 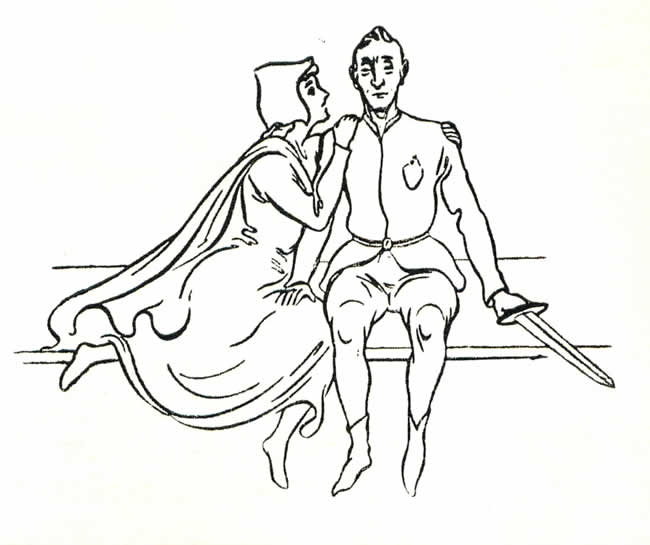
[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951 [2] Schupo : Schutzpolizei = police militaire allemande. [3] Ohne Gepäck : Sans bagages |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©