 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Jamais ne Désespère...[1] Elsterhorst – 1941 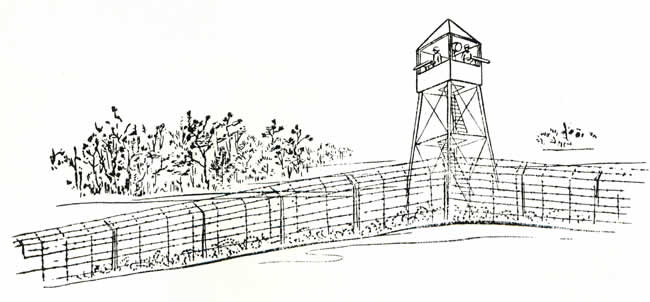
Comment un Allemand se
soumit aux arrêts que lui infligea un prisonnier français. Les prisonniers internés au Château de Colditz et dont
l’état de santé nécessitait qu’ils fussent transférés dans un hôpital, étaient
envoyés à Elsterhorst. Le trajet était long ; il fallait prendre le train,
changer deux fois, et si l’on tient compte des formalités de levée d’écrou à
Colditz qui étaient particulièrement laborieuses, il fallait près d’une journée
entière pour faire le voyage. L’hôpital
d’Elsterhorst était attenant à « l’Oflag VI.D » qui hébergeait plus
de 5.000 officiers français. Entre ce camp et l’hôpital, un va-et-vient continu
de malades permettait à ceux qui venaient de Colditz, spécialement aux Français,
d’avoir des contacts avec d’autres camarades et de voir une captivité somme
toute assez différente de celle à laquelle ils étaient eux-mêmes soumis. Un camp de
prisonniers où sont réunis 5.000 officiers de la même armée est un petit monde
en soi. Les services généraux du camp y prennent une grande importance et leur
organisation implique certains permanents de travail entre tous ceux qui y sont
affectés : prisonniers ou gardiens. Ces
rapports de travail en entraînent fatalement d’autres, notamment ces petits
échanges de complaisances qui contribuent à rendre moins pénible, pour
certains, la longue captivité. Pendant mon
séjour à l’hôpital d’Elsterhorst, on m’a raconté une histoire, arrivée au camp
voisin, qui illustre bien ce que je veux dire : Les
services généraux du camp : ravitaillement, colis, censure, etc... étaient
établis à l’intérieur même des barbelés, où ils occupaient un ensemble de
baraques spécialement conçues pour ces services. L’un des
officiers français, un capitaine, qui travaillait à la réception et à la
distribution des colis, avait souvent été l’objet de démarches discrètes de la
part d’un des officiers allemands affectés au même service, et qui aurait
beaucoup voulu recevoir, de temps en temps, une tasse de « Nescafé ». 
L’officier
français fit, avec l’officier allemand, un marché qui se résumait à ceci :
tous les jours, l’officier allemand viendrait après le déjeuner, avant la
reprise du travail, à la chambre du capitaine français et y recevrait une tasse
de café, moyennant quoi, chaque fois qu’une fouille aurait lieu dans le camp,
l’officier allemand en informerait le capitaine français la veille en indiquant
les baraques où la fouille aurait lieu. De cette façon, les prisonniers
pourraient déménager, avant la fouille, les objets compromettants tels
que : appareils de T.S.F., cartes militaires, vêtements civils, etc... Le marché
fut très scrupuleusement observé pendant plusieurs mois à la pleine
satisfaction des contractants ; mais un matin une fouille eut lieu, qui
n’avait pas été annoncée, et les fouilleurs firent main basse sur plusieurs
objets qui avaient été introduits à grand’peine dans le camp. A une
heure, après-midi, l’officier allemand se présente chez le capitaine français
et celui-ci de l’interpeller : « Eh bien, vous ne m’avez pas prévenu
de la fouille de ce matin ! » A quoi l’Allemand répond en
bredouillant une excuse embarrassée.
« C’est bon » réplique le Français, « vous aurez quinze
jours d’arrêts ». L’Allemand
sourit et, ne comprenant pas le sens que le Français donnait à ces arrêts,
attend son café. Comme on ne
fait pas mine de lui en donner, il le demande timidement en indiquant que le
temps passe, et le Français de lui dire : « Mais je vous le
répète ; vous avez quinze jours d’arrêts ». « Ach
so » répond l’Allemand en riant jaune et en partant. Le lendemain, à la
même heure, il revient et le Français lui rappelle qu’il est aux arrêts. Enfin
l’Allemand comprend ; il s’en va et s’abstient de venir jusqu’à l’échéance
des quinze jours. Après quoi, il recommence ses visites le plus naturellement
du monde. 
Il n’y eut
plus jamais de fouille surprise aussi longtemps que cet Allemand resta à
Elsterhorst, et lorsqu’il reçut une autre affectation, il vint, avant de partir,
présenter son successeur et lui transmettre les consignes qui furent toujours
scrupuleusement observées. La grande évasion. Un matin d’hiver, pendant que j’étais à l’hôpital
d’Elsterhorst, nous constatâmes, dès le réveil, à la tête de nos infirmiers
allemands et à leur nervosité, qu’il se passait quelque chose d’anormal. Nous
eûmes bientôt la clef du mystère ; la veille, dans la soirée, trente-deux
camarades français s’étaient échappés du camp ! Voici ce qui est
arrivé : Les soldats
allemands préposés aux services généraux du camp, arrivaient chaque matin, à la
mode allemande, en colonne par trois. Ils étaient commandés par un
sous-officier fort en gueule qui scandait le pas cadencé : « eins,
zwei ». A huit
heures trente, ponctuellement, ils arrivaient à la porte du camp que le
personnel de garde leur ouvrait largement et ils continuaient au pas :
« eins, zwei, eins, zwei », jusqu’aux baraques des services, où leur
chef prenait un vif plaisir, avant de faire rompre les rangs, à leur faire
exécuter l’une ou l’autre évolution, afin de montrer à tous comme il commandait
bien. 
A midi, le
détachement se reformait pour sortir du camp ; à deux heures, il y
rentrait pour en ressortir à six heures. Chaque fois, dès qu’il arrivait près
de la porte du camp, la garde ouvrait largement celle-ci et le sous-officier du
détachement, en passant devant son collègue de garde, haussait un peu la voix
et scandait le pas un peu plus sèchement, à moins qu’il n’interpellât l’un ou
l’autre de ses soldats dont l’allure n’était pas assez martiale, le tout afin
que personne n’ignore son ton de commandement. Tout cela
se renouvelait régulièrement cinq jours par semaine ; car, outre le
dimanche, les services généraux ne fonctionnaient pas le vendredi, parce que ce
jour-là le personnel du camp était repris en mains par l’autorité militaire et
participait à des exercices et manœuvres. Nous étions
en hiver, il était six heures, il faisait déjà noir. Le détachement se présenta
à la porte du camp pour sortir, la garde ouvrit la porte toute grande et comme
d’habitude le détachement sortit marchant au pas que le sous-officier scandait
sèchement : « eins,zwei, eins,zwei ». Une seule
chose avait échappé à la garde de la porte : ce jour-là était un vendredi
et le détachement qui sortait n’était pas entré au camp à deux heures ! En réalité,
il était formé par trente-deux officiers prisonniers dont l’un, bel alsacien
blond, imitait à la perfection le sous-officier allemand. L’illusion était
complétée par les uniformes : on avait saupoudré de chaux les capotes
françaises préalablement recoupées, ce qui leur donnait sous la lueur des
projecteurs, tant pour la couleur que pour la forme, l’aspect de manteaux
allemands. On avait fait des bonnets de police avec des couvertures, des
ceinturons et leurs plaques avec du carton et des boites à conserve, et les
baïonnettes étaient en planches de lit.
« Eins,zwei, eins, zwei » nos trente-deux prisonniers avaient
pris la clef des champs ; leurs capotes, leurs ceinturons et leurs
baïonnettes de comédie furent retrouvés le matin dans un fossé, le long de la
route. Si
quelques-uns des évadés furent repris, la plupart réussirent. Si les Allemands
étaient nerveux ce matin-là, nous étions, nous, bien joyeux. L’art de voyager. Quatre jeunes camarades français, les lieutenants
Navelet, Charvet, Le Jeune et Lévy, également pensionnaires de Colditz,
m’avaient rejoint à Elsterhorst. Le Jeune
avait dû être opéré de l’appendicite ; Navelet souffrait d’un épanchement
de synovie particulièrement douloureux et tenace ; quant à Charvet et
Lévy, je ne pense pas qu’ils fussent réellement malades, mais avec la
complicité du bon médecin français de Colditz, le Docteur Le Guet, ils étaient
parvenus à se faire envoyer à l’hôpital avec l’espoir qu’en cours de route ils
trouveraient bien l’occasion de s’évader. Bien que le
genou de Navelet continuât à le faire souffrir et que Le Jeune fût encore très
affaibli par les suites de son opération, l’autorité allemande décida, un beau
matin, que tous les quatre devaient réintégrer le Château de Colditz. Lorsqu’on
allait d’Elsterhorst à Colditz, il fallait partir tôt : On vous réveillait
à quatre heures du matin, à quatre heures et demie il fallait se présenter tout
habillé, avec son bagage, à la fouille et l’on partait à cinq heures, à pied,
pour la gare de Königswerda, distante de quelque trois ou quatre kilomètres. Le
train partait vers six heures. La route d’Elsterhorst à Königswerda
franchissait tout d’abord une lande sablonneuse où croissaient des pins tordus
et clairsemés, puis le relief du sol se relevait, la végétation devenait plus
touffue et, avant d’arriver à Königswerda, il fallait traverser un bois de
chênes et de hêtres couvrant du taillis. Nous étions
en hiver et l’obscurité régnait jusqu’après sept heures de matin. Trois de
nos amis, les lieutenants Navelet, Charvet et Lévy, avaient décidé de profiter
du voyage pour tenter de s’échapper. Le Jeune était encore incapable de tenter
une telle aventure, mais sa présence pouvait être utile à ses camarades :
l’escorte des voyageurs serait toujours, au moins en partie, immobilisée par la
crainte de le voir, lui aussi, tenter de prendre le large. Les trois
candidats fugitifs avaient décidé de tirer parti du premier moment favorable
pour s’éclipser simultanément, mais ils avaient aussi décidé de se séparer
immédiatement et de courir, chacun pour soi, ses propres chances. Navelet, le
plus ancien, le plus réfléchi et aussi le plus handicapé par son genou, devait
donner le signal de départ. Nous
partagions à l’hôpital la même chambre et, lorsque vint l’heure du réveil, je
m’habillai en même temps que les voyageurs. A côté de
la chambre des fouilles se trouvait le bureau de l’infirmier en chef où brûlait
un poêle : j’obtins de pouvoir aller y faire du café chaud pour les
voyageurs pendant qu’on les fouillait. 
Nous nous
étions arrangés pour que Le Jeune fût le dernier fouillé. L’escorte,
composée d’un sous-officier et d’un seul soldat, se chauffait près du poêle,
tandis que deux soldats français attendaient dehors avec la charrette à bras
sur laquelle ils allaient transporter les bagages jusqu’à Königswerda. L’odeur de
mon café chatouillait agréablement les narines des membres de l’escorte ;
ils apprécièrent beaucoup la tasse que je leur donnai et trouvèrent très
naturel que, de l’auvent de la baraque, j’en offrisse une à la sentinelle qui
gardait, en grelottant, la porte du camp. La sentinelle, assurée de ne pas être
surprise à cette heure, vint sous l’auvent et, par la porte ouverte, la
conversation s’engagea entre lui, l’escorte et moi, sur la qualité du
café ; pendant ce temps, successivement, au fur et à mesure qu’ils
sortaient de la fouille, Navelet, Charvet et Lévy allaient dehors poser leurs bagages
sur la charrette. Les deux
soldats français leur remettaient papiers d’identité et vêtements civils qu’ils
allaient revêtir dans la guérite même du factionnaire ; puis ils nous
rejoignaient, ayant repris, sous leur vaste manteau militaire, l’apparence
qu’ils avaient en sortant de la fouille. Quand nos
camarades eurent, tous les quatre, rempli les formalités officielles et
occultes de la levée d’écrou, le détachement se mit en route vers la gare. Nous
apprîmes plus tard, par le récit que nous en fit Le Jeune, qu’au moment où la
route allait traverser un carrefour, au milieu du bois, avant d’arriver à Königswerda,
Navelet donna le signal convenu. Les trois fugitifs partir en courant, dans
l’obscurité, chacun par un chemin différent. Au moment de prendre la course,
ils s’étaient débarrassés de leurs manteaux militaires. Le
sous-officier d’escorte, dès qu’il fut revenu de sa surprise, prit son pistolet
et tira, au jugé, quelques coups de feu ; mais le temps qu’il avait pris
pour ouvrir la gaine de son arme et pour armer celle-ci avait suffi à nos
camarades pour disparaître. Le
sous-officier d’escorte était bien ennuyé : que devait-il faire ?
Continuer vers Colditz avec le seul Le Jeune ou rentrer à Elsterhorst ?
Ayant consulté son prisonnier, il opta pour la seconde solution et c’est ainsi
qu’avant midi nous apprenions déjà que le premier acte de l’évasion avait
réussi. Malheureusement Charvet et Lévy furent repris quelques jours après. Navelet fut
plus heureux ; comme il ne marchait qu’avec difficulté, il s’était
contenté, après avoir couru cent mètres, de reprendre, sur la route même de
Königswerda, le pas ordinaire. Et c’est par le train qui devait l’emmener
prisonnier vers Colditz qu’il partit libre vers la Belgique. Le voyage fut,
sans doute, une véritable odyssée, mais il réussit. Dès la frontière belge, des
amis sûrs l’accueillirent, le cachèrent et l’aidèrent ensuite à gagner la
France non occupée ; il participa à la campagne d’Afrique du Nord et à
celle de France. L’autorité
militaire allemande prenait grand soin de moi. J’avais le curieux privilège
d’être classé sous deux étiquettes différentes : l’une me qualifiait de
malade, ou en termes administratifs « D.U. »[2] ;
pour l’autre, j’étais simplement un mauvais garçon :
« Deutschfeindlich », c’est-à-dire « germanophobe ». Ce
bipartisme, si j’ose dire, eut pour conséquence qu’après avoir décidé de me
rapatrier pour raisons de santé et en avoir informé, outre moi-même et ma
famille, la Croix-Rouge Internationale, l’autorité allemande décida pour des
raisons policières que je ne serais pas rapatrié et que je passerais le reste
de ma captivité dans un « Sonderlager » ou camp spécial, où étaient
rassemblés les prisonniers mauvais garçons de toutes les armées en guerre contre
le Grand Reich. Mais, là
encore, ma double personnalité imposait des mesures spéciales ; l’autorité
médicale confirmait toujours que mon état de santé justifiait ce rapatriement
que me refusait l’autorité militaire ; il fallait éviter qu’une des commissions
d’inspection de la Croix-Rouge Internationale me trouvât toujours en captivité
et toujours malade. C’est pourquoi, dès qu’une commission suisse était
annoncée, on me faisait disparaître en m’envoyant à l’hôpital ou dans un autre
camp. C’est ainsi
qu’en septembre 1941 on m’avait envoyé de Colditz, en Saxe, à l’hôpital
d’Elsterhorst, en Basse Silésie et qu’en janvier 1942, comme une commission
suisse était annoncée à Elsterhorst, on me renvoyait à Colditz. Ces voyages
à travers l’Allemagne avaient ceci de particulier pour un prisonnier :
alors que mes camarades ne se déplaçaient jamais qu’en nombre et en trains
spéciaux, j’étais généralement seul avec mon escorte de gardiens et je prenais
avec eux les trains ordinaires où seulement un compartiment nous était réservé. Pour le
personnel allemand des camps, ces voyages étaient une aubaine ; c’était
l’occasion d’échapper au service fastidieux des gardes et parfois celle
d’avoir, au retour, un jour ou deux de répit à passer en famille. Ceux que l’on
désignait pour constituer mon escorte étaient des privilégiés et ils espéraient
par surcroît avoir en cours de route l’occasion de me rendre l’un ou l’autre
service que je paierais d’une cigarette ou d’un bâton de chocolat : cet
espoir et le fait qu’ils échappaient à la discipline du camp les rendaient
particulièrement serviables et réduisaient au minimum les inconvénients de ces
voyages. Lorsqu’on
m’expédiait ainsi, comme j’étais faible et malade, je refusais toujours de
porter moi-même mes bagages ; ces refus n’allait pas sans incidents ni
éclats de voix, mais devant ma calme indifférence d’être privé de mes
possessions et la fermeté avec laquelle j’annonçais que dès mon arrivée dans le
nouveau camp je déposerais une plainte pour vol de mes effets personnels, on
m’accordait toujours un ou deux soldats allemands pour porter mes
valises ; c’était d’ailleurs pour les officiers une occasion de les
récompenser ou d’obtenir d’eux qu’ils rapportassent de la campagne l’une ou
l’autre victuaille échappée au contrôle. 
J’avais
aussi le privilège d’avoir pu me faire expédier de Belgique une tenue neuve et
c’est elle que j’arborais pour ces déplacements. Ce prisonnier bien habillé,
pour lequel on mobilisait une telle escorte : généralement un officier, un
sous-officier et deux ou trois soldats, impressionnait fort le public ; on
ne savait pas très bien si j’étais un prisonnier particulièrement redoutable ou
un collaborateur de haut vol, mais quelle fût l’opinion que l’on se fit, on me
regardait avec déférence et intérêt et on cherchait à entrer en contact avec
mon escorte pour satisfaire une curiosité très générale. Or donc, en
janvier 1942, ainsi escorté, je partis d’Elsterhorst à l’aube pour arriver à
Colditz au crépuscule ; en cours de route, j’avais à changer de train à
Leipzig où deux bonnes heures de battement séparaient l’arrivée et le départ de
mes trains. Dès que j’eus
mis le pied sur les quais de Leipzig, le personnel militaire de la gare
transmit l’information à l’officier de service qu’un prisonnier de marque
venait de débarquer. L’officier de garde lui-même se précipita à ma rencontre.
Le chef de mon escorte lui fit par de son désir de profiter de son passage à
Leipzig, ce qui impliquait qu’il souhaitait être débarrassé de moi pendant deux
heures. L’officier de garde, ravi de cette aubaine qui lui promettait de rompre
la monotonie de son service par une conversation avec quelqu’un qu’il présumait
être très important, s’offrit immédiatement à me prendre en charge. Comme il
savait que l’insigne qui distingue, à l’armée belge, les colonels est une
barrette et trois étoiles, et qu’il ne savait pas qu’à part l’épaisseur et l’emplacement
de la barrette, l’insigne des commandants répond à la même description, mon
nouveau gardien me donnait du « Herr Oberst » par ci et du « Herr
Oberst » par là. Cette confusion amusait mon escorte, mais celle-ci ne
désirait pas détromper un officier de garde qui manifestait de si bonnes
intentions, de peur que, s’il devait être déçu par mon manque d’importance, il
perdit tout intérêt pour moi et refusât de se substituer momentanément à elle. M’ayant
introduit dans le petit salon mis à sa disposition à côté du corps de garde, m’ayant
offert une tasse de cette horrible décoction de glands torréfiés dénommée « Wehrmacht
Kaffee Michung », il m’adressa la parole dans son meilleur français : 
- Vous êtes belche Monsieur le Colonel ? Et moi de répondre : - Je ne suis pas colonel, mais vieux
capitaine, et je suis en effet belge. - Ach so,
wie interessant, je suis aussi catholique, Monsieur le Capitaine. Ceci était
pour moi l’occasion d’exprimer à un Allemand l’un de mes « dadas »
habituels : l’une de ces dissertations que nos promenades circulaires le
long des barbelés nous permettaient de mettre au point, d’approfondir et d’améliorer
de mois en mois et d’année en année. Je ne pouvais manquer cette occasion, et voici
ce que j’expliquai à cet auditeur avide de m’entendre : - Vous
savez, cette distinction entre catholiques et protestants n’a pas, chez nous, l’importance
que vous y attachez ici en Allemagne. Il y a moins de différence entre un
protestant anglais et un catholique belge qu’entre ce catholique belge et un
catholique espagnol ou entre ce protestant anglais et un protestant allemand. Mon
auditeur marquait déjà de la surprise et de l’intérêt, je continuai : - Oui, il y
a ce que j’appellerai le christianisme de la Mer du Nord, qui marque d’une
façon assez semblable les Norvégiens, les Anglais, les Hollandais et les
Belges, tandis que vous avez un christianisme propre à l’Allemagne. Mon
auditeur était de plus en plus surpris et intéressé : - Chez
nous, dis-je, l’idée de Dieu est indissolublement liée à l’idée de bonté. Nous
disons « Bon Dieu », « Bonne Mère » ; les Anglais
disent « Good God », les Flamands : « Goede God ».
Vous dites « Lieber Gott ». - Ja, das
ist wahr ! interrompit mon gardien. - Oui, vous
dites « Lieber Gott », votre Dieu est un ami, un associé. Vous dites
aussi « Gott mit uns », c’est bien un associé. Mais un associé pour
quoi faire ? C’est un associé pour faire la guerre et faire triompher la
Grande Allemagne, le Germanisme Impérial. Votre Dieu c’est le Dieu des armées,
le Dieu terrible à l’épée flamboyante ; si le nôtre est le Christ, le
vôtre est Jehovah. - Ach ja,
das ist wahr ! - Oui,
notre Dieu est le Dieu du Nouveau Testament, le vôtre est celui de l’Ancien ;
en réalité votre Dieu est le Dieu des Juifs ! - Ach,
Monsieur le Capitaine, ne dites pas ça, taisez-vous, c’est tanchereux ! Mon geôlier
rougit et la conversation en resta là ! 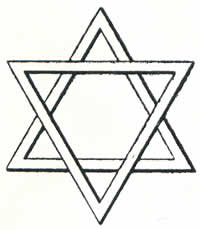
[1] Jamais ne Désespère... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne 1940-1945 racontées par Henri Decard et illustrées par Jean Remy officiers de réserve de l’Armée Belge. – Librairie Parchim (Marcel Vanden Borne) 57bis, Rue du Sceptre, Bruxelles - 1951 [2] « D.U. » pour « Dienst – unfähig », c’est-à-dire inapte au service. C’est par ces initiales « D.U. » que les Allemands désignaient les prisonniers qui, pour des raisons de santé et en exécution de la convention de Genève, devaient être libérés. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©