 Maison du Souvenir
Maison du Souvenir

![]() Accueil
-
Accueil
-
![]() Comment nous rendre visite
-
Comment nous rendre visite
-
![]() Intro
-
Intro
-
![]() Le comité
-
Le comité
-
![]() Nos objectifs
-
Nos objectifs
-
![]() Articles
Articles
![]() Notre bibliothèque
-
Notre bibliothèque
-
![]() M'écrire
-
M'écrire
-
![]() Liens
-
Liens
-
![]() Photos
-
Photos
-
![]() Signer le Livre d'Or
-
Signer le Livre d'Or
-
![]() Livre d'Or
-
Livre d'Or
-
![]() Mises à jour
-
Mises à jour
-
![]() Statistiques
Statistiques
|
Le calvaire de Breendonck[1] P. Lansvreugt et R. Lemaitre. 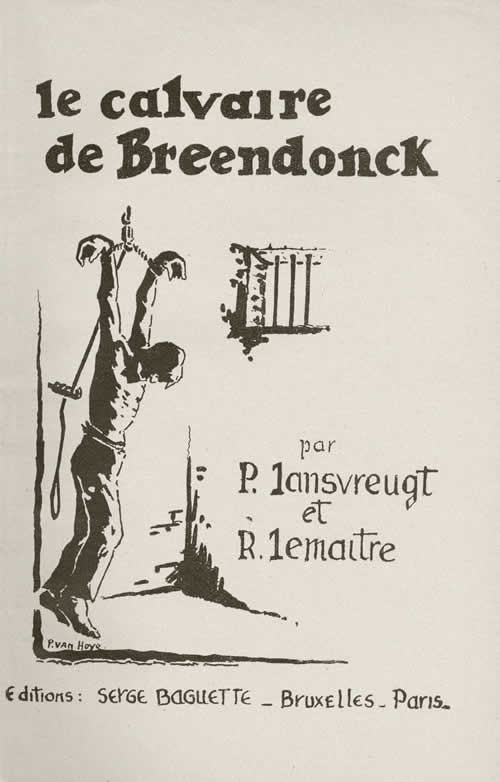
Une introduction qui s'impose Ce
petit travail que nous avons voulu être populaire et accessible: en raison. de
son prix, à toutes les bourses, a été fait rapidement par deux hommes responsables
se trouvant à la direction de l'Association Nationale des Rescapés de Breendonck. Nous avons cru que cette hâte s'imposait pour
éviter des contradictions qui ne sont qu'apparentes entre les différents écrits
qui ont vu le jour sur le même sujet. Breendonck de 1940 n'est pas le Breendonck
de 1943. Ce camp sinistre sous la Wehrmacht ou sous les SS allemands et
flamands c'est tout autre chose. Il faut donc fixer des dates pour situer
exactement les faits. En attendant que paraisse le livre officiel – le Livre
Noir de Breendonck – qui procèdera chronologiquement
depuis 1940 jusqu'à la libération, les auteurs de cet opuscule ont décrit les
horreurs qui vont de septembre 1942 à juillet 1943. Ainsi
pour ne citer qu'un détail qui est un détail d'une importance capitale pour le
bagnard, ont remettait des colis de la famille ou des moitiés de colis aux
prisonniers de septembre 1942 jusqu'à janvier 1943 ; on ne les remettait plus
du tout de février à juillet 1943. Le lecteur ayant lu dans certaines publications
que le détenu recevait des colis doit se demander : « mais qui donc dit la
vérité dans cette histoire-là » ! Et bien les deux affirmations sont vraies. Il
s'agit de fixer les périodes. Rob.
Lemaître, facteur de postes, a été détenu à Breendonck
de septembre 1942 à avril 1943 pour être conduit ensuite à l' hôpital allemand
d'Anvers, se voir reconduire au camp pour être libéré ; Lansvreugt
est arrivé après lui. Voici donc une période s'étendant sur 11 mois. Le
début de cette brochure et les chapitres « L'ordre Allemand », « Travail Forcé »,
« Voyage-Surprise », « Honnêteté », « La Vermine », « Les Poteaux de la Mort »,
« Dans la Chambre des Tortures », sont de Lemaître. Les autres chapitres « Le Major,
son Chien et sa Maîtresse », « Comme le Chat joue avec la Souris », « La
Journée des Pendus », « Tortures Morales », « Tortures Physiques », « Les Trois
Criminels », « Un Premier Hommage », sont de Pierre Lansvreugt. Les Auteurs. j'y suis retourné, en visiteur, libre...
Il y a quelque chose de changé ! 
L’entrée du fort de Breendonck. En groupe, tous ex-détenus ; le
cœur se serre en entrant dans cette île, où nous avons tous pensé devoir
rester, pour y mourir... Je dois l'avouer : nous avions encore
peur en revoyant Breendonck ; le cœur oppressé, une
angoisse terrible nous serrait la poitrine ; nous y avons trop, trop souffert,
et il n'est pas possible de revoir ce camp de la Mort sans avoir peur de
ne pas en sortir... Au retour de cette visite, en marchant
vers la petite ville de Willebroeck, comme c'était
bon cette route, vers la lumière, vers la liberté ! Que ceux qui reçoivent des confidences
d'ex-détenus fassent un effort et ne publient que la vérité stricte. Il est
certain, et j'en appelle au témoignage de tous les anciens de Breendonck, que la vérité exacte, toute nue, est assez
terrible, assez atroce par elle-même... Breendonck
n'est pas un roman ... Hélas. Trop de tortures, trop de morts ! Avec les anciens de Breendonck,
je salue les morts. Pour tous ces martyrs, la Justice n'a qu'un seul nom :
Vengeance ! Pour le repos de leurs âmes, pour la
paix de nos cœurs : IL LE FAUT ! *
* * Un matin de septembre 1942, le premier
du mois. Nous sommes une trentaine dans un camion boche, sur des bancs. Il
pleut, bien... comme il sait pleuvoir à Bruxelles. Par les trous de la bâche, nous
apercevons certains bâtiments, certaines rues larges, qui mènent vers Laeken.
L'église de Laeken. Quelqu'un parmi nous murmure : Breendonck ! Breendonck !
un camp dont très peu des nôtres ont entendu parler, et pour cause : on y
emprisonne beaucoup, on y libère très, très peu... Une vague angoisse nous étreint :
serait-ce Breendonck, la destination ? Et
qu'est-ce que cela signifie ? On roule, et toujours la pluie qui
claque sur le camion. On roule vers... on ne sait. On se tait... Quelques minutes avant 8 heures ; le
camion tourne et s'arrête devant un fort ; c'est ça Breendonck
? Barbelés, coupoles noires, voûtes sombres. On descend du camion. Et tout de
suite, brusquement, brutalement : la Kultur allemande
! 
Le commandant du fort, Philipp Schmitt au milieu de ses adjoints Nous sommes reçus par un officier,
lieutenant SS, nommé Praus : allemand pur sang,
paraît-il, et fixés de suite. Encore près du camion, nous regardons :
cette sombre brute hurle, à vingt mètres de nous ; les plus ignobles injures
que comporte un vocabulaire allemand, injures où la scatologie a la place
d'honneur ! Cravache levée, rauque, déchaîné,·
menaçant : « Vous êtes ici chez les SS et je vous
apprendrai ce que c'est que Breendonck ! » Le tout avec des insultes, impossibles à
reproduire avec une encre honnête. Et nous croyions avoir compris. Pauvres
de nous ! Et la danse commence ... A coups de pied, coups de poing, nous
sommes rangés dans un couloir, face au mur : très près ! Notre chef, Percepteur principal des
postes, reçoit des coups en pleine figure ... Je reçois des coups de pied dans le dos.
Pourquoi ? .. on ne sait. Et toujours, la brute hurle derrière nous. Malheur à celui qui tourne, fut-ce
légèrement, la tête ; malheur, à celui qui murmure, à son voisin, une question
angoissée : des coups, et la figure qui s'écrase contre le dur béton du mur. Des heures, debout, devant ce mur ... Et ce n'est rien encore. Ce n'est que le
début de cette méthode, de cette Kultur. Petit début.
J'ai vu enterrer un homme vivant .... Saurai-je décrire cela ? J'essayerai. Visions horribles que l'on ne peut
oublier... Cauchemars, brusques réveils ; terribles sursauts de la mémoire qui,
la nuit, nous harcèlent encore. On voudrait oublier... dormir comme tout le
monde. L’ordre allemand 1er septembre 1942. 8 heures
du matin. Debout. Face au mur, 9 heures. Debout. Las. Inquiets. Et toujours
cette brute galonnée qui hurle dans notre dos. On entend des coups donnés, on
ne sait à qui : il faut rester absolument immobile ; et je ne puis pas voir
qui, dans cette longue rangée d'hommes écope, on ne sait pourquoi. Voisin direct de notre chef, j'ai vu
tomber un poing allemand sur la figure du plus calme d'entre nous. 10 heures : longues heures qui n'en
finissent pas ! Ah ! pouvoir se battre, désespérément : recevoir des coups,
soit, mais au moins pouvoir en donner ! Statues mornes, nous sommes toujours là
... 11 heures : Ah ! on bouge : un à un, à l'appel
de notre nom un SS nous conduit dans un bureau. Petit aperçu sur le vif de leur
« ordre » : Fiche d'identité. Il faut vider ses
poches. Ça doit aller vite : tout disparaît : crayon, porte-plume réservoir,
porte-mine, canif, bijoux, tout doit être remis, tout. Petite parenthèse : quand la Gestapo
fouille chez vous, il ne faut surveiller leurs pieds à ces oiseaux-là, mais
bien leurs mains : ils ont les doigts « longs ». Chez moi, pendant que ces « messieurs »
fouillaient mon petit appartement à quatre, heures du matin, vite habillé,
j'avais eu le temps de prendre deux, bonnes pipes et du tabac. Mes pipes qui, je le croyais, allaient
être une compagnie pour moi, hélas, disparaissent aussi, On me donne une étiquette, avec un
numéro : le fameux numéro que l'on devient à Breendonck
! Des ordres hurlés : encadrés de soldats,
bousculés par les SS on s'enfonce sous la voûte du fort. Halte. C'est à croire que tout ce qui parle
allemand dans ce camp maudit ne connaît qu'un langage : on ne parle pas à Breendonck, ils hurlent, tous, sauvagement ! Le triste tableau des « cagoulards » se
montre : des hommes, des femmes, prisonniers isolés, sont conduits par le bras
par les soldats-gardiens, avec, sur la tête, un sac de toile bleue, le sac du
butin militaire belge, sac qu'ils doivent tenir des deux mains : ils ne voient
que leurs pieds, ne savent ni voir où ils vont ni où ils sont ! Ils ne savent pas nous voir, nous.
toujours alignés, en silence devant le mur nu : nous-mêmes, furtivement, nous
ne pouvons qu'entrevoir ces ombres, durement conduites par les brutes grises. Que signifiaient ces mystères ? On ne
sait. Le cœur lourd, le corps las, on est
inquiet on voudrait savoir... On ne sait pas encore qu'à Breendonck, il vaut mieux ne pas savoir, ne rien voir. Patience ! Ceux qui peuvent se battre ont de la
chance. Encore des ordres hurlés : on est parqués,
debout, dans une baraque ; il faut se déshabiller et ne garder que ses
chaussures et la chemise. Des SS nous jettent à la tête des
pantalons kaki : en route avec les hurlements accompagnateurs, vite, vite, « schnell », et poussés dans une chambrée. Chambrée d'un fort
: fenêtre à barreaux épais. Porte épaisse, avec grosse barre à l'extérieur, comme
sûreté. On se regarde : un peu « bête » d'abord. Je suis volontaire de 1914. Pour moi, ce
n'est pas la première fois : de 1914 à 1918 « ils » m'ont « logé » dans quatre
prisons : une de plus. La pire, cette fois. Mais camarades de chambrée, braves,
sont un peu, mettons moroses, mais nullement abattus ; on se questionne,
on compare la façon dont on a été arrêté, certains même révèlent qu'ils ont
posé une question aux gestapistes : « Dois-je prendre des vivres ? Il en
est qui ont demandé : « Reviendrons-nous ? » Et savez-vous, amis lecteurs, ce que ces
braves ont commencé à faire ? Non ? Eh bien, voilà : ce même jour, premier
d'une captivité terrible, ils ont commencé à faire des pronostics sur leur
libération ! Je crois que nous sommes ainsi : on aime
la Liberté ! Chère liberté, il va falloir l'attendre pendant de longs mois. Des
mois épouvantables. Hélas ! Ils n'en sont pas tous sortis vivants. Premières heures et déjà des coups. Que
sera-ce tantôt, demain ? Il est midi, maintenant. On ouvre brusquement la porte, des
hommes déposent un grand bidon de soupe, des gamelles et cuillères à
l'intérieur. Porte fermée, bruit dur de la barre de
fer. On s'organise. Répartition de cette soupe : liquide clair où nagent de
gros morceaux de choux blancs mal cuits. Sans sel. On n'a pas faim. On se regarde, et on
songe intensément au foyer, à l'épouse, aux enfants... La prison est triste, avec ses lits en
bois, à trois étages. Va falloir vivre là-dedans. Tant pis. Un peu de répit :
on rêve, tristement, à la Liberté. On ne sait pas encore que ces rêves sont
dangereux ... On pense trop, ce n'est pas bon. 
Six prisonniers occupent chacun des trois étages de chaque ensemble de lits. Midi. On n'a pas faim. La soupe aux
choux blancs ne plaît pas : on n'est pas riche, mais c'était tout de même mieux
à la maison. Qu'est-ce que vous voulez ? On est
toujours difficile, le premier jour, en prison. Ce que l'on ne sait pas encore, le
premier jour, c'est que l'on mangera des patates crues, pendant. l'épluchement. On mangera des morceaux de betteraves,
avec la pelure, pour ne rien perdre. Des navets, des rutabagas crus. On volera
aux lapins du major, de la verdure, avec le risque d'être surpris et battu à
mort par les SS belges. Cuites dans le couvercle d'une boîte à
confiture, on mangera des cuisses de grenouilles, oh ! pas à la douzaine, bien
sûr, comme les gourmets, mais par paire. Dans un couvercle on ne sait cuire
qu'une ou deux paires. Les souris aussi seront mangées. Elles
ne manquaient pas ! La faim à Breendonck,
l'horrible faim, persistante, tenaillante comme une maladie. La maladie de la
faim. Terribles effets sur les hommes. Des hommes
sensés, courageux, honnêtes, des hommes enfin, deviennent des bêtes ; bêtes
qui, par tous les moyens, cherchent à manger. Le premier jour on est là ; on est
difficile : qu'est-ce cette soupe ? Après, on sera prêts à se battre pour
une cuillère. Jamais personne ne pourra comprendre. Travail forcé Bruit de fer. La porte s'ouvre. On
hurle. Dehors. Dans la cour. De l'étage des écuries, on nous jette un sac à
paille. A la file indienne, on se charge et en route vers la chambrée. C'est la
chambrée 7. Couvertures. On attend. Encore des
hurlements : il faut sortir, vite, toujours vite, prendre chacun une pelle ; se
mettre en rang par trois et, avec les SS comme chiourmes, on marche hors le fort,
sur un pont de bois et sur la rive extérieure. C'est le chantier de travail. Il pleut. Tristement. Nous sommes
vêtus d'un pantalon kaki et de notre chemise : ça fait drôle de travailler dans
la terre avec des boutons de manchettes à la chemise ! Des hurlements : « Schaùfeln,
schaùfeln. On jette des pelletées de terre dans des
trous. Un peu abrutis par les hurlements, on cherche à regarder autour de soi :
des prisonniers sont 
Le terrassement là, tête rasée, qui
nous regardent tant qu'ils peuvent : nous sommes des « nouveaux ». Les SS sont bien habillés : manteaux
gris et bottes. Toute la pluie est pour nous, nu-tête et en bras de chemise. Un besoin urgent à satisfaire : comment
faire ? Je demande au SS, poliment ; il gueule quelque chose et montre là, sur
place. Devant tous ! C'est difficile aussi cela, le premier jour, de se déc... déboutonner en public. Avec le temps, on change. Peller, toujours peller. Pas parler. Les
mains font mal. Les reins aussi. Les pieds dans la boue. Trempés. Fatigués. Dure journée. Sombre journée :
arrêtés le matin et crevés le soir. Un ordre. Rangés en colonne par trois. Des prisonniers rangés devant nous, en
colonne. Ils sont tous en kaki, tête rasée, maigres et peureux. Un ordre. Marche. Nous suivons et, soudain...
Un chant s'élève... Les prisonniers chantent. C'est en allemand, à plusieurs voix, au
rythme de la marche : ils doivent chanter « très fort ». Sinon un hurlement : «
Lauter » (plus fort). C'est terrible, lugubre, ce chant des
prisonniers. Ce sont les Juifs qui doivent chanter. Ce qu'ils chantent ? « A Breendonck, on est bien soigné, Il y a plusieurs couplets à ce chant
sinistre. Nous marchons, mouillés, la pelle sur l'épaule. Cour du fort. Halte.
Alignement. Nettoyage des pelles et des souliers, dans l'eau sale des bacs. Remise des pelles. Elles doivent être
nettes. Sinon... Alignement, encore. Ordres hurlés, toujours. Marche. Dans la
chambre. Attention, ce n'est pas fini ! Vite, alignés devant les lits ; fixes,
toujours. Silence. On vient. Les SS. On nous compte. Ce
n'est pas la première fois, aujourd'hui : sur une journée, ils nous comptent
six à huit fois. On reçoit les vivres. Pain coupé en
rations. 200 grammes environ par homme. Environ une cuiller à café de sucre en
poudre, autant de confiture et quelques grammes de beurre ou margarine. On est affamé. Partage. On s'organise et
on compare : on a reçu les vestons-tuniques, avec notre numéro sur le côté
gauche. Café fait avec on ne sait quoi : des
glands de chêne, paraît-il. Plus tard, j'ai vu manger les marcs. Bruit de fer. La porte s'ouvre. On nous
envoie un prisonnier qui sait parler allemand : ce sera notre premier chef de
chambrée. Petite tête, front bas. Un primate. De
la gueule. Ex-sous-off. belge, paraît-il. Une véritable gouape. Il est de
Hasselt. On ignore son cas. Apprenant la présence d'un percepteur
parmi nous, il veut faire l'intelligent avec notre chef. Il nous fait un peu de
théorie. Pour la nuit, il faut plier l'uniforme, avec l'insigne visible, sur
notre escabeau, au pied du lit. Alignement sévère. Harassés, on se couche sur
les paillasses dures. On se parle très peu, parce que
maintenant on compare. On revoit la maison, le soir, sous les lampes. Pantoufles,
fauteuil, robe de chambre, lit avec des draps. On se tourne. On n'est pas bien.
On se retourne. Ça ne va pas. On pense trop... Cinq heures et demie du matin. Une
première nuit est passée à Breendonck. Des hurlements
dans le long couloir, devant les portes : « Debout ! », en allemand,
naturellement. Du dehors, les gardes-soldats allument. On se dresse en sursaut : on a fini par
dormir, malgré les bruits de la lourde grille qui roule la nuit pour laisser
entrer encore d'autres victimes de la Gestapo. Réveil brutal. On est tout
étonné de se trouver sur un lit de bois, dans une chambre qui pue. Nous sommes en fermés depuis la veille,
vers 7 heures du soir, à quarante-huit, avec des seaux qui doivent servir à
tout. Porte ouverte : dans le long couloir, des robinets. Demi-nus, on se lave.
Vite, toujours, vite, au garde-à-vous, au pied du lit ; les SS nous comptent.
Nettoyage de la chambrée, avec des moyens de fortune et beaucoup d'eau. Debout. On attend. On ne sait encore
quoi. 
Le chantier tel qu’il se présentait pendant la guerre. Mais propagande allemande de manière à faire croire que les prisonniers travaillaient dans de bonnes conditions. C’était loin d’être le cas. Un SS vient nous donner l'ordre de faire
les « lits » de façon à ce qu'ils soient tous absolument égaux, au même niveau.
Tâche ingrate, les sacs-à-paille étant les uns minces et plats, d'autres plus garnis. Combien ce « bettenbau
», nous a-t-il valu de coups ? Les anciens seuls le savent. Discipline allemande. Si encore ils nous
donnaient de quoi faire les couchettes convenablement ! Toujours porteurs de
matraques ou de bâtons, les SS rôdent et frappent. Des ordres. Corvée de café. Quelques
hommes doivent aller chercher le bidon d'erzats et
les gamelles. Pour tout il faut courir. Au pied du lit, garde à vous. Achtung ! Silence, « Ils » sont là ! Voici le système : en deux rangées
partant de la porte, on est rangés, face à face, dans le milieu de la chambrée.
Au moment où le poste de comptage paraît, le chef de chambrée crie « Achtung » (Attention, garde à vous). Tout le monde doit être aligné ; les
bouts de pieds doivent ,être exactement en ligne. Toutes les têtes doivent être tournées
vers 1a porte ; au fur et à mesure que passe devant nous, pour nous compter
encore une fois, le plus haut en grade, les yeux et les têtes doivent suivre
son mouvement. Le
chef de chambrée, vient de crier le garde-à-vous : paraît le poste de service. Il faut déclarer, en allemand, ceci : «
M, le sous-officier, je vous déclare avec obéissance que la chambrée 7 est
occupée par quarante-huit hommes ». Une voix rauque, une voix de vieil
ivrogne. C'est le lieutenant Praust qui hurle : « Antreten ! » Rassemblement. Les portes sont ouvertes, il
faut se ranger par trois dans le long couloir. Les plus grands devant. Gare à celui qui murmure un conseil à
son voisin : « Mets-toi là, etc. » Un ordre : « Stilstand
» « Im gleichschritt, march
». « Ein, zwo, drei, vier ». Les SS gueulent : « Balancez les bras,
les doigts allongés, gardez vos distances ». On marche, on vire, voici la cour du
camp. Alignés, par sections, sur trois lignes de front. Les hommes doivent être alignés de telle
sorte que tous les bouts de souliers soient sur une ligne impeccable. Et, pour
y arriver, le chef de chambrée se place à un bout de la ligne, baissé. Il vise
littéralement chaque pied et crie pour faire reculer ou avancer de deux
millimètres le pied gauche ou le droit. Nous sommes levés depuis cinq heures et
demie. A 7 h., nous sommes dans cette cour, pour faire un alignement, à la
prussienne. Le petit Paul CI... pour n'avoir pas
bien compris, assez vite, est frappé durement en pleine figure. A son allure,
il était pourtant visible que le malheureux n'avait jamais été soldat ; il
avait aussi un âge qui compte : 64 ans. L'alignement des pieds continue.
Immobiles de puis trois longs quarts d'heure, les doigts allongés, les pouces
pliés vers l'intérieur. Et on attend, pendant que les SS rôdent,
comme des chiens ; ils sont à l'affût d'un léger mouvement, d'un rien qui bouge
et, à pleine volée, la matraque entre en jeu, sur nos têtes nues. Je ne connais pas le texte du Manuel du
Parfait Tortionnaire allemand, mais je crois qu'il doit s'y trouver une phrase
comme celle-ci : « Il faut briser les énergies, annihiler le moral ». « Augen... rechts ! » La brute galonnée se présente, cravache à la
main. Rapport. Le sous-off de service lui
présente les détenus. Salut hitlérien. Je remarque que, seule, notre section de
postiers a échappé à la tondeuse ; nos hommes ont encore des vestiges de raie.
En... volés, les peignes, alors ... Marche-marche ! Ça veut dire courir. On
court vers les pelles. En rang. En colonne et en route vers le chantier où l'on
tue. La « kapelle », l'orchestre du lieutenant,
entonne son chant sinistre. « A Breendonck,
on est bien soignés ». Les malheureux juifs de la colonne qui
nous précède, chantent. C'est l'ordre. C'est lugubre dans le matin, ce chant. Halte. Devant une série de bennes
basculantes. Quatre hommes par benne. 
Wagonnet utilisé à Breendonck. Peller,
peller, vite. Remplir la benne, très fort. En forme de tour, au-dessus. Les
coins bien garnis. Sinon... Pousser la benne, lourdement chargée, sur des
rails, à même le sol. Pour tourner, une plaque. Ces plaques, terreur des hommes pas habitués.
On pousse la benne dessus. Elle semble y tenir en équilibre, puis : une roue
est à côté de la plaque. Pour remettre la benne en place, on fait
des efforts désespérés et maladroits ; le train des bennes est arrêté. Le SS
arrive en hurlant et la danse commence : des coups, drus, tant que la benne
n'est pas repartie. Un prisonnier de près de septante ans
est là, à une plaque tournante. Les présentations sont vite faites : L.,
de Wavre, cheminot. C'est L., qui nous initie aux trucs du métier de
terrassier. On roule, en descente, un peu ; il faut freiner avec un bâton, sur
la roue. On traverse un pont de bois et les
bennes doivent être poussées sur la rive extérieure, où on les bascule. Travail dur. On n'est pas habitué. On se
blesse. Faux mouvements. Et toujours vite, vite. Charger, pousser, basculer.
Revenir au pas de course. Nous sommes chargés. Le train des bennes
avance... Quatre hommes poussent chaque benne. Plaque tournante. Attention de
ne pas rouler au delà. Dure manœuvre. En vitesse, on passe sur le pont. Pour
aller, ça descend, on doit sauter sur la benne. s'accrocher au bordage. Des juifs travaillent là, à rejeter les
terres que nous basculons. A deux mètres l'un de l'autre, ils sont
déjà habitués, ils cherchent à savoir d'où on est. En sourdine. Les SS
sont là. Il se passe quelque chose. Un homme est là, étendu sur la terre
meuble. Ils sont deux pour le frapper : Weis et Raes. Ils frappent. Les coups résonnent. Ils crient : « Auf
! » (Debout). Tout autour, les prisonniers continuent.
Eux savent : pas regarder. Le malheureux ne se relève pas. Coups de
pied dans l'estomac. « Auf ! Auf !
». Il reste couché. Un des SS prend une pelle et le recouvre de terre.
Puis il piétine en ricanant. Il marche sur l'homme enterré. L'autre SS nous court dessus ; matraque
levée, en hurlant : « Voulez-vous le même sort ? » On ne sait pas encore que sous peine de mort,
il ne faut pas regarder à Breendonck. Le major, son chien et sa maîtresse 
Le major et sa maîtresse Vers la mi-mai 1943, soixante-dix civils
sont rangés dans la cour. Ils portaient paquets, valises : serviettes. Ils
étaient bien habillés, contraste violent avec nos pauvres hardes miteuses et
pouilleuses. Costauds et forts, ils l'étaient tous. On se rendait compte tout
de suite qu'ils étaient originaires d'une région agricole où il y avait encore
abondance de ravitaillement. Leurs mères et épouses leur avaient remis à la
dernière minute les victuailles nécessaires pour tenir le coup. Hélas, une
demi-heure après il ne leur restait rien, tout prenait le chemin des autorités
du camp. Ils venaient de Saint-Trond et environs.
Répartis dans deux chambrées avec d'autres prisonniers à Breendonck
depuis longtemps, ils étaient pleins d'illusions quant à leur relaxement proche. Car, n'est-ce-pas, leur arrestation
était une erreur ! Ils en ont vu des vertes et des pas
mûres, ceux-là. Le lieutenant Praust, avec sa tête de
citrouille, disait à qui voulait l'entendre que ces flamands-là étaient ses
prisonniers, à lui. Il leur a fait faire des marche-marche, des heures
entières, courir, se jeter au sol, dans les flaques d'eau, dans la boue : se
relever, courir, se rejeter au sol, ramper avec les coudes sur les talus, et
recommencer encore, toujours. J'en ai vu un qui devait tourner comme une toupie,
toujours, toujours, jusqu'à ce qu'il tombe, pour recommencer, longtemps. Vite, plus vite que les autres
prisonniers, on les a mis à la question. A coups de chicotte, à partir de la
partie inférieure du dos jusqu'aux genoux, on les frappait jusqu'à ce que les
tortionnaires en eurent assez. On les « rapportait » pantelants dans notre
chambrée, le derrière bleu et noir, incapables de se lever pendant plusieurs
jours. Ceux de Saint-Trond ne trouvèrent le réconfort que dans leur foi. Le
soir, avant de se coucher, ils s'agenouillaient à plusieurs dizaines entre les
rangées de nos sacs à puces et récitaient la prière. Quelques « vieux » pensionnaires
y participèrent dans leur coin, n'osant pas manifester publiquement qu'eux
aussi, en fin de compte, espéraient en l'Etre suprême pour les sortir de cet enfer... *
* * Le major SS Schmidt était le chef du
camp. Il ne s'intéressait pas aux travaux, ne donnait jamais un commandement.
Il était mystérieux, éthéromane et alcoolique. Deux fois par jour il fait le tour
du camp, presque toujours accompagné d'un grand chien et souvent de sa
maîtresse. Le chien était la terreur des
prisonniers. Lorsqu'un prisonnier recevait des coups, ou lorsque les colonnes
de détenus passaient, il leur sautait dessus et mordait. Beaucoup de mes
camarades portent des morsures, d'autant plus difficiles à guérir qu'il n'y avait
là-bas rien pour se soigner. 
Le commandant du camp entraînait son berger à attaquer les déportés. Sa maîtresse pouvait voir l'immense détresse
des prisonniers sans émotion et je crois même avec un certain plaisir. Elle
assistait à toutes les scènes d'horreur à Breendonck
sans broncher. Elle voyait des centaines de prisonniers nus, attendant la
visite du major-médecin (il en examinait 400 en 2 heures !) Elle s'approchait
parfois des grands travaux de terrassement et d'endiguement, où plusieurs
centaines de détenus s'épuisaient de longues heures durant, et semblait
regarder avec un intérêt curieux des hommes accroupis de toutes parts pour
satisfaire des besoins
d'autant plus impérieux que la nourriture du camp provoquait soit la diarrhée, soit
la constipation. Femme qui n'avait plus rien de féminin,
Allemande qui psychanalyse même ça ! *
* * Oui, on devrait pouvoir, parler de ce
que j’appellerais la négation totale de toute hygiène. C'est tellement
difficile ! « Te rappelles-tu, Oscar, que le barbier m'ayant remis un restant
de stick, je m'étais frotté très parcimonieusement et prudemment avec cette
aubaine, et tu m'enlevas des cuisses, la mousse pour que toi aussi tu aies
l'illusion d'être lavé ? » « Tu te souviens
encore, Lucien, que nous avons entendu des hommes supplier leurs camarades de leur
passer la petite loque pour s'essuyer... tu sais bien ! « Voyez-vous encore ce
spectacle, mes amis, de vingt à trente hommes accroupis sur d'immenses cuvelles
pleines sous l'œil intéressé du feldwebel qui ne voulait même pas se détourner ? » « Et toi, Alphonse, te rappelles-tu les
disputes le matin pour sortir les seaux et les déverser dans les fameuses
cuvelles ? » Privilège magnifique : avoir un seau sur
lequel on pouvait s'asseoir tout seul, dans un coin ! Misère de l'homme, pitié humaine ! Comme le chat joue avec les souris Breendonck
était une cour des miracles... sans le miracle. On y a mis de jeunes garçons,
des vieillards cacochymes et hébétés, des unijambistes, des estropiés, des
bossus. Tous devaient, malgré tout, aller au chantier, soit pour les travaux de
terrassement, soit pour casser des pierres ou couper du bois. Je me souviendrai longtemps du père et
du fils qui essayaient toujours d'être de la même équipe. Le vieux papa était
un ouvrier mineur flamand, qui avait quitté son pays depuis plus de trente ans.
Il ne parlait pour ainsi dire plus sa langue maternelle et ne connaissait que
le dialecte wallon. Son garçon, un frêle gamin de 18 ans, était complètement
épuisé par le travail et la famine. Il était faible à un tel point que son père
devait le porter sur le dos vers les lieux du travail. C'était un spectacle
lamentable de voir ce père se substituer à son fils pour lui épargner le
travail lourd à la pelle et recevant les coups à la place de son enfant. La répartition des instruments de
travail le matin, était un petit drame qui donnait lieu chaque fois à des
incidents sérieux avec les SS. Au lieu de remettre à chaque prisonnier la pelle
ou la pioche, on jetait ces instruments pêle-mêle sur le sol. Chacun devait
faire en sorte de prendre l'outil le plus tôt possible. C'était une bataille
épique entre prisonniers qui s'arrachaient les instruments, se blessaient et ne
parvenaient pas à être dans les rangs à la seconde prescrite. Les coups
pleuvaient drus à ce moment là. Ce que le bossu a souffert dépasse toute
description. Il était âgé de plus de 60 ans. Particulièrement visé par les SS,
parce que anarchiste, on en a fait le bouc émissaire pendant de longs mois.
Petit de stature et assez corpulent, on lui imposait de porter avec d'autres
bagnards – plus grands que lui et choisis dans cette intention – de longues
poutres, ce qui faisait un effet plutôt drôle. N'étant pas en mesure de
brouetter la même quantité de terre que nous, il essayait de n'en mettre que la
moitié. Le surveillant était tout proche, le truc ne prenait pas deux fois. Le
SS l'installait dans la brouette et avec une vitesse que lui permettait la
splendide nourriture qu'il nous volait, le versait avec la terre dans le fossé.
Il répétait ce jeu plusieurs fois. La victime en sortait chaque fois plus
stupide que jamais, étonné que des hommes pussent faire cela à d'autres hommes. Une autre fois, les SS ont obligé le
pauvre homme à lever une grosse barre de fer, longue et lourde et lui, qui ne
pouvait pas lever les bras d'une façon naturelle, ne parvenait pas à soulever ce
poids. A coups de cravache et à coups de pied ils le maltraitèrent ainsi
pendant une heure. Et puis las de cet « amusement », ils l'ont fait grimper plusieurs
fois un talus abrupt. Il fallait voir notre camarade faire un effort surhumain
pour donner satisfaction à ses tortionnaires, pour se voir, à chaque réussite,
brutalement rejeté à coups de botte dans le fossé, pour recommencer, encore,
encore... Comme le chat avec la souris. La journée des pendus Par un hasard inexplicable nous était
parvenue la nouvelle de l'exécution du sinistre traître Colin. Un petit bout de
journal était tombé entre les mains des prisonniers, relatant le fait et les
circonstances de l'exécution. Quelques jours plus tard les autorités
du camp firent appel à des hommes de métier. Il s'agissait de faire en toute
hâte certains travaux de menuiserie. Notre ami C, homme de 60 ans, n'ayant plus
fait le métier depuis plus de trente ans, se présente. Il était heureux
de se trouver de ce fait à l'abri du travail forcé et des coups. Sa joie ne fut
pas longue. II vint nous dire un jour, que les bois qu'il avait à travailler ressemblaient
singulièrement à des bois de Justice. Il en était terrifié. 
La potence. C'était la potence qu'on préparait, une
large estrade avec trois planchettes basculantes qu'on faisait descendre d'un
seul coup de levier. Nous nous attendions à une exécution de prisonniers, et ne
nous doutions nullement que ce seraient les héros qui abattirent Paul Colin. La veille du drame le plus épouvantable
de Breendonck, la Gestapo et les SS flamands étaient joyeux.
Dès le coucher des prisonniers ils firent la fête, chantèrent à tue-tête, les
radios de leurs bureaux envoyaient la musique à travers tout le camp, ils
circulaient ivres dans les couloirs, tiraient des coups de révolver. Nos cœurs
cessèrent de battre. Le lendemain matin, défense de sortir.
Tous les prisonniers cloîtrés dans leurs chambrées. La nôtre, qui avait deux
larges fenêtres, permettait de jeter un regard sur la cour qui menait au lieu
du supplice. Brusquement un silence glacial. On
entend des pas sur le gravier de la cour intérieure ; nous nous précipitons
vers les fenêtres. Des autorités de la Wehrmacht passent, puis les chefs allemands
du camp, trois prisonniers, les mains liées au dos, en chemise et pantoufles,
suivis d'une petite charrette. Le cortège est fermé par les SS flamands. – « Faisons vite une prière pour les
suppliciés », dit un des nôtres. – « N'en faisons rien », dit un autre
qui sait qu'il y a un traître dans la chambre. Nous nous retirons tous dans notre coin,
terrorisés, émus jusqu'au tréfonds de notre âme. Chacun pense au tragique
destin de ces trois jeunes gens qui sont partis, la tête haute, avec un courage
stoïque vers le dernier supplice, épouvantable, rapide, humiliant. Immolés sur
l'autel de la Patrie qui gardera éternellement leur mémoire. Cinq minutes plus tard la sinistre
charrette repasse, emmenant les cadavres de trois héros qui se sont sacrifiés
pour que le pays vive. *
* * On vient de repêcher du Canal de
Charleroi le corps du pauvre C. ... qui fabriqua les potences : il avait dans
la poche de son veston un livre sur Breendonck ... Tortures morales L'époque dont je parle, va de février à
juillet 1943. L'isolement. La maison des morts. Pas de colis, pas de lettres,
jamais. Si, de temps à autre, exceptionnellement, une lettre pour l'un d'entre nous,
pour que les autres se disent : « Mais nom de nom, que fait ma femme, elle
ne m'envoie rien, elle ne bouge pas ! » Semer la démoralisation parmi les
prisonniers, voilà le but. Du colis, on enlève et on remet au prisonnier la
paire de sabots que la maman ou l'épouse y a mise. Car cela c'est une économie
de chaussures pour le camp. Un signe de la maison, c'est beaucoup ! On est souvent mis nu comme un ver.
C'est qu'il y a pesage, mesurage. Pesage inexact ; il faut des statistiques aux
Allemands. Il n'y a pas à dire plus tard que X ou Z ont maigri d'autant
de kilos ! Les données sont là qui démontreront le contraire. Les cheveux coupés à ras tous les quinze
jours. Travailler tête-nue et sans sous-vêtements, dans tous les temps, En
position devant les lits, sacs à puces, pendant des heures. Interdiction le
dimanche après-midi, le travail étant supprimé, d'aller à la cour.
Quarante-huit hommes dans une chambrée avec deux seaux qui dégoulinent à
travers la place. Ni journal, ni livre, aucune nouvelle de
l'extérieur, sinon de fausses nouvelles sur des victoires alliées amplifiées considérablement
pour se faire illusion, disputes entre les prisonniers affamés parce qu'il y en
a qui ronflent la nuit ou qui utilisent trop les seaux. 
Ce que chacun mangeait sur la journée : un bol d’une sorte de café fait avec des glands torréfiés, une tranche de pain. A midi, une tranche de pain avec une sorte de soupe. Le soir, une tranche de pain. Travaux forcés sous la pluie, on. rentre
trempé, nul moyen de se sécher. Le lendemain on remet les vêtements mouillés.
Faire les « lits ». Contrôle. Refaire les lits. Recontrôle.
Recommencer encore, cinq fois, six fois. Laver la chambrée. Contrôle.
Recommencer. Ceci se passe surtout le dimanche, pour vous le faire plus gai ! Se mettre nu dans la cour, tous
ensemble, à cinq cents prisonniers. Corps lamentables, décharnés, traces de
sévices, de tortures, de furoncles partout. Trente gamelles, vingt cuillères pour
quarante huit hommes. Affamés, les prisonniers devaient attendre que les autres
aient fini de manger. Et les premiers étaient poussés à manger vite, alors
qu'on essayait de le faire lentement pour se créer l'illusion d'avoir plus. Les cris de douleur et de souffrance
venant des chambres de torture, les fusillades dans l'enclos sinistre, les
travaux près des dix poteaux d'exécution. Pauvre humanité, pauvre civilisation ! Tortures physiques Ce qui s'est passé dans les chambres de
torture ne peut être décrit que par les victimes elles-mêmes. Personne n'était
présent, hormis les tortionnaires. Ceux qui ont passé par là sont morts des
tortures subies ou morts au poteau d'exécution. D'autres ont été expédiés
ensuite dans les camps allemands. Nous n'avons. rencontré aucun de nos
camarades ayant passé par le « frigidaire ». Les tortionnaires avaient installé
une petite chambre avec, dans le mur... un grand trou qui amenait l'air froid.
Le détenu était couché sur un lit de planches... C'est un architecte belge qui
a fabriqué l'installation ! Une femme belge libérée par hasard par
les armées alliées a déposé devant la Commission d'enquête parlementaire
britannique, le rapport suivant : «
Arrêtée en décembre 1942 sous l'inculpation d'espionnage, j'ai été transférée à
Breendonck vers le 21 janvier 1943. Mise en cellule,
je devais rester debout toute la journée. De 20 h. à 6 h. couchée sur une
planche, sans paillasse ni couverture. Pendant mon séjour j'ai été interrogée 6
ou 7 fois à la SS Zimmer (chambre de torture). Cette
chambre était circulaire et sans porte. Dans le fond à gauche se trouvait une
poulie dans laquelle passait une corde terminée par un nœud coulant. Je devais
me dévêtir complètement, puis on me mettait derrière le dos de grandes menottes
qui étaient placées dans le nœud coulant et par traction j'étais soulevée de
terre puis battue à l'aide d'une sorte de grande matraque en caoutchouc, cerclée
de cuir et maniée par le major Schmidt, le lieutenant Praust
ou un des SS Weis et Debodt.
Actuellement je garde encore sur le siège de profondes cicatrices, qui ont du
reste été photographiées et filmées par les services. anglais. 
Le jour, on leur posait des fers aux pieds. Ils devaient rester debout face au mur, planche relevée. S’ils bougeaient, ils se faisaient matraquer. Au
cours d'un de ces interrogatoires j'ai eu les doigts écrasés dans une presse. Tous
les matins les cellulaires devaient à tour de rôle aller vider dans la cour
intérieure la boîte à confiture qui
servait de seau hygiénique. Pour circuler nous avions une cagoule sur la tête.
Un poste ayant eu l'impression que je voulais soulever ma cagoule, je reçus un
coup de baïonnette dont je garde encore la trace au bras gauche : Une autre
fois j'ai reçu un coup de crosse dans la nuque. La radiographie qui vient
d'être faite montre deux vertèbres écrasées. Après
avoir été condamnée à mort, j'ai été emmenée en Allemagne, puis ramenée en Belgique
pour un nouveau procès qui inculpait un officier supérieur allemand. La
libération m'a sauvée. En
rentrant d'Allemagne, fin octobre 1943, j'ai passé quelques jours en cellule
avec une compagne qui vient de faire à l'Auditorat Général une déclaration relative
à l'état dans lequel elle m'a vue. A ce moment-là outre les nombreuses plaies
et cicatrices, je n'avais pas encore les ongles entièrement repoussés. » Et voici le rapport de trois hommes qui
déposent en lieu et place d'un martyr qui ne le peut lui-même : A
l'aube du 22 juin 1941, alors que « l'invincible » Wehrmacht envahit leur
Patrie, quelques dizaines de Russes, résidant en Belgique depuis de nombreuses
années, sont pris à leur domicile, amenés au 453 avenue Louise et de là,
directement, sans aucun interrogatoire, au camp de Breendonck. Parmi
ces hommes se trouve Lazare... Il est âgé de 47 ans, marié. Sa fille unique a
16 ans, Lazare... était un de ceux qui avaient au début un superbe moral, un de
ceux qui encourageaient souvent les camarades. L'homme jouissait d'une santé de
fer, mais la période dont il s'agit fut une des plus atroces dans le régime de Breendonck. Rations dérisoires, pas de colis, pas de
courrier. Travail exténuant en semaine, exercices militaires le dimanche,
coups, punitions. Malgré une résistance. exemplaire l'organisme de Lazare... cédait
rapidement, la faim le tenaillait, l'espoir de sortir de l'enfer l'abandonnait. Vers
le mois de septembre Lazare ... a commencé à donner des signes d'un état
anormal. Il déraisonnait, n'entendait plus bien, ne comprenait pas ce qu'on lui
disait. Comme certains ordres, donnés surtout pendant les appels, n'étaient pas
bien entendus et compris par lui, nos sinistres bourreaux l'ont choisi comme
objectif de leur hideuse activité. Des coups se sont abattus sur lui pour
détruire ce qui restait encore de vie dans l'homme. Il nous disait souvent que
des parties de son corps lui paraissaient périodiquement paralysées, il perdait
parfois l'usage de la parole. Les crises devinrent de plus en plus fréquentes
et violentes, mais malgré tous nos efforts le médecin ne voulait pas l'admettre
à l'infirmerie. Ce n'est que deux mois plus tard que Lazare... fut admis à
l'infirmerie et c'est là qu'une attaque foudroyante est venue le frapper, alors
qu'il était couché dans son lit. Emmené d'urgence à l'hôpital, il en est revenu
un peu plus tard paralysé (côté droit) et privé de l'usage de la parole.
Il fut « libéré » de Breendonck
en décembre 1941. Sa femme dut prendre une ambulance pour le ramener au foyer.
Trois années se sont écoulées et il est toujours dans le même état. Les conclusions d’un troisième rapport
sont celles-ci : Trois
assassinats furent commis sous mes yeux. ..
1) Le 27 juin 1941 un pauvre homme épuisé fut horriblement frappé à
coups de cravache par le lieutenant aidé du surveillant juif Obier. Au bout de
peu de temps la pauvre victime succomba dans d'horribles souffrances. 2)
Un tout nouveau venu, d'environ 20 ans, fut abattu à coups de feu sans raison
par un surveillant boche. La dépouille fut placée dans l'allée principale du
Fort et nous dûmes défiler un à un. Le Commandant nous réunit et nous déclara
en termes violents que notre sort à tous serait réglé de la même façon. 3)
Un homme malade, complètement à bout, blessé sur tout le corps et incapable de
travailler fut assassiné à coups de bâton par Obier. Le Dr S., grande victime de Breendonck, raconte : Ceux
dont on voulait obtenir des aveux étaient durement torturés. Ils étaient
attachés les bras derrière le dos et hissés en l'air et un SS ou le lieutenant Praust les frappait de sa cravache jusqu'à ce qu'ils
avouent ou s'évanouissent. Une méthode Spéciale consistait à frapper du talon
de la botte dans les testicules. Puis on donnait aux victimes des bains chauds
et froids (wechselwarm Bâder).
Une punition grave, quand un détenu ne voulait pas avouer, consistait à se
tenir debout durant 48 heures devant un poste militaire, dans une attitude
courbée, les mains liées derrière le dos et entre les jambes. La plupart
s'évanouissaient après quelques heures. Mais on les battait et « baignait »
jusqu'à ce qu'ils reprennent connaissance. Il y a eu beaucoup de décès à la
suite de ces punitions. Le
Sturrnbahnführer Schmidt a soutenu tous les crimes
des autres, qu'il excitait. Obersturrn-führer Katschutser a tué deux hommes d'un coup de pistolet et a
donné des ordres aux SS Weis et Debcdt
de tuer au moins 20 hommes après la défaite de Stalingrad, Untersturmführer
Praust, comme supérieur, a fait semblant d'ignorer
que les SS tuaient des hommes et a lui-même frappé des hommes à mort. Weis et Debodt sont les meurtriers
d'au moins 40 hommes. Notre ami A. D. a déclaré : ...
Le 3 novembre 1944 j'ai reçu la visite d'une délégation anglaise à qui j’ai
raconté ce qui précède et montré mon palais ressoudé, mon ventre et mon pied. Parmi
les choses les plus terribles dont j'ai été témoin, je cite : Un
Juif tué net par les coups de poing et de pied d'un lieutenant. Le
petit-fils du grand banquier L. qui s'est pendu. Un
détenu qui s'est noyé dans les douves entourant la forteresse. Un
autre qui s'est jeté du haut des casemates dans la cour. Un
prisonnier qui portait une lourde chaîne à son pied droit. Un
autre dont la tête était couverte d'un grand sac. Un
détenu dont on avait entouré les poignets souffrants de manchettes d'acier. Les trois criminels Le lieutenant Praust,
Weiss et De Bodt. – Un militariste prussien, avec
tout ce que cela comporte de cruel et de sadique ; deux SS flamands. 
Richard De Bodt et Fernand Weiss Praust était
un petit bonhomme, nerveux, alcoolique, puant le cognac. Il avait toujours une
cravache. C'est lui qui dirigeait les travaux à l'immense chantier de Breendonck. A l'époque où je m'y trouvais (avril-juin1943)
les travaux exécutés étaient utiles. Ils avaient un but, c'est de dégager des
fortins, d'endiguer les grands fossés qui entourent le fort, de les solidifier
au moyen des pierres des bunkers, d'étaler les terres le long des digues pour
en faire des jardins potagers. C'est au moyen d'instruments insuffisants et
primitifs que ces travaux s'exécutaient. C'est avec des brouettes (pas des
brouettes à roues carrées, comme on raconte) mais rafistolées par les
prisonniers eux-mêmes, trop lourdes et jamais entretenues, que les terres
étaient amenées à l'endroit voulu. Praust
dirigeait ces travaux de main de maître. Ancien chauffeur de taxi à Berlin,
mais ayant dirigé un camp de concentration en Allemagne, il concevait bien les
choses, Il était fier de ses travaux et savait donner des conseils pratiques. Il
avait certes des qualités et je l'ai vu mettre lui-même la main à la tâche
surtout à l'endiguement au moyen de pierres que les bagnards lui apportaient en
files interminables. Mais a part ça, quelle brute ! Nulle
pitié pour les lamentables loques que nous étions, frappant dur et faisant
travailler par les temps les plus épouvantables. Nous n'oublierons jamais la
journée du 10 mai 1943 où il a plu et grêlé tout le jour. Praust
ne prétendait pas nous faire rentrer. Il faut savoir que nul n'avait de bonnet
de police, que nos têtes étaient comme des billes de billard – encore une tradition
prussienne ! – que nous n'avions le droit d'avoir ni sous-vêtements, ni
écharpes. Il fallait travailler sans veston, en chemise du camp, c'est-à-dire déchirée
et trouée. Ce fut, une journée horrible et
lorsqu'enfin Praust et ses épigones SS n'y tinrent
plus eux-mêmes, l'ordre fut de rentrer. Ne croyez pas qu'on pouvait se hâter.
Sous prétexte que l'alignement n'était pas à leur goût, ils obligèrent les
centaines de bagnards, armés de leurs pelles et pioches, à courir, se jeter par
terre dans les flaques d'eau, courir et encore « hinlegen
». Praust
possédait l'art de nous torturer moralement. Alignés dans la cour avant de
regagner nos misérables chambrées, tandis qu'il disparaissait pendant une
grosse demi-heure, on nous comptait, on examinait nos vêtements et chaussures,
qui ne pouvaient pas être boueux Chose difficile puisqu'on ne travaillait que
dans la boue. Ce doit être Praust qui outre le «
système d'hygiène » dont nous avons parlé, avait inventé jusqu'à l'organisation
des courants d'air ! A Breendonck
il y avait les chambres de tortures, où le bagnard était suspendu nu à une
poulie, monté et descendu et frappé chaque fois par trois ou quatre Prussiens
et SS ; ou on le couchait nu sur un lit de planches pour lui casser bras et
jambes ; ou encore on le mettait nu dans une chambre frigidaire, toutes
installations qui ont été exécutées par un architecte belge ! D'autres étaient
enfermés dans d'étroites cellules éclairées jour et nuit d'une lumière
violente. Attachés à des fers dam le fond de la cellule, il ne leur était
possible d'atteindre la pitance qu'on leur apportait qu'à croupetons ! Il y
avait d'autres horreurs. Les Allemands ne font rien sans
raffinement. Par files de 60 à 80 détenus, on nous obligeait, en pantalon et
veston seulement, à attendre dans une galerie non-couverte notre tour de bain-douche.
L'air y soufflait avec violence. Tous les bâtiments de Breendonck
étaient achevés, mais cette galerie est restée non-couverte pendant quatre ans. Les SS De Bodt
et Weiss étaient les aides-bourreaux. D'un physique puissant, tous deux bien
nourris et vêtus, magnifiquement bottés, ils étaient la terreur des bagnards.
Ils ont des dizaines de morts sur la conscience. Des hommes ont été frappés à mort,
abattus à coups de cravache, de revolver ; ils en ont noyé. Je ne ferai pas la relation de ces
crimes épouvantables. Il est des regards humains, les derniers regards, qu'on
n'oublie jamais ! Voyage-Surprise Tout au début, un soir. Nous sommes
couchés, lumières éteintes, sur nos sacs à paille ; on tourne et retourne sa
fatigue de toute une journée de travail forcé aux bennes. Je ne dirai jamais
que le travail de terrassier est facile ! Mon apprentissage est rapide ; les reins
cassés, les mains ouvertes, déjà des blessures. Un bruit de fer, la porte
s'ouvre, un SS crie : « Huit hommes, vite ! » Un peu curieux, je me lève ; on nous
emmène dans la cour. A quatre, nous sommes conduits sur le pont-levis fixe ; je
suis de ceux-là. Bizarre impression : je suis à l'entrée
du fort, près de la « liberté ». Que faut-il faire ? Les quatre autres
reviennent avec des pelles. On s'embarque dans une remorque et en route vers Willebroeck. Il est 8 h. 30 du soir. Beau soir d'été. Dans l'avenue des
Eperons d'Or, les gens « libres » sont assis sur les trottoirs et nous
regardent curieusement. On roule vers la gare. Halte ! Le SS qui
nous accompagne va voir. Il paraît qu'il faut décharger du charbon, mais tout
est fermé. Le SS Baele revient ; retour au camp. «
Demain vous serez 8 pour ce travail ». Coucher. Fatigués, on se dit bonsoir.
Les ronfleurs de la chambrée ont déjà commencé leur musique. Nuit sur Breendonck. « Aufstehen »
(Debout). Cris dans le couloir. Lumière. On se lève et on se regarde, toujours
ahuris de se trouver si nombreux dans sa chambre à coucher. Jef Van ... , brave camarade s'il en
fut, nous salue ; et ce sera ainsi tous les matins : « Bonjour, messieurs,
encore un de passé ». Dans sa misère, on sourit tout de même. Toilette rapide,
demis-nus. Corvée des seaux. Cette corvée des seaux, des seaux de la nuit... Je
vous laisse à penser : enfermés à 48, depuis la veille, avec deux seaux pour
toute installation. On nous compte. Combien de fois
aujourd'hui ? « Café ». Attendre. « Antreten ».
(Rassemblement). C'est l'homme à la voix d'ivrogne qui hurle...
On se met en colonnes. Marche. Dans la cour, alignement. Le fameux alignement
des pieds : ce petit exercice dure trois quarts d'heure. Notre équipe de huit hommes se met à
part. On prend des pelles, grandes et plates.
En route vers l'auto-camion à remorque. Embarqués. On roule sur un quai. Arrêt devant des
wagons plats, chargés de charbon. Il faut décharger du wagon sur le camion ou
la remorque. C'est le SS Debodt qui nous surveille,
revolver à la ceinture. La première fois, les gens de Willebroeck nous ont regardés passer, curieux et intrigués.
Au deuxième voyage, dans les rues, les gosses nous ont reconnus. Et c'est avec
des Cris qu'ils nous saluent : « Ma ! ze zijn daar ! » (Maman, ils
sont là !). Les femmes courent vers le camion, avec des paquets de
tartines, fourrées de tout. Le SS Debodt,
un traître, nous savait de Bruxelles. Est-ce une raison ? On ne sait. Il ne
nous défend pas d'accepter ces tartines, mais nous donne l'ordre de tout faire
disparaître avant d'arriver au camp. On mange assis sur le charbon, les mains
noires. De plus en plus, les braves femmes de Willebroeck
guettent l'arrivée du camion et nous passent des tartines, des pommes, des
poires. Et le travail continue ; charger le camion
et la remorque, rouler à travers Willebroeck jusqu'au
camp, décharger devant le fort et repartir. Les journées passent. Le travail
continue, harassant. Les bennes sont considérées par le lieutenant Praust, comme un travail de punition. Des hommes sont occupés sur le fort à
rejeter les terres. De là-haut, on voit encore un peu la campagne... On voit
passer des gens, des cyclistes, des femmes. Et plus d'un s'imagine reconnaître
un être aimé. Mais c'est trop loin, on s'illusionne facilement ! Le plus triste, c'est ce petit
cimetière, près du fort. De temps en temps, on entend une cloche tinter : encore
un qui entre au champ de repos. Te souviens-tu, mon pauvre Henri Lee ...
, quand tu disais que tu finirais là, dans ce petit cimetière ? Les bennes roulent. On compte les
voyages. On essaie de deviner l'heure, pour savoir quand finira la journée de
travail forcé. On observe les sentinelles et d'après la relève, on compte un
peu … Encore combien ? Attention, encore un qu'ils veulent tuer. Ils l'ont jeté au bas du talus. A coups
de lourdes mottes de terre, ils le font tomber à l'eau. Et un terrible jeu
commence : chaque fois que le malheureux remonte sur la berge de terre, ils
jettent des pierres, visant la tête. Des cailloux plats le touchent. Le sang
coule. Il a le crâne rasé ; les pierres crèvent la peau, le sang lui coule de
partout et il retombe toujours à l'eau ! Ils sont deux SS qui ,se disputent pour
savoir qui l'a atteint. Et le terrible jeu continue, pendant des heures. Il
retombe à l'eau et son sang rougit l'onde ... Un malheureux, jeté à l'eau, y est
rejeté à coup de pelle dans la figure. En plein visage, un violent coup de
tranchant de pelle. La figure broyée, méconnaissable et toujours le malheureux
voulait sortir de l'eau, il ne voulait pas se noyer. Le SS, avec sa pelle, frappait
sauvagement... La tête en sang, il a fini par couler, rougissant l'eau. Les brutes nazies et leurs satellites ne
pouvaient supporter des prisonniers intellectuels. Les SS surtout avaient une
haine féroce envers tous ceux qui, par leur conduite, ou leur condition
sociale, leur étaient supérieurs. Notre chef, homme calme s'il en fut,
mais que sa situation de fonctionnaire désignait tout spécialement à leur
bestialité, a été battu sauvagement par le SS Raes,
qui semblait bêtement heureux de pouvoir martyriser impunément un intellectuel.
Roué de coups, tombé sous la brutalité de cet ignoble individu, le chef a subi
l'affront : comme les autres, il est resté serein. Nulle
part mieux qu'à Breendonck, on apprend ceci : dans le
cœur le plus calme, dans l'esprit le plus noble, naît un terrible désir : une
immense soif de justice et surtout de vengeance ! Ils l'ont montré, leur « système » :
pour eux, tout ce qui « pense » est ennemi. En Allemagne, ce système produit
des brutes, des machines à voler et à tuer. Chez nous, le peuple entier se
rebiffe, et non content de « penser », juge. Honnêteté Jusqu'au 18 octobre 1942, nous avons pu
recevoir quelques colis. Ils auraient dû être pour nous un appréciable
supplément à un ordinaire par trop réduit: un peu d'erzats
de café le matin, de l'eau et des choux blancs à midi et, le soir, environ 200 grammes
de pain... Avec cela, un travail forcé, continu : pas
une seconde de répit ; celui qui était surpris inactif, ne fût-ce qu'un
instant, était battu. Trop souvent, hélas, l'homme battu, assommé, ne se
relevait pas assez vite à l'ordre du SS. : « Auf ! ». C'était la mort. Coups de pieds dans l'estomac,
coups de matraque sur la tête, celui qui ne pouvait plus se relever, pour venir
se remettre en position devant la brute ; pieds joints et mains allongées le
long du corps, celui-là était fini... J'ai vu partir ainsi plus d'un de mes
compagnons : battus dans la journée, morts le soir... Un soir, dans la chambrée, on entend
hurler « Antreten ! ». Vite, en rang, dans le
couloir, par sections. Marche. Dans la cour, alignement. Toutes les sections sont là. Paraît le
major Schmidt. Grand, nonchalant. Le type de l'officier éthéromane. Suivi de
l'homme à la voix d'ivrogne, le lieutenant. A coups de cravache de cuir, le
lieutenant fait avancer jusque devant nous, un malheureux tout sale, tout noir,
noir jusque dans les loques dont il est mal couvert. Martelant la tête du
malheureux qui regarde, hagard, autour de lui, la brute galonnée nous fait un
discours en allemand. Debodt doit traduire, en
français. Voici .le thème : « Ce prisonnier est un
soldat de l'Armée Rouge : il est sale, ne connaît pas l'usage du savon, ni
aucun usage civilisé. C'est tout le résultat du Communisme ! ». Le malheureux, toujours battu, est
conduit vers la fameuse salle de douches. On hurle. C'est pour nous faire rentrer
dans nos chambrées. Dans la soirée, la porte s'ouvre brusquement, et les SS
poussent brutalement le russe dans la chambre. La porte fermée, j'essaie de parlementer
avec le « nouveau » : rien à faire. Mais Joseph, le Polonais qui a un nom en «
ski », va nous sauver. Joseph a été arrêté en France, dans le
Nord. Il travaillait à la mine, comme lampiste, je crois. Amputé d'une jambe.
Il parle le français. On est vite fixé : le soi-disant russe
est un déporté polono-russe, qui a voulu s'évader des mines du Limbourg. Ils
l'ont battu, laissé sans manger, et sans pouvoir se laver. Le SS Debodt a
donné l'ordre a une équipe de rentrer : il a plu, les souliers sont pleins de
boue. Pendant que les prisonniers nettoient leurs pelles et leurs souliers,
arrive le premier lieutenant Katchuster. Celui-ci
pique une crise de rage, et hurle, parce que cette équipe est rentrée avant son
ordre. Debodt,
lâchement, ne dit pas que c'est lui-même qui a donné l'ordre de rentrer ... L'ober hurle qu'il faut punir ces hommes... Dans la cour, ils
doivent courir, en rond : les SS les frappent au
passage, tant qu'ils peuvent ! La brute à galons crie à Debodt
: « Il faut qu'ils tombent comme des mouches ! » Les prisonniers
courent, et trébuchent sous les coups... Ainsi pendant une heure et demie ... Quand ces malheureux sont entrés dans la
chambre, ils étaient sales, trempés et morts de fatigue... L'ober a donné
l'ordre de les laisser 48 heures sans manger. Tant pis pour lui : mais cet
ordre n'a pas été exécuté. Qu'on me permette de parler un peu d'une
partie spéciale du système de discipline allemande. A Breendonck,
il y a deux cours intérieures : dans chacune, un petit édicule avec, chacun,
quatre ouvertures servant de W.-C. Pas de porte, rien. Un trou. 
Les toilettes, celles-ci disponibles pour 300 prisonniers, étaient des toilettes à pédales. Chaque homme se baisse, avec, devant
lui, deux ou trois hommes qui attendent... C'est tout. Mais tout cela doit aller vite, très
vite : faites le compte : deux cents hommes doivent aller à la cour, par
équipe, en 20 minutes ! Gare à la chiourme c'est à coups de crosse que l'on est
conduit ! Les neuf dixièmes des prisonniers y ont
contracté des hémorroïdes ! Nous étions traités comme des bêtes par
ces sauvages ! Le lecteur qui n'y a pas été, dans cet enfer, pourrait juger que
ce qui précède est un détail dont il ne faudrait pas parier, ne fut-ce que par
simple pudeur : quelques semaines de séjour là-bas laissaient une marque
suffisante dans l'état de santé pour ne jamais plus oublier ces « détails » là
! La vermine En septembre 1942 on ne connaissait pas
encore, du moins dans les chambrées d' « aryens », les poux et autres...
parasites. Mais les tristes conditions de vie en commun, dans des chambrées surchargées,
ne pouvaient manquer de produire de déplorables résultats. En effet, nous
étions couchés sur des paillasses, dont le sac, ainsi que la paille, servaient
depuis le début de l'occupation nazie... Les sacs étaient déjà sales, troués : la
paille, cassée et réduite en petits bouts, passait par tous les trous, tombait
sur le voisin du dessous, ou sur le sol. Au moindre mouvement, ces brins de
paille parsemaient le sol et ont été plus d'une fois la raison, ou plutôt le
prétexte, pour les SS, de battre les prisonniers ou le chef de chambrée. Les
paillasses, à elles seules, étaient des nids à vermine : jamais elles n'étaient
lavées, et la paille n'en était jamais renouvelée. Que dire des couvertures ? Torchons de
coton, troués et minables, voilà ce qu'on appelait des couvertures ! Nous sommes restés, dans notre chambrée,
avec des hommes qui ont dû garder la même chemise pendant cinq et six semaines !
Sans pouvoir la laver, naturellement ! Il fallait dormir à moitié habillé, pour
le froid : il n'y avait rien pour se désinfecter et pas de savon. Parfois, un prisonnier trop affaibli,
débilité, se laisse aller : le moral tombe, et l'homme insensiblement décline,
et se néglige !... Il y avait la douche. Oui. Mais quelle
douche ! Le samedi, après le travail vers midi :
nettoyage des souliers et des pelles. Rentrée en rang, dans les chambrées,
Préparation pour la douche : prendre sa serviette et attendre l'ordre. Rangés
dans la cour, parfois dans la pluie, attendre. Une équipe sort : on entre à son
tour. Dans une pièce où douze hommes pouvaient
à peine se déshabiller sans se bousculer, on en fourre 32 ou 35... Je vous
laisse à penser : poussés, bousculés, on se dévêt, et vite, dans la salle de
douche. L'horreur de ces corps, maigres et
décharnés, marqués de coups, de plaies qui suppurent ! Quelques secondes d'eau froide : une
minute d'eau chaude, et vite, se rhabiller, avec le même linge, et en vitesse,
en se bousculant, se presser, mouillés, dans la cour. Le lieutenant Praust
a réalisé ceci : conduire, déshabiller, doucher, rhabiller et ranger dans la cour
64 hommes en 7 minutes ! « Propreté allemande ! » Le 15 septembre 1942, les prisonniers
rentrent harassés après le travail quotidien, Contrairement à l'habitude, on
nous fait rassembler dans la cour avec alignements impeccables et hurlements
appropriés des zug-führers. Que va-t-il se passer ? Tout le monde est plus ou moins inquiet. Tout à coup, le lieutenant Praust paraît, un papier à la main, « 230 heraus ! » 230 c'est notre percepteur. Il sort des
rangs et se place à gauche de l'officier dans la position réglementaire. Praust
commence la lecture de son papier : c'est en allemand, mais nous comprenons
cependant tous que notre chef est démis de ses fonctions pour avoir refusé d'exécuter
des ordres donnés par l'autorité allemande : l'arrêté est signé par le
commandant militaire en Belgique. Nous sommes fiers : aussitôt les rangs
rompus et Praust parti, nous félicitons notre chef.
Nous remarquons le lendemain, au cours du travail, quand nous avons l'occasion
d'échanger un mot avec d'autres prisonniers que le groupe des postiers a gagné
une forte considération dans tout le camp. Même un SS s'est laissé
impressionner, c'est le nommé Baele : plus jamais il
ne s'est montré inhumain vis-à-vis de nous. Les poteaux de la mort Ils ont été plantés en novembre 1942. 
Les poteaux contre lesquels les prisonniers étaient fusillés. J’étais détaché près de l'entrée du
fort, avec quatre hommes, à un travail particulier. On l'aimait bien, quoique
salissant : mais on travaillait près de l'entrée, on pouvait voir la route, et
parfois des gens qui passaient... Nous devions planter des grands poteaux,
par un bout, dans une cuve en ciment, contenant un liquide noir, genre goudron ;
c'étaient les poteaux qui devaient servir à achever la clôture du camp, avec des
barbelés. Ce matin-là, arrive le lieutenant qui
fait charger dix poteaux sur une charrette et conduire ce chargement dans le
camp. Une équipe de prisonniers a dû les planter, en ligne, à intervalles
réguliers, derrière une galerie, devant un remblai de terre. A midi, tous les prisonniers rentrés ne
sont plus repartis. A une heure, nous avons entendu lire en trois langues la
condamnation à mort de dix hommes. A trois heures, nous avons vu passer le
peloton de soldats pour l'exécution... Puis les condamnés. Tous droits et
fiers. Parmi eux, des hommes ayant travaillé à placer leur propre poteau. Une
décharge de fusils... Debout, en silence, on attendait. Certains priaient. Des
nôtres étaient tombés. *
* * C'est
devant ces poteaux qu'a été installé la sinistre potence où ont été pendus
Arnaud Fraiteur, Raskin et
Berthelot. A chaque visite d'autorités, après ce
drame, ce fut pour les allemands du camp une véritable joie de montrer la
potence, de faire basculer les planchettes, avec des commentaires hilarants.
Comme à la foire... Lors de la fuite, ils ont eu soin de faire disparaitre les
poteaux déchiquetés par les balles et la potence. Dans la chambre de tortures Les méthodes de la Gestapo étaient assez
spéciales, pour faire parler les prisonniers. Quand on voyait une petite auto noire
arrêtée devant le fort, on savait que les tortionnaires de la Gestapo étaient
là ! Ils avaient une chambre spéciale pour
interroger les détenus : dans une galerie du fort, aux murs épais de béton, au
fond d'un couloir étroit, couloir bâti en zig-zag, se
trouvait une petite pièce étroite, sans aucune ouverture que la porte d'accès.
Pas de fenêtre, rien. Des murs épais nus, froids. Au plafond, une poulie à
laquelle pendait une forte corde. Une table servant de bureau. Deux chaises.
Sur la table, des papiers, des revolvers, des matraques. 
Les prisonniers étaient élevés mains derrière le dos. Les bras se déboitaient puis on les lâchait brusquement pour qu’ils tombent sur les arêtes des bois posés à terre. Des tartines aussi. Des poires, des
cigarettes. L'équipe des interrogateurs était
souvent composée de deux hommes, parfois de trois. Un commissaire de guerre,
allemand celui-là, et un autre, interprète belge à la solde de l'ennemi. Le prisonnier était interrogé, parfois
durant des heures. Privé de tabac depuis longtemps, il devait sentir la fumée que
faisaient les tortionnaires. Car c'était à dessein qu'ils fumaient. Le
prisonnier affamé voyait devant lui des tartines. Elles lui étaient promises,
s'il voulait parler. Les fruits et le pain blanc étaient là pour tenter le
pauvre diable qui se raidissait pour ne pas parler. Ils promettaient tout, même la liberté,
pour essayer. Ils inventaient des mensonges, prétendant tout savoir. Infâmes,
ils ne reculaient devant rien pour venir à bout de la résistance de leurs
victimes. Quand, lassés eux-mêmes par le courage
du prisonnier, ils voulaient en finir, alors c'était la torture... Fatigués de jouer avec leurs revolvers,
ils attachaient l'homme à la corde, par les poignets, derrière le dos. Tout le
poids du corps portait sur les épaules. Pendu, descendu, pendu, descendu, tel
était le supplice. Et, avec le renfort des brutes SS, c'était alors quatre
assassins s'acharnant sur leur victime ! Quand le prisonnier était plus fort
qu'eux ! ils essayaient la nuit : après un interrogatoire de plusieurs heures
dans la journée ; ils escomptaient la fatigue et la douleur et recommençaient
la nuit ! En septembre déjà, nous pouvions
entendre une femme courageuse et qui ne manquait pas de cran. Elle nous criait
: « J'ai été battue ». Les SS se précipitaient, trop tard, on avait compris. La nuit, ces brutes la torturaient,
croyant abattre sa résistance ; mais rien à faire : elle hurlait sous les
coups. Ces hurlements, la nuit, ça faisait
mal... J'ai vu jeter, une nuit, sur un lit sans
paillasse, un gosse de 17 ans. On l'avait entendu hurler longtemps ; de l'infirmerie,
voisine de la chambre de torture, on entendait les coups, Ce gamin avait les
mains et les pieds enchaînés, comme une bête dangereuse. Ce n'était qu'un beau petit garçon, qui
pleurait sourdement, couché sur le ventre ; il était gonflé sur tout le corps,
tellement les brutes s'étaient acharnées sur lui ! Pauvre petit Georges, qui
appelait sa maman, qu'est-il devenu ? Ce fut dur, mon interrogatoire : battu,
interrogé, battu, réinterrogé, toujours en français. Et comme je ne paraissait
pas comprendre l'allemand, ils échangeaient des réflexions devant moi. Je n'étais pas à la noce, loin de là ;
il faut y passer pour le comprendre. Mais, tout de même. Je me sentais plus
fort qu'eux, ayant compris la question avant qu'elle ne me fût posée en
français. Ce fut un dur moment. Je fus battu au
point d'en avoir les reins violets et les chairs gonflées. Pendant de longs
jours, je n'ai pu me coucher sur le dos. A noter les habituelles menaces d'être
fusillé. Thème connu de moi. Et ces assassins avaient l'audace d'affirmer que
ce serait eux, les interrogateurs tortionnaires, qui composeraient le tribunal
et que je ne verrais d'autre tribunal qu'eux-mêmes. Un jour, un homme fut poussé dans la
chambre : André Louis. Il a l'air abattu, n'ose parler
et ne connaît personne ... Plus tard, on saura. C'est un agent de
police. Son cas semblait assez grave. Lui-même n'en parlait pas beaucoup. Un
matin, ils l'ont appelé. Quand il est revenu, il paraissait hagard ; en
quelques mots, il nous dit qu'il serait peut-être fusillé. Pauvre André, Louis . Un matin, on me prévient que Paul H.,
chef facteur de Bruxelles est là. Je
me range sur son passage. Il était conduit à la cour et enfermé spécialement.
Je l'ai vu et lui ai fait un furtif bonjour. Il ne fut que
quelques jours à Breendonck. Il fut fusillé à ces
poteaux de Breendonck auxquels j'ai travaillé. Comme les autres, Hermans partit droit
et fier... j'en ai vu partir tant... Mais je veux dire quelques mots encore
de l'un des nôtres : le. camarade Herkenraedt ; qui
était tailleur et logeait à la chambre 7. Herkenraedt
était le type même du copain sûr, toujours calme. Il était l'ami de tous. Ce brave copain, ils sont venus le
chercher un jour ; avec un groupe, il a passé dans la cour pour la dernière
fois, la tête droite, marchant à la mort comme il avait marché dans la vie,
toujours le regard en avant. Tous ceux qui l'ont connu ne l'oublieront pas ... Un premier hommage Les Allemands ont à peine quitté le
pays, que les rescapés de Breendonck fondent une
Association Nationale en vue de la défense des droits moraux et matériels des
victimes. Son président a prononcé le 17 septembre 1944, à l'enclos des
fusillés devant les dix poteaux d'exécution, le discours suivant : C'est avec une
émotion profonde – émotion que ressentent les rescapés qui m'entourent – que je
me retrouve aujourd'hui dans ce lieu sinistre, dans ce lieu sacré. Breendonck,
lieu sacré ! Car, c'est ici que tant des nôtres ont été martyrisés lâchement,
c'est ici qu'ils sont morts, le cœur ferme et la tête haute, nous laissant une
grande et inoubliable leçon. L'Histoire rapporte que, lors des
guerres de Religion dans le Midi de la France, un homme, que l'on avait jeté
dans une fosse, écrivit sur une pierre, avec un clou : « Résistez ! » Eh
bien, c'est cela même qui demeure aux murs des cellules de Breendonck
: ce sont des appels au courage, à l'amour de la Patrie, à la résistance envers
l'oppresseur, ce sont des cris de foi dans la victoire finale, dans la
délivrance. Leurs dernières pensées, à ces martyrs,
elles furent pour leurs parents, pour leurs épouses, pour leurs fiancées, pour
leurs amis, pour la Patrie, bloc vivant de terre, de chair et d'amour, souvenir
des grandes choses que l'on a faites ensemble, espérance de choses plus grandes
encore. Car, ils devaient se dire, les pauvres morts tombés ici : « Soit, notre sort est misérable et nous
sentons toute la cruauté de quitter pour toujours la douce terre de Belgique. Mais
notre sang ne coulera pas en vain. On peut prendre notre vie, détruire notre
corps, notre esprit jamais ». Bientôt, on connaîtra leurs noms, on
saura quelles furent leurs douleurs, quelle fut leur foi. On saura que
c'est de leur sang que doit renaître une Belgique nouvelle, libre, grande,
belle, une Belgique dont tous les citoyens s'uniront afin qu'elle prenne le
rang qui lui revient parmi les nations civilisées, dans la paix, la justice et
le travail. On connaîtra leurs noms. On les gravera dans le marbre où l'on écrira
: « Ils ont bien mérité de la Patrie ». *
* * On connaîtra aussi les noms des infâmes
bourreaux. S'il est une justice sur la terre, ils
seront châtiés comme ils le méritent. Mes chers compatriotes, je n'ai pas
l'intention de vous décrire le camp de Breendonck,
lieu sinistre, ni de vous en dévoiler les horreurs. Pour en avoir écouté quelque
écho, il n'est personne qui ne sente les larmes lui venir aux yeux, larmes de
pitié, larmes de colère. Et moi-même, aujourd'hui où je puis parler librement,
je frémis jusqu'en mon âme au souvenir de ce que nous avons entendu, de ce que nous
avons vu, de ce que nous avons enduré. La douleur et les râles rôdent encore
ici comme des fantômes. Il faudrait la voix d'un Dostojevski pour évoquer cette nouvelle « Maison des Morts
». On le fera plus tard. Qu'il me suffise de dire que la fureur et la bestialité
des tortionnaires ont dépassé en ignominie, en cruauté, en sadisme, tout ce que
l'on peut imaginer. Faut-il vous dire notre misère, la faim
perpétuelle, la fatigue, le néant de toute hygiène, le travail exténuant par
tous les temps ; puis les coups, les injures et les tortures les plus
abominables. Ce fut l'enfer ! L'Enfer de Breendonck
! C'est que, outre les tortures physiques, nos âmes et nos cœurs se sentaient parfois
envahis de détresse. Toutes les valeurs morales, la justice, la bonté,
la pitié, avaient disparu pour faire place à la terreur de jour, à la terreur
de nuit, sans répit, sans miséricorde. L'espoir, cette source suprême des plus
misérables, je vous avoue qu'à certaines heures il faillit nous manquer.
Abandonnés de Dieu et des hommes, nous semblait-il, on nous privait des
consolations spirituelles. Il nous restait que la petite prière chacun dans son
coin, le spiritisme, l'appel aux réussites des jeux de cartes, les coups de la
table tournante. Abandonnés des hommes. Nulle voix de l'extérieur ne parvenait
jusqu'à nous, nul signe ne venait nous réconforter, nous n'avions pas la
consolation d'une lettre de chez nous, d'un colis de vivres, gage d'une affection
qui veille. Eh bien, si, dans ces moments-là, nous
n'avons pas sombré dans l'accablante réalité, si, à l'entrée de notre enfer il
eût été malséant d'inscrire la parole de Dante : « Vous qui entrez. ici.
laissez toute espérance », nous le devons à l'exemple, au courage, à la foi, au
patriotisme, à la haute dignité de ceux qui allaient mourir. Qu'ils en soient glorifiés ! *
* * Mes chers compatriotes, ce lieu est plus
sinistre que jamais. Sans doute on n'y entend plus de cris d'agonie, le sang
n'y coule plus, Mais on y a enfermé des traîtres et des dénonciateurs. Pendant l'occupation ennemie, Breendonck fut un camp de martyrs ; aujourd'hui, c'est un
camp de scélérats. La Belgique est libérée du joug de l'ennemi
; nous pouvons nous écrier enfin avec la certitude de jours meilleurs : « Tout
ce qui se fait de grand dans le monde se fait dans l'honneur, le devoir, le sacrifice;
tout ce qui s'y fait de misérable, se fait dans la honte, la trahison et les
basses passions de l'égoïsme ». La Belgique devra à jamais être
reconnaissante à ceux qui sont morts ici. Honneur et justice pour tous ceux qui
ont souffert pour la Patrie ! Honneur et justice pour tous ceux qui
sont tombés pour Elle ! Vive
la Belgique, libre et indépendante !
[1]
Editions : Serge Baguette – Bruxelles-Paris. Achevé d’imprimer le 28
février 1945 par « Le comptoir des imprimeries réunies Bruxelles »
sur les presses de l’imprimerie F. Van Buggenhoudt s.a. Bruxelles. |
© Maison du Souvenir. Tout droit réservé. ©